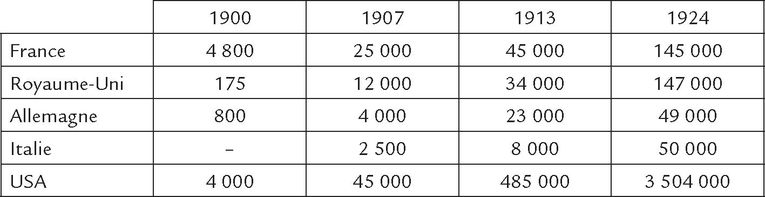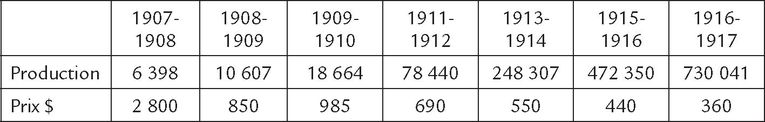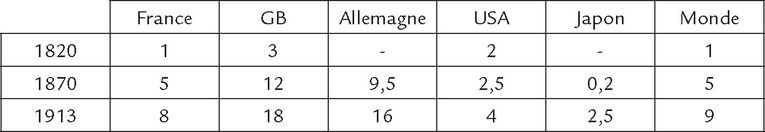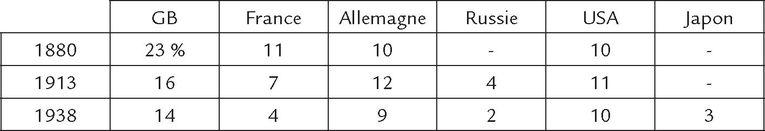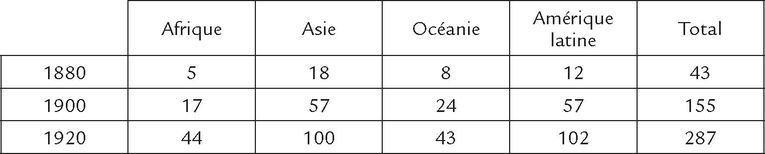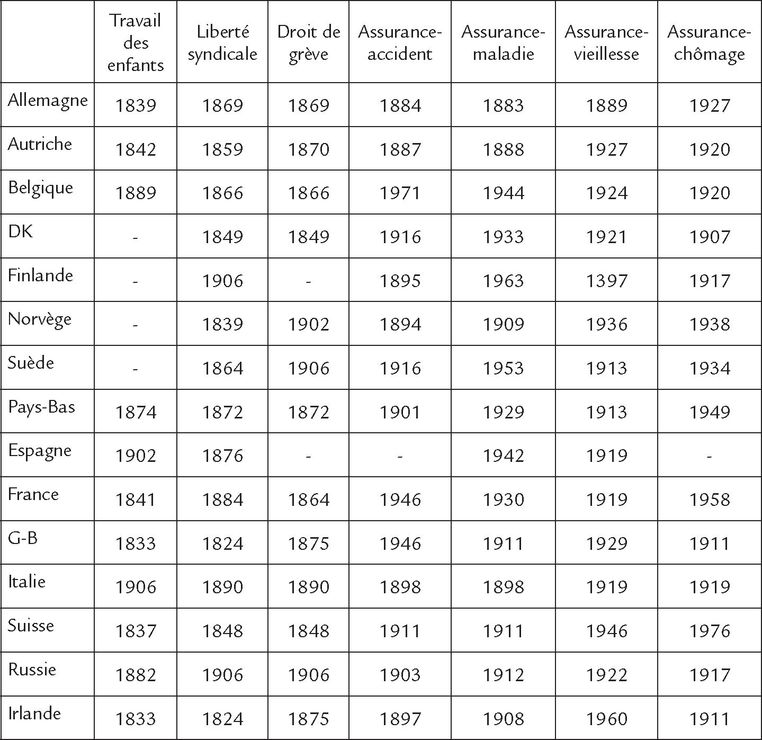Chapitre 5
Les aspects techniques et économiques
On a vu dans le chapitre précédent que le
capitalisme industriel se mettait en place au XIXe siècle dans les pays d’Europe occidentale et aux
États-Unis. Leurs économies présentent certaines caractéristiques
et traits d’évolution communs: les fluctuations cycliques, les
transformations technologiques et les processus de concentration et
d’organisation des firmes. Elles sont aussi de plus en plus liées
par les échanges, les migrations et les mouvements de capitaux,
dans ce qu’on a appelé une première mondialisation.
Cycles, fluctuations et crises
Les classiques attribuaient aux crises et aux
phases d’expansion des causes extra-économiques aléatoires comme
les guerres, les inventions, le climat, les épidémies, les bulles
spéculatives, et ils ont donc ignoré leur caractère régulier. Ce
n’est que dans la deuxième moitié du XIXe siècle que ce caractère est reconnu et analysé.
Le cycle des affaires est un mouvement périodique en quatre temps,
une phase d’expansion (I), suivie de la crise (II) qui fait
basculer l’économie dans une période de dépression (III). Le creux
de la dépression est suivi de la reprise (IV), début d’une nouvelle
phase de prospérité. La crise est donc un des moments du cycle, une
étape qui permettra par la « destruction créatrice » des anciennes
industries, pendant la phase de dépression, d’autres progrès avec
des activités nouvelles.
Les cycles longs Kondratiev
Le cycle étudié par l’économiste russe est un
cycle des variations de prix à long terme depuis les débuts de
l'industrialisation. Il s’agit bien des prix et non de la
production, car le XIXe siècle dans son
ensemble est un siècle de croissance, il est impossible de parler
de phases longues de stagnation ou de recul du produit global. Tout
au plus peut-on constater un ralentissement de la croissance dans
les phases de déflation et inversement. Les dates des pics pour les
phases ascendantes (A) et descendantes (B) des prix depuis la fin
du XVIIIe siècle jusqu’à la crise de
1929, apparaissent ci-dessous, en reprenant les dates et la
terminologie de Schumpeter. Le premier cycle est celui de la
révolution industrielle, basé sur le
coton, la vapeur et le fer ; le deuxième, celui des chemins de
fer et de l’acier, à l’apogée de la bourgeoisie, est le
cycle bourgeois ou cycle de la railroadization ; le troisième est
celui de l’électricité, de la chimie, du
pétrole et des moteurs à combustion (cycle de la 2e révolution
industrielle, ou néomercantiliste parce qu’il est marqué par le
retour au protectionnisme).
• Premier
cycle, dit de la 1re révolution
industrielle: phase A (de 1787 à 1813), phase B (de 1814 à
1842) ;
• Deuxième cycle, dit de la railroadization : phase A (de 1843 à 1869),
phase B (de 1870 à 1897) ;
• Troisième cycle, néomercantiliste :
phase A (de 1898 à 1924), phase B (de 1925 à 1939).
Les cycles longs des prix ont été expliqués par
la présence ou l’absence d’innovations (Schumpeter, cf. ch. 1). On
a avancé également le rôle de l’abondance ou de la pénurie de
métaux précieux: la déflation des périodes 1814-1834 et 1873-1896,
dans un contexte dépressif, est liée à une pénurie monétaire,
tandis que les reprises d’inflation correspondent aux découvertes
d’or (1849, 1900). Enfin, les facteurs sociaux ont été mis en
avant: une durée de 25 ans correspond à l’arrivée d’une nouvelle
génération d’ouvriers sur le terrain social et une reprise des
conflits qui expliquerait les retournements de la
conjoncture.
Les cycles de l’activité économique
En ce qui concerne l’évolution des variables
réelles (production, investissement, emploi, commerce extérieur) et
non plus seulement des prix, trois types de cycles ont été
analysés: le cycle Juglar en 1862, un cycle de 7 à 11 ans ; le
cycle Kitchin en 1923, de 40 mois environ; le cycle Kuznets (1967)
de 16 à 22 ans. Le retournement du cycle correspond à la crise
économique, qui change au XIXe siècle,
passant de la crise d’ancien régime à
la crise industrielle capitaliste au
fur et à mesure que l’agriculture décline dans les économies au
profit de l’industrie, que le commerce international et les
mouvements de capitaux progressent et que le système bancaire et
financier s’étend à toutes les activités. Les crises les plus
fortes (1847, 1873 et 1929) sont celles qui coïncident avec un
retournement du cycle long. Les fluctuations de l’investissement,
notamment ferroviaire, expliquent en partie les crises
industrielles. Le commerce accru rend compte des effets de
propagation, alors que l’expansion des échanges limite la portée
des facteurs agricoles et climatiques: les importations de grains
peuvent éviter au XIXe les pénuries dues
à de mauvaises récoltes. Enfin les paniques bancaires et boursières
se répercutent sur toute l’activité et aggravent la crise.
• Crise d’ancien
régime : crise agricole qui se transmet aux industries,
surtout le textile et le bâtiment, hausse des prix, chômage; elle
profite aux vendeurs de grains et prend un tour politique. Prix et
quantités varient en sens opposé.
• Crise industrielle
capitaliste: crise de surproduction et/ou crise financière
accompagnées de baisse de prix, baisse de la production, de
l’emploi, et de faillites en chaîne. Prix et quantités varient dans
le même sens, la déflation accompagne la crise, l’inflation
accompagne l’expansion.
La deuxième révolution industrielle
La vapeur est encore la principale source
d’énergie jusqu’au début du XXe siècle,
mais son rendement thermique est faible, les accidents sont
toujours une menace et elle est moins accessible aux petites
entreprises. Le moteur à explosion et le moteur électrique
permettront de résoudre ces difficultés. La deuxième révolution
industrielle, qui commence vers 1880, se caractérise aussi par une
évolution des applications scientifiques, allant du visible vers
l’invisible, depuis le monde apparent des leviers, engrenages,
axes, poulies, etc. vers le monde caché des atomes, courants,
molécules, flux, ondes, bactéries, gènes, virus, etc.
Électricité
Cette nouvelle forme d’énergie est capable
d’usages multiples (moteurs, chauffage, éclairage) et peut être
transportée. La puissance produite par un générateur à distance est
utilisée sans perdre d’énergie, au lieu de devoir nécessairement
l’employer sur place. À la place d’un moteur central dans l’usine
dont les mouvements sont transmis avec des pertes énormes par des
câbles, des courroies, des poulies et des axes, on peut désormais
transporter l’énergie vers la plus petite entreprise, qui peut se
passer d’acquérir une machine coûteuse et surdimensionnée. Le
mouvement de concentration des firmes dans les années 1890-1910 est
ainsi contrebalancé par la multiplication de firmes de taille
réduite utilisant des outils modernes et travaillant de façon
complémentaire avec les géants de l’industrie.
Michael Faraday, à partir des recherches de
Volta et d’Ampère, conçoit le moteur électrique dès 1821. Des
dynamos plus efficaces seront construites par Werner von Siemens en
1866 et le Belge Zénobe Gramme en 1870. L'éclairage au gaz est peu
à peu remplacé par l’éclairage électrique dans les lieux publics.
Deprez réalise le premier transport d’énergie en 1882 entre
Grenoble et Vizille. En 1890, Bergès met au point la turbine
hydroélectrique qui permettra la mise en œuvre du potentiel alpin.
L'ampoule est inventée par Joseph Swan en Angleterre en 1860, et
perfectionnée par Thomas Edison aux États-Unis en 1878, ce qui
ouvre la voie à une utilisation domestique générale et exige la
création de centrales électriques. Celles-ci se multiplient à la
fin du siècle pour réaliser cette véritable révolution,
l’équipement de millions de foyers en électricité. Plus que toute
autre invention, les applications de l’électricité révolutionnent
en effet la vie humaine. Les premiers tramways et métros
apparaissent, ce qui relance les activités ferroviaires avec
l’équipement des villes. Les ascenseurs électriques permettent de
construire des immeubles de plus en plus élevés et les premiers
gratte-ciel s’élancent à New York ou Chicago. Le télégraphe est mis
au point et l’Américain Samuel Morse lui invente un code (1834).
Une première liaison est établie entre Washington et Baltimore en
1844 et un câble sous-marin est posé entre la France et
l’Angleterre en 1851. La liaison vers les États-Unis sera réalisée
en 1866. Le télégraphe électrique permet de relier les divers
marchés et Bourses au niveau mondial et aussi de gérer les filiales
éloignées, ce qui permet la multinationalisation des grandes
firmes. Le téléphone est inventé par l’Américain Graham Bell en
1876, conférant aux États-Unis une avance considérable avec 8
millions d’abonnés sur 12 millions dans le monde en 1912. En 1896,
la transmission sans fil (TSF), utilisant les ondes, est découverte
par Marconi. C'est l’origine de la radio, mise au point en 1906. De
nouvelles activités et débouchés dans les transports urbains, dans
les industries électriques et électromécaniques, dans les
communications, se développent et contribuent à la reprise
économique de la Belle Époque.
Pétrole, automobile, aviation
La première automobile est construite par
Gottlieb Daimler et Karl Benz en 1885, après que le moteur à
explosion ait été mis au point en 1876 par Nikolaus Otto. Les puits
de pétrole étaient apparus en Pennsylvanie dès 1859. En 1888, John
Dunlop fabrique les premiers pneumatiques à Birmingham. Rudolf
Diesel crée à Munich un moteur thermique à injection en 1897, le
moteur qui portera son nom, d’un rendement supérieur au moteur à
essence, sans mélange et sans dispositif d’allumage. Très lourd, il
servira pour produire de l’électricité dans les centrales, puis
pour les navires, les sous-marins, les locomotives, les camions et
finalement les automobiles à partir de 1920.
L'industrie automobile et celle du pétrole
seront au cœur des économies industrielles au XXe siècle. Dans les années 1900, la première est
encore de type artisanal avec des centaines de constructeurs (155
en France en 1914). Les modèles sont construits à l’unité, à la
demande du client, chers et réservés à une élite. En 1906, une
petite voiture représente 6 à 7 fois le salaire annuel d’un
ouvrier. Le démarrage de l’automobile est difficile faute
d’infrastructures (routes, garage, pièces, essence) et du fait des
pannes constantes. Les réglementations commencent à être mises en
vigueur; le permis de conduire fait son apparition ainsi que les
écoles de conduite et les plaques d’immatriculation. Le premier
salon de l’auto a lieu à Paris en 1889. Des courses sont
organisées, comme Paris-Rouen en 1894, Paris-Marseille en 1896, ou
Paris-Amsterdam en 1898, qui montreront la supériorité du moteur à
explosion.
La France, malgré son relatif retard industriel,
devient le premier producteur mondial (tableau
13) : en 1903 elle est à l’origine des 3/5 des voitures
construites dans le monde. Armand Peugeot démarre en 1890 la
fabrication d’automobiles, De Dion et Bouton produisent un véhicule
équipé d’un moteur à essence et d’un démarreur électrique en 1895,
De Dietrich lance ses premières automobiles en 1897 et Louis
Renault fonde sa firme en 1898 avec 6 ouvriers (elle en comptera
4000 en 1913). Berliet entreprend la production de camions en série
en 1906. René Panhard et Émile Levassor s’associent à Daimler pour
les moteurs et à Peugeot pour les châssis, ils réalisent en 1891 le
premier véhicule à essence commercialisé, avec tous les éléments
basiques de la voiture à venir. André Citroën entre en 1908 dans la
Société d’électricité et d’automobiles Mors dont il reprendra la
direction. À la fin de la guerre, la firme, établie au quai de
Javel, prend son nom et compte 13 000 ouvriers. Elle construit en
1919 la première voiture populaire en France, le modèle A1, suivi
de la 5 CV en 1922, fabriquée en série.
L'industrie automobile américaine dépasse
cependant celle de la France dès 1905. La production moyenne par
entreprise en Europe n’est que le dixième de celle des firmes
américaines et la productivité environ quatre fois inférieure en
1913. La Ford Motor Company est créée
en 1903 à Detroit avec 12 ouvriers. Henry Ford annonce son projet
de fabriquer les automobiles les unes après les autres, toutes
identiques, venant de la même usine. Après avoir produit divers
modèles sous les noms A, B, C, etc., il arrive à T en 1908… Ce
modèle, solide, simple et léger, révolutionne l’industrie par la
production en série sur une chaîne mobile d’assemblage
(assembly line) qui permet d’augmenter
massivement la productivité tout en réduisant les coûts et les prix
(tableau
14). Le modèle T était vendu 850 dollars au départ, mais le
prix passera à 290 dollars en 1924 pour un modèle bien supérieur.
Ford augmente en même temps les salaires en 1914 avec le
Five-dollars day (plus du double du
tarif en vigueur), créant ainsi des débouchés pour ses propres
produits, lançant le principe de la consommation de masse. Le temps
de travail est en même temps réduit de 10 à 8 heures par jour, puis
dans les années 1920 de 6 à 5 jours par semaine. Une automobile sur
deux aux États-Unis est une Modèle T dans les années 1920 et 15
millions d’exemplaires ont été fabriqués au total en 1926. Ford
réalise alors la moitié de la
production mondiale.
La nouvelle industrie exerce des effets
d’entraînement énormes: « Aucun autre produit n’a donné une moisson
aussi riche de liaisons en amont et en aval » (Landes). La
production d’aluminium passe ainsi de 360 t en France en 1895 à 13
483 t en 1913. Les secteurs de l’acier, du bois, du caoutchouc, des
produits électriques, des peintures et du plastique trouvent aussi
des débouchés croissants et se développent, comme tous les services
liés à l’automobile, auparavant inexistants: assurance, garages,
location, stationnement, écoles de conduite, tourisme, banques,
adaptation des routes, régulation publique, etc.
Dans l’aviation, la France a une avance
considérable jusqu’en 1914, malgré le succès des frères Wright en
1903, grâce à son industrie automobile. Les mêmes techniques sont
utilisées et les mêmes firmes produisent les aéroplanes et les
voitures. Les principales avancées techniques, les exploits, les
premières et les records sont réalisés en France. Santos-Dumont
multiplie les vols, Blériot traverse la Manche en 1909 et Roland
Garros la Méditerranée en 1912. Les dirigeables ou Zeppelins, plus
légers que l’air, se développeront en parallèle jusqu’à la
catastrophe du Hindenburg en 1930 qui marque le triomphe définitif
de l’avion.
Industries chimiques
Elles offrent un éventail extrêmement large de
productions: des explosifs aux colorants et peintures, des films
aux fertilisants, des textiles artificiels à la pharmacie et aux
parfums, des industries métallurgiques aux cimenteries, et sont à
l’origine d’activités qui connaîtront un essor extraordinaire comme
l’industrie des médicaments ou celle du cinéma. L'Allemagne est le
pays leader dans la chimie. Von Liebig dès 1840 élabore les
premiers engrais artificiels. La firme Bayer met au point des
colorants synthétiques en 1880. BASF (Badische
Anilin und Soda Fabrik) multiplie les découvertes de teintes
artificielles et d’explosifs à partir des nitrates. De nombreux
médicaments sont développés: la quinine, le chloroforme, l’aspirine
surtout, mise au point par Hoffmann en 1899. La nitroglycérine est
transformée en dynamite par le Suédois
Alfred Nobel en 1866 : un mélange moins dangereux à manier qui
fait la fortune de son inventeur, à une époque de construction
générale de bâtiments et d’infrastructures : « si jamais il y
eut une invention labor-saving, ce fut
celle-là » (Mokyr). L'usage du caoutchouc apparaît en 1839 grâce à
Charles Goodyear qui met au point la vulcanisation. Les premières
formes de plastique apparaissent aussi aux États-Unis comme le
celluloïd et la bakélite.
Les inventions de la deuxième révolution
industrielle abondent dans bien d’autres domaines (machine à
écrire, machine à coudre, bicyclette, rayons X, presses, w-c,
phonographe, etc.). Pour donner un exemple, avant 1914, plus de 40
000 brevets sont délivrés chaque année dans les seuls
États-Unis.
Les mutations de l’entreprise
La concentration
La concentration des entreprises est un
phénomène commun aux pays industriels à la fin du XIXe siècle, même si elle prend une ampleur plus
grande en Allemagne et aux États-Unis avec les cartels et les
trusts. Les industries traditionnelles comme le bois, le mobilier,
l’édition, le vêtement, le cuir ou les articles métalliques,
rassemblent l’essentiel des petites entreprises, tandis que les
activités industrielles nouvelles (chimie, mécanique, ciment,
papier, sidérurgie, métaux non ferreux et caoutchouc) sont
concentrées dans ces groupes géants.
Les trusts américains contrôlent à la fin du
siècle 60 % de la production de papier du pays, 77 % dans les
métaux non ferreux, 81 % de la chimie, 84 % de la sidérurgie et 85
% du pétrole. En 1860, 19 sociétés fabriquaient des locomotives,
mais en 1900 deux entreprises seulement contrôlent la production.
L'American Tobacco Company détient les
trois quarts de son marché, et des parts comparables sont
constatées pour bien d’autres firmes comme la McCormick Harvester Cy, la United States Steel Corporation, l’American Sugar Refining Company ou l’American Smelting and Refining Cy. Dans les
services également, la concentration progresse de façon
spectaculaire: le transport, les assurances, la finance et les
banques voient des firmes dominantes opérer à l’intérieur et
intervenir de plus en plus à l’échelle internationale.
Le capitalisme de petites unités se transforme
en un capitalisme à tendance monopolistique ou oligopolistique à la
fin du XIXe siècle. Mais cela ne
signifie pas paradoxalement une réduction de la concurrence, car
les régions et les pays étaient jusque-là relativement isolés.
L'insuffisance des transports laissait subsister une foule de
petits monopoles locaux. Cette fragmentation des marchés est
détruite par les chemins de fer et l’ouverture des frontières. La
lutte acharnée que se livrent les firmes géantes américaines à la
fin du siècle témoigne que l’ère des trusts n’est pas celle de
monopoles endormis sur un marché protégé. Les guerres de prix, les
faillites spectaculaires, les fusions et rachats dramatiques
caractérisent cette période. Sous l’effet des économies d’échelle
et des progrès techniques, les prix baissent à long terme même dans
les secteurs contrôlés par les trusts: la tonne de rails en acier
voit son coût baisser de 100 $ en 1870 à 12 $ à la fin du siècle,
le prix du gallon de pétrole est divisé par trois, un colorant
chimique allemand passe de 200 marks le kilo en 1870 à 9 en 1886,
etc.
La concentration s’explique par la volonté des
entreprises d’éviter les effets de la concurrence pour leurs
profits, mais aussi par les contraintes techniques des nouvelles
industries (les investissements sont énormes et il faut produire
sur une grande échelle pour réduire les coûts unitaires et financer
la recherche). Il y a également la nécessité d’affronter les firmes
étrangères sur un marché devenu mondial: seules les entreprises de
grande taille pourront établir un réseau international de ventes.
Les crises successives du capitalisme conduisant aux faillites et
aux rachats aboutissent aussi à la formation de groupes industriels
toujours plus puissants. La grande dépression de 1873-1896
s’accompagne d’une déflation à long terme qui incite également aux
regroupements.
L'organisation des firmes
La concentration s’accompagne d’une
rationalisation de toute l’organisation des entreprises. La gestion
scientifique permet d’éliminer les gaspillages et de réduire les
coûts, selon les principes d’Henri Fayol en France, et surtout de
Frederick Taylor aux États-Unis, promoteur de « l’organisation
scientifique du travail ». Le taylorisme révolutionne les modes
d’organisation des entreprises en « transformant l’ouvrier en un
automate fonctionnant au même rythme que sa machine » (Landes).
Dans ses Principles of Scientific
Management (1911), Taylor explique comment les tâches
doivent être chronométrées, fragmentées et parcellisées pour
accroître la productivité. Les réactions syndicales dénoncent «
l’organisation du surmenage » et la transformation du travailleur
en « automate crétinisé ». Le livre est cependant traduit en
français dès 1912 et la guerre facilite l’adoption du système,
parce que la lutte des classes passe au second plan et aussi parce
que les femmes qui remplacent alors les hommes sont à l’époque
moins revendicatives.
Une autre transformation importante est
l’apparition d’une nouvelle classe de dirigeants professionnels,
les managers, qui ne sont plus les propriétaires. La séparation
entre actionnaires et dirigeants introduit une vision à long terme
dans la gestion, les gestionnaires voyant avant tout l’intérêt de
la firme. Ils prendront les décisions capitales en matière
d’investissement et de stratégie d’entreprise de façon de plus en
plus indépendante des actionnaires, trop dispersés pour exercer un
contrôle.
En résumé, l’avènement de la production de masse
commence aux États-Unis au début du XXe
siècle avec le travail à la chaîne et la standardisation des
pièces. Ces deux innovations permettent une hausse considérable de
la productivité et de la production, ainsi qu’une baisse des coûts
par unité produite. En même temps que la production de masse,
apparaît le marketing de masse, la vente par des moyens de
promotion et de distribution modernes à des millions de
consommateurs dont le pouvoir d’achat a augmenté grâce à des
hausses massives de salaire.
La mondialisation du XIXe siècle
L'Europe établit au XIXe siècle un immense réseau de relations économiques
dont elle est le centre. Cette situation peut être analysée au
niveau des flux migratoires, des échanges de biens et de services
et des mouvements de capitaux. Elle provoque une accélération du
processus de globalisation économique qui avait démarré avec les
grandes découvertes.
Les hommes
Le continent représente un quart de la
population mondiale vers 1900 (contre 9 % un siècle après, cf.
tableau
15). Mais la population européenne ou d’origine européenne
compte pour environ un tiers des habitants de la planète du fait
des migrations. Le XIXe siècle peut
ainsi être caractérisé par une diaspora planétaire des Européens, «
une grande réinstallation » (Roberts) qui a démarré vers les
Amériques au XVIe siècle, mais qui
s’accélère après 1830 dans le monde entier.
À l’origine de ces migrations, on trouve les
facteurs bien connus de la pression démographique, de l’oppression
politique et raciale, des difficultés économiques, de l’écart des
salaires avec des pays où la main-d’œuvre est rare, des progrès des
transports et des possibilités de colonisation de pays à faible
densité. Il y a aussi l’idée bien établie de chances d’une vie
nouvelle remplie d’occasions de s’élever et la croyance en des
sociétés plus dynamiques, sans barrières sociales.
Environ 60 millions d’Européens partent
outre-mer jusqu’à la Belle Époque lorsque cet exode culmine (1,4
million de départs chaque année de 1909 à 1913). Les îles
Britanniques fournissent les gros bataillons, elles représentent
plus de 40 % des migrants européens, soit 8,5 millions de 1880 à
1910. Malgré le départ de 20 millions de personnes cependant, la
population du Royaume-Uni s’élève de 16 à 42 millions entre 1800 et
1900. Les autres grands pays d’émigration sont l’Italie (6
millions), l’Allemagne (5), la péninsule Ibérique (3,5), la Russie
(2), la Pologne, l’Autriche-Hongrie et les pays scandinaves (1,5).
Les gouvernements européens facilitent les démarches car ceux qui
partent sont les plus pauvres et donc les plus mécontents, leur
départ ne peut que réduire les tensions sociales, soutenir les
salaires réels et renforcer la cohésion nationale.
La France au contraire manque de main-d’œuvre et
fait venir des travailleurs à la fin du siècle : les étrangers
constituent près de 10 % de la population ouvrière. Les immigrants
sont italiens, belges, espagnols, polonais, Juifs d’Europe
centrale. Ils suscitent, surtout les Italiens dans le Midi, la même
hostilité et les mêmes réactions que les immigrés d’Afrique du Nord
un siècle après, puis ils s’assimilent progressivement au début du
siècle.
L'Asie est également un grand foyer
d’émigration. L'Inde en premier lieu avec trente millions de
départs de travailleurs engagés entre 1846 et 1932, soit plus que
les deux premiers pays d’émigration en Europe, l’Angleterre (18) et
l’Italie (10). La diaspora indienne, organisée par les
Britanniques, se retrouve aux Antilles, en Afrique orientale, à
Madagascar, à Maurice, à la Réunion, etc. Elle remédie à la pénurie
de main-d’œuvre causée par l’abolition de la traite au
XIXe siècle.
Les États-Unis constituent la première terre
d’accueil: ils reçoivent les deux-tiers de l’émigration européenne
(33 millions d’arrivées entre 1820 et 1950, dont 10 de 1900 à
1914). Vers 1850, le pays compte 23 millions d’habitants, mais 75
millions en 1900. L'Amérique reçoit plus d’émigrants en une seule
année, dira Th. Roosevelt en 1905, qu’entre l’arrivée du
Mayflower et la déclaration
d’indépendance. Les Américains d’origine ne représentent plus que
la moitié de la population du pays vers 1900 et seulement 20 % dans
des villes comme New York ou Chicago. Les Noirs qui comptaient pour
un cinquième de la population en 1790 sont passés à un dixième en
1890, suite à cette immigration essentiellement européenne. Les
États-Unis sont suivis par d’autres terres d’accueil comme
l’Argentine, le Brésil, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande
et l'Afrique du Sud. L'Amérique latine reçoit dix millions de
migrants entre 1870 et 1914.
Les marchandises
Le commerce mondial est multiplié par six en
volume de 1860 à 1914, soit une croissance de 3 à 4 % par an en
moyenne, supérieure sur le long terme à celle de la production (1 à
2 %), malgré le protectionnisme de la Belle Époque. Un pour cent de
la production mondiale seulement était exporté en 1820, mais près
de 10 % en 1913. Les taux d’ouverture apparaissent pour quelques
grands pays et le monde entier dans le tableau
16.
L'Europe domine toujours les échanges mondiaux
(58 % du commerce mondial, 83 % des échanges de produits
manufacturés en 1910). Les pays du continent exportent et importent
surtout entre eux-mêmes, les colonies ne représentant qu’une part
plus faible (moins de 3 % de la production y est exporté en 1910).
Les principaux pays commerçants apparaissent dans le tableau 17qui
montre le déclin relatif de la Grande-Bretagne et de la
France.
La capacité de transport dans le monde croît de
10 à 32 millions de tonneaux de 1840 à 1910, tandis que le réseau
de voies ferrées passe de 100 000 km à 1 million entre 1870 et
1914. Le coût du transport, maritime et terrestre, est divisé par
sept au XIXe siècle en termes réels,
grâce à la vapeur et à l’ouverture de nouvelles voies.
Les capitaux
Les investissements internationaux
• Caractères
Les mouvements de capitaux atteignent une
ampleur sans précédent à la fin du XIXe
siècle. Ils servent à financer des infrastructures à travers le
monde (chemins de fer, ports, télégraphe, tramways, téléphone, eau,
énergie, etc.), mais aussi des activités extractives, des
industries de transformation, des banques, des assurances et des
exploitations agricoles. Les voies ferrées représentent les travaux
les plus gigantesques (tableau 18).
Les capitaux vont vers l’Amérique du Nord (34
%), l’Amérique du Sud (17 %), l’Asie (14 %), l’Europe (13 %),
l’Afrique (11 %) et l’Océanie (11 %). Les neuf dixièmes viennent
d’Europe occidentale. Cette épargne externe, qui atteint entre 3 et
5 % du PNB des pays européens au début du XXe siècle, correspond à un record absolu (1 %
seulement dans les années 1960). Pour l’ensemble des grands pays
créditeurs, le stock de capital détenu à l’étranger représente
l’équivalent de 20 % de la production totale en 1840, 57 % en 1870
et 100 % en 1900-1910. Les grands pays créanciers sont la
Grande-Bretagne (43 % des investissements étrangers en 1914), la
France (20 %), l’Allemagne (13 %), la Hollande, la Belgique et la
Suisse (12 % à eux trois). En 1914, la Grande-Bretagne place ses
capitaux dans son empire (47 %), aux États-Unis (41 %), puis en
Amérique latine.
Les capitaux français se dirigent vers la
Russie, l’Espagne, le Portugal, l’Europe centrale, le Moyen-Orient
et les colonies. Les fameux emprunts russes, d’une importance
considérable puisqu’ils représentent un quart des placements
français, seront répudiés par le régime bolchevik en 1917. Pour la
IIIe République, vers 1900, l’idée était
d’aider le tsar à développer son pays afin que la France puisse
compter sur un allié puissant. Le développement économique de la
Russie tsariste sera effectivement facilité par ces capitaux. Mais
les prêts massifs de la France permettront en fait à la Russie
d’accroître ses achats de matériel et de biens d’équipement en
Allemagne, plus proche et plus industrialisée, et la France
contribuera donc indirectement à affirmer la puissance économique
et militaire de son grand rival continental.
• Causes
Les pays européens étant passés par le processus
d'industrialisation avant les autres, ils ont un excédent de leurs
paiements courants, contrepartie des sorties massives de capitaux.
De même pour les pays en retard, le déficit structurel de la
balance courante entraîne la nécessité de recourir aux emprunts, à
l’endettement externe. Les mouvements de prêts et d’emprunts de la
fin du XIXe siècle s’analysent donc
comme un simple phénomène de vases communicants: les pays à
trop-plein d’épargne déversent cette épargne vers les pays qui en
manquent.
En outre, du fait des rendements décroissants,
les occasions de placement deviennent moins intéressantes dans les
pays déjà équipés. Ainsi les chemins de fer en Amérique ou en
Russie attirent des capitaux énormes : les taux d’intérêt sont
de 8 % en Amérique, contre 4 % en Europe de l’Ouest, entre 1870 et
1913. Pour les emprunts russes les taux sont de 4 %, contre moins
de 3 % pour les placements en France.
Une autre explication, celle de Hobson en 1902,
à l’origine des analyses marxistes, attribue les sorties de
capitaux à une consommation insuffisante en Europe, un excès
d’épargne, du fait de la très forte inégalité sociale et d’un début
de vieillissement de la population. Ce surplus se déverse dans les
pays qui s’ouvrent à l’expansion capitaliste.
• Conséquences
L'endettement massif facilite le développement
économique des pays neufs (Canada, États-Unis, Amérique latine) ou
des pays en retard (Turquie, Égypte, Chine). Le transfert d’épargne
des pays à excédent vers les pays à déficit accélère la mise en
valeur, la construction d’infrastructures et la formation
d’industries. Dans de nombreux cas, les investissements réalisés
entraînent la création de capacités nouvelles de production et de
flux d’exportation qui permettront ensuite de rembourser les
emprunts. C'est ce qui se produit dans les pays scandinaves, en
Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et bien sûr aux
États-Unis. La mise en œuvre de ressources minières et agricoles
exportées (blé, viande, laine) permet à ces pays de faire face à
leur dette. Les produits sont en outre de plus en plus transformés
et élaborés sur place, permettant une valeur ajoutée plus forte et
l'industrialisation. Cependant pour d’autres pays endettés, ce
mécanisme vertueux n’a pas joué, à cause de blocages structurels ou
institutionnels, à cause du gaspillage des capitaux ou
d’investissements douteux, et l’endettement n’a fait qu’accroître
la dépendance, en plongeant ces pays dans des crises
d’insolvabilité. Dans cette période colonialiste, le non-paiement
des dettes entraîne des représailles immédiates de la part des pays
créanciers, la mise en place de commissions internationales de
contrôle, et parfois le débarquement armé.
Le système monétaire international : le
ralliement à l’étalon-or
• Les faits
Un système monétaire international est la
combinaison d’un étalon monétaire et
d’un système de change. L'étalon
monétaire (l’or, l’argent, la livre sterling) permet d’évaluer et
de convertir les différentes monnaies nationales et aussi de régler
les soldes des balances commerciales. Le système de change est
l’ensemble des mécanismes qui président à la détermination des taux
de change. L'étalon-or de la fin du XIXe
siècle est un SMI basé sur l’or, comme son nom l’indique, et sur la
fixité des changes entre monnaies.
En 1816, la Grande-Bretagne adopte
officiellement l’étalon-or et la monnaie nationale, la livre
sterling, qui était définie en argent, se trouve définie par un
poids fixe du métal jaune, la parité or. Le stock d’or détenu par
la Bank of England varie en fonction
des mouvements du commerce extérieur, et la livre est librement
convertible à un cours fixe en métal précieux. Les partisans de la
currency school l’emportent sur ceux de
la banking school en 1844, ce qui
signifie que l’émission de la monnaie fiduciaire doit être liée de
façon stricte au stock d’or, et non laissée à l’initiative de la
Banque centrale. En France, le second principe, plus souple, est
adopté, il donne à la Banque de France, titulaire du monopole de
l’émission des billets en 1848, la possibilité de faire varier la
circulation monétaire en fonction des besoins de l’économie. La
contrainte plus forte en Grande-Bretagne explique le développement
rapide dans ce pays de la monnaie scripturale. En 1914, les deux
tiers des paiements se font par chèque en Angleterre, contre 45 %
en France. La répartition des formes de monnaies à la fin du
XIXe siècle dans le monde apparaît dans
le tableau
19.
La plupart des autres pays avaient un système de
bimétallisme or-argent ou de monométallisme argent. L'Allemagne
initie le mouvement vers l'or en 1871 en exigeant le paiement de 5
milliards de francs-or par la France vaincue et en adoptant
l’étalon-or. Les pays de l’Union latine, autour de la France, font
de même entre 1873 et 1878. Les États-Unis suivent en 1879, puis
l’Autriche-Hongrie en 1892, la Russie en 1897, le Japon en 1895,
etc. Ce régime dure donc dans le monde pendant une période assez
courte, de 1870 à 1914. Le basculement quasi-général vers l’or
s’explique par l’effet des externalités de réseau, c’est-à-dire les
gains qui résultent de l’adoption d’un système lorsque la plupart
des autres l’utilisent déjà: à partir du moment où deux grandes
puissances économiques, la Grande-Bretagne puis l’Allemagne,
adoptaient l’étalon-or, il était plus avantageux pour tous de s’y
rallier.
• Les mécanismes
L'étalon-or assurant stabilité et équilibre, il
aurait permis une croissance harmonieuse de l’économie mondiale. La
stabilité des cours des devises favorise le développement des
échanges, tandis que des mécanismes automatiques garantissent la
stabilité monétaire. S'il y a pénurie d'or, son prix s'élève, ce
qui stimule de nouvelles découvertes, et inversement en cas
d’abondance. Ainsi les besoins de métal précieux pour faire face
aux échanges mondiaux tendent à être satisfaits à long terme. Le
système comporte aussi un mécanisme de rééquilibrage automatique
des balances commerciales : un déficit se traduit par une
sortie d’or qui réduit la masse monétaire intérieure et les prix,
ce qui relance les exportations et freine les importations,
corrigeant ainsi le déséquilibre initial. Le mécanisme inverse joue
pour les pays à excédent.
Pour ses critiques cependant, l’or n’est qu’une
« relique barbare » (Keynes) qui fait dépendre l’économie mondiale
de découvertes aléatoires de gisements miniers. On ne peut laisser
le stock d’or mondial déterminer la quantité de monnaie en
circulation avec des conséquences non maîtrisées sur la croissance
et l’emploi. La crise de 1873-1896 aurait été moins prononcée sous
un régime différent. Pour d’autres, le système de l’étalon-or
n’aurait été en fait qu’un système d’étalon-sterling. Il
fonctionnait grâce à la domination de l’économie britannique et au
rôle de la city comme centre de la
compensation financière mondiale. La livre jouait le rôle du dollar
aujourd’hui, les Anglais payant leurs importations avec leur propre
monnaie sans se soucier du taux de change, tandis que les autres
pays devaient détenir des avoirs en sterling pour leurs opérations.
Enfin, le mécanisme de rééquilibrage de l’étalon-or ne fonctionnait
pas en réalité, car les pays à déficit ont conservé leur déficit et
les pays à excédent ont gardé leur excédent à long terme. Les
mouvements de capitaux internationaux ont été le résultat de ces
déséquilibres, les pays excédentaires plaçant et investissant leur
excédent dans les pays déficitaires.
La mondialisation des années 1900 et celle de
la fin du XXe siècle
À la fin du XIXe, «
l'univers devient une unité économique » (Baumont) : la
liberté de circulation des biens, des hommes et des capitaux n’a
jamais été aussi grande. Des câbles relient toute la planète par
télégraphe, connectant en permanence les Bourses de commerce
(denrées) et les Bourses de valeur (titres) dans un marché mondial
des biens et des capitaux.
Les taux d’ouverture au commerce international
ont progressé à la fin du XXe siècle par
rapport à la Belle Époque (tableau 20) et
les échanges internationaux sont également plus intégrés qu’en
1900, dans la mesure où les accords commerciaux sont aujourd'hui
multilatéraux. Le GATT puis l'OMC ont remplacé les traités de
commerce bilatéraux et les règles sont générales et non limitées à
deux pays comme dans le cas des traités de la période
1860-1914.
Malgré tout, les marchés financiers étaient
davantage intégrés en 1900 qu’aujourd’hui. Les investissements
directs à l’étranger représentaient en 1900-1910 à peu près
l’équivalent de l’investissement intérieur, alors que dans les
années 1990 ils en représentaient moins de 10 % dans les pays
développés. Les placements externes comptaient pour 5 % du PIB
britannique entre 1880 et 1913 contre seulement 2 à 3 % pour les
grands pays créditeurs actuellement. Le marché du travail était à
l’époque également beaucoup plus intégré. Aujourd’hui, la
main-d’œuvre est moins mobile du fait des restrictions
considérables à l’entrée dans les pays développés et aussi entre
pays du tiers-monde. Au XIXe siècle le
marché global du travail était une réalité, les États-Unis
comptaient jusqu’à 10 % de migrants et la montée spectaculaire du
pays depuis les années 1830-1840 est la conséquence directe de cet
afflux massif.
Sur d’autres points cependant la mondialisation
est plus poussée aujourd’hui. Elle concerne d’abord toute la
planète, alors qu’en 1914 nombre de régions du monde restaient
isolées. Les organisations internationales n’existaient pas en
1900, alors qu’elles jouent aujourd’hui un rôle considérable dans
le processus d’intégration. Les firmes multinationales avaient
encore un rôle mineur en 1900, mais elles sont maintenant la force
principale derrière les flux mondiaux de capitaux, de biens et de
services. Le commerce international est actuellement beaucoup moins
transport intensive qu’il ne l’était au
début du siècle. À l’époque, l’agriculture et l’industrie
représentaient l’essentiel de la production (70 % en Allemagne, en
Italie, en France), on échangeait surtout des matières premières
pour lesquelles le coût du transport était élevé, si bien que les
pays commerçaient surtout avec leurs voisins et dans une moindre
proportion avec des pays éloignés. Aujourd’hui, les produits
primaires ne représentent qu’une part faible des échanges,
l’essentiel est composé de produits finis qui sont de moins en
moins lourds et volumineux, du fait de l’évolution technique.
Ainsi, pour chaque dollar de produits échangés, les frais de
transport sont plus réduits. La distance n’est plus autant un
obstacle et la mondialisation en est facilitée. En outre la baisse
des coûts des communications joue dans le même sens en permettant
des échanges d’informations et de services instantanés par le
satellite et les réseaux informatiques.
Les aspects sociaux
La révolution industrielle crée de nouvelles
classes sociales comme le prolétariat et la bourgeoisie. La prise
du pouvoir par la seconde s’accompagne d’une domination sur la
première, qui se révolte, obtient des droits et un meilleur partage
du revenu national. Le nouveau système de production, le
factory system, favorise les
revendications puisque les ouvriers sont regroupés dans les mêmes
lieux. Le XIXe siècle est ainsi à la
fois celui où triomphe le libéralisme et celui du socialisme
montant. L'aspiration à la dignité humaine, à la justice sociale, à
la fraternité et à l’égalité, par la partie la plus faible,
ignorante et exploitée de la population, est l’aspect le plus
frappant de cette époque, aspect qu’on peut comparer aux Lumières
du siècle précédent, la recherche de la connaissance, de la liberté
et de la tolérance. On étudiera dans un premier temps les diverses
catégories sociales, puis les luttes ouvrières et enfin les
réformes sociales du siècle.
Les structures sociales des pays
industrialisés
Les classes supérieures
L'aristocratie se distingue moins de la haute
bourgeoisie, car la révolution industrielle et la Révolution
française ont eu pour effet d’une part d’enrichir et de renforcer
les entrepreneurs et chefs d’industrie, d’autre part de réduire ou
d’éliminer les privilèges de la noblesse. Les révolutions et les
guerres d’indépendance du XIXe siècle
achèvent, sur le plan des régimes politiques, des libertés et des
droits individuels, ce que la grande révolution avait commencé.
Mais même si son rôle se réduit, la grande noblesse continue à
figurer au sommet du pouvoir et de la richesse. En France, elle
compte encore pour un tiers des membres de l’Assemblée en 1869 et
23 % en 1893.
La vieille aristocratie se retrouve dans les
carrières militaires, dans la haute fonction publique,
l’administration coloniale et la diplomatie, alors que la direction
des grandes firmes relève bien sûr de la haute bourgeoisie,
composée des grands capitalistes de la finance et de l’industrie,
comme les Pereire, Laffitte ou Schneider. Elle voit son influence
se renforcer tout au long du siècle. Ainsi les aristocrates
formaient à peu près la majorité du gouvernement britannique
jusqu’en 1895, mais plus jamais par la suite. Asquith est en 1908
le premier des Premiers Ministres de Sa Majesté qui ne soit pas
d’origine noble.
La fortune bourgeoise qui accompagne le
développement industriel est plus mobilière (titres, actions)
qu’immobilière (terres, immeubles). Ces « bourgeois conquérants »
(Morazé) partagent l’idéal de l’entrepreneur protestant décrit par
Weber: épargne, effort, austérité, esprit d’entreprise, sens de sa
responsabilité individuelle, optimisme et confiance dans le progrès
technique et économique. Beaucoup sont issus d’un milieu populaire
comme les frères Schneider, Édouard Empain, Étienne Solvay, Marius
Berliet, ou en Angleterre Thomas Cook, Thomas Lipton, Samuel
Cunard, et en Allemagne Carl Bosch et Gottlieb Daimler, signe des
possibilités nouvelles d’ascension sociale par rapport aux sociétés
d’Ancien Régime.
La bourgeoisie
Le XIXe, siècle du
capitalisme et du libéralisme triomphants, est celui de la montée
de la bourgeoisie. Elle détient le pouvoir économique, politique et
culturel et prend ainsi la suite de la noblesse dans l’Ancien
Régime. La bourgeoisie se compose d’une minorité d’oisifs rentiers
et d’une majorité d’actifs, car « la bourgeoisie est une classe qui
travaille » (Jaurès), et elle travaille dans les diverses activités
économiques: l’industrie, le commerce, la banque, le service de
l’État ou les professions libérales. Daumard distingue la bonne bourgeoisie des notables (chefs
d’entreprise, propriétaires, médecins, hommes de loi, architectes,
ingénieurs, hauts fonctionnaires) de la
moyenne bourgeoisie (commerçants, fonctionnaires,
enseignants, cadres, journalistes, petits rentiers) et de
la bourgeoisie populaire (artisans,
employés, boutiquiers). Les écarts sont considérables: dans la
bourgeoisie censitaire, l’éventail des fortunes va de 1 à
280 ; avec le peuple, il s’étend de 1 à 10 000. La persistance
jusqu’en 1848 du suffrage restreint s’explique par la certitude que
seules les classes aisées sont à même de décider et de
diriger.
La Révolution a ouvert des possibilités de
promotion sociale et l’industrialisation a permis un enrichissement
progressif dans la seconde moitié du siècle. La bourgeoisie
s’élargit en attirant à elle nombre d’enfants de paysans et
d’ouvriers, qui forment progressivement une classe moyenne. Cette
middle class ou Mittelstand est donc composée, dans les échelons
inférieurs, des artisans et petits commerçants, des professions
libérales et des employés, dont le nombre augmente constamment avec
la montée du secteur tertiaire dans des économies de plus en plus
complexes. Ils passent de 800 000 à 1 800 000 en France entre les
années 1870 et 1900, alors que la classe ouvrière atteint alors son
effectif le plus élevé (6 millions, un tiers de la population
active). Cette montée irrésistible de la classe moyenne comblera au
XXe siècle le fossé infranchissable
entre les classes du XIXe.
Le peuple
À Paris, tout au long du siècle, les trois
quarts des gens vivaient dans la misère, logeant dans des
conditions épouvantables: « un effroyable entassement populaire
dans les quartiers du centre et de l’est…où la densité et la saleté
de l’habitat avaient converti la ville en un amas de pierrailles
sans air et sans lumière » (Bergeron). Londres n’est pas mieux
loti : le quart de la population, plus d’un million des quatre
que compte la ville en 1890, est en dessous du minimum vital. À New
York, c’est près d’un tiers des citadins qui sont sous le seuil de
pauvreté en 1889.
Vers 1840, les ouvriers travaillent en moyenne
12 à 14 heures par jour, et même 15 heures dans les industries
textiles, pour des salaires de subsistance. Dans les activités
domestiques, la durée du travail tourne autour de 16 heures par
jour. Elle n’est nulle part limitée, sauf pour les enfants pour qui
les réglementations datent de la première moitié du siècle. Il est
courant d’en voir à partir de l’âge de quatre à cinq ans, ils
composent environ la moitié de la main-d’œuvre de l’industrie
textile en Angleterre, plus de 20 % en Alsace. Dociles, moins
payés, plus agiles et plus aptes à certains travaux que les
adultes, ils constituent une force de travail exploitée sans merci.
Levés dès l’aube, se rendant à pied à leur travail, debout la
journée entière, ils sont soumis, comme le dit Villermé, non plus à
un travail mais à une véritable torture.
Les conditions de vie misérables de la classe
ouvrière sont bien connues: le dénuement, la faim, le rachitisme
des enfants, l’alcoolisme, la violence, l’insécurité,
l’analphabétisme, la promiscuité, l’alcoolisme, la prostitution.
L'insalubrité des logements dans les ghettos des quartiers
populaires, les eaux souillées, la sous-nutrition, favorisent les
maladies comme le typhus ou le choléra. Le chômage est général dans
les pays européens, un chômage structurel, aggravé dans les
périodes de dépression. Cette armée de réserve
du capital n’est naturellement en rien indemnisée. La notion
d’assurance ou d’indemnité de chômage est longtemps inconcevable.
Quand les premières formes d’assurance sociale apparaissent à la
fin du siècle, elles ne concernent que l’accident, la maladie,
l’invalidité, la retraite. La multiplication des petits métiers et
l’abondance de la main-d’œuvre domestique prête à s’embaucher pour
un faible salaire, sont le signe évident de ce sous-emploi massif.
Le nombre des domestiques diminuera au XXe siècle, et cette main-d’œuvre deviendra de plus
en plus chère et inaccessible aux classes moyennes. Une évolution
qui est le signe d’une réduction considérable du taux de chômage à
long terme, du XIXe au XXe, réduction qui accompagne paradoxalement la
mécanisation, grâce à la baisse du temps de travail et à la
croissance économique. On ne dispose pas de chiffres exacts du
chômage au XIXe siècle, car il n’y a pas
à cette époque de mesure officielle des indicateurs économiques,
mais il pouvait être, selon les périodes d’expansion ou de
dépression, de l’ordre de 20 à 30 % de la population active.
Les accidents du travail sont constants: on
arrive, pour les seules victimes dans les mines, au chiffre
effrayant de 1400 morts par an dans les années 1840 en Angleterre.
La même succession de désastres se répète sur le continent: la
catastrophe de Courrières fait 1200 morts en 1906. Les accidents
industriels sont la routine en l’absence de dispositifs de
protection. Les blessés et handicapés se retrouvent à la rue sans
autre ressource que la mendicité. Engels parle « d’une armée qui
revient de campagne », tant il y a d’estropiés et de mutilés dans
les faubourgs de Manchester. Tous ces accidents n’émeuvent guère la
société qui trouve des médecins pour en minimiser la portée: « Quel
tort professionnel peut faire la perte d’un pied à un ouvrier qui
travaille assis ? ». Les maladies du travail (saturnisme,
silicose, scoliose, asthme, tuberculose, troubles de la vue) sont
également la norme.
La répression contre les revendications est
féroce. En 1886, à la suite d’un attentat attribué aux anarchistes
lors d’une grande grève à Chicago, sept leaders anarchistes sont
condamnés à la peine capitale et quatre d’entre eux pendus. En
France, la litanie des grands massacres lors des soulèvements
populaires (1834 : 400 morts, 1848 : 5 000 morts,
1871 : 30 000 morts) est accompagnée des multiples répressions
locales lors des grèves et manifestations. Le 1er mai 1891, pendant
une grève à Fourmies, l’armée tire sur les manifestants et fait
neuf morts; depuis, la célébration de cette date dans le monde
ouvrier prend en France une résonance particulière. Mais la
répression ne se limite pas à ces affrontements violents et
épisodiques, elle est permanente à l’usine où règne une discipline
de fer, une surveillance constante des ouvriers au travail, une
pluie d’amende ou des renvois aux moindres incartades.
Les schémas de pensée de cette époque
prémarxiste sont très différents d’aujourd’hui : ils tournent
surtout sur les oppositions monarchie/république,
tolérance/répression, droits de l’homme/oppression, et moins sur
les rapports de classe, les questions sociales, le syndicalisme ou
le socialisme; il n’y a pas de sentiment de culpabilité de la part
des patrons et des nantis assurés de leur bon droit et de leur
légitimité, et la division de la société entre riches et pauvres
semble un phénomène normal, éternel.
L'essor des idées socialistes et les réformes
sociales
L'essor du socialisme
Les idées socialistes prennent cependant une
ampleur croissante qui favorise les mouvements ouvriers et
l’adoption un peu partout en Europe de lois sociales.
Les idées nouvelles
Les grands auteurs socialistes et les militants
révolutionnaires du XIXe siècle œuvrent
pour une prise de conscience de la classe ouvrière et l’espoir
d’une société meilleure. Dans son analyse du capitalisme
(exploitation, crises, paupérisation, concentration) et sa théorie
de l’histoire (matérialisme historique), Marx est l’héritier de
trois courants de pensée et d’action:
• L'économie politique
classique anglaise, dont il reprend les outils d’analyse
(valeur-travail et baisse du taux de profit, théorie de la
répartition des revenus).
• La philosophie
allemande, notamment Hegel et sa vision dialectique,
Feuerbach et sa dénonciation de la religion.
• L'action politique
militante et révolutionnaire des socialistes français
comme
Louis Blanc, Armand Barbès et Auguste
Blanqui.
L'opposition entre Marx et Bakounine aboutira à
l’éclatement de la première Internationale en 1872. Le second
considérait que la révolution viendrait des plus déshérités, et non
de la classe ouvrière dont il prévoyait qu’elle s’intégrerait
progressivement au système en en recueillant les fruits. La théorie
de la paupérisation absolue des ouvriers de Marx est contredite par
les faits dès la fin du XIXe siècle. Les
pays les plus avancés et industrialisés sont ceux où les thèses
réformistes d’un accès au pouvoir par le vote s’imposeront.
Par ailleurs la nécessité d’un passage par une
étape bourgeoise et capitaliste dans l’évolution des sociétés,
avant la révolution prolétarienne, sera également infirmée. Tout
d’abord, les sociétés capitalistes éviteront la révolution par des
réformes successives (lois sociales, montée du secteur public,
hausse des salaires réels, intervention croissante de l’État), et
ensuite, conformément aux idées de Bakounine, ce sont les pays les
plus pauvres qui connaîtront des révolutions socialistes.
Socialistes du XIXe
siècle
– Les
réformistes: Saint-Simon
(1760-1825), Robert Owen (1771-1858),
Sismondi (1773-1842), Louis Blanc (1811-1882), Ferdinand Lassalle (1825-1864), Henry George (1839-1897), Eugène Varlin (1839-1871 ), August Bebel (1840-1913), Benoît Malon (1841-1893), Jean Allemane (1843-1935), Vera Zassoulitch (1849-1919), Eduard Bernstein (1850-1932), Karl Kautsky (1854-1938), Béatrice et Sydney Webb (1858-1943, 1859-1947), Jean Jaurès (1859-1914), Rudolf Hilferding (1877-1941).
– Les
révolutionnaires: Louis Auguste Blanqui (1805-1881), Armand Barbès (1809-1870), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Wilhelm et Karl Liebknecht (1826-1900/1871-1919), Jean-Baptiste
Clément (1837-1903), Paul Lafargue (1842-1911), Jules Guesde (1845-1922), Clara Zetkin (1857-1933), Lénine
(1870-1924), Rosa Luxemburg (1871-1919),
Trotski (1879-1940), Antonio Gramsci (1891-1937).
– Les utopistes:
Charles Fourier (1772-1837), Étienne
Cabet (1788-1856), Armand Bazard (1791-1832), Prosper Enfantin (1796-1864), Pierre Leroux (1797-1871), Victor Considérant (1808-1893), les populistes russes dans les années 1860-70,
Jean-Baptiste Godin (1817-1888).
– Les
anarchistes : Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), Michel Bakounine (1814-1876), Élisée Reclus (1830-1905), Piotr Kropotkine (1842-1921 ), Georges Sorel (1847-1922), Errico Malatesta (1853-1932), Jean Grave (1854-1939), Fernand Pelloutier (1867-1901 ), Emma Goldman (1869-1940), Nestor Makhno (1889-1935).
– Les terroristes et les
nihilistes : D.I. Pissarev
(1840-1868), Serge Netchaïev (1847-1882),
Ravachol (1859-1892), Auguste
Vaillant (1861 -1894), Georges
Darien (1862-1921) et Jules Bonnot (1876-1912) chef de la fameuse bande dont les
exploits marquent vers 1910 le pic de l’activité anarchiste
violente en France. ■
Les mouvements populaires
• Les syndicats
La Grande-Bretagne, premier pays industrialisé,
développe avant les autres des organisations de travailleurs sur la
base des métiers. Les premiers syndicats regroupent des ouvriers
qualifiés qui revendiquent des hausses de salaires par le moyen
essentiellement de la négociation. Ils organisent la formation de
leurs membres, assurent une protection contre les maladies, les
accidents, la vieillesse et le chômage. Cette première vague
d’organisation, limitée à l’élite ouvrière, reflue assez vite
devant la fermeté patronale et l’hostilité des lois. Le mouvement
ne renaîtra que lorsque les Trade
Unions seront officiellement reconnues en 1871. On compte
environ un million de syndiqués à cette époque en Grande-Bretagne
et un syndicalisme de masse avec des droits bien établis s’impose à
la fin du siècle. Les Unions s’organisent en un organe fédérateur,
le Trade-Union Congress. Le Labour
Party est créé en 1893 par les syndicats dans le but de faire
progresser au Parlement les revendications sociales.
En France, les premières formes de syndicats
sont les Sociétés de secours mutuel, dont la fonction est d’aider
les membres en cas d’accident ou de maladie, grâce aux cotisations
de l’ensemble. Les Sociétés de résistance, dans les années 1830,
fonctionnent suivant le même principe et appuient les grèves en
versant de l’argent aux ouvriers. À la fin du siècle, sous l’action
de Pelloutier, apparaissent les Bourses du Travail qui sont des
syndicats interprofessionnels voués à la solidarité ouvrière, aux
revendications sociales et à l’enseignement. En 1902, la
Confédération générale du travail devient le principal syndicat
national, elle se caractérise alors par des tendances
anarcho-syndicalistes hostiles aux partis politiques et au jeu
parlementaire. Les conflits se multiplient dans les années 1900 et
l’idée s’impose que la grève générale est le principal instrument
de la révolution sociale.
Les syndicats se développent en Allemagne après
1890 à la chute de Bismarck et la fin de sa politique
antisocialiste de 1878. En 1914, le pays compte 4 millions de
syndiqués, le même nombre qu’en Angleterre, contre un million en
France et en Italie.
Les révoltes des canuts de Lyon en 1831 et
1834
Les canuts sont les tisserands de la soie,
ouvriers et artisans établis à la Croix-Rousse. Il s’agit d’une
industrie domestique où les marchands-fabricants confient la
matière première et achètent les étoffes aux chefs d’atelier
indépendants qui possèdent des métiers Jacquard et emploient
quelques ouvriers. Les conditions sont effroyables, les ouvrières
travaillent « quatorze heures par jour sur des métiers où elles
sont suspendues à l’aide d’une courroie afin de pouvoir se servir à
la fois de leurs pieds et de leurs mains dont le mouvement
continuel et simultané est indispensable au tissage »…
(Blanqui)
Le conflit surgit entre les fabricants et les
producteurs misérables, artisans et ouvriers confondus, à propos
des prix. Les canuts réclament un tarif, c’est-à-dire des prix
minimums pour les étoffes payées à la pièce, et se mettent en grève
en 1831, grève qui tourne à l’insurrection. Lyon tombe aux mains
des révoltés pendant dix jours, avant sa reprise par Soult. Le
tarif est supprimé, la victoire se transforme en échec, sans
répression sanglante toutefois.
Ce ne sera pas le cas de la deuxième
insurrection en avril 1834. Le projet de loi du gouvernement
d’interdire les associations déclenche la grève et des émeutes à
travers la ville. La répression est immédiate et une terrible
bataille est livrée dans le centre de Lyon. On compte plus de 300
morts et des procès suivront jusqu’en 1836.
Les barricades, les combats, le drapeau noir, le
cri fameux: «Vivre en travaillant ou mourir en combattant », la
fraternisation avec les soldats, les chants des canuts, tout cela a
suscité l’espoir et l’admiration à travers l’Europe. Le soulèvement
de cette « armée de spectres » (Blanqui) a effrayé le monde des
notables et des nantis, il est resté dans la mémoire ouvrière et
surtout il a ouvert la voie aux revendications sociales. ■
• Partis socialistes
Après les émeutes luddites des années 1810, les
mouvements ouvriers en Angleterre s’orientent vers le réformisme.
Le Chartisme réclame le suffrage universel en 1838, il dénonce le
machinisme et le capitalisme et réclame le partage des terres. Une
grande manifestation en 1848 se termine par un échec et marque la
fin du chartisme.
À la suite du fameux cri, « Prolétaires de tous
les pays, unissez-vous ! », dans le Manifeste du parti communiste de Marx et Engels en
1848, les militants socialistes agiront en faveur d’organisations
ouvrières qui dépassent le cadre national. À la frontière des
organisations et des partis ouvriers, les diverses Internationales
regroupent à la fois syndicats et partis du monde entier. Cette
vision internationaliste est bien sûr liée à la solidarité
nécessaire des travailleurs, mais aussi à la nécessité de mettre
fin aux guerres par la fraternité entre tous les hommes.
Internationales
La Ire Association Internationale des Travailleurs,
dirigée par Marx, dure de 1864 à 1876; l’arrivée des anarchistes de
Bakounine en 1867 provoque des heurts qui se terminent par leur
exclusion en 1872. La même année, avec la réaction qui suit la
Commune, elle est interdite en France.
La IIe Internationale
ou Internationale socialiste, fondée à
Paris en 1889, se réunit tous les trois ans en congrès et regroupe
les partis socialistes de l’époque. Elle représente environ 10
millions de syndiqués à travers l’Europe, mais sera incapable
d’arrêter la guerre. Lénine et les bolcheviks rompront
définitivement avec elle en 1914. En 1923, reconstituée sous le nom
d’Internationale ouvrière et socialiste, elle évolue vers le
réformisme après avoir interrompu ses activités entre 1939 et 1951.
Le parti socialiste français s’intitule Section française de l’Internationale socialiste
(SFIO) jusqu’au congrès de Tours en 1969.
La IIIe
Internationale est le mouvement communiste lancé par Lénine en
1919, le Komintern, (KOMmounnistitcheski INTERNatsional), une
organisation centralisée de type militaire qui devient un
instrument de la politique soviétique. Elle a été dissoute par
Staline en 1943 pour satisfaire les alliés anglo-saxons dont l'URSS
avait besoin pour lutter contre les Allemands.
La IVe Internationale
est l’internationale trotskiste fondée
par Trotski lui-même à Mexico en 1937. ■
Ferdinand Lassalle crée en 1863 le premier parti
ouvrier dans le monde, l’Association des travailleurs allemands,
transformé en 1875 au congrès de Gotha en SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) à la suite
de l’union avec les partisans de Marx menés par W. Liebknecht.
Lassalle a milité sans relâche pour un parti ouvrier puissant qui,
grâce au suffrage universel, pourrait arriver au pouvoir. Le Parti
social-démocrate comptera plus d’un million de membres en 1911 et
représentera un tiers de l’électorat en 1914. En 1877, il a 12
sièges au Reichstag, 35 en 1890 et 110 en 1912, c’est alors le plus
grand parti socialiste en Europe et le premier parti en Allemagne.
En France, le Parti socialiste est fondé en 1905. Il compte 76 000
membres en 1914 et représente près d’un million et demi d’électeurs
et 103 députés à l’Assemblée. En Angleterre, le Parti travailliste
passe un accord électoral avec les libéraux et accède au parlement
en force en 1906.
Les progrès sont remarquables partout en Europe,
car la classe ouvrière tend à s’accroître dans la population
active, et la prolongation des tendances laisse croire à une
évolution inéluctable vers la majorité absolue des voix pour les
partis socialistes. Le débat entre le marxisme et le réformisme
commence lorsque Bernstein en 1899 annonce ses idées
révisionnistes. Elles seront finalement adoptées par le SPD vers
1910 qui abandonne les dogmes marxistes. En France le même débat
oppose le marxiste Jules Guesde aux thèses et aux pratiques
réformistes d’Alexandre Millerand et de Jean Jaurès. En Russie,
l’interruption des réformes provoque la montée des mouvements
révolutionnaires, les premières grèves et l’assassinat du tsar en
1881. Lénine et les majoritaires (bolcheviks) du parti socialiste
fondé en 1898 sont opposés à toute collaboration avec la
bourgeoisie et partisans d’une avant-garde de révolutionnaires
professionnels capable de forcer le destin.
Les réformes sociales
Dans la première partie du siècle, les mesures
sociales viennent d’en haut. Des philanthropes, libéraux ou
progressistes au pouvoir font voter ou décident des lois
protectrices. Ensuite, elles sont acquises par la base, par les
luttes de la classe ouvrière organisée. Les dates indiquées dans le
tableau
21n’ont qu’une signification relative car, pas plus qu’il ne
suffit d’interdire les grèves ou les syndicats pour les empêcher,
il ne suffit pas de voter des lois ou édicter des décrets pour
qu’ils soient appliqués. Faute d’inspections du travail efficaces,
ce ne sera guère le cas jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les
lois sociales sont nécessaires mais non suffisantes pour éliminer
les abus.
La Grande-Bretagne
Les conservateurs sont à l’origine des premières
mesures, opposés en cela aux industriels et aux libéraux partisans
de la liberté du travail. Ils sont plus dans l’esprit des
législations issues du Moyen Âge, alors que les libéraux veulent se
débarrasser des restes du corporatisme et établir une liberté
économique totale. Par contre, à la fin du siècle, le suffrage
étant élargi, les deux partis se livrent à une sorte de surenchère
dans le vote des lois sociales pour s’attirer les électeurs de la
classe ouvrière, qui représentent alors plus de 60 % de la
population active.
Les lois interdisant les syndicats sont abrogées
en 1824 et le droit de grève obtenu en 1875. La nouvelle loi sur
les pauvres de 1834 (New Poor Law),
mise en place par le parti libéral, crée un marché libre du
travail, dans lequel l’assistance est remplacée par des
workhouses, maisons où les vagabonds et
chômeurs sont mis au travail de force. Le pays compte environ deux
millions de personnes dans ces sortes de bagnes dans les années
1830.
En 1833, grâce à l’exemple de Robert Owen, le
travail des enfants dans les industries textiles est limité à 8
heures pour les moins de 13 ans, avec le Factory Act. En 1854 le repos du samedi après-midi
est rendu obligatoire, c’est le début du fameux week-end. En 1874
la durée du travail est limitée à 9 heures par jour. Autour de
1900, les lois sociales se multiplient: le Compensation Act de 1897 impose à l’employeur
l’indemnisation des accidents du travail; en 1905, l’Unemployed Workmen Act entreprend de limiter la
population des workhouses ; un
système de retraite est mis en place en 1908 (Old Pension Act) ; Beveridge publie en 1909 un
ouvrage intitulé Unemployment qui
marque le début de l’attention au problème du chômage;
l’assurance-maladie est créée en 1911 (National Insurance Act).
La France
En France, la loi Guizot de 1841, « fondatrice
pour la protection sociale » (Burguière), limite le travail des
enfants à huit heures entre 8 et 12 ans et l’interdit en dessous de
8 ans. La publication du rapport Villermé en 1840 a favorisé une
prise de conscience des questions sociales. L'âge minimum du
travail est porté à 12 ans en 1874, puis treize en 1882 lorsque
l’école devient obligatoire. Le livret ouvrier fondé par Bonaparte
en 1803 tombe en désuétude après 1871 pour être finalement aboli en
1890. La création du ministère du Travail par Clemenceau date de
1906. La même année, la limite quotidienne de travail est fixée à
10 heures par jour et le repos hebdomadaire devient obligatoire. La
journée de huit heures, vieille revendication ouvrière (8 heures de
travail, 8 heures pour soi, 8 heures de repos) sera obtenue par une
loi de 1919. C'est une des plus anciennes revendications du
mouvement ouvrier, « les huit heures »,
qui est satisfaite. Le mouvement est général à l'Europe: la Russie
bolchevique les avait adoptées le 29 octobre 1917, en Allemagne la
nouvelle république dès novembre 1918, de même qu’en Autriche et en
Tchécoslovaquie, en mars 1919 en Espagne.
Le droit au travail avait été proclamé par Louis
Blanc lors de la révolution de 1848 et mis en application avec les
Ateliers nationaux qui sont lancés pour réduire le chômage massif,
aggravé par la crise de 1846-1847 : un décret garantit « le
droit de l’ouvrier à l’existence par le travail ». L'afflux est tel
qu’on ne sait où employer les candidats et le système devient une
forme d’assistance. La fermeture des ateliers par le royaliste
Falloux provoque l’insurrection, la répression et les déportations
en Algérie. La voie est libre pour le coup d’État du 2 décembre
1851. Napoléon III tentera de mettre en œuvre une politique sociale
afin de rallier les ouvriers à l’Empire, rendant notamment la grève
légale (1864). La IIIe République abroge
la loi Le Chapelier en 1884, reconnaissant ainsi les
syndicats.
L'Allemagne
La Prusse interdit le travail des enfants de
moins de 9 ans en 1839, impose une scolarité et limite la durée de
travail pour les autres. En 1853, le travail des enfants avant
douze ans est interdit, et en 1869 le travail des adolescents est
limité à dix heures par jour…Les réformes sociales de Bismarck, les
premières en Europe, sont mises en place entre 1883 et 1889 :
assurance-maladie, assurance-accident, assurance-vieillesse,
obligatoires, financées et gérées en commun par les employés et les
employeurs. Ces mesures sociales sont plus proches des sécurités
médiévales, conservées plus tard par l’Allemagne, que des régimes
libéraux français et anglais. La politique du Chancelier manie la
carotte et le bâton: des lois répressives sont appliquées à
l’encontre des mouvements socialistes en 1878, comme l’interdiction
des syndicats et du SPD, en même temps que les lois sociales sont
lancées. Elles sont introduites au moment du retour à la protection
des années 1880 et du renforcement des droits de douane qui
serviront en partie à les financer. En 1910, l’Allemagne est très
en avance sur les autres pays: 81 % des travailleurs sont protégés
contre les accidents, 53 % ont une retraite et 44 % sont couverts
contre les maladies; les chiffres correspondants sont de 20, 13 et
18 % en France. Un système national d'assurance-maladie n'y sera
introduit qu'en 1930. L'État-providence apparaît ainsi dans
l’Allemagne des années 1880.
L'extension des lois sociales
L'idée de réduire la durée du travail pour tous
progresse partout, et l’horaire quotidien tend à baisser en Europe
à la fin du XIXe siècle, aux alentours
de 10 heures, contre 12-14 heures vers 1850. Les pays neufs sont
ceux où la législation sociale est la plus avancée: la
Nouvelle-Zélande fixe le temps hebdomadaire de travail à 48
heures pour tous dès 1901 et l’Australie
établit un salaire minimum dès 1896. Les États-Unis font cependant
exception: la législation sociale y est plus limitée et plus
tardive. Le travail des enfants (moins de 13 ans) n’est par exemple
interdit par une loi fédérale qu’en 1888. Au début du XXe siècle, la réduction des inégalités par l’impôt
se met en place. L'impôt progressif sur le revenu est voté en 1909
en Grande-Bretagne. En France, Caillaux réussit à faire voter la
loi qui l’institue en 1914. L'income
tax est introduit en 1913 aux États-Unis par un amendement à
la constitution.
Progrès scolaires, progrès des femmes
François Guizot, ministre de l’instruction
publique sous Louis-Philippe établit le principe de l’instruction
primaire universelle: toute commune est tenue d’entretenir une
école publique. La loi Guizot de 1833 crée un enseignement primaire
public, une école normale dans chaque département, une école
primaire dans chaque commune, financées par les impôts locaux.
L'école devient un établissement familier à côté de la mairie et de
l’église dans tous les villages. En 1882, Jules Ferry met en place
le système de l’éducation laïque, gratuite et obligatoire de 6 à 13
ans. Les maîtres sont payés par la République et la délivrance des
diplômes devient un monopole d’État. Un corps d’enseignants dévoué
à sa mission est créé avec les écoles normales. L'enseignement
secondaire au lycée reste payant et non obligatoire. En 1910, en
France, moins de 3 % du groupe d’âge entre 12 et 19 ans, suivaient
l’école secondaire et seulement 2 % atteignaient le baccalauréat.
La gratuité du secondaire ne sera assurée qu’en 1933 et
l’obligation des études jusqu’à 16 ans date de 1959.
En Angleterre, les écoles publiques élémentaires
sont instituées en 1870 pour les enfants de 5 à 13 ans, et elles
deviennent obligatoires en 1880. Mais l’effort d’éducation est
poussé le plus loin en Allemagne, notamment avec les fameux
Instituts de Technologie copiés dans le monde entier, si bien qu’en
1900 le pays compte seulement 0,05 % d’illettrés contre 1 % en
Grande-Bretagne et 4 % en France. En Espagne, on monte à 66 %, 72 %
en Russie et 48 % en Italie. Pendant la Restauration, en France,
seuls les hommes de plus de quarante ans étaient éligibles. Ne
pouvaient voter que les hommes de plus de trente ans qui
justifiaient d’un revenu élevé. Les femmes n’ont aucun droit
économique important et sont considérées comme des mineures dans la
société du XIXe siècle. Julie Daubié est
en 1861 la première femme à avoir le droit de passer le
baccalauréat. Par la suite, le bac restera encore l’apanage des
garçons, et avant 1914, « les étudiantes étaient encore fort peu
nombreuses dans les facultés…En 1914, on compte une centaine de
femmes médecins, quelques femmes avocats » (Daumard).
Les premiers mouvements féministes orientés vers
les conquêtes politiques apparaissent dans les pays anglo-saxons.
L'Amérique est en pointe dans ces luttes, les militantes et les
organisations se multiplient: les syndicats, les associations pour
le vote, les ligues pour développer l’éducation, défendre les
consommateurs, éliminer la prostitution, le travail des enfants,
les jeux d’argent, etc. Les suffragettes en Angleterre lancent des
actions violentes à partir de 1912 (attentats à la bombe, grèves de
la faim, manifestations diverses). Grâce à l’accroissement de leur
rôle pendant la guerre, les femmes obtiennent le droit de vote en
1918, les États-Unis suivront en 1920, la France en 1944. ■
Une question qui se pose aux historiens de
l’économie dans le domaine social est celle de la cause essentielle
des progrès dans les conditions et les niveaux de vie populaires.
Pour les libéraux, c’est l’économie capitaliste de marché qui a
permis l’explosion productive du XIXe
siècle et donc un accroissement général de la consommation. La
cause essentielle est à rechercher du côté de l’offre et des
facteurs qui ont agi sur l’offre : liberté économique,
institutions adaptées, innovations techniques, etc. La
redistribution suit la croissance par des effets de diffusion vers
le bas. Pour les socialistes, ce sont les luttes ouvrières qui ont
permis l’amélioration des salaires et des conditions de travail.
Sans elles, l’économie libérale, « qui produit la richesse en
créant la misère » (Hugo), tourne à vide. Les luttes sociales ont
permis une répartition plus juste de la plus-value, elles ont donné
sa dignité à la classe ouvrière tout en la faisant sortir d’une
misère dramatique. En outre cette redistribution a stimulé à son
tour la demande et favorisé l’essor de la production.
Les deux explications ne sont pas incompatibles.
Si l’origine de la croissance économique moderne est bien à
rechercher du côté de l’offre, de l’extension des relations de
marché, de la création d’institutions efficaces pour empêcher la
montée des coûts de transaction, il reste évident que si le monde
ouvrier n’avait pas réagi et s’était satisfait de salaires de
subsistance et de conditions de travail inhumaines, les employeurs
se seraient contentés de verser les salaires les plus faibles
possibles et maintenir des enfants de huit ans douze heures par
jour au travail, comme le montrent de multiples affirmations de
l’époque. Sans la peur des socialistes et de la révolution,
Bismarck n’aurait jamais mis en place ses lois sociales. Le
mouvement ouvrier a donc joué un rôle essentiel dans la formation
progressive d’une classe moyenne avec des conditions de vie
décentes. Cependant ces luttes n’auraient rien donné en l’absence
d’une croissance de la production depuis plus d’un siècle qui a
rendu possible la redistribution. L'offre reste première, toute
l'histoire des origines de la révolution industrielle montre
l’importance des échanges, des institutions et de la liberté
économique. Aucun soulèvement des esclaves romains ni aucune
jacquerie des serfs du Moyen Âge n’ont permis de mettre fin à la
misère, tout simplement parce qu’il n’y avait rien à répartir, que
la prise et le pillage des richesses des classes favorisées,
justifiés par une misère noire et une exploitation féroce, ne
permettaient en rien d’améliorer le sort des pauvres. Il faut
commencer par augmenter la production avant de la répartir de façon
équitable, et pour accroître la production, il faut des incitations
économiques et un système de régulation des offres et des demandes
qui sont fournis par le marché et l’entreprise privée.