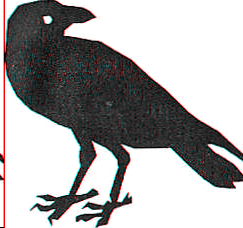- Pourquoi perdre ton temps à te regarder dans la glace ? Tu sais qui tu es.
Elle sortit en claquant la porte. J'hésitai à la rattraper pour lui tirer les poils du menton, la gifler - ou même pire. Au heu de quoi, je montai appeler Kathleen.
- Mes cours viennent d'être annulés.
En poussant mon vélo dans l'allée gravillonnée qui menait du garage à la rue, je remarquai que la voiture des pompes funèbres n'était plus là. Mon père s'apprêtait peut-être à remonter. J'hésitai à rebrousser chemin, puis décidai de partir quand même. Kathleen m'attendait
C'était un jour maussade de la mi-novembre, l'odeur des feuilles mortes partout Le vent me piquait le visage tandis que je roulais. Bientôt il neigerait et il faudrait ranger mon vélo au garage jusqu'en avril, voire mai.
En entrant dans la cafétéria, je repérai immédiatement Kathleen, assise dans un box.
Elle portait un pull et un pantalon noirs et buvait un café. Je m'assis et commandai un cola.
- Il est curieux, ton collier.
A côté du petit sachet d'herbes, un anneau en argent pendait à un fil de soie.
- C'est un pentacle. Ari, il faut que je te dise : je suis devenue païenne.
La serveuse m'apporta mon cola. Je déballai lentement la paille, ne sachant quoi répondre.
- Ça peut vouloir dire plein de choses.
Kathleen se passa la main dans les cheveux : ses ongles étaient peints en noir et elle venait de se teindre les cheveux. Je me sentis quelconque à côté d'elle, avec mon jean et ma veste en polaire.
- On fait de la magie noire et notre truc, c'est les jeux de rôle.
Je ne voyais pas du tout de quoi elle parlait.
- C'est ça qui inquiète ta mère ?
- Ma mère ! soupira-t-elle en secouant la tête. Elle est insupportable en ce moment. Elle ne se rend pas compte.
Elle but une gorgée de café - noir, comme le reste. J'étais incapable d'avaler ce truc et je la regardai avec admiration.
- Elle est tombée sur un de mes carnets, ça l'a fait flipper.
Kathleen fouilla dans le sac à dos élimé posé à côté d'elle et en sortit un carnet à spirale à la couverture noire. Elle l'ouvrit et le fit glisser sur la table.
Sous le titre Chants de magick, je lus ce qui ressemblait à un poème.
Oh, de notre art ne dis rien au prêtre,
Il n'y verrait que péchés,
Mais dans les bois nous irons la nuit entière,
Appelant l'été.
Et sur la page suivante :
Quand le malheur t'accable,
Porte sur ton front l'étoile bleue.
Être sincère en amour tu dois
À moins que ton amant faux ne soit
Je me gardai de lui demander ce que cela signifiait. Mon père m'avait appris que c'est une question à ne pas poser en poésie.
- Il n'y a rien de préoccupant là-dedans.
- Bien sûr que non ! dit-elle en jetant un regard méprisant au siège à côté de moi, comme si sa mère était assise là.
- C'est vraiment super comme truc, tu verras. On va aller jouer chez Ryan.
- Ah bon ? Quand ça ?
- Tout de suite.
Nous accrochâmes nos vélos devant la cafétéria et partîmes à pied chez Ryan, qui habitait à quelques rues de là. La maison délabrée ressemblait à celle des McGarritt, sauf qu'on lui avait récemment adjoint une serre. Nous jetâmes un œil à travers la verrière embuée, dont les carreaux étaient couverts de gouttes de condensation, sans pouvoir distinguer autre chose que des formes vertes sous l'éclairage violacé.
- Le père de Ryan, son passe-temps, c'est cultiver les orchidées. Il les vend aux riches vieilles qui habitent à l'autre bout de la ville. Elles ont même un club.
On sonna et Ryan vint nous ouvrir. Ses cheveux courts et blonds étaient coiffés en pétard avec une sorte de gel. Il était habillé tout en noir, comme Kathleen.
- Heureux de te voir.
- Heureuse de te voir, répéta Kathleen.
- Salut, dis-je simplement
Toutes les lumières étaient éteintes à l'intérieur de la maison, et des bougies disposées un peu partout. Ils étaient quatre, allongés sur des poufs, dont deux que j'avais croisés à la soirée. Mais Michael n'était pas là.
- C’est qui ?
- Je vous présente Ari. J'ai pensé que le jeu avait besoin de sang neuf.
L'heure qui suivit me sembla interminable, une succession d'innombrables lancers de dés, de lents déplacements à travers la pièce, ponctués de cris : «Vaincre !» «Mon niveau d'invisibilité est très faible !» «Régénère !» Ou encore : «Ma colère est vaine ! »
Deux des garçons jouaient le rôle de loups-garous (la lettre L était imprimée sur leur tee-shirt) et les autres celui des vampires (ils portaient des tee-shirts noirs et des dents pointues en plastique). J'étais la seule «mortelle» dans la pièce. Comme c'était ma première fois, ils m'avaient proposé d'être simple spectatrice -et je sentais que cela leur plaisait d'avoir un public.
Ce qu'ils racontaient et ce qu'ils faisaient recoupait à peu près ce que j'avais lu sur Internet à propos des vampires. Ils frémissaient à la vue d'un crucifix, se transformaient à volonté en chauves-souris, et «volaient»; ils escaladaient des murs imaginaires et sautaient au-dessus de toits eux aussi imaginaires, grâce à leur agilité et à leur force toutes virtuelles - et tout cela dans une pièce de trente mètres carrés.
Es se déplaçaient dans les rues d'une ville imaginaire, piochant des cartes qui représentaient des pièces de monnaie, des outils spéciaux et des armes, faisant semblant de se battre et de se mordre alors qu'ils se touchaient à peine. Je fus de fait frappée par la timidité réelle de ces cinq garçons, réduits à en faire des tonnes pour avoir des amis. Kathleen était la seule fille, à part moi. Elle se déplaçait à travers la pièce de manière conquérante, comme si c'était son territoire. Les autres se liguaient parfois contre elle et elle les repoussait presque sans effort. C'est elle qui connaissait le plus de sortilèges et qui avait manifestement le carnet de notes le plus fourni.
Il y avait parfois des vols et les joueurs déposaient leur butin dans des banques imaginaires - capitalistes en toutes circonstances, pensai-je. Le jeu reposait bien plus sur la cupidité et la domination que sur l'imagination.
Tous ces efforts physiques ajoutés à l'odeur infecte de leurs casse-croûte de couleur orange rendaient l'atmosphère fétide. Je tentai de prendre sur moi, mais au bout d'un moment, l'ennui et la sensation de claustrophobie eurent raison de ma patience, et je quittai la pièce. Je traversai la cuisine, fis un tour dans la salle de bains, puis suivis le couloir au bout duquel se trouvait une épaisse porte vitrée : l'entrée de la serre.
Quand j'ouvris la porte, je sentis l'air humide glisser sur moi, charriant une riche odeur de végétation. D'une table à l'autre, les orchidées en pot semblaient se balancer dans l'air brassé par les lentes rotations du ventilateur. Je pris garde de ne pas me mettre sous le faisceau violet des lampes, qui me faisait un peu tourner la tête. Elles faisaient ressortir de façon lumineuse les couleurs des fleurs : violets et magentas intenses, ivoires veinés de rose plus pâle, jaunes parsemés d'ambre - autant de teintes éclatantes qui se détachaient sur le feuillage vert Les orchidées étaient semblables à de minuscules visages, avec des yeux et une bouche, et je parcourus les allées en les saluant: «Bonjour, Ultraviolette. Bonsoir, madame Banane. »
Enfin ! pensai-je, une échappatoire au gris hivernal de Saratoga Springs. Le père de Ryan devrait faire payer l'entrée. L'air humide qui pénétrait dans mes poumons et parcourait mon corps me procura une impression de détente presque soporifique.
La porte s'ouvrit brutalement sur un garçon costaud avec des taches de rousseur, vêtu de noir.
- Mortelle, je suis venu t'étreindre, m'annonça-t-il d'une voix chevrotante.
- Je ne crois pas, non.
Je le regardai fixement dans les yeux - des yeux sombres et petits que grossissait le verre de ses lunettes.
Il soutint mon regard, sans bouger. Je le dévisageai un moment: il avait le visage rougeaud, et deux boutons au menton sur le point d'éclore. Il ne bougeait pas d'un cil, et je me demandais si je ne l'avais pas hypnotisé.
- Va me chercher un verre d'eau, lui ordonnai-je.
Il pivota sur ses talons et se dirigea d'un pas lourd vers la cuisine. Il ouvrit la porte et j'entendis les autres pousser des cris et se mordre ; quand la porte se referma, je savourai ma solitude tropicale, troublée seulement par le bruit de l'eau qui gouttait quelque part Je m'amusai à imaginer ce qui se passerait si on inversait les rôles - si je plantais mes dents dans son cou au milieu des orchidées. Et je dois avouer que ça m'excitait un peu.
Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau : il était de retour, un verre d'eau à la main.
Je pris mon temps pour boire, puis je lui rendis le verre vide.
- Merci. Tu peux t'en aller à présent.
Il cligna des yeux et soupira plusieurs fois avant de partir.
En ouvrant la porte, il fut bousculé par Kathleen.
- Qu'est-ce qui s'est passé au juste ?
Elle avait dû observer la scène par la vitre de la porte. Je me sentis un peu gênée, sans savoir pourquoi.
- J'avais soif.
Il faisait déjà nuit quand je les abandonnai à leur jeu. Kathleen, à court d'énergie, était étendue sur le canapé, tandis que Ryan et les autres psalmodiaient au-dessus d'elle : «Mort! Mort !» J'agitai la main pour leur dire au revoir, mais je ne crois pas qu'ils me virent.
Je retournai à pied devant la cafétéria, détachai mon vélo et pédalai jusque chez moi. Les voitures me dépassaient et à un moment un jeune me cria «Poupée ! » par la vitre. Ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait et Kathleen m'avait recommandé de «faire comme si de rien n'était». Mais il m'avait distraite ; mon vélo dévia et dérapa sur les feuilles humides. J'eus du mal à en reprendre le contrôle. Par coquetterie, je ne portais pas le casque que mon père m'avait acheté, et je réalisai, tout en continuant de pédaler, que j'aurais pu me faire très mal.
Je rangeai le vélo dans le garage et pris quelques minutes pour observer la silhouette à la fois imposante et gracieuse de la maison, la vigne ligneuse dessinant les contours de la façade gauche. Derrière les fenêtres éclairées se trouvaient les pièces familières de mon enfance, et dans l'une d'entre elles j'allais retrouver mon père, sans doute en train de lire, assis dans son fauteuil en cuir. L'idée qu'il en serait peut-être toujours ainsi me rassurait. Mais je réalisai soudain que lui serait peut-être là pour toujours mais moi pas.
Debout devant la maison, l'odeur du bois brûlé dans l'air froid me revint très nettement en mémoire et je me demandai si, après tout j'étais bien mortelle.
Je levai les yeux du plat de macaronis laiteux au fromage.
- Père ? Est-ce que je vais mourir ? Il était assis en face de moi et regardait mon plat avec un dégoût manifeste.
- C'est bien possible. Surtout si tu ne portes pas ton casque de vélo.
Je lui avais raconté la frayeur que j'avais eue sur le chemin du retour.
- Sérieusement. Si j'étais tombée et que je m'étais cogné la tête, je serais morte ?
- Je n'en sais rien, Ari.
Il tendit le bras pour attraper le shaker argenté sur la table et se resservit un verre.
- Jusque-là, tu t'es toujours bien remise de tes petite bobos, non ? Et ce coup de soleil l'été dernier... en une semaine tu étais sur pied, si je me souviens bien. Tu as de la chance de n'avoir encore jamais eu de problèmes de santé plus graves. Mais cela pourrait t'arriver, bien sûr.
- Oui, bien sûr.
C'était la première fois que je me sentais jalouse de lui.
Ce soir-là, alors que nous étions en train de lire dans le salon, une autre question me vint à l'esprit
- Père, quel est le principe de l'hypnose ?
Il glissa son marque-page, une plume grise, dans le roman qu'il était en train de lire - je crois me souvenir qu'il s'agissait d'Anna Karenine, parce que peu de temps après il m'en conseilla vivement la lecture.
- C'est le principe de la dissociation. Il faut que la personne se concentre sur ce que dit l'autre ou le fixe dans les yeux jusqu'à ce qu'une séparation s'opère entre la conscience qu'elle a habituellement d'elle-même et son comportement. Si cette personne est très influençable, elle va faire tout ce que l'autre lui demande.
Je repensai à ce qui s'était passé dans la serre, me demandant jusqu'où j'aurais pu aller avec ce garçon.
- Est-il vrai qu'on ne peut pas amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il réprouve ?
- Cette question fait l'objet d'un grand débat. Les recherches les plus récentes ont montré que, dans les bonnes circonstances, on peut faire faire presque tout ce qu'on veut à une personne influençable.
Il me regarda d'un air amusé, comme s'il savait ce qui s'était passé.
Je changeai mon angle d'attaque.
- M'avez-vous déjà hypnotisée ?
- Bien sûr. Tu ne t'en souviens pas ?
- Non.
Je n'aimais pas vraiment l'idée que quelqu'un puisse influer sur mon comportement
- Quand tu étais toute petite, tu avais tendance à pleurer, m'expliqua-t-il de sa voix douce et grave, marquant un temps après le mot pleurer. Tu faisais un raffut incroyable, sans raison apparente, et moi, bien sûr, j'essayais de te calmer en te donnant du lait en te prenant dans mes bras, en te chantant des berceuses, et toutes sortes de choses qui me passaient par la tête.
- Vous me chantiez des berceuses ?
Je n'avais jamais entendu mon père chanter - c'est du moins ce que je croyais.
- Tu ne t'en souviens vraiment pas ?
Il avait l'air mélancolique.
- Je me demande bien pourquoi. En tout cas, oui, je chantais, mais parfois cela ne suffisait pas. Et donc, un soir, en désespoir de cause, je t'ai regardée droit dans les yeux en t’intimant silencieusement de te calmer. Je t'ai dit que tu étais en sécurité, que je m'occupais de toi et que tu devrais être contente. Et tu as soudain arrêté de pleurer, puis tu as fermé les yeux. Je te tenais dans mes bras, enroulée dans une couverture blanche : tu étais si petite. Il garda un moment les yeux fermés.
- Je t'ai serrée contre moi et je suis resté ainsi, à écouter ta respiration, jusqu'au lendemain matin.
J'eus soudain envie de me lever de ma chaise pour le prendre dans mes bras, mais je n'en fis rien. Il m'intimidait. Il rouvrit les yeux.
- Avant d'être père, j'ignorais ce qu'était l'inquiétude. Il reprit son livre.
Je me levai et lui dis bonne nuit. Puis une autre question me vint :
- Père, quelle berceuse me chantiez-vous ?
- Murucututu répondit-il sans détacher les yeux de sa page, une berceuse brésilienne que me chantait ma mère. C'est le nom d'une petite chouette et dans la mythologie brésilienne, la chouette est la mère du sommeil.
Il leva les yeux et nos regards se croisèrent
- Oui, je te la chanterai un jour, mais pas ce soir.
Vois-tu toi aussi les lettres et les mots en couleur ? Du plus loin que je me souvienne, la lettre P a toujours été vert émeraude pour moi, et le S bleu roi. Les jours de la semaine ont également leur couleur spécifique : mardi est bleu lavande, vendredi est vert Cette affection s'appelle la synesthésie et on estime qu'elle touche une personne sur deux mille.
D'après Internet tous les vampires sont potentiellement synesthètes.
Je passais mes matinées à surfer sur Internet avec mon ordinateur portable, à la recherche de définitions que je recopiais sur les pages de mon journal (que j'ai déchirées depuis pour des raisons qui te paraîtront bientôt évidentes). Page après page, je recopiais ce que me livrait Internet consciente de ne pas valoir mieux que Kathleen et ses partenaires de jeux avec leurs carnets noirs remplis d'incantations et de sortilèges.
Pourtant même si j'avais parfois des doutes sur mes recherches et que je me posais des questions sur ce que j'apprenais, je continuais mon rituel. Je ne savais pas où cela pouvait me mener, mais j'éprouvais une irrésistible envie de poursuivre mes recherches. C'est comme avec un puzzle : avant même de les avoir assemblées, on sait que les différentes pièces dispersées dans la boîte formeront une image.
Mrs McG insista beaucoup pour que je passe le week-end avec Kathleen. Elle m'en parla tous les jours de la semaine, et quand elle rentra chez elle le vendredi, ce fut avec moi (le vendredi est toujours pour moi d'un vert éclatant, pas pour toi ?).
Je ne trouvai pas Kathleen changée. Je m'étais faite à ses vêtements noirs et à son maquillage excessif. Elle me parut un peu plus à cran, c'est tout. Nous passâmes la soirée à regarder la télé en famille, en mangeant des pizzas. Michael resta dans son coin ; il n'était pas très causant mais il avait les yeux fixés sur moi, et je savourais cette attention qu'il me portait.
Le lendemain, Kathleen et moi fîmes la grasse matinée. Nous passâmes ensuite des heures à déambuler dans le centre commercial, essayant des vêtements et observant les gens.
Il ne se passa rien de spécial jusqu'au samedi soir. Mrs McG insista pour qu'on aille à la messe. Kathleen répliqua que nous avions autre chose de prévu, et sa mère lui rétorqua que ça pouvait attendre.
Kathleen céda assez rapidement. Je compris alors que cette petite dispute faisait partie de leur rituel du week-end.
- Je ne suis jamais rentrée dans une église, dis-je. Tous me regardèrent comme si j'étais une extraterrestre.
- La chance ! marmonna Kathleen.
L'église était une bâtisse rectangulaire délabrée en brique - rien à voir avec l'architecture imposante à laquelle je m'attendais. À l'intérieur, ça sentait le renfermé, le vieux papier et l'eau de Cologne éventée. Pendant l'office, j'observai fixement les vitraux derrière l'autel, qui représentaient Jésus et ses disciples. Les vitraux sont toujours pour moi source de rêveries. Dans l'assemblée, assis sur les bancs, je repérai trois des copains rôlistes de Kathleen, dont celui qui avait voulu m'« étreindre ». Ils étaient tous vêtus de noir et je fus surprise de les voir articuler en silence les cantiques et les prières.
Assise à côté de moi, Kathleen n'arrêtait pas de croiser et de décroiser les jambes en soupirant. Les rôlistes avaient prévu de se retrouver chez Ryan dans la soirée pour une nouvelle partie, et Kathleen m'avait promis de me donner un vrai rôle à jouer. Je n'étais pas tellement impatiente d'y être.
Debout devant l'autel, le prêtre citait la Bible. C'était un vieil homme à la voix chantante, que je n'eus aucun mal à ignorer — jusqu'à ce que ses paroles fassent brutalement irruption dans ma rêverie.
- Si vous ne mangez pas la chair du fils de l'Homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle.
Il leva les deux coupes en argent qu'il tenait dans ses mains.
Tandis qu'il continuait son discours sur la chair et le sang, une file de fidèles se forma pour rejoindre l'autel. Les McGarritt se levèrent à leur tour pour sortir de leur rangée.
- Attends-nous ici : toi, tu ne peux pas recevoir la communion.
J'attendis donc en regardant les autres se faire consacrer, mangeant la chair et buvant le sang.
- Mémento homo quia putois es et in pulverem revertis (Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu redeviendras poussière), murmura le prêtre.
Ma tête se mit à bourdonner: est-ce que quelqu'un m'observait ? Le bourdonnement s'amplifia tandis que les McGarritt rejoignaient leur banc. Mrs McGarritt semblait comme revigorée et arborait un sourire de satisfaction. Tu ne devrais pas être ici, dit une voix dans ma tête, ce n'est pas ta place.
Michael passa devant Bridget pour venir s'asseoir à côté de moi. Tandis que les autres entonnaient les chants et les prières, il serra ma main dans la sienne et le bourdonnement s'atténua.
- Jette un œil à ces foutaises, me dit Kathleen en me lançant un livre sur les genoux.
Je lus le titre à voix haute :
- Manuel à l'usage des adolescents catholiques. C'est mieux que Devenir femme ?
Nous étions dans sa chambre et elle était en train de parfaire son maquillage de vampire avant de partir chez Ryan. J'étais assise en tailleur sur le lit et Wally, le chien, était couché en rond à côté de moi
- C'est exactement le même genre de truc. Kathleen avait coiffé ses cheveux en petits chignons sur lesquels elle appliquait à présent du gel avant de les dresser en pointes. Sa technique me fascinait.
- Des conneries sur le fait de rester vierge jusqu'à la nuit de noces et sur le fait que Jésus nous accompagne partout.
Je feuilletai le livre.
- « Le corps féminin est un jardin magnifique, lus-je à haute voix, mais il doit rester fermé à clé et ses clés ne doivent être confiées qu'à son mari »
- Quelle connerie !
Kathleen balança le tube de gel et attrapa son tube de mascara. Je réfléchis à l'image du jardin.
- Dans un certain sens, notre corps peut effectivement être comparé à un jardin. Regarde-toi : tu te rases les jambes, tu t'épiles les sourcils, tu te coiffes les cheveux et tout. C'est un peu comme du désherbage.
Kathleen se tourna vers moi et me lança son regard «Tu plaisantes ? » : elle avait les yeux exorbités, la bouche ouverte et secouait la tête. Nous éclatâmes de rire. Mais je pensais vraiment ce que je disais : dans l'univers de Kathleen, l'apparence avait une très grande importance. Son poids, ses vêtements, le dessin de ses sourcils — tout cela la préoccupait jusqu'à l'obsession. Alors que, pour moi, il y avait des choses bien plus essentielles, pensais-je de manière un peu prétentieuse.
Kathleen se retourna vers le miroir.
- Ça va être une soirée exceptionnelle. Mon horoscope m'a prédit une journée à marquer d'une pierre blanche.
- Samedi est rouge, pas blanc, répliquai-je mécaniquement.
Elle me gratifia d'un nouveau regard éberlué.
- Je ne savais pas que tu lisais l'horoscope, ajoutai-je précipitamment
- C'est la seule chose intéressante dans le journal. Mais je suis prête à parier que les gens comme toi préfèrent lire l'éditorial.
Chez moi, personne ne lisait les quotidiens, nous n'étions même pas abonnés, mais je me gardai de le lui dire.
Nous étions prêtes à partir chez Ryan, mais le bourdonnement dans ma tête avait repris et je me sentais barbouillée.
- Je ne me sens pas bien, annonçai-je à Kathleen.
Elle me regarda avec attention et bien que malade, je ne pus qu'admirer l'épaisseur de ses cils et la hauteur impressionnante de sa coiffure.
- Tu peux pas rater la partie de ce soir, nous allons tous partir en quête. Il faut que tu manges quelque chose.
À cette seule idée, je me précipitai dans la salle de bains des McGarritt pour vomir.
Quand j'eus terminé, je me passai de l'eau sur la bouche et le visage. Kathleen fît irruption dans la pièce sans frapper.
- Qu'est-ce qui t’arrive ? C'est le lupus ?
Je lus de l'inquiétude dans ses yeux, et même de l'amour.
- Je n'en ai pas la moindre idée.
Mais je mentais, d'une certaine façon. J'avais un très fort soupçon quant à la source du problème : j'avais oublié d'emporter mon flacon de tonifiant.
- Je peux t'emprunter une brosse à dents ?
Nous croisâmes Michael dans le couloir, l'air intrigué. Il avait laissé la porte de sa chambre ouverte et on entendait une voix monotone chanter: «Le monde est peuplé de fous. Et j'en fais partie... »
Michael et Kathleen commencèrent à se disputer sur la question de savoir si je devais rester chez eux ou aller chez Ryan.
- Je veux rentrer chez moi, tranchai-je. Je me sentais comme une idiote.
Le visage de Kathleen s'assombrit
- Tu vas rater la chasse aux trésors.
- Désolée, mais malade comme je suis, je risque de ne pas être très marrante.
Une voiture klaxonna dehors. Les copains de Kathleen venaient la chercher pour l'emmener chez Ryan.
Michael me raccompagna en voiture. Il était silencieux, comme à son habitude. Au bout d'un moment il dit :
- Qu'est-ce qui ne va pas, Ari ?
- Je ne sais pas. Je crois que j'ai l'estomac fragile.
- Tu penses que c'est le lupus ?
- Je ne sais pas.
J'en avais assez de parler, assez de ces bourdonnements de moustiques dans ma tête.
- On t’a fait un test ?
- Oui, et les résultats sont négatifs.
Je regardai par la vitre les arbres gelés qui scintillaient et les glaçons qui pendaient des avant-toits des maisons. D'ici quelques semaines, on accrocherait les décorations de Noël un peu partout Encore un rituel auquel je ne participerais pas, pensai-je avec amertume.
Michael se gara le long du trottoir. Puis il se pencha vers moi et je me blottis spontanément dans ses bras. Il se produisit quelque chose, quelque chose d'électrique, suivi d'une explosion d'émotions.
Oui, je sais qu’explosion n'est pas le terme approprié. Pourquoi est-ce si compliqué de décrire ses sentiments ?
L'important c'est que ce fut la première fois que je pris réellement conscience de nos corps. Je me souviens qu'à un moment je me reculai pour observer Michael à la lumière des lampadaires, son cou si pâle qui semblait si fort, et que je ressentis un besoin impérieux de m'enfouir et de disparaître en lui. Tu comprends ?
Une partie de moi restait cependant à l'écart nous observant tandis que nos mains et nos bouches s'affolaient. Je m'entendis dire calmement :
- Je n'ai pas l'intention de perdre ma virginité à l'avant d'une voiture garée devant chez mon père.
Mon ton guindé me fit rire. L'instant d'après, Michael se prit lui aussi à rire. Puis il s'arrêta net, le visage et le regard sérieux. M'aime-t-il vraiment ? Comment est-ce possible ?
Nous nous dîmes au revoir, rien de plus. Pas de rendez-vous pour le lendemain.
Pas de déclaration enflammée - nos corps s'en étaient chargés.
En rentrant je jetai par réflexe un œil dans le salon. Les portes étaient ouvertes mais les lampes éteintes. C'est vrai qu'il n'était pas prévu que je rentre ce soir-là, mais je m'étais malgré tout attendue à le trouver dans son fauteuil, comme d'habitude.
Il valait mieux qu'il ne soit pas là, finalement me dis-je en montant l'escalier. Rien qu'en me voyant il aurait deviné à quoi j'avais passé la fin de ma soirée.
Je m'arrêtai dans le couloir. Mais il n'y avait rien, aucune trace d'une autre présence. Personne ne m'observait ce soir.
Chapitre 6
Je me réveillai en croyant que quelqu'un m'appelait - j'ouvris les yeux et fis : « Oui? »
Mon père était dans ma chambre ; il faisait complètement noir mais je sentais sa présence. Il se tenait à côté de la porte.
- Ari, où étais-tu hier soir ?
Je me redressai et allumai ma lampe de chevet : les petits oiseaux surgirent dans le noir.
- Il y a un problème ?
- Mr McGarritt vient de téléphoner.
Ses yeux sombres étaient grands ouverts. Il portait un costume et une chemise et je me demandai : Est-il resté debout toute la nuit ? Ne porte-t-il donc pas de pyjama ?
- Ce n'est pas une heure pour téléphoner.
Je ne voulus pas en entendre davantage, je pressentais de mauvaises nouvelles.
- Kathleen n'est toujours pas rentrée chez elle. Sais-tu où elle pourrait être ?
Je lui parlai des jeux de rôle.
- Certains sont des loups-garous et d'autres des vampires. Ils vont et viennent en psalmodiant des incantations et en faisant semblant de boire le sang les uns des autres.
- Quelle indécence ! fit-il sèchement
- Hier soir, ils devaient partir en quête, paraît-il. Ils avaient prévu de se retrouver chez Ryan. Je ne me suis pas sentie bien après la messe et Michael m'a ramenée ici.
- Après la messe ?
- Il y avait tout le monde, les McGarritt et même certains des rôlistes. Ils y vont chaque week-end.
- Je vois, dit-il d'un ton qui signifiait le contraire. Les loups-garous et les vampires prient pour leur absolution avant de se nourrir.
- C'est juste un jeu.
Mon père semblait perplexe.
- Bien, je vais rappeler Mr McGarritt et lui dire ce que tu m'as raconté. Si Kathleen ne rentre pas bientôt chez elle, il aura sans doute envie de te parler.
- Ne rentre pas chez elle ? Quelle heure est-il ?
- Bientôt quatre heures, et il est temps que tu te rendormes. Je suis désolé d'avoir dû te réveiller.
- Ils doivent encore être en train de jouer, avançai-je, plus pour m'en convaincre qu'autre chose.
Il faisait nuit et froid dehors, où pouvaient-ils être s'ils n'étaient pas chez Ryan ?
Mon père sortit et j'éteignis la lumière. Mais je ne parvins pas à me rendormir.
Quand je descendis dans la cuisine ce matin-là, Mrs McGarritt n'y était pas. Je me préparai des toasts. J'étais assise à table, en train de manger, quand mon père remonta du sous-sol.
Il s'assit en face de moi et me regarda mastiquer mes tartines sans rien dire. Je cherchai un signe de réconfort dans ses yeux.
- On l'a retrouvée, finit-il par dire.
Plus tard ce jour-là, je parlai à Mr McGarritt, avec le policier qui vint nous rendre visite et, après dîner, avec Michael.
Kathleen avait retrouvé les autres rôlistes chez Ryan. Chacun était parti en mission - une chasse au trésor à ce que j'ai compris. Kathleen devait rapporter un ornement de jardin, un nain de préférence. Ils avaient jusqu'à minuit pour réussir, et tous étaient revenus chez Ryan avant l'heure fatidique. Tous, sauf Kathleen. Ils avaient décrété la fin du jeu autour d'une heure du matin, en se disant que Kathleen avait dû rentrer chez elle. C'est du moins ce que m'expliqua Michael, et la version qu'ils donnèrent à la police.
Les deux policiers dépêchés chez nous s'assirent au salon, mal à l'aise. Ils affichaient un air contrit, tout en observant les meubles et en nous scrutant du regard, mon père et moi Je ne pus pas leur dire grand-chose, et eux ne nous révélèrent aucune information.
À un moment, l'un d'eux se tourna brusquement vers mon père :
- À quelle heure Ariella est-elle rentrée ?
- Il était dix heures et quart
Je n'osai le regarder mais me demandai juste : Comment le sait-il ?
- Vous avez passé toute la soirée ici, monsieur ?
- Oui, comme toujours.
Au téléphone, ce soir-là, Michael avait la voix qui tremblait
- C'est Mr Mitchell, le père de Ryan, qui l'a trouvée dans la serre. Mon père a dit à ma mère qu'elle était étendue là et qu'elle avait l'air si paisible que Mr Mitchell a d'abord cru qu'elle dormait. Mais quand il l'a touchée - Michael se mit à sangloter -, tout son corps s'est disloqué.
Je faillis lâcher le combiné. Je visualisais très bien la scène : Kathleen étendue parmi les orchidées, baignant dans la lumière bleu-violet des néons, la tête étrangement inclinée, bien que Michael n'ait pas précisé ces détails. Son corps était parsemé de persil, échappé du petit sac qu'elle portait comme un talisman.
Quand il fut capable de parler à nouveau, Michael me dit :
- Maman est complètement déboussolée. Je crois qu'elle ne s'en remettra jamais.
Nous n'avons rien dit à Bridget, mais elle sent bien qu'il s'est passé quelque chose de grave.
- Que s'est-il passé ? Qui l'a tuée ?
- Je n'en sais rien. Personne ne le sait. Les autres ont été interrogés et ils ont tous dit qu'ils ne l'avaient pas revue après le début du jeu. Ryan est dans tous ses états.
Il parlait de manière hachée, le souffle irrégulier.
- Je te jure que je retrouverai celui qui a fait ça et que je le tuerai de mes propres mains.
Je restai assise un long moment à l'écouter pleurer, déverser sa rage et pleurer encore jusqu'à ce que nous soyons tous les deux épuisés. Mais je savais pertinemment que nous ne dormirions ni l'un ni l'autre cette nuit-là, pas plus que la suivante.
Quelques jours plus tard, je tapai le nom de Kathleen dans un moteur de recherche et obtins plus de 70 000 réponses. La semaine suivante, il y en avait plus de 700 000.
Le journal de Saratoga Springs publia plusieurs articles dressant le portait de rôlistes adeptes du culte satanique, insinuant que Kathleen avait été la victime d'un sacrifice rituel. On donnait très peu de détails sur les circonstances de sa mort, précisant juste que son corps avait été retrouvé mutilé et quasi exsangue. Un éditorial mit en garde les parents sur le danger des jeux de rôle pour leurs enfants.
Tous les journaux ne s'érigèrent pas en moralistes : certains se contentèrent de rapporter les faits, sans spéculer sur les mobiles du crime.
Mais tous se rejoignaient sur un point : on ne connaissait pas l'identité de l'assassin. On pensait qu'elle n'avait pas été tuée dans la serre, mais dans un champ tout proche, où l'on avait retrouvé des traces de sang et les débris d'un nain en plâtre dans la neige. La police locale avait fait appel au FBI pour conduire l'enquête.
Si je ne m'étais pas sentie mal, pensai-je, je l'aurais accompagnée et j'aurais peut-être pu la sauver.
Parmi les réponses Internet figurait le site myspace.com. Trois copains de Kathleen y tenaient un blog sur sa mort. Je me contentai de les survoler, n'appréciant pas le genre de précisions qu'ils donnaient. L'un d'entre eux disait que le corps de Kathleen avait été « découpé comme un sushi ».
Les semaines passèrent néanmoins. Et quelques jours plus tard, mon père et moi reprîmes nos leçons quotidiennes. Nous n'évoquâmes pas Kathleen. Un soir, il me dit simplement :
- Eileen McGarritt ne reviendra pas travailler : c'est Mary Ellis Root qui te préparera les repas désormais.
C'était la première fois que j'entendais son prénom.
- J'aimerais mieux m'en charger moi-même.
À vrai dire, je n'avais plus d'appétit.
- Soit
Michael me téléphonait une à deux fois par semaine. On ne pourrait pas se voir avant un moment. Sa famille et les amis de Kathleen étaient harcelés par les médias locaux et il était préférable qu'il reste chez lui. La police et le FBI se refusaient à tout commentaire, se contentant d'indiquer qu'ils avaient des soupçons.
Les McGarritt enterrèrent Kathleen. Si cérémonie il y eut, elle se déroula dans la plus stricte intimité. Mon père et moi assistâmes à la messe donnée une semaine avant Noël.
Elle eut lieu dans le gymnase du collège - là où s'était déroulée la soirée de Halloween. Les décorations de Noël avaient remplacé les serpentins en papier. Un conifère orné de guirlandes se dressait près de la statue de Jésus, à l'entrée du gymnase, répandant une forte odeur de pin. On avait placé une photographie de Kathleen sur un chevalet - un portrait pris quand elle avait les cheveux longs - à côté d'un registre ouvert que chaque personne signait en entrant. Nous nous assîmes ensuite sur d'inconfortables chaises pliantes en métal.
Au premier rang, à côté d'un vase blanc rempli de roses, se tenait le prêtre. Je ne fis guère attention à ce qu'il dit préférant observer l'assistance.
Mrs McG avait maigri et son visage semblait s'être affaissé. Elle ne disait rien, ne touchait personne, ne serrait même pas les mains. Elle restait assise, hochant la tête de temps à autre. Elle avait l'air d'une vieille dame.
Assis à l'autre bout de la salle, Michael ne me quittait pas des yeux mais nous n'eûmes pas l'occasion de nous parler. Quant aux autres membres de la famille, ils ne me jetèrent pas un regard. Tous avaient le visage plus anguleux que dans mon souvenir, et les yeux cernés. La petite Bridget elle-même, à qui on avait fini par annoncer la mort de sa sœur, paraissait plus mince et avait l'air triste et délaissé. Wally, le chien, était couché à côté d'elle, la tête sur les pattes. Les amis « païens » de Kathleen, en costume et cravate, avaient une mine misérable et se jetaient des regards suspicieux.
Je suis incapable de décrire la tension qui régnait dans la salle, au milieu du parfum écœurant des roses.
Les gens se succédèrent pour prononcer quelques mots sur Kathleen. Des platitudes, le plus souvent. Comme elle aurait ri si elle avait pu les entendre ! Je n'écoutai pas vraiment. J'avais décidé de ne pas parler : je n'arrivais pas à croire qu'elle était morte et je n'allais pas jouer les hypocrites. C'était aussi simple que cela.
Mon père était assis à côté de moi et nous sortîmes ensemble de la salle. Il serra la main de Mr McGarritt et lui exprima notre tristesse. Je n'ouvris pas la bouche.
Michael me jeta un dernier regard avant que nous partions, mais je continuai d'avancer, comme un zombie.
Nous étions sur le point de quitter le collège quand mon père m'entraîna soudain loin de la porte, vers une sortie latérale. Ce n'est qu'une fois dans la voiture que je compris pourquoi : l'entrée principale était prise d'assaut par les photographes et les caméras de télévision.
Mon père démarra. Je frissonnai à la vue des journalistes se pressant autour de la famille de Kathleen et de ses amis qui sortaient du gymnase. Il neigeait: de gros flocons, pareils à des morceaux de gaze, dérivaient dans l'air. Deux restèrent collés quelques secondes sur le pare-brise, avant de glisser en fondant J'aurais voulu rester là, à regarder la neige, mais la voiture se mit à rouler. Je m'enfonçai dans le siège en cuir, laissant mon père nous ramener à la maison.
Nous passâmes la soirée à faire semblant de lire au salon, jusqu'à ce que je monte me coucher. Je m'allongeai sous les couvertures, le regard fixe. Je finis sans doute par sombrer dans le sommeil... et me réveillai en sursaut, une nouvelle fois persuadée que quelqu'un m'appelait.
- Ari ?
C'était une petite voix haut perchée qui venait de dehors.
- Ari ?
J'allai à la fenêtre et ouvris les rideaux épais. Elle était en bas, pieds nus dans la neige avec son tee-shirt noir déchiré, le visage éclairé par les réverbères de l'allée. Le pire, c'était sa tête : on aurait dit qu'on la lui avait arrachée puis remise n'importe comment : elle était tout de travers.
- Ari ? Tu viens jouer ? appela Kathleen en se balançant. Ce n'était pas sa voix elle était trop aiguë et chantante.
- Tu viens jouer avec moi ?
Je me mis à trembler.
C'est alors que mon père surgit par la porte de derrière.
- Va-t’en ! Retourne dans ta tombe !
Il ne parla pas d'une voix forte mais son ton impérieux me donna la chair de poule.
Kathleen resta encore quelques instants à se balancer doucement. Puis elle s'en alla d'un pas saccadé, comme une marionnette, la fête penchée en avant. Mon père rentra dans la maison, sans un regard vers ma fenêtre. Quelques secondes plus tard, il était dans ma chambre.
Etendue par terre, toujours tremblante, les genoux ramenés sur la poitrine, je serrais mon corps dans mes bras aussi fort que je le pouvais.
Il me laissa pleurer un moment puis il me souleva sans effort comme si j'étais un bébé, et me remit au lit. Après m'avoir bordée, il approcha une chaise et se mit à chanter : Murucututu, detrâs do Murundu.
Je ne parle pas portugais, mais peu m'importait de comprendre les paroles. Finalement je m'arrêtai de pleurer et m'endormis, bercée par le murmure de sa voix grave.
Quand je me réveillai le lendemain matin, j'avais séché mes larmes et pris une décision.
Lorsque mon père me rejoignit dans la bibliothèque l'après-midi, je l'attendais de pied ferme. Je le laissai s'asseoir et je me levai :
- Qui suis-je, père ?
- Tu es ma fille.
Je me surpris à admirer la beauté de ses cils - comme malgré moi, comme s'il me téléguidait pour détourner mon attention. Mais je ne me laisserais pas faire cette fois.
- Je veux que vous m'expliquiez comment c'est arrivé -comment je suis arrivée.
Il resta silencieux une minute ou deux. Je ne bougeai pas. Je ne pouvais deviner ce qu'il pensait
- Tu ferais bien de t'asseoir. C'est une longue histoire.
- Je n'ai aucun moyen de savoir si tu ressembles davantage à ta mère ou à moi, commença-t-il.
Son regard dériva vers la fenêtre, puis vers la vitrine, avant de revenir sur moi.
- J'ai souvent pensé que tu tenais plutôt de moi par ta manière de réfléchir ; et que, le moment voulu, tu saurais tout ce qui est nécessaire pour ta survie, sans qu'on te l'ait appris. Mais je ne peux en être certain, continua-t-il en croisant les bras. Pas plus que je ne peux être certain d'être toujours en mesure de veiller sur toi. J'imagine que l'heure est venue de tout te raconter, tout depuis le début .C'était une longue histoire et il me demanda d'être patiente et de ne pas l'interrompre avec des questions.
- Je voudrais que tu comprennes l'enchaînement des événements, la façon dont chacun a entraîné le suivant. Comme l'écrit Nabokov dans ses Mémoires : «Permettez-moi d'examiner en toute objectivité le démon qui vit en moi. »
- Oui, je veux comprendre.
Il me raconta alors l'histoire que j'ai retranscrite au début de ce cahier, le récit de cette soirée à Savannah. Les trois hommes qui jouaient aux échecs ; l'intimité surprenante entre mon père et ma mère. Le portail, le fleuve, le châle. Quand il eut terminé, il recommença son récit en précisant certains détails. Les deux joueurs d'échecs, des camarades de troisième cycle à l'université de Virginie, étaient à Savannah pour le week-end. L'un d'entre eux n'était autre que Dennis. L'autre s'appelait Malcolm.
Mon père était né en Argentine. D'après ce qu'on lui avait dit, son père était allemand, mais il ne l'avait pas connu. Ses parents ne s'étaient jamais mariés et son nom, Montero, lui venait de sa mère, une Brésilienne, qui mourut peu de temps après sa naissance.
- Vous avez dit à ma mère que vous la connaissiez.
- Oui, c'est une étrange coïncidence : nous nous étions croisés quand nous étions enfants. Ma tante vivait en Géorgie et j'ai rencontré ta mère un après-midi d'été à Tybee Island : nous avons joué ensemble sur la plage. J'avais six ans et elle dix. J'étais un enfant et elle était un enfant.
C'était une citation d’Annabel Lee.
- J'ai passé mon enfance à l'intérieur des terres en Argentine, et vivre ainsi au bord de la mer... Je ne sais pas, cela m'a fait une forte impression. Le bruit et l'odeur de l'océan m'ont apporté une paix inconnue jusque-là.
Son regard se détacha de moi pour aller se poser de nouveau sur la vitrine et sur les trois petits oiseaux prisonniers à l'intérieur.
- Je passais mes journées sur la plage, à faire des châteaux de sable et ramasser les coquillages. Un après-midi, une fille en robe d'été blanche s'est approchée de moi et m'a attrapé par le menton : «Je te connais, a-t-elle dit tu habites la villa La Bouée bleue. » Elle avait les yeux bleus, les cheveux auburn, un petit nez, et ses lèvres pleines ont esquissé un sourire qui m'a fait sourire à mon tour. Je l'ai regardée dans les yeux et quelque chose est passé entre nous.
Il s'arrêta On n'entendit plus que le tic-tac de l'horloge antique.
- Alors vois-tu, quand nous nous sommes revus à Savannah, je ne me suis pas posé de question sur notre amour futur, ajouta-t-il d'une voix douce. J'étais déjà tombé amoureux d'elle vingt ans auparavant
- Amoureux ?
- Oui, répondit-il, avant d'ajouter, d'une voix plus forte : l'amour, comme le disait Bertrand Russell, est une forme de coopération d'ordre biologique, où les sentiments des uns permettent de satisfaire les instincts des autres.
Mon père se renfonça dans son fauteuil.
- Pourquoi es-tu si triste, Ari ? Russell disait aussi que l'amour est source de joie et de connaissance. L'amour implique la coopération, qui est à l'origine de la morale humaine. Dans sa forme la plus pure, l'amour révèle des qualités que l'on n'aurait jamais soupçonnées.
- Tout cela est tellement abstrait. J'aimerais mieux que vous me parliez de vos sentiments.
- Eh bien, Russell avait raison à tout point de vue. Notre amour a été une source de joie. Et ta mère répondait à tous les principes moraux auxquels je tenais.
- Pourquoi dites-vous toujours « ta mère » ? Pourquoi ne l'appelez-vous jamais par son prénom ?
Il décroisa les bras et plaça les mains derrière sa nuque, m'examinant de son regard froid.
- C'est douloureux pour moi de prononcer son nom. Même après tant d'années. Mais tu as raison, tu dois savoir qui était ta mère. Elle s'appelait Sara. Sara Stephenson.
- Où est-elle ?
Cette question, je l'avais déjà posée, longtemps auparavant sans obtenir de réponse.
- Que lui est-il arrivé ? Est-elle toujours en vie ?
- Je n'ai pas la réponse à ces questions.
- Était-elle très belle ?
- Oui, très belle, confirma-t-il d'une voix rauque. Mais elle n'en tirait aucune vanité, contrairement à la plupart des belles femmes. Et puis, elle était un peu lunatique.
Il toussa.
- Elle composait le temps que nous passions ensemble, organisant nos journées comme des événements artistiques. Un après-midi, nous sommes allés pique-niquer à Tybee Island : nous avons mangé des myrtilles et bu du Champagne teinté de curaçao, en écoutant Miles Davis. Quand je lui ai demandé quel parfum elle portait, elle m'a répondu: «L'Heure bleue.» Elle qualifiait certains moments de «parfaits», et nous en avons vécu un cet après-midi-là. Je lisais, étendu près d'elle, pendant qu'elle faisait la sieste. Je me souviendrai toujours du bruit des vagues, des pages que l'on tourne, et de l'odeur de L'Heure bleue. Ils resteront dans mon esprit synonymes d'amour. Je me suis moqué d'elle, la traitant de romantique écervelée et elle m'a répliqué que je n'étais qu'un intellectuel rabat-joie. Mais elle était convaincue que l'univers nous envoyait en permanence des messages sensoriels, que nous ne parvenions jamais à décoder complètement. Et qu'elle, elle s'efforçait simplement d'y répondre.
C'était assez pour ce soir - il était tard à présent et il faisait nuit noire dehors. II reprendrait demain.
Je montai me coucher sans protester. Cette nuit-là, je ne pleurai pas et dormis d'un sommeil sans rêve.
Je m'attendais à ce que mon père continue de me raconter comment il avait séduit ma mère, mais la leçon débuta d'une façon très différente.
Il avait souhaité qu'on se retrouve au salon plutôt que dans la bibliothèque. Il avait un verre de Picardo à la main, alors que d'habitude il attendait la fin de notre séance de travail pour boire.
- Certaines qualités humaines me font défaut, dit-il de but en blanc dès que nous fûmes installés dans nos fauteuils respectifs. Comme cette faculté que tu as à parler avec Dennis. Le badinage, la tendresse désinvolte. J'ai d'autres compensations, bien sûr, ajouta-t-il avec son sourire d'érudit, parmi lesquelles la mémoire. Je me souviens de tout - contrairement à toi, ai-je cru comprendre. Tu possèdes en revanche une mémoire implicite - tu n'as peut-être pas conscience des événements passés, mais tes neurones sont capables de retenir des fragments très nets d'une expérience codée.
J'ai toujours pensé qu'un jour tu saurais les déchiffrer, qu'un stimulus approprié provoquerait un sursaut dans ta mémoire, et que le souvenir deviendrait conscient.
Je levai la main et il s'arrêta. Il me fallut un peu plus d'une minute pour comprendre ce qu'il venait de dire. Je finis par opiner et il reprit son récit Mon père découpait sa vie en cinq phases. Il avait eu une enfance monotone: repas, couchers et devoirs à heures fixes. Il avait essayé de reproduire cette monotonie pour moi. Bertrand Russell lui-même affirmait que la monotonie était indispensable à une vie heureuse.
La deuxième phase de sa vie commença quand il partit de chez sa tante pour s'inscrire à l'université de Virginie. Les cours ne lui semblaient pas très difficiles, et il passait beaucoup de temps à boire, à parier et à parfaire sa connaissance des femmes.
La rencontre avec ma mère à Savannah marqua le début de la troisième phase.
Après avoir quitté son mari, elle emménagea dans un appartement situé dans une vieille maison en brique, en face du cimetière colonial. (Et comme pour me montrer l'étendue de sa mémoire, il se mit à me décrire les allées du cimetière, incrustées d'éclats de coquilles d'huîtres, et les spirales gravées sur le trottoir en brique. Ce motif le mettait mal à l'aise, mais c'est une de mes figures préférées. Pas toi ? Les spirales symbolisent la création et le développement si leur sens de rotation à partir du centre est celui des aiguilles d'une montre, et la destruction dans le sens opposé. Figure-toi que les ouragans de l'hémisphère Nord tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.)
Ma mère trouva du travail dans une société qui récoltait conditionnait et vendait du miel. Elle refusa l'argent de son mari et entama la procédure de divorce.
Mon père faisait chaque week-end huit heures de voiture pour aller de Charlottes-ville à Savannah, et rentrait le lundi. Le trajet aller ne lui pesait pas, c'était le retour qui était difficile.
- Quand on est amoureux, on souffre physiquement d'être séparés.
Il parlait si bas que je dus me pencher pour l'entendre.
Et moi, que ressentirais-je pour Michael si j'étais moins insensible ? Ari est insensible : quand je pensais à moi, à cette époque, j'employais facilement la troisième personne. Ari est déprimée, Ari préfère rester seule, pensais-je.
Mais je m'oubliais dès que j'étais avec mon père. Je me rendis compte que l'écouter raconter son histoire était la meilleure façon pour moi d'accepter la mort de Kathleen.
À Savannah, ma mère habitait dans une maison en brique de trois étages, recouverte de glycine, aux volets verts et aux balcons en fer forgé. Son appartement était situé au deuxième et elle s'installait parfois avec mon père sur le balcon qui donnait sur le cimetière : ils bavardaient en buvant du vin.
Les gens du coin racontaient que le lieu était hanté. Une nuit où elle était seule, ma mère fut brusquement réveillée par la sensation d'une présence dans la pièce.
Elle en parla à mon père le lendemain au téléphone : «Je me sentais glacée jusqu'aux os alors que j'étais sous l'édredon et qu'il ne faisait pas froid. Il y avait comme une brume dans la pièce, qui ondulait à la lueur du réverbère. Puis elle a pris forme en se condensant. J'ai murmuré machinalement : «Dieu, protège-moi. Dieu, sauve-moi.» Quand j'ai ouvert les yeux, la chose avait disparu. Complètement disparu. Il faisait à nouveau bon dans la pièce et je me suis rendormie, rassurée. »
Mon père tenta de la réconforter, tout en pensant qu'elle fabulait - que son côté superstitieux lui jouait des tours.
La suite lui fit assez vite réviser son jugement
- Vous m'avez dit que ma mère était superstitieuse. En disant cela, je m'aperçus que je tripotais le petit sac de lavande accroché à mon cou et je retirai vivement mes mains.
- Elle l'était oui.
Mon geste ne lui avait pas échappé, et il savait que je pensais à Kathleen.
- Elle pensait par exemple que la couleur bleue et la lettre S portaient chance.
- La lettre S est bleue, dis-je.
- Elle n'était pas synesthète.
Je l'écoutai me raconter la visite du fantôme sans l'interrompre. Depuis cette nuit où j'avais vu Kathleen par la fenêtre, mon scepticisme était définitivement ébranlé.
Un week-end, mes parents remarquèrent une drôle d'odeur dans le salon de ma mère : ils avaient dîné dehors et venaient de rentrer. Ça sentait le moisi et la rouille.
Ils eurent beau aérer, l'odeur persista. Ils s'apprêtaient à aller se coucher quand une mince volute de fumée verte se mit à tourbillonner dans la chambre, comme un vortex, puis parut se solidifier, sans pour autant prendre une forme distincte.
Il faisait à présent froid dans la pièce : mon père serra ma mère dans ses bras tandis qu'ils observaient la chose. Ma mère finit par lancer : «Bonsoir, James.»
Comme démasquée, la fumée se dissipa, et quelques instants après il faisait à nouveau bon dans la pièce.
- Comment connais-tu son nom ?
- Il est revenu plusieurs fois, mais je ne t'en ai rien dit puisque tu ne m'as pas crue quand je t'ai parlé de sa première visite.
Ma mère était persuadée que cette chose était le fantôme d'un certain James Wilde, et le lendemain, elle conduisit mon père sur sa tombe, de l'autre côté de la rue.
Il y avait du vent, et la mousse espagnole, qui enveloppait les chênes verts du cimetière, semblait danser autour d'eux.
Mon père examina la pierre tombale tandis que ma mère récitait de mémoire :
Cette humble pierre
pour se souvenir de la piété filiale,
de la tendresse fraternelle et des vertus masculines de JAMES WILDE, écuyer, feu Intendant principal dans l'armée américaine.
Frappé dans un duel le 16 janvier 1815,
par la main d'un homme, qui, peu de temps auparavant, n'avait d'autre ami que lui ;
et décédé sur le coup dans sa 22e année :
il est mort comme il a vécu,
avec un courage inébranlable et une réputation sans faille.
Cette mort prématurée prive une mère
de son bâton de vieillesse,
anéantit tout espoir et tout réconfort pour ses sœurs, foule aux pieds l'honneur de ses frères, et laisse toute une famille, heureuse jusque-là,
submergée par le chagrin.
Mon père apprit plus tard que le frère de Wilde avait évoqué sa mort dans un poème, dont il me cita quelques lignes :
Ma vie est comme une rose d'été
Qui s'ouvre sous le ciel matinal,
Puis, avant que ne tombe la pénombre,
S'effeuille sur le sol - et meurt
Contrairement à ma mère, mon père n'était pas convaincu qu'il s'agissait bien du fantôme de Wilde.
J'ai ainsi pénétré dans un nouveau royaume, où les faits et la science n'expliquaient pas tout Chose qu'Edgar Allan Poe ne savait que trop : «Je pense que les démons profitent de la nuit pour tromper les imprudents - et ce, alors que, comme vous le savez, je ne crois pas en eux. » Tu te rappelles cette phrase ?
Je ne m'en souvenais pas.
Je ne compris que bien plus tard pourquoi mon père m'avait raconté cette histoire de fantôme et cité ces lignes : il voulait à la fois me distraire de la mort de ma meilleure amie et m'aider à l'accepter.
Chapitre 7
Mais je ne pouvais pas faire mon deuil avant de savoir qui l'avait tuée. Les McGarritt étaient bel et bien « une famille, heureuse jusque-là, submergée par le chagrin »et ils méritaient de savoir - nous le méritions tous - ce qui s'était réellement passé.
Je fus surprise, mais étrangement soulagée, quand mon père m'annonça, un jour atrocement froid de janvier, qu'un agent du FBI nous rendrait visite dans l'après-midi.
Il s'appelait Cecil Burton et c'était la première fois que nous recevions un Afro-Américain à la maison. C'est fou, non ? Mais souviens-toi que nous vivions comme des ermites à Saratoga Springs.
Mon père fît entrer Burton dans le salon. Il dégageait une odeur de tabac brun et d'eau de Cologne pour homme. Ce fut la première chose que je remarquai chez lui : il sentait bon et il me regardait comme s'il savait que je le pensais. Il portait un costume très bien coupé, qui mettait en valeur ses muscles, sans le serrer. Il ne devait pas avoir plus de trente-cinq ans, pourtant on lisait la lassitude dans ses yeux.
En une heure, il obtint de moi plus d'informations sur Kathleen que je croyais en détenir. Il me posa d'abord des questions élémentaires sur notre amitié : « Comment vous êtes-vous rencontrées ? Vous vous voyiez souvent ? » Puis ses questions se firent plus précises : «Tu savais qu'elle était jalouse de toi ? Depuis combien de temps sors-tu avec Michael ? »
Je répondis franchement à toutes ses questions, tout en pensant que cela ne servait à rien. Puis, tandis qu'il parlait, je tentai de deviner ce qu'il avait derrière la tête.
Je découvris que j'étais capable de lire certaines de ses pensées.
Tu regardes quelqu'un dans les yeux et c'est comme s'il te télégraphiait ses pensées : tu sais exactement ce qui lui traverse l'esprit à ce moment-là. Il n'est parfois même pas nécessaire de le regarder : se concentrer sur les mots qu’il prononce peut suffire à te donner accès à ses réflexions.
Burton nous soupçonnait d'être, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans le meurtre de Kathleen. Non pas qu'il eût la moindre preuve, mais il ne nous « sentait pas » (l'expression m'était inconnue). Il avait vérifié nos antécédents et ne cessait de s'y reporter mentalement, surtout quand il s'adressait à mon père. (Cambridge, hein ? Parti du jour au lendemain, il y a seize ans de ça. Quel âge a ce type ? On lui donne pas trente ans. Le mec doit se faire du Botox. Il est foutu comme un marathonien. Le bronzage en moins.)
- Et où se trouve Mrs Montero ? demanda-t-il à mon père.
- Nous sommes séparés. Je ne l'ai pas vue depuis des années.
Vérifier l'acte de divorce.
Voilà ce qu'il avait pensé et que j'avais entendu. Pourtant, à d'autres moments, je n'avais pas accès à ses réflexions.
Je jetai un œil vers mon père : son regard était éloquent Il savait ce que j'étais en train de faire et voulait que je cesse.
- De quoi avez-vous parlé avec Michael cette nuit-là, quand il t'a raccompagnée ?
Sa question interrompit ma réflexion.
- Oh, je ne me rappelle pas.
C'était mon premier mensonge et on aurait dit qu'il le savait
- Michael nous a dit que c'était devenu - son regard marron se fit plus flou - un peu chaud et sérieux.
En un instant, son regard redevint perçant
- Est-ce nécessaire ? demanda mon père d'une voix neutre, qui trahissait cependant un certain dégoût
- Oui, Mr Montero, je crois vraiment qu'il est nécessaire d'établir ce qu'Ariella a fait cette nuit-là.
J'aurais voulu savoir ce qu'il pensait mais je me retins. J'inclinai la tête et le dévisageai, sans parvenir à déchiffrer son regard.
- Nous nous sommes embrassés.
Après avoir raccompagné Burton à la porte, mon père revint au salon. Sans lui laisser le temps de s'asseoir, je lui demandai :
— Vous vous souvenez de Marmelade, la chatte du voisin ? Savez-vous qui l'a tuée ?
- Non.
Nous échangeâmes un regard méfiant, puis il quitta la pièce pour rejoindre le sous-sol.
Avait-il menti à Burton ? Et sinon, pourquoi n'était-il pas au salon quand j'étais rentrée cette nuit-là ? C'était un homme d'habitudes. Et s'il avait menti, alors où avait-il passé la nuit ?
Mais la vraie question qui me taraudait était celle-ci : mon père avait-il quelque chose à voir avec la mort de Kathleen ? Et même, mais je ne pouvais me résoudre à la formuler : L'avait-il assassinée ?
En une heure, Burton avait réussi, par ses questions, à altérer l'ambiance de la maison en y introduisant un élément inconnu jusque-là : la suspicion. Quand je montai l'escalier, tout me parut soudain étrange et mystérieux, presque sinistre : le bruit de mes pas sur les marches, la forme des coussins marocains sur le palier, et même les tableaux accrochés au mur.
J'allumai mon ordinateur et tapai le nom de Kathleen sur Internet. II n'y avait pas grand-chose de neuf, hormis un échange entre blogueurs, dont l'un affirmait que les rôlistes avaient tué Kathleen. Cela me paraissait tellement stupide que je m'abstins de lire leurs commentaires.
Sur un coup de tête, je tapai «Sara Stephenson»: j'obtins plus de 340 000 réponses, qui se réduisirent à 25 000 quand j'ajoutai « Savannah ». Je fis défiler plusieurs pages mais aucune n'associait «Sara» et «Stephenson» - les deux noms étaient mentionnés dans des contextes distincts.
En tapant « Raphaël Montera », j'atterris sur des sites consacrés à l'un des personnages de Zorro. Il se trouvait que « Montero » était aussi le nom d'un 4x4 de luxe.
Quel outrage !
J'abandonnai, je n'avais plus envie de réfléchir. L'exemplaire usé de Sur la route que Michael m'avait prêté traînait sur mon bureau et je décidai de le lire.
Une heure plus tard, éblouie par son style, je posai le livre. Kerouac traitait ses personnages d'une façon étrange — aucun des personnages féminins ne me semblait réaliste, et la plupart des personnages masculins paraissaient extrêmement idéalisés —, mais il avait l'art de faire des descriptions magnifiques, très précises, et presque lyriques à certains moments. Ce livre me donnait envie de voyager, de découvrir l'Amérique que Kerouac avait vue. Je sentais qu'un vaste monde m'attendait Peu importait la quantité de livres que je lirais ou de recherches Internet que je ferais : rien ne remplacerait l'enseignement de l'expérience.
Quand je redescendis, mes soupçons s'étaient dissipés et la maison avait retrouvé son aspect familier. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais même faim. Je fouillai les placards de la cuisine et trouvai une boîte de soupe à la crème d'asperges.
Je pris le lait dans le frigo, mais il datait de plusieurs semaines - c'est Mrs McG qui l'avait acheté -et il avait tourné. Je préparai donc ma soupe avec de l'eau.
Je la mis à chauffer et m'assis à table pour lire le livre de recettes de ma mère tout en faisant une liste de courses. C'était une première : jusque-là, Mrs McG s'était toujours occupée des courses.
Une fois la soupe prête, je la versai dans un bol. Il y avait un pot de miel dans le garde-manger et j'eus tout à coup l'idée d'en verser une grosse cuillerée dans le bol.
Mon père entra dans la cuisine pendant que je mangeais. Il regarda alternativement mon plat puis moi, et je devinai ce qu'il pensait : ma mère mettait du miel dans sa soupe.
Après le dîner, nous nous installâmes au salon et mon père reprit son récit, sans que j'aie à le lui demander.
L'année de ses vingt-sept ans, l'université de Cambridge lui proposa de diriger une recherche postdoctorale. Son ami Malcolm avait reçu la même proposition et ils firent en sorte que Dennis puisse les accompagner en tant qu'assistant. Mon père hésita, il ne voulait pas laisser ma mère. Elle exprima d'abord de l'inquiétude, avant d'insister pour qu'il accepte. « C'est une chance pour ta carrière », lui dit-elle.
Il partit donc. Après avoir réglé les formalités administratives, il déballa ses livres et ses vêtements dans son nouvel appartement.Il prit alors conscience de sa solitude.
Malcolm et Dennis avaient repris l'avion pour assister à une conférence au Japon ; il aurait pu les accompagner, mais il avait besoin de réfléchir.
Il avait une semaine devant lui avant le début du trimestre d'automne, et il décida d'en profiter pour visiter un peu l'Angleterre. Il passa d'abord quelques jours à Londres, puis il loua une voiture et prit la direction de la Cornouailles.
Il avait dans l'idée de trouver un endroit où il pourrait séjourner avec Sara quand elle viendrait le voir au printemps suivant. Il l'emmènerait d'abord à Berkshire, pour qu'elle puisse voir le site dont elle lui avait si souvent parlé - le cheval celtique creusé dans une colline de calcaire, près d'Uffington - puis ils continueraient leur route jusqu'en Cornouailles. Il trouva une auberge en haut d'une route sinueuse qui menait au village de pêcheurs de Polperro. Il y passa trois jours dans une des chambres situées tout en haut de la maison, à lire et à écouter le cri des mouettes qui tournaient au-dessus du port
Il allait tous les jours marcher le long des falaises. Il avait passé les cinq dernières années dans les salles de classe et les laboratoires et son corps avait grand besoin d'exercice. Et puis, cela lui remontait le moral. Ma mère lui manquait toujours autant mais il commençait à croire qu'il pourrait supporter cette séparation.
Sur le chemin du retour vers Cambridge, il s'arrêta à Glastonbury, une petite ville du Somerset dominée par le Tor, un mont sacré. Sara lui en avait parlé comme étant le lieu de rendez-vous des « penseurs alternatifs », un endroit qu'il devait visiter.
Trois choses étranges s'y produisirent
Mon père descendait Benedict Street quand un chien noir se jeta sous les roues d'une voiture ; le véhicule fit une embardée et percuta violemment le bord du trottoir, le pare-brise vola en éclats et les morceaux de verre se répandirent un peu partout. Mon père s'assura que les passants s'occupaient de la conductrice — penchée sur le volant, elle semblait plus sous le choc que blessée - puis reprit sa promenade, les bouts de verre crissant sous ses chaussures.
En voyant l'enseigne du café Blue Note, il pensa tout de suite à Sara, qui adorait le bleu. Selon elle, tous les noms dans lesquels figurait le mot bleu portaient chance. Il se vit l'emmener à Glastonbury au printemps, descendre avec elle Benedict Street et regarder son visage s'illuminer à la vue de l'enseigne. Il entra et, après avoir commandé un sandwich, il l'imagina assise en face de lui.
La femme qui avait pris sa commande lui avait dit qu'il « avait manqué le meilleur». Quelques instants avant, un client s'était déshabillé méthodiquement après avoir fini son repas, puis il avait entassé ses vêtements plies sur une chaise. Et elle lui montra la chaise et la petite pile de vêtements pliés. L'homme était ensuite sorti en courant et avait traversé la rue.
- Quelqu'un aura sûrement appelé la police.
L'incident était au centre des conversations et les convives s'accordaient pour dire que l'homme n'était pas d'ici.
- Ce doit être un fou
Son repas terminé, mon père régla la note et retourna vers le parking. En traversant une rue, il vit un aveugle approcher. Il était fort, plutôt gros, et complètement chauve. Il tapait de gauche à droite devant lui avec sa canne blanche. Comme il arrivait près de lui, mon père remarqua ses yeux tout blancs, comme si ses pupilles étaient passées de l'autre côté du globe oculaire. Une seconde avant qu'ils se croisent, l'homme tourna la tête vers mon père et lui sourit
Mon père ressentit comme une poussée d'adrénaline — et autre chose, qu'il n'avait jamais éprouvé. Il eut le sentiment d'avoir rencontré le Mal. Il accéléra le pas, puis jeta un œil par-dessus son épaule : l'homme avait disparu.
Sur la route du retour, il repensa à ces trois épisodes sans parvenir à en saisir la signification. Plus tard, devant Dennis et Malcolm, il évoqua en plaisantant cet homme qui faisait semblant d'être aveugle. Quand il leur dit qu'il avait rencontré le diable à Glastonbury, Dennis et Malcolm se moquèrent de lui. Il aurait voulu partager leur scepticisme.
Mon père marqua une pause.
- Vous croyez au diable ? lui demandai-je.
- Ce n'était pas une question de croyance. C'était une sensation instinctive, immédiate : j'avais rencontré le mal -un terme auquel je n'avais même jamais pensé, je crois.
Je voulais qu'il reprenne son récit qu'il me dise ce que j'avais le plus besoin de savoir. J'adorais le son de sa voix quand il prononçait le prénom de ma mère : Sara.
- Vous étiez différent à cette époque, il me semble, dis-je pour l'inciter à parler.
Vous faisiez de la marche, vous jouiez sur la plage... Vous n'étiez pas atteint - j'hésitai
- du lupus étant jeune ?
Il reposa son verre sur le plateau en marbre de la table en acajou.
- J'étais en pleine santé à l'époque. Je ne craignais pas le soleil, je ne me souciais pas de ce que je mangeais. J'étais fou amoureux de Sara et passionné par mon travail.
L'héritage de mon père me mettait à l'abri des problèmes d'argent L'avenir - il sourit d'un air narquois - s'annonçait radieux.
Un diable, plus terrible que celui qu'il avait croisé à Glastonbury, l'attendait à Cambridge.
Son directeur de recherche avait d'abord été le professeur A. G. Simpson, un homme doux et plutôt timide, dont les bonnes manières ne parvenaient pas à dissimuler l'intelligence. Ses recherches, pour lesquelles il percevait une allocation qui se chiffrait en millions de livres sterling, portaient sur les cellules souches.
Au bout de quelques mois, Malcolm et mon père furent courtisés — il n'y a pas d'autre mot - par John Redfern, un autre professeur du département d'hématologie.
Il travaillait sur la transfusion sanguine, et son laboratoire était associé aux actions de la Banque nationale du sang sur le campus d'Addenbrooke.
A ce moment du récit j'interrompis mon père
- Vous ne m'avez pas dit grand-chose sur Malcolm.
- C'était mon meilleur ami. Il était grand et je ne le dépassais que de quelques centimètres ; il avait les cheveux blonds, la raie sur le côté et une frange qui lui tombait sur le front. Sa peau très claire rosissait facilement dès qu'il était gêné ou en colère. Il était intelligent et plutôt beau garçon, de l'avis des femmes en tout cas. Mais il aimait jouer les misanthropes et les cyniques et n'avait pas beaucoup d'amis.
Un matin, Malcolm passa prendre mon père dans la voiture qu'il avait louée. Il portait une cravate et une chemise blanche sous son sempiternel gilet boutonné. Ils retrouvèrent Redfern dans un restaurant qu'ils ne connaissaient pas, à l'autre bout de la ville. C'était un endroit enfumé, rempli d'hommes d'affaires rougeauds attablés devant des assiettes de rosbif saignant accompagné de deux légumes.
Redfern se leva quand ils entrèrent et le silence se fit dans la salle, le temps pour l'assistance de dévisager les deux nouveaux venus. Ils étaient habitués à provoquer ce genre de réaction dans les lieux publics parce qu'ils n'avaient pas l'air anglais.
Redfern ne mesurait pas plus de 1 mètre 75, il avait les cheveux bruns et les yeux marron, un gros nez et le visage rougeaud. Il n'était pas beau et pourtant mon père le croisait toujours sur le campus en compagnie de très belles femmes.
Devant une bouteille de vin rouge et une assiette de viande également rouge, Redfern leur expliqua son projet. Il voulait créer une nouvelle entité de production afin d'élaborer une base de données des prélèvements sanguins utilisés pour dépister les maladies. Il insista sur le rôle que pourraient jouer Malcolm et mon père dans le développement de cette entreprise, et sur l'argent que cela leur rapporterait.
- C'est vrai qu'il n'y a que l'argent qui nous intéresse, fit Malcolm.
Redfern parut surpris par son ton méprisant
- Je croyais que les Amerloques avaient tous le goût du lucre, rétorqua-t-il.
(Je me rappelai qu'en latin lucrum signifiait avarice, et que, dans la langue courante, lucre désignait le profit, mais aussi l'enrichissement illicite.) Quoi qu'il en soit, Redfern se méprenait sur Malcolm et mon père. De l'argent, ils en avaient déjà plus que nécessaire : l'arrière-grand-père de Malcolm, John Lynch, avait fait fortune dans la sidérurgie aux États-Unis, et Malcolm était millionnaire.
Quant à mon père, sa fortune provenait de son père, un riche Allemand qui avait augmenté son capital grâce à des trafics en Amérique latine, après la Seconde Guerre mondiale.
Au-dessus des assiettes pleines de sang et de la nappe tachée, les yeux de Redfern lançaient des éclairs. La seconde d'après, il prit un air triste et suppliant.
- Je vous laisse réfléchir à ma proposition, dit-il avec humilité.
Ils le laissèrent payer l'addition et se moquèrent de lui sur le trajet du retour.
Je m'agitai sur ma chaise.
- Tu as sommeil ? me demanda mon père.
Je n'en savais rien, j'avais perdu la notion du temps.
- Non, répondis-je, j'ai juste besoin de me dégourdir les jambes.
- Peut-être devrions-nous en rester là pour ce soir, dit-il, une pointe d'impatience dans la voix.
- Non, je veux que vous me racontiez tout
- Tu en es sûre ? Je ne voudrais pas te faire de la peine.
- Je crois que plus rien ne me fera jamais de peine.
Quelques jours après le fameux déjeuner, mon père croisa Redfern par hasard alors qu'il se baladait dans le centre-ville. Il était accompagné d'une grande Suédoise qui travaillait dans le laboratoire de Cavendish. Ils se saluèrent et mon père se sentit soudain comme paralysé.
Ses jambes ne répondaient plus, ses yeux restaient accrochés à ceux de Redfern et il ne parvenait pas à regarder ailleurs.
Redfern souriait. Mon père tenta de nouveau de diriger son regard vers la femme. Mais ses yeux restèrent fixés sur ceux de Redfern.
Il ne retrouva l'usage de ses membres qu'au bout d'une longue minute. Il observa alternativement la femme et Redfern, qui évita son regard.
- On se reverra bientôt dit Redfern.
Mon père aurait voulu s'enfuir en courant au lieu de quoi il descendit lentement la rue, poursuivi par leurs rires. Une semaine plus tard, Malcolm appela mon père pour l'inviter à venir prendre le thé chez lui, mais celui-ci était trop occupé.
- J'ai vu une hémoglobine incroyable aujourd'hui, lui dit Malcolm.
Malcolm n'était pas du genre à employer le mot «incroyable » à la légère et cela suffît à éveiller la curiosité de mon père.
En montant l'escalier jusqu'à l'appartement de Malcolm, il fut frappé par la forte odeur de toasts brûlés. Personne ne répondit quand il frappa à la porte. Elle n'était pas fermée à clé, il décida d'entrer.
Un feu brûlait comme d'habitude dans la cheminée ; Redfern était penché au-dessus, tenant à la main un tisonnier au bout duquel brûlait un morceau de pain carbonisé.
- J'aime les toasts brûlés, expliqua-t-il sans se retourner. Pas vous ?
Malcolm ne semblait pas être là.
Redfern invita mon père à s'asseoir. Ce qu'il fit, bien qu'il eût préféré partir. Outre celle du pain brûlé, il perçut une autre odeur déplaisante.
Redfern se mit à lui parler et mon père le trouva tour à tour génial et idiot D'après mon père, l'adjectif « génial » était employé à tort et à travers à Cambridge - et sans doute aussi dans la plupart des grandes universités de recherche. Le monde universitaire le faisait penser à un cirque miteux. Les professeurs étaient semblables à des animaux mal nourris, lassés de tourner en rond dans une cage - qui n'était de toute façon jamais assez grande -, et qui répondaient mollement aux coups de fouet Les trapézistes tombaient avec une régularité monotone dans des filets mal fixés. Les clowns avaient l'air affamés, le chapiteau prenait l'eau, le public peu attentif se manifestait en criant de manière intempestive. Et à la fin du spectacle, personne n'avait le sourire.
(Mon père avait parfois recours à ce genre de métaphore filée, et je le soupçonnais de le faire autant par amusement que par souci de clarté. Mais j'avais bien aimé cette image du cirque miteux et c'est pourquoi je la retranscris ici.) Mon père observa Redfern arpenter la pièce en discutant philosophie - et de tout autre chose. Il voulait en savoir plus sur les principes moraux de mon père, mais lui exposa les siens sans lui laisser le temps de répondre.
Il se voyait comme un utilitariste.
- Admettez-vous que le seul devoir de l'homme est d'obtenir le plus de plaisir possible ?
- Uniquement si le plaisir obtenu entraîne une égale diminution de la souffrance, répondit mon père en croisant les bras. Et si le plaisir d'une seule personne n'est pas jugé plus important que celui de n'importe quelle autre.
Le visage de Redfern paraissait encore plus rouge à la lumière du feu et mon père le trouva particulièrement laid.
- Bien, alors vous admettez que la quantité de plaisir ou de douleur résultant d'une action est un critère décisif pour déterminer la conduite à tenir.
Mon père approuva, tout en ayant l'impression d'assister à un cours de morale en dix leçons.
- Beaucoup d'actes sont répréhensibles parce qu'ils sont source de souffrance, poursuivit Redfern en agitant le tisonnier et son bout de pain noirci. Vous êtes d'accord ? Et s'il était démontré qu'un acte donné puisse causer une souffrance, cela serait une raison suffisante pour ne pas l'accomplir.
À cet instant, mon père perçut un mouvement dans la pièce, quelque part derrière lui. Il se retourna mais ne vit rien. L'odeur écœurante sembla s'intensifier.
- Il s'ensuit alors qu'il est parfois nécessaire d'infliger une souffrance pour éviter une souffrance future plus grande encore, ou pour s'assurer un plaisir futur qui justifie la souffrance actuelle.
Mon père regardait Redfern dans les yeux, essayant de deviner où il voulait en venir, quand Malcolm surgit derrière lui, tira la tête de mon père en arrière et lui enfonça les dents dans le cou.
- Qu'avez-vous ressenti ?
- Tu n'éprouves pas de dégoût à m'entendre raconter cela ?
J'étais à la fois excitée et engourdie.
- Vous avez promis de tout me raconter.
Il ressentit une douleur cuisante, bien plus violente que tout ce qu'il avait connu, et se débattit en vain.
Malcolm l'enlaçait gauchement - une étreinte que mon père aurait qualifiée d'impensable s'il avait été capable de penser. Il essaya de tourner la tête pour voir le visage de Malcolm - puis il s'évanouit sans doute, non sans avoir eu le temps d'apercevoir Redfern qui, du fond de la pièce, observait la scène avec un plaisir évident. Quand mon père recouvra ses esprits, il était étendu en travers du canapé. Il se passa la main sur le visage : elle était noire de sang séché. Ses amis n'étaient plus là.
Il se redressa : sa tête lui semblait lourde et enflée, et ses membres faibles, il n'avait qu'une envie, partir en courant. Le feu s'était éteint et il faisait froid dans la pièce, même si l'odeur de pain brûlé persistait. Tout comme cet effluve qu'il ne parvenait toujours pas à identifier, et qui lui semblait à présent presque appétissant de même que ce goût nouveau de cuivre dans la bouche.
Il avait des frissons. Il se sentait vidé, et cependant ses veines lui paraissaient gorgées d'une sorte d'adrénaline. Il réussit à se lever et à marcher jusqu'aux toilettes. Il se regarda dans le vieux miroir accroché au-dessus du lavabo : il avait une blessure dans le cou et une croûte de sang autour de la bouche. Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête comme le choc du métal contre le métal.
En face des toilettes, il y avait une porte fermée d'où semblait provenir l'odeur inconnue. Mon père pensa qu'il devait y avoir un truc mort dans cette pièce.
Il descendait l'escalier quand il aperçut en bas Redfern et Malcolm. Il s'arrêta sur le palier et les regarda monter.
Malgré la honte, la colère et le désir de vengeance qu'il éprouvait, il resta planté là à les attendre. Redfern lui fit un signe de tête et Malcolm le regarda brièvement avant de détourner les yeux. Ses cheveux lui tombaient sur les yeux et il avait le visage tout rose comme s'il venait de le frotter, le regard terne et indifférent, et il n'exhalait aucune odeur.
- Je n'ai pas à me justifier, dit-il comme si mon père le lui avait demandé. Mais un jour, tu réaliseras que c'était pour ton bien.
Redfern secoua la tête puis continua de monter l'escalier en marmonnant : «Ces Américains... Totalement dépourvus d'ironie. »
- Saviez-vous ce que vous étiez devenu ?
- Je m'en doutais. J'avais vu des films et lu des livres - mais c'était de la fiction pour moi. Et d'ailleurs, une bonne partie s'est révélée fausse.
- Pouvez-vous vous transformer en chauve-souris ?
Il me fit son regard déçu.
- Non, Ari, ce n'est que du folklore. J'aimerais beaucoup que ce soit vrai parce que j'adorerais pouvoir voler.
Je m'apprêtais à lui poser une autre question mais il ne m'en laissa pas le temps.
- Tu as besoin de dormir. Je te raconterai la suite demain.
Je m'aperçus alors que mes jambes avaient déjà trouvé le sommeil. L'horloge antique sonna le quart d'heure : il était minuit quinze. Je secouai mes jambes et me levai lentement
- Père, en suis-je un aussi ?
Il savait de quoi je voulais parler.
- Ça m'en a de plus en plus l'air.
Chapitre 8
- Il y a très peu de vrai dans ce que les gens racontent sur nous, me dit mon père le lendemain après-midi. N'écoute jamais ceux qui se prétendent experts en vampires.
Ce ne sont souvent que des poseurs à l'imagination morbide.
Nous avions de nouveau délaissé la bibliothèque pour le salon. Je m'étais préparée à notre rendez-vous - tout au moins le croyais-je - en apportant toute la documentation sur le mode de vie des vampires que j'avais pu trouver sur Internet et que j'avais soigneusement recopiée dans mon journal. Mon père parcourut quelques pages et secoua la tête.
- Tout cela est écrit par des idiots bien intentionnés. Il faudrait que les vampires rétablissent les faits. Quelques-uns l'ont déjà fait et j'aime à penser que d'autres prendront le relais, au fur et à mesure que nous apprendrons à mieux accepter notre condition.
- Et les pieux dans le cœur ?
Il fronça les sourcils, une moue de dédain sur les lèvres.
- N'importe qui mourrait si on lui plantait un pieu dans le cœur, ou s'il était très grièvement brûlé, même un vampire. Mais le fait de dormir dans des cercueils, les coutumes mélodramatiques, le besoin de nouvelles victimes -tout cela n'est que foutaises.
D'après lui, on compte des centaines de miniers, peut-être même des millions, de vampires dans le monde. Il n'y a aucune certitude quant à leur nombre : il faut dire qu'il y a peu de chances que la question figure un jour sur les formulaires de recensement. La plupart vivent une vie plutôt normale, une fois qu'ils ont trouvé le moyen de satisfaire leurs besoins spécifiques - d'ailleurs pas si différents des personnes qui souffrent d'une maladie chronique.
- Comme le lupus, hasardai-je.
- Je t'ai menti à ce sujet Ari, et je te prie de m'en excuser. C'est la fable que je me suis inventée pour donner le change dans ce monde. J'aurais voulu te dire la vérité, mais j'ai estimé qu'il valait mieux attendre que tu sois plus âgée. Je pensais que c'était tout aussi bien que tu me croies atteint du lupus s'il apparaissait que tu étais mortelle.
Et si tu ne l'étais pas... A dire vrai, une partie de moi était persuadée que tu savais depuis le départ que je n'avais pas le lupus.
Selon lui cependant, le vampirisme est sous certains aspects, comparable au lupus
- sensibilité à la lumière du soleil, douleurs articulaires et migraines fréquentes. Certains médicaments et suppléments alimentaires, prescrits aux personnes atteintes de lupus, sont également efficaces sur les vampires, en particulier pour réguler leur système immunitaire. Seradrone avait développé des suppléments sanguins, utilisés par les vampires comme par les personnes atteintes du lupus, dérivés de ses recherches dans le domaine du sang artificiel.
- Nous sommes en train de développer de nouveaux médicaments spécialement adaptés aux vampires. L'an dernier, nous avons commencé à mener des essais cliniques sur un nouvel hybride appelé Complexe méridien. Il permet d'augmenter la tolérance à la lumière du soleil et d'inhiber l'appétence pour le sang.
Cette idée me mettait mal à l'aise et il dut s'en apercevoir parce qu'il me regarda avec bienveillance.
- Cet aspect de la légende est, malheureusement, exact
- Avez-vous tué ma mère ? lui demandai-je sans réfléchir. J'avais de plus en plus tendance à formuler mes pensées à voix haute.
- Bien sûr que non.
Il prit de nouveau son air déçu.
- Avez-vous déjà bu son sang ?
- Tu m'as promis d'être patiente.
Les gens emploient des mots ridicules pour qualifier notre état mais le terme vampirisme a la préférence de mon père, bien qu'il tire son origine de l'histoire slave la plus sombre. Il existe d'autres termes pour désigner le fait de devenir vampire : les rôlistes parlent d'« étreinte », d'autres de «transformation» ou de «renaissance».
- On ne naît qu'une fois, remarqua mon père, et je le regrette.
Pour sa part, il préférait parler d'un «changement d'état».
- Cela rend malade pendant un certain temps. J'essayai en vain d'imaginer ce qu'il avait ressenti. Puis je me mis subitement à imaginer ce que cela ferait de le mordre -oui, de mordre mon propre père dans le COU. Quel goût son sang pouvait-il bien avoir ?
Il me regarda d'un œil noir et menaçant, et je m'empressai de m'excuser.
Après un silence gêné, il me dit :
- Je vais te raconter comment c'est.
Il resta couché pendant des jours, dans un demi-sommeil, trop faible pour faire quoi que ce soit d'autre.
Malcolm passait le nourrir quotidiennement. La première fois fut la plus horrible : il entra, sortit de la poche de son manteau un couteau au manche en ivoire et sans autre cérémonie, s'ouvrit les veines du poignet. Il força mon père à poser ses lèvres sur la blessure, qu'il se mit à téter comme un nourrisson.
Il se sentait plus vigoureux après chaque repas, tout en se promettant de ne jamais recommencer. Mais il n'avait pas encore assez de forces pour résister à Malcolm.
Dennis rendit visite à mon père un après-midi, alors que Malcolm était en train de le nourrir.
Selon la légende, sucer le sang des autres est une expérience assez érotique. Mon père admit qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans : il ressentait en buvant une sorte de plaisir écœurant
Dennis sembla à la fois choqué et dégoûté. Malgré un fort sentiment de honte, mon père continua de sucer. Une fois qu'il fut rassasié et que Malcolm eut retiré son bras, ils levèrent tous deux les yeux sur Dennis, dont l'expression était devenue suppliante.
Malcolm ouvrit la bouche. Devinant qu'il allait sauter sur Dennis, mon père hurla « Non» de toutes ses forces.
Malcolm poussa comme un rugissement.
— Je peux vous aider, plaida Dennis. Vous aider tous les deux.
Les cinq jours suivants prouvèrent à mon père que Dennis était son meilleur ami.
Mon père restait au lit, délirant par moments à la fois de faim et de colère contre Malcolm. Il rêvait de le tuer. À cette époque, il ne connaissait pas grand-chose au vampirisme, en dehors des romans et des films. Il avait demandé à Dennis de lui fournir des pieux en bois et un maillet
À la place, Dennis lui rapporta du sang de l'hôpital. S'il n'avait pas les mêmes vertus que celui de Malcolm, il se révéla néanmoins plus digeste. Mon père se sentait moins vigoureux après les transfusions, mais aussi moins agité. Dennis l'informa des recherches en cours sur l'élaboration de sang artificiel et sur des hormones stimulant la production de globules rouges par la moelle osseuse. Ensemble, ils mirent ainsi au point un protocole de survie permettant de se passer de sang humain.
C'est pendant cette période que Dennis fit découvrir à mon père les écrits du Mahatma Gandhi et du dalaï-lama, en lui lisant des passages de leur autobiographie.
Tous deux accordaient une importance suprême à la bonté et à la compassion. Gandhi dénonçait la futilité de la vengeance et vantait les mérites de la non-violence ; quant au dalaï-lama, il écrivait ceci : «En matière de tolérance, notre ennemi est notre meilleur professeur. »
Je ne compris pas d'emblée cette dernière phrase.
- Je crois que je vois ce qu'il voulait dire, fis-je après quelques minutes de réflexion
- J'ai mis moi aussi un peu de temps à saisir la portée de cette phrase, mais par la suite elle m'a procuré un réconfort inestimable. J'avais l'impression que ces vérités avaient toujours été les miennes, mais ce n'est qu'après les avoir entendues qu'elles devinrent pour moi comme un fil conducteur. Quand Malcolm revint, je lui dis que je ne me soumettrais plus à ce cannibalisme absurde. Grâce à Dennis, j'avais repris assez de forces pour retourner à mes études et vivre avec ma maladie.
- Malcolm vous a laissé tranquille ?
- Oui, il a fini par me laisser tranquille, mais non sans avoir essayé de me convaincre d'intégrer son labo, arguant que grâce à lui j'avais désormais la chance de pouvoir vivre à jamais. Mais le vampirisme ne garantit pas la vie éternelle. Contrairement à ce que raconte la documentation que tu m'as apportée, seul un petit pourcentage de ceux qui ont changé d'état vivent au-delà de cent ans. Beaucoup d'entre eux se font tuer en agissant de façon agressive et provocante. Et ils meurent dans les mêmes douleurs que les mortels.
- Mais il existe sûrement des compensations ?
Les mains jointes sous le menton, mon père me regarda et je lus dans ses yeux un sentiment très proche de l'amour, que je n'y avais jamais vu.
- Oui, Ari, dit-il d'une voix douce. Comme je te l'ai déjà dit, il y a en effet des compensations.
Mon père s'interrompit pour aller répondre aux coups frappés à la porte. Quelqu'un - Root probablement - lui tendit deux verres de Picardo sur un plateau d'argent Il referma la porte et me présenta le plateau.
- Prends celui de gauche.
Une autre première, pensai-je en attrapant le verre. Mon père posa le plateau, prit l'autre verre et le leva pour porter un toast :
- Gaudeamus igitur juvenes dura sumus.
- Réjouissons-nous tant que nous sommes jeunes, traduisis-je. Je ferai graver cette phrase sur ma tombe.
- Moi aussi.
C'était la première fois que nous riions ensemble d'une plaisanterie. Nous trinquâmes avant de boire.
Ce truc avait un goût horrible et ma grimace le fit presque rire.
- Encore une chose qu'il va te falloir apprendre à Apprécier, dit-il
- Ou pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
Il fit tournoyer le liquide rouge dans son verre.
- C'est un apéritif, du latin aperite.
- Ouvrir.
- C'est exact : pour ouvrir l'appétit chatouiller les papilles avant un repas. Les premiers apéritifs étaient faits à base d'herbes, d'épices, de racines et de fruits.
- Qu'est-ce qui lui donne cette couleur rouge ? Mon père posa son verre.
- La famille Picardo en garde la recette secrète.
Mon père reprit son récit tandis que nous sirotions notre cocktail. Ceux qui subissent un « changement d'état», selon la formule de mon père, prennent immédiatement conscience de leur nouvelle nature. Mais le statut d'un enfant né d'un vampire et d'une mortelle est indéterminé.
- J'ai lu des récits atroces sur des parents qui exposaient leur enfant hybride au soleil, attaché par des cordes et des pieux, et attendaient de voir s'il brûlait. Alors même que la photosensibilité n'est pas un indice fiable de vampirisme. Tout comme dans la population générale, la sensibilité au soleil peut énormément varier d'un individu à l'autre.
Je n'étais pas sûre d'apprécier le terme hybride.
- J'ai utilisé le terme originel, aujourd'hui on parlerait plutôt de métis.
Je bus une petite gorgée de Picardo, m'efforçant de faire abstraction du goût.
- Il n'existe pas de test sanguin pour savoir si l'on est ou non un vampire ?
- Non, pas de test fiable.
Il croisa les bras sur sa poitrine et je me surpris à examiner les muscles de son cou.
Mon père m'expliqua qu'il y avait des vampires partout, dans tous les pays et dans toutes les professions. Ils sont nombreux à être attirés par la recherche scientifique, et particulièrement dans le domaine sanguin - ce qui n'a rien de surprenant ; mais certains sont enseignants, avocats, fermiers, politiciens. Deux députés américains étaient même soupçonnés d'être des vampires ; et d'après des rumeurs du Web, l'un d'eux envisageait de « sortir de sa boîte » - un euphémisme pour désigner le fait de reconnaître publiquement son statut de vampire.
- Mais je ne crois pas qu'il le fasse de sitôt. Les Américains ne sont pas prêts à considérer les vampires comme des citoyens comme les autres. Ils ne connaissent que les mythes relayés par les romans et les films, dit-il en prenant mon journal pour le reposer ensuite. Et par Internet. Je pris une profonde inspiration.
- Et les miroirs ? Et les photographies ?
- Je me demandais quand tu allais me poser la question.
Il me fit signe de le suivre vers la vitrine fixée au mur. Nous nous plantâmes devant. Je ne compris pas tout de suite où il voulait en venir. Puis je découvris mon reflet indistinct sur la vitre bombée. Ne voyant pas celui de mon père, je me retournai pour vérifier qu'il était toujours là.
- C'est un mécanisme de protection que nous appelons immutation. Les vampires immutent plus ou moins. Nous sommes capables de nous rendre invisibles aux yeux des humains ou de rendre notre image partielle ou floue en empêchant les électrons de notre corps d'absorber la lumière. C'est un procédé volontaire qui devient un réflexe Involontaire au fil du temps. Quand ton amie a voulu me prendre en photo, mes électrons se sont bloqués, laissant la lumière de la pièce - ou plus exactement les radiations électromagnétiques - passer à travers mon corps.
Je réfléchis un instant
- Pourquoi vos vêtements n'apparaissaient-ils pas sur la photo ? Et pas non plus sur cette vitre ?
- Mes vêtements et mes chaussures sont fabriqués avec des métamatériaux, m'expliqua-t-il. Les fibres du tissu contiennent du métal, parce que le métal renvoie très bien la lumière ; c'est d'ailleurs pour cela qu'il est utilisé dans la fabrication des miroirs. Quand mes électrons se bloquent la température de ma peau augmente, la structure microscopique du tissu se modifie, et lui permet de dévier la lumière, qui ondoie autour de moi. Ainsi, quand les ondes électromagnétiques atteignent mon corps, elles ne produisent ni reflet ni ombre.
- C'est cool, fis-je machinalement
- Certains tailleurs britanniques sont de vrais magiciens, ajouta-t-il. Quoi qu'il en soit l'invisibilité est une des compensations de cette maladie, si on veut l'appeler ainsi. Avec le fait d'avoir accès aux meilleurs tailleurs du monde.
- C'est une maladie, selon vous ? demandai-je en scrutant dans le miroir l'endroit où son reflet aurait dû apparaître.
Il me laissa observer le miroir un moment, avant de retourner s'asseoir.
- L'hématophagie n'est pas le seul élément. Notre condition, si tu veux, a plus à voir avec la physique - conversion énergétique, modification de la température, de la pression et des mouvements des molécules. Nous avons besoin de sang de mammifère, ou de bons substituts, pour le supporter. Pour survivre, de petites quantités nous suffisent - j'en ai fait l'expérience - mais nous nous affaiblissons si nous ne nous nourrissons pas.
J'approuvai d'un signe de tête : j'avais faim.
Je m'efforçai de manger mon repas (ma première tentative de lasagnes végétariennes n'était pas convaincante), tandis que mon père évoquait les bons côtés du vampirisme en sirotant un autre cocktail.
- Avant mon changement de statut tout m'avait semblé aller de soi, mais le présent me paraissait désormais extraordinaire. Mes sens devinrent cent fois plus aiguisés.
Malcolm m'avait conseillé d'appréhender le monde à petites doses, afin d'éviter qu'il me submerge. Cette nouvelle acuité sensorielle peut se comparer à celle que provoque la prise de LSD.
Je posai ma fourchette.
- Vous avez déjà pris du LSD ?
- Non, mais Malcolm m'a fait part de son expérience, et d'après lui c'est comparable. Le quotidien prend une apparence et une signification nouvelles. Traverser la chapelle de King's Collège alors que l'orgue jouait c'était presque plus que ses sens ne pouvaient supporter. Les couleurs étaient devenues lumineuses, les sons incroyablement purs et vrais; et puis tous ses sens se conjuguaient ce qui fait qu'il pouvait à la fois goûter la texture des murs en pierre, toucher le parfum de l'encens, et voir le son du carillon.
- Cela m'arrive à moi aussi.
- C'est vrai, tu m'as dit un jour que les mercredis étaient toujours gris argent alors que les mardis étaient lavande.
Tandis qu'il parlait, je contemplai sa chemise, à la fois tricolore - bleu, vert et noir- et incolore.
- Je devins également sensible aux motifs. D'après Malcolm, ce n'est pas le cas pour tous les vampires. Certains dessins - comme le cachemire ou les motifs élaborés des tapis orientaux - ont la capacité de m'hypnotiser, à moins que je détourne le regard. Une complexité gratuite - qui n'a pas de raison d'être - retient mon attention, m'obligeant à rechercher une anomalie inexistante. C'est apparemment lié à ma difficulté à ouvrir les choses, comme une forme de dyslexie. Tu as déjà vécu cela ?
- Non.
Je venais de comprendre pourquoi tous les tissus de la maison étaient unis, et pourquoi les poignées de portes étaient énormes.
- Et les changements d'apparence ?
- Encore un mythe. Comme je te l'ai expliqué, je peux devenir invisible. Je peux aussi lire dans les pensées – pas toujours, mais la plupart du temps. Et je peux également - il fit un geste dédaigneux de la main - hypnotiser les autres. Mais toi aussi, comme beaucoup d'êtres humains. On raconte que Freud pouvait se faire obéir de la tablée familiale d'un simple mouvement de son sourcil gauche.
- Freud était un des nôtres ?
- Mon Dieu, non. Freud est le père de la psychanalyse. Tout vampire qui se respecte refuse d'en entendre parler.
Je relevai la tête de mon assiette et perçus une lueur d'humour dans ses yeux.
- Je ne considère pas ces dons comme des avantages, mais plutôt comme des capacités inhabituelles dont j'ai choisi de me servir le moins possible. Les avantages réels sont les plus évidents - ne pas vieillir et profiter d'une longévité potentiellement infinie, l'invulnérabilité à de multiples risques et maladies, ainsi qu'une capacité à se rétablir rapidement quand nous contractons les rares auxquels nous sommes vulnérables.
Je repoussai mon assiette.
- Qui sont.. ?
- L’erlthema solare - ou coup de soleil ; le feu, et les lésions sévères au cœur.
- Père, suis-je mortelle ou pas ?
- Une partie de toi l'est bien sûr.
Il prit son verre en coupe dans sa main. Il avait des mains puissantes, sans être carrées, et de longs doigts.
- Nous ne pouvons pas déterminer à quel point pour le moment. La question se résoudra d'elle-même, avec l'âge. L'hérédité n'est pas qu'une question d'ADN, tu sais.
Les caractères se transmettent aussi à travers le comportement et la communication symbolique, qui inclut le langage.
- Avec l'âge, répétai-je, cela veut-il dire que je suis mortelle - le fait que j'évolue avec l'âge, alors que vous restez exactement le même ?
Il posa son verre avant de me répondre.
- Il est vrai que, jusque-là, tu as grandi comme n'importe quel mortel. Viendra peut-être un moment où tu choisiras...
Il marqua une pause, une expression familière de tristesse apparut sur son visage et je lus presque du désespoir dans ses yeux.
- ... où tu choisiras - ou ce choix sera fait pour toi - d'arrêter de vieillir.
- J'ai le choix ?
Je n'avais pas envisagé cette hypothèse.
- Oui, tu as le choix.
Il grimaça en regardant mon assiette.
- Ton repas refroidit à force de me poser des questions. Je ne relevai pas.
- J'ai tant d'autres questions à vous poser. Comment est-ce possible d'avoir le choix ? Et qu'est-il arrivé à ma mère ? Est-elle morte ?
Il leva la main.
- Trop de questions. J'y répondrai, mais pas comme cela, au coup par coup. Je vais d'abord te raconter ce qui s'est passé entre ta mère et moi, d'accord ? Ensuite, comme je te l'ai déjà expliqué, tu seras capable de répondre toi-même à ces grandes questions.
Je repris ma fourchette, et lui son récit
Malcolm assura à mon père qu'il aurait une vie bien meilleure qu'auparavant
- Nous ne vieillissons pas, avait-il dit Nous pouvons survivre à tout : aux accidents de voiture, au cancer, au terrorisme, aux multiples petites horreurs sans importance de la vie sociale. Nous persistons à exister en dépit des obstacles. Nous finissons toujours par l'emporter.
Dans la culture occidentale, vieillir implique de voir ses facultés diminuer. D'après Malcolm, les vampires seraient à l'abri de la douleur — et de l'amour, la malédiction des mortels. Ils pouvaient vivre en faisant abstraction de l’éphéméra, comme il l'appelait : des problèmes ponctuels liés la personnalité des mortels et à la politique, dont personne ne se souviendra au bout du compte. Malcolm parlait des mortels comme s'ils étaient les pires ennemis des vampires. «La vie sur terre serait bien plus agréable si la race humaine disparaissait», disait-il.
Je bus une autre gorgée de Picardo, et ressentis des picotements à travers tout le corps.
- Vous êtes d'accord avec cela ?
- J'aurais parfois tendance à l'être, répondit-il en agitant la main vers la fenêtre aux rideaux tirés. On croise dans ce monde tant de souffrances inutiles, tant de cupidité et de malveillance. La maltraitance et le meurtre des gens et des animaux - inutiles et pourtant si banals. Les vampires - certains d'entre nous du moins - sont très conscients de la laideur du monde. Nous ressemblons un peu à Dieu de ce point de vue. Tu te rappelles ce que disait Spinoza, que, pour appréhender les choses comme Dieu lui-même, Il faut le faire sous l'angle de l'éternité ? - Mais nous ne croyons pas en Dieu, n'est-ce pas ? - On ne sait jamais, fît-il en souriant Malcolm avait passé sous silence les aspects négatifs : le besoin, impérieux de se nourrir, les sautes d'humeur, la sensibilité excessive et tout ce qu'implique cette nouvelle vie du point de vue moral.
Au début mon père se voyait comme un cannibale. Au fil du temps, il put vérifier la pertinence des propos de Bertrand Russell : si l'on met de l'ordre dans son esprit le bonheur devient accessible, même à un autre.
Malcolm raconta à mon père qu'une nuit il avait appelé Sara dans un demi-sommeil. Il lui conseilla de ne plus jamais la revoir.
- Il y a quelque chose que tu ne sais pas, lui expliqua-t-il. Des vampires ont essayé de vivre avec des mortels, et cela n'a jamais fonctionné. Tu n'as pas d'autre solution que de la mordre : tu pourrais l'utiliser comme donneuse, à condition de ne jamais la laisser te mordre. Personnellement ça ne me plairait pas que tu permettes à une femme de devenir une des nôtres.
Malcolm était à demi étendu sur le canapé de mon père, tel un personnage d'une pièce d'Oscar Wilde - le type même du misanthrope.
À l'époque, mon père songea que Malcolm avait peut-être raison - rompre avec Sara était sans doute la chose la plus généreuse à faire. Il se rongeait les sangs pour savoir comment lui expliquer ce qui s'était passé. Comment lui annoncer cela ? Quel genre de lettre fallait-il écrire ?
Ma mère n'était pas à proprement parler pieuse, mais elle croyait qu'il existait un dieu parmi beaucoup d'autres, qu'elle pouvait prier dans les moments difficiles. Le reste du temps, elle n'y pensait pas, comme la plupart des mortels. Mon père craignait que la nouvelle déclenche chez elle une réaction irrationnelle. Il envisagea de rompre tout contact avec elle - de déménager dans un lieu où elle ne le retrouverait jamais.
Mais il commença à considérer différemment la question quand Dennis prit le relais de Malcolm comme garde-malade. D'autres solutions existaient peut-être. Il était en tout cas évident que cela ne pouvait pas se régler par lettre. Peu importait ce qu'il écrirait, elle ne le croirait pas - et elle méritait une explication de vive voix.
Certains jours, comme il recouvrait des forces, il pensait que ma mère et lui seraient capables de tenir le coup. Mais la plupart du temps, il restait convaincu du contraire. Malcolm lui avait fait des récits étranges pendant qu'il était alité, et il était persuadé que l'union d'un vampire et d'une mortelle était vouée à l'échec.
De sorte qu'il décida de ne rien dire à ma mère pour le moment. C'est Dennis qui, étonnamment aborda la question.
- Que vas-tu dire à Sara ?
- Je lui raconterai tout dès que je la verrai.
- N'est-ce pas risqué ?
Dennis en avait-il parlé à Malcolm ? En regardant son ami - son visage taché de son, ses grands yeux marron -, mon père prit une nouvelle fois conscience de tout ce que Dennis avait fait pour lui. Il tenait dans sa main une ampoule de sang qu'il se préparait à lui injecter.
- Qu'est-ce qu'une vie sans prise de risque, si ce n'est de la mauvaise foi ?
Mon père me rappela que la mauvaise foi était littéralement, un défaut de croyance.
- Il faudrait que nous passions un peu plus de temps sur les existentialistes, tu ne crois pas ?
- Père, je serais ravie de passer plus de temps sur les existentialistes, et j'apprécie que vous me donniez tous ces détails. Vraiment. Mais je ne supporte pas l'idée d'aller me coucher ce soir sans savoir ce qu'est devenue ma mère, ni si je vais ou non mourir un jour.
Il s'agita sur sa chaise en regardant mon assiette, vide à présent
- Passons dans le salon, alors, et je te raconterai la suite.
Au bout du compte, mon père n'eut pas à trancher. Il suffit d'un regard à l'aéroport pour qu'elle lui dise :
- Tu as changé.
Plutôt que de retourner avec elle à Cambridge, mon père l'amena à l'hôtel Ritz de Londres, où ils passèrent cinq jours à essayer de trouver un accord. Sara avait fait sa valise avec soin ; elle avait un style bien à elle, et mon père se souvenait notamment d'une robe en mousseline verte plissée comme une laitue romaine.
Mais elle n'eut pas l'occasion de s'habiller chic. Au lieu d'aller au théâtre, ou de descendre simplement prendre le thé, ils ne bougèrent pas de leur suite, y prenant leurs repas et se disputant âprement quant à leur avenir.
Elle réagit à l'annonce du changement d'état de mon père comme les humains réagissent en apprenant la mort d'un être cher : passant du saisissement au déni, du chantage à la culpabilité, de la colère au découragement, pour finir par une espèce d'acceptation.
(Il me fit remarquer que je n'avais pas réagi ainsi à tout ce qu'il avait pu me raconter. Ce qui pouvait laisser penser que j'étais « des leurs ».) Ma mère s'en voulait: pourquoi l'avait-elle encouragé à partir en Angleterre ? Mais elle lui en voulait à lui aussi. Qui avait bien pu lui faire cela ? N'était-il pas responsable de ce qui était arrivé ? Puis elle s'était mise à pleurer. Cela avait duré plus d'une journée.
Quand elle le laissait faire, mon père la prenait dans ses bras, mais avec précaution, tant il craignait d'être tenté, d'une manière ou d'une autre. Il devait rester vigilant en sa présence.
Il lui dit qu'il regrettait d'être né - s'excusant immédiatement après d'avoir employé un tel cliché. Il allait sortir de sa vie pour leur bien à tous les deux.
Elle ne voulait pas en entendre parler. Maintenant qu'elle ne pleurait plus, elle insistait pour qu'ils restent ensemble. Elle se suiciderait si mon père la quittait. Mon père lui reprocha son mélodramatisme.
- C'est toi qui as rendu notre existence mélodramatique ! C'est toi qui t’es débrouillé pour devenir un maudit vampire !
Elle se remit à pleurer.
- Même dans ses meilleurs moments - et ce n'en était pas un -, Sara n'était pas douée pour les discussions argumentées.
À la fin de la semaine, mon père se sentait épuisé, émotionnellement et physiquement.
Sara l'avait emporté. Elle repartit à Savannah avec une bague de fiançailles au doigt ; une réplique d'un bijou étrusque avec un oiseau perché dessus, que mon père avait achetée lors de son premier voyage à Londres. Quelques semaines plus tard, il fît ses bagages et prit l'avion pour rentrer chez lui.
Il retrouva Sara dans la maison en brique près du cimetière - qui était effectivement hantée - et au fil des jours, ils apprirent à s'accommoder de ce que Sara appelait son « affliction». Dennis était resté à Cambridge, mais il envoyait régulièrement à mon père des « cocktails » lyophilisés, dont la composition se rapprochait chaque jour un peu plus de celle du sang humain frais. Ces recherches constituèrent la première étape de ce qui allait devenir Seradrone.
Au bout de quelques mois, ma mère et mon père se marièrent à Sarasota, une ville côtière de Floride, puis déménagèrent quelque temps plus tard à Saratoga Springs.
(Mon père céda au penchant de ma mère pour la lettre S, qui, d'après elle, portait chance. Il était prêt à tout pour la rendre heureuse, en dédommagement de ce qu'il était devenu.)
Ils s'installèrent dans la maison victorienne. Puis Dennis termina ses recherches à Cambridge et se fit embaucher dans une des universités de Saratoga Springs, afin de continuer de travailler avec mon père. Ensemble, ils créèrent la société Seradrone et recrutèrent Mary Ellis Root comme assistante. D'après mon père, elle possédait une formation tout à fait exceptionnelle en hématologie. A eux trois, ils mirent sur pied une méthode d'épuration du sang qui permit de nombreuses transfusions à travers le monde.
Sara avait trouvé à s'occuper, décorant la maison, entretenant le jardin, et, plus tard, s'occupant des abeilles - elle avait installé des ruches à côté des pieds de lavande. Ils étaient (la voix de mon père trahissait un certain étonnement) heureux.
Sauf que ma mère voulait un enfant
- Tu as été conçue de façon normale, m'expliqua mon père avec flegme. L'accouchement a été long mais ta mère s'en est plutôt bien sortie. Elle était très résistante.
Tu ne pesais que deux kilos, Ari. Tu es née dans la chambre au papier peint lavande -c'était très important pour ta mère. Dennis et moi l'avons aidée à accoucher et nous étions inquiets de ne pas t'entendre pleurer. Tu me fixais de tes yeux bleu foncé - un regard très posé, qui nous a surpris chez un nouveau-né — comme si tu saluais prosaïquement le monde. Ta mère s'est endormie presque immédiatement après et nous t’avons emmenée en bas pour te faire passer quelques tests. Une prise de sang nous a révélé une anémie - ce qui n'était pas surprenant, étant donné que ta mère avait souffert d'anémie pendant toute sa grossesse. Nous avons débattu un moment du traitement le plus approprié ; j'ai même téléphoné au docteur Wilson. Puis je t'ai ramenée en haut.
Il leva les deux mains en signe d'impuissance :
- Ta mère avait disparu.
- Elle n'était pas morte.
- Non, elle n'était tout simplement plus là. Le lit était vide. C'est à ce moment-là que tu as poussé ton premier cri.
Nous restâmes debout jusqu'à quatre heures du matin : j'avais besoin de connaître les détails.
- Vous n'êtes pas partis à sa recherche ? demandai-je. Bien sûr qu'ils la cherchèrent Dennis sortit pendant que mon père me nourrissait - ils avaient acheté du lait maternisé au cas où je n'aurais pas toléré celui de ma mère. Quand il revint mon père sortit à son tour et le laissa s'occuper de moi.
- Elle n'avait pas pris son sac à main, me dit-il d'une voix assombrie par le souvenir. La porte d'entrée était entrebâillée. La voiture était dans le garage. Nous n'avons rien trouvé qui puisse nous indiquer où elle était partie. Savoir ce qui avait pu lui passer par la tête.
- Vous avez appelé la police ?
- Non.
Mon père se leva de son fauteuil et se mit à arpenter le salon.
- Les services de police sont tellement limités. Je ne voyais pas l'intérêt de les alerter, je n'avais pas envie d'attirer leurs soupçons.
- Mais ils auraient peut-être pu la retrouver ! protestai-je en me levant à mon tour. Ça vous était égal ou quoi ?
- Bien sûr que non. Je ne suis pas insensible, quoi qu'on en dise. Mais j'étais convaincu que Dennis et moi avions plus de chances de la retrouver nous-mêmes. Et puis - il hésita -j'ai l'habitude d'être abandonné.
Je repensai à sa mère, morte quand il était bébé, et à ce qu'il avait dit sur les enfants endeuillés - qu'ils étaient pour toujours marqués par la mort, Il avait parfois l'impression qu'un voile tendu entre lui et le monde l'empêchait de l'appréhender directement
- Je n'ai pas ton sens de l'immédiateté. En cela, tu ressembles à ta mère : elle ressentait tout de façon immédiate. Une fois atténuée l'horreur de sa disparition, j'ai repensé à des choses qu'elle avait dites les quelques mois précédents. Elle avait été malade à plusieurs reprises, elle se sentait visiblement déprimée et malheureuse. Elle tenait quelquefois des propos irrationnels : elle menaçait de me quitter, de t'abandonner à la naissance. Elle se sentait comme un animal enfermé dans une cage.
- Elle ne me désirait pas, avançai-je en me rasseyant
-Elle ne savait pas ce qu'elle voulait Je pensais que c'était dû à un dérèglement hormonal, mais pour être honnête, c'était parce que je ne voyais pas d'autre explication. Enfin, quelles que soient ses raisons, elle avait choisi de partir.
Il baissa les yeux.
- Les gens finissent toujours par partir, Ari. C'est une chose que j'ai apprise : la vie n'est faite que de gens qui partent
Nous restâmes un instant silencieux. Quatre heures sonnèrent à l'horloge antique.
- J'ai téléphoné à sa sœur, Sophie, qui vit à Savannah. Elle m'a promis de m'appeler si Sara venait chez elle. Elle l'a fait un mois plus tard. Sara lui avait demandé de ne pas me dire où elle se trouvait : elle affirmait ne pas vouloir rentrer, Ari.
Je me sentais vide à l'intérieur, mais c'était un vide pesant dont les contours aigus me faisaient mal.
- Si je n'étais pas née, elle serait restée.
- Non, Ari. Si tu n'étais pas née, elle aurait été encore plus triste. Elle te désirait tellement tu sais.
- Et pas vous ?
Je levai les yeux vers lui et compris que j'avais vu juste.
- Je pensais que ce n'était pas une bonne idée.
Il tendit les mains vers moi, paumes ouvertes, comme pour demander grâce.
- Les vampires ne sont pas faits pour avoir des enfants, pour toutes les raisons que je t'ai expliquées.
Le vide que je ressentais se transforma en torpeur. J'avais la tête pleine de toutes les réponses que j'avais enfin obtenues. Mais au lieu de me rassasier, elles me rendaient malade.
Chapitre 9
Les bébés - humains ou animaux - ont tendance à reproduire les comportements : ils enregistrent instinctivement les caractéristiques de leurs parents, pour les imiter ensuite. C'est ce que font par exemple les poulains avec le premier être plus imposant qui surgit au-dessus d'eux juste après leur naissance. Il n'y avait que mon père pour se pencher au-dessus de moi quand je suis née, et c'est donc lui que j'ai pris pour modèle.
Mais in utero, j'avais dû m'imprégner du caractère de ma mère. Comment expliquer sinon certains de mes comportements par la suite - à moins que ce ne soit génétique. C'est un débat complexe que nous aborderons à un autre moment, d'accord ?
Chaque année, en janvier, mon père partait pendant une semaine assister à une conférence professionnelle. Et c'est habituellement Dennis qui supervisait mes leçons à sa place.
La veille de son départ, Dennis dîna avec nous. Root avait préparé des aubergines (bien meilleures, étonnamment, que tout ce qu'avait jamais cuisiné la pauvre Mrs McG), mais je n'avais pas assez faim pour en avaler plus d'une fourchetée.
Ari est déprimé, pensai-je. Je levai les yeux vers mon père et Dennis et je compris qu'ils pensaient la même chose. Je culpabilisai de les voir aussi inquiets. Ils faisaient semblant de parler de physique - notamment de l’électrodynamique, sur quoi devait porter mon prochain cours -mais j'étais en fait leur véritable sujet de conversation.
- Tu commenceras par lui faire réviser la structure atomique, expliqua mon père à Dennis, sans me quitter des yeux.
- D'accord.
Je ne l'avais pas beaucoup vu depuis la mort de Kathleen, mais chaque fois qu'il passait, il posait la main sur mon épaule, comme pour me donner du courage.
Root remonta du sous-sol, une grosse bouteille marron à la main. Elle la posa sur la table, devant mon père, qui la poussa à côté de mon assiette. Root et moi échangeâmes un regard et, pour la première fois, je perçus dans ses yeux une once de sympathie, qui disparut presque aussitôt. Elle se dépêcha de redescendre au sous-sol.
- Bon, très bien, dit mon père en repoussant sa chaise. Ari, je serai de retour vendredi prochain, et j'espère que d'ici là tu seras à même de me parler de la théorie quantique et de celle de la relativité.
Il resta quelques secondes debout - mon père, si beau dans son costume impeccable, avec ses cheveux bruns qui brillaient sous la lumière du lustre. Nos regards se croisèrent l'espace d'une seconde, puis je reportai mon attention sur la nappe. Tu ne me désirais pas, pensai-je en espérant qu'il m'entende.
Le nouveau tonifiant avait un goût plus fort que le précédent, et dès la première cuillerée, je ressentis une décharge d'énergie. Mais une heure plus tard, j'étais de nouveau apathique.
Nous n'avions pas de balance en haut ; je pensais qu'il y en avait une au sous-sol mais je ne voulais pas pénétrer dans le domaine de Root. Je savais que j'avais perdu du poids parce que mes vêtements ne m'allaient plus : mon jean était trop large, mes tee-shirts trop grands d'au moins une taille. C'est à ce moment-là que mes règles s'arrêtèrent. Je ne réalisai que longtemps après que j'avais traversé une période d'anorexie.
Dennis et moi nous attelâmes péniblement à la théorie quantique : je l'écoutai sans poser de questions. À un moment, il s'arrêta.
- Qu'est-ce qui ne va pas, Ari ?
Je remarquai quelques mèches grises dans sa chevelure rousse.
- Cela t'arrive-t-il de penser à la mort ? Il se frotta le menton.
- Chaque jour.
- Tu es le meilleur ami de mon père.
Je m'entendais parler, me demandant où je voulais en venir.
- Mais tu n'es pas...
- Je ne suis pas comme lui, dit-il, achevant ma phrase. Je sais. C'est dommage, hein ?
- Tu veux dire que ça te plairait ?
Il s'appuya sur le dossier de sa chaise.
- Ouais, bien sûr. Qui refuserait cette chance de vivre à jamais ? Mais je ne suis pas certain qu'il apprécierait que je parle ainsi devant toi. En quelque sorte, tu es encore...
Comme il hésitait, je terminai sa phrase :
- Disponible ?
- Si on veut, dit-il avec un grand sourire.
- Ce qui veut dire que c'est à moi de choisir, d'après lui ; sauf que je ne comprends toujours pas comment
- Moi non plus, je suis désolé. Mais je suis certain que tu trouveras.
- C'est aussi ce qu'il dit
Si seulement j'avais une mère qui puisse me conseiller. Je croisai les bras sur ma poitrine.
- Et où est-il, au fait ? À une importante conférence sur le sang ? Pourquoi ne l'as-tu pas accompagné ?
- Il est à Baltimore. Il y va tous les ans, mais cela n'a rien à voir avec le sang. II s'agit du fan club d'Edgar Allan Poe, ou plutôt de la Société des amis d'Edgar Allan Poe, ou je ne sais quoi, dit-il en secouant la tête et en rouvrant le manuel de physique.
Nous avions fini le cours, et je faisais mes exercices de yoga (Dennis avait ri quand je lui avais proposé que nous les fassions ensemble), lorsque j'entendis le heurtoir de la porte d'entrée. C'était un heurtoir ancien, en cuivre, sur lequel était reproduit le visage de Neptune, et personne ou presque ne s'en servait - hormis les enfants le soir de Halloween, dont les espoirs étaient vite déçus.
J'ouvris la porte : l'agent Burton se tenait sous le porche.
- Bonsoir, Miss Montero.
- Nous ne sommes que l'après-midi.
- C'est vrai. Comment allez-vous cet après-midi ?
- Ça va
Je n'aurais jamais osé répondre ainsi devant mon père. J'aurais plutôt dit : «Très bien, merci. »
- Formidable. Formidable.
Il portait un manteau en poil de chameau sur un costume noir, ses yeux vifs étaient injectés de sang.
- Votre père est là ?
- Non
- Quand rentrera-t-il ? demanda-t-il en souriant comme s'il était un ami de la famille.
- Vendredi. Il est parti assister à une conférence.
- Une conférence, répéta-t-il en hochant trois fois la tête. Vous pourrez lui dire que je suis passé, s'il vous plaît et qu'il me téléphone dès son retour ?
Je répondis que je n'y manquerais pas. J'allais fermer la porte quand il ajouta:
- Dites-moi, vous avez déjà entendu parler des kirigamis ?
- Les kirigamis ? Vous voulez parler des figures en papier découpé ?
Mon père m'avait appris à en fabriquer des années auparavant Une fois le papier plié, on pratique de minuscules découpages, puis on le redéplie et on obtient un dessin. C'était le genre de figure que mon père pouvait supporter parce qu'elle était symétrique, et qu'elle pouvait aussi être utile.
- C'est un art très minutieux, dit-il en continuant de hocher la tête. Qui vous l'a enseigné ?
- Je l'ai lu. Dans un livre.
Il sourit avant de me dire au revoir. Je parie que son vieux en connaît un rayon sur le découpage, pensait-il.
Ce soir-là, Dennis prépara le dîner - des tacos végétariens farcis à la viande végétale -, et malgré mon envie de les apprécier, j'en fus incapable. Je lui dis que je n'avais pas faim, en m'efforçant de sourire. Il me fit prendre deux cuillerées de tonifiant et me donna deux « barres de protéines » maison, emballées dans du plastique.
Le visage de Dennis devenait plus rouge et plus foncé quand il était contrarié.
- Tu es déprimée, et cela n'a rien d'étonnant. Mais ça va passer, Ari. Tu m'entends ?
- Oui
La vue du fromage qui fondait sur la viande artificielle et visqueuse me donna envie de vomir.
- Ma mère me manque.
J'avais encore une fois parlé sans y penser. Et oui, quelqu'un que tu n'as jamais vu peut te manquer.
Il eut un air coupable, et je me demandai pourquoi.
- Et ce garçon avec qui tu sortais ? Mitchell, c'est ça ?
- Michael.
J'étais certaine de ne lui en avoir jamais parlé.
- C'est le frère de Kathleen.
Visiblement il l'ignorait
- C'est dur.
Il mordit dans son taco et la sauce tomate goutta sur sa chemise. En temps normal, j'aurais trouvé ça drôle.
- Pourquoi tu ne l'inviterais pas, un de ces jours ? proposa-t-il en mâchant son taco.
- Pourquoi pas ?
Je téléphonai chez les McGarritt ce soir-là, mais personne ne répondit. Je réessayai le lendemain matin et cette fois, Michael décrocha.
Il ne sembla ni content ni triste de m'entendre.
- Ça va, dit-il. Les journalistes nous laissent à peu près tranquilles maintenant. Maman ne va toujours pas bien.
- Tu veux venir à la maison ?
Je n'entendis plus que sa respiration dans le combiné.
- Il ne vaut mieux pas, finit-il par répondre. Il marqua une pause avant d'ajouter : Mais j'aimerais bien te voir. Tu peux venir ?
Après un autre cours de physique abrutissant (Dennis préférait travailler avec moi le matin, ce qui lui permettait d'aller à l'université l'après-midi), je montai me regarder dans la glace. Mon reflet vacillant ne me fit pas bonne impression. Je flottais dans mes vêtements, ce qui me donnait l'air d'une enfant miséreuse.
Heureusement, j'avais eu de nouveaux vêtements à Noël (que nous avions fêté encore plus discrètement que d'habitude). J'avais trouvé dans le salon, posée à côté de mon fauteuil, une énorme boite Gieves & Hawkes : elle contenait un pantalon noir ajusté et une veste, quatre magnifiques chemises, des chaussettes, des sous-vêtements, et même des chaussures faites main et un sac à dos. Je m'étais sentie trop déprimée pour les essayer jusqu'à maintenant. Ils m'allaient parfaitement : je n'avais plus l'air maigrichonne, mais gracieuse.
Redevenue présentable, je me traînai jusque chez les McGarritt.
Il ne faisait pas très froid - probablement au-dessus de zéro puisqu'il ne gelait pas : la neige se liquéfiait sur le sol et les glaçons des gouttières dégoulinaient lentement Le ciel était comme toujours, d'un gris morne. Je réalisai alors à quel point j'en avais marre de l'hiver. On a parfois du mal à comprendre pourquoi les gens choisissent de vivre là où ils vivent et c'est encore plus vrai s'agissant de Saratoga Springs. Je ne lui trouvai vraiment rien de pittoresque ce jour-là : ce n'était que rangées après rangées de maisons de plus en plus miteuses à la peinture écaillée, encadrées par de la neige sale et un ciel maussade.
J'appuyai sur la sonnette des McGarritt - trois notes ascendantes joyeuses (do, mi, sol), plutôt incongrues. Michael me fit entrer ; si j'avais perdu du poids, il en avait perdu davantage encore.
Il avait le regard vide. Je posai la main sur son épaule, comme une sœur. Nous nous assîmes sur le canapé du salon et nous restâmes ainsi, côte à côte, sans parler, pendant près d'une heure. Le calendrier accroché au mur représentait Jésus menant un troupeau de moutons : c'était toujours la page du mois de novembre.
- Où sont les autres ? finis-je par lui demander, en chuchotant presque.
La pièce était inhabituellement rangée et la maison silencieuse.
- Papa travaille. Les petits sont à l'école et maman est en haut couchée dans son lit
- Pourquoi tu n'es pas en cours ?
- J'ai des choses à faire ici, m'expliqua-t-il en repoussant ses cheveux, aussi longs que les miens à présent. Le ménage, les courses, la cuisine.
Je détestais cet air perdu que me renvoyaient ses yeux.
- Ça va ?
- Tu es au courant pour Ryan ? me demanda-t-il comme s'il ne m'avait pas entendue. Il a tenté de se suicider la semaine dernière.
Je n'étais pas au courant et j'avais du mal à croire que Ryan puisse accomplir un acte aussi grave.
- Ils n'ont rien dit aux journaux, ajouta-t-il en se frottant les yeux. Il a pris des cachets. Tu es allée sur les blogs ? Ils disent que c'est lui qui l'a tuée.
- Je n'imagine pas Ryan faire une chose pareille. L'avant-bras de Michael était couvert de zébrures rouges, comme s'il s'était trop gratté.
- Moi non plus. Mais les gens disent que c'est lui, qu'il avait le mobile et qu'il a eu l'opportunité. Ils disent qu'il était jaloux d'elle, mais moi, je n'ai jamais rien remarqué.
Il regarda dans ma direction, le regard brumeux.
- Mais connaît-on jamais vraiment les gens ?
Il n'y avait plus rien à dire. Je restai assise avec lui encore une demi-heure, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je me levai alors brusquement
- Je dois y aller.
Il me regarda d'un air ébahi.
- Au fait, j'ai lu Sur la route.
Je me demandais bien pourquoi je lui disais ça.
- Ah ouais ?
- Ouais, c'est super bien. Je crois que je vais moi aussi partir sur les routes.
En fait, hormis une vague velléité de découvrir l'Amérique, je n'y avais jamais songé. Mais tout à coup, cela me parut être une très bonne idée, une réaction nécessaire à l'inertie qui m'entourait. Je ferais ce que mon père et Dennis n'avaient pas fait: je partirais sur les traces de ma mère pour découvrir ce qui lui était arrivé.
Michael me raccompagna à la porte.
- Fais attention à toi si tu t'en vas.
Nos yeux se croisèrent une dernière fois : il avait le regard éteint. Je me demandai s'il ne se droguait pas.
Je me mis à envisager sérieusement mon projet sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui m'empêcherait de quitter cet endroit pendant un moment ? Pourquoi ne pas partir à la recherche de ma mère ? Je ne savais pas si c'était le temps, ou le fait d'avoir vu Michael, ou encore le besoin de briser le cercle de la dépression, mais j'avais grand besoin de changement
La sœur de ma mère vivait à Savannah : et si j'allais la voir ? Peut-être saurait-elle me dire pourquoi ma mère nous avait abandonnés. Peut-être même ma mère se trouvait-elle encore dans les parages, à attendre que je la retrouve.
En dépit de l'éducation que j'avais reçue, je n'avais pas vraiment la notion des distances géographiques. Je connaissais la distance de la Terre au Soleil, mais je n'avais aucune idée du nombre de kilomètres qui séparaient Saratoga Springs de Savannah.
J'avais bien sûr déjà vu des cartes, mais je n'avais pas l'intention de les consulter pour déterminer le meilleur itinéraire, ni pour calculer la durée du trajet. Je prévoyais d'atteindre Savannah en deux ou trois jours, d'aller voir ma tante et de revenir chez moi avant le retour de mon père.
La seule chose que Kerouac ait jamais programmée, c'est le nombre de sandwichs nécessaires pour rallier les deux côtes ; sandwichs qui, pour la plupart finirent par pourrir. Le mieux, c'était de partir tout simplement, d'initier le mouvement et de voir où il menait.
Quand j'arrivai à la maison, ma décision était prise. Je montai dans ma chambre et fourrai dans mon nouveau sac à dos mon portefeuille, mon journal, un vieux jean, mes nouvelles chemises, des sous-vêtements et des chaussettes. Je fis tout cela très vite tant je me sentais claustrophobe dans cette chambre. J'étais embêtée de devoir laisser mon ordinateur portable, mais cela aurait fait trop lourd. J'ajoutai après coup une brosse à dents, un savon, mes flacons de tonifiant de la crème solaire et des lunettes de soleil, les barres de protéines, ainsi que l'exemplaire de Sur la route de Michael.
Je laissai un mot à Dennis, qui disait simplement : Je pars quelques jours.
À l'office, je trouvai un bout de carton sur lequel j'écrivis en grosses lettres au marqueur : SUD. Je ne m'enfuyais pas ; je m'élançais vers quelque chose.
Partie Deux
En route vers le Sud