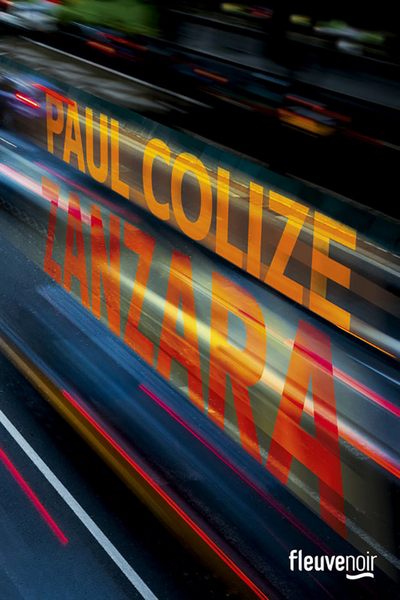
Fred, 28 ans, est journaliste. Membre d’une team de jeunes pigistes web, il rêve de gloire et de signer un article papier qui fera date.
La nuit venue, Fred mène une double, voire une triple vie.
Avant tout, il aime une femme mariée. Une liaison passionnelle, mais sans espoir. Ensuite, il aime le risque, les paris et l’adrénaline. Fred se sent vivre quand il flirte avec les limites.
Ces savants cloisonnements vont voler en éclats le jour où il reçoit un coup de fil à la rédaction. Rendez-vous lui est donné le lendemain pour recueillir des révélations fracassantes.
Arrivé sur les lieux, Fred va faire une rencontre qui le poussera à enquêter sur un fait divers apparemment anodin. Son obstination va provoquer une réaction en chaîne, jusqu’au final, inattendu et époustouflant.
Paul Colize est né à Bruxelles. Auteur de romans noirs, il a écrit une douzaine de livres, dont , paru en 2012 à La Manufacture de livres (et en poche chez Folio, Prix Saint Maur en poche 2013) et paru en 2013 à la Manufacture de livres (également repris par Folio), qui a remporté la même année trois récompenses : Prix Landerneau Polar, Prix Boulevard de l'Imaginaire et Prix Polars Pourpres. Après paru en 2015 et quatre fois primé en 2016 (Prix Plume de cristal, Prix des lecteurs Livresque du Noir, Prix Arsène Lupin et Prix Gouttes de Sang d'encre), est son deuxième titre à paraître chez Fleuve Éditions.
PAUL COLIZE
Zanzara
Le plus beau présent de la vie est la liberté qu’elle vous laisse d’en sortir à votre heure.
Prologue
J’étais fêlé.
Tout le monde le disait. Toi, tu le pensais tout bas.
Tu restais dans l’ombre. J’étais la star, tu étais mon fan. Tu assistais à mes délires, muet, admiratif.
Tu rêvais d’en faire autant, mais tu n’osais pas. Je le voyais à ton regard.
Quand on me lançait un défi, je faisais rouler mes yeux dans mes orbites en grimaçant comme le dernier des tarés.
Je voulais être le premier, aller plus vite, monter plus haut.
J’impressionnais les mecs et fascinais les filles. Mon mépris du danger te filait les jetons.
En plus, je me fichais de toi. Ce n’était pas méchant, je t’aimais bien. J’aurais dû t’initier à mon art. On aurait formé un sacré tandem.
Un jour, il faudra que je te dise ce que tu ne sais pas, avant que tu fasses une connerie.
Jamais je n’aurais pu imaginer que tu étais plus cinglé que moi.
Tu m’as bien eu.
MARDI 16 JUIN 2015
1. Vivre vite
Je déboule à fond de troisième sur l’aire de repos.
Ils sont là, Jeremy, Arthur, Ilian et les autres, bagnoles en arc de cercle, phares déchirant la nuit, Hollywood style. Je donne un brusque coup de volant, tire le frein à main pour dessiner une arabesque sur le bitume.
Soigner l’entrée en scène, le secret des stars.
Je sors de la Golf, expédie ma clope. Des cris fusent. Une douzaine de caisses, portières ouvertes, sono à donf. Les basses martèlent l’air. Dancefloor sur le Ring de Bruxelles.
Ils s’élancent à ma rencontre. On s’embrasse, les mains claquent. Des morceaux de phrases me parviennent, noyées dans les décibels. Je discerne de nouvelles têtes, l’air intimidé, le sourire crispé. Greg est là, il m’observe, à l’écart. Instinctivement, je tâte ma poche pour sentir la présence de la pièce d’échecs.
Les yeux injectés, Jeremy brandit sa cannette, braille comme un hooligan.
— Ladies and gentlemen, que le spectacle commence !
Les autres beuglent, applaudissent, exultent.
Je les remercie d’un geste.
— Maintenant, le pognon.
Ils fouillent leurs poches, tendent les mains, agitent les billets. Je rafle la mise. Cinquante la tête. Je ne rends pas la monnaie. En dessous de mille boules, ils peuvent faire une croix sur le spectacle. Pour faire grimper les enchères, Jeremy comptait trouver une candidate prête à se pencher sur mon cas pendant le trip. Les miss ont décliné.
J’encaisse le fric, dévisse les plaques d’immatriculation et remonte à bord. Ilian se fraie un chemin, me fait signe d’ouvrir la fenêtre.
Il a l’œil inquiet et une mine de déterré.
— Ça va, mec ? Tu le sens comment ?
— Cool. Ça va aller.
Je passe la première, fais crisser les pneus et démarre en beauté. Ils se ruent vers leurs bagnoles pour me prendre en chasse.
Je m’engage sur le Ring, grimpe à 130, le peloton à mes trousses. Huizingen. Je rétrograde, emprunte la sortie. Le moteur rugit. En haut de la côte, je vire à gauche et franchis le pont. La meute déferle dessous et poursuit sa course.
Rival Sons.
Play.
Volume au max.
Le riff retentit. Pressure and Time.
Je jette un coup d’œil à droite, laisse passer une voiture, me précipite à contresens dans l’échangeur. Je fonce droit sur l’autoroute. Même à 22 heures, le trafic reste dense.
Pied au plancher.
J’entre sur le Ring, esquive une camionnette, traverse en diagonale, me jette sur la voie la plus rapide.
Une moto fond sur moi. Appels de phares. Elle s’écarte in extremis. La voix rauque de Jay Buchanan se mêle au vacarme.
« Give me only what I need. »
Des projecteurs s’affolent de toutes parts.
« Hunger’s got a way to tame a man’s pride. »
Je hurle avec le chœur.
— « Can we build it up ? »
Je les sens, de l’autre côté, aux premières loges, les yeux exorbités, la bouche ouverte, roulant en va-et-vient pour rester à ma hauteur.
« Let’s get to work every woman and man. »
Raide comme un pieu, figé sur mon siège, je reprends à pleins poumons.
— « Can we build it up ? »
Certains se garent sur le bas-côté, appellent chez eux, le souffle coupé, « J’ai évité la mort de justesse ». D’autres alertent la radio. Conducteur à contresens entre Beersel et Alsemberg.
Ma chemise me colle à la peau. Je me déporte vers la gauche. Les phares palpitent.
Un essaim d’abeilles tourbillonne dans mes intestins.
— « With Pressure and Time. »
Les silhouettes défilent, m’aveuglent. L’une d’elles louvoie, hésite, arrache mon rétro au passage. Le tintamarre s’estompe dans mon dos.
L’habitacle pue la rage.
Deux cents mètres.
« I can only pray he doesn’t forget about me. »
— « Can we build it up ? »
Sortie, cent mètres.
« I don’t know, we can. »
— « Can we build it up ? »
Une sirène pousse une longue plainte. Un camion surgit. Coup de volant. Les ténèbres l’aspirent. Je m’élance dans la bretelle, toujours en sens inverse. Des phares. Je serre à droite, rase la barrière.
J’arrive au bout, pantelant, respiration bloquée. Virage en épingle. Je passe le pont et reprends le Ring, dans le bon sens cette fois.
« I said I’m gonna get mine. »
Mon corps tremble sous l’effet de l’adrénaline.
Ils slaloment sur le Ring, me guettent dans leurs rétroviseurs. J’accélère pour leur coller au cul. Ils lèvent le pied, m’encerclent, agglutinés aux carreaux, hurlants, grimaçants, admiratifs, incrédules.
Je les nargue, allume une clope, descends la vitre.
Le vent s’engouffre dans l’habitacle.
Je tends le bras, majeur dressé.
— Enfoirés.
MERCREDI 17 JUIN 2015
2. Dîner thaï
16 h 45.
Je sors de l’ascenseur, emprunte l’allée centrale.
Les journalistes sont immergés dans leur sujet, les yeux rivés à l’écran, visage fermé. On entend voler les mouches. Même ma chemise bariolée et mon pas décidé ne parviennent pas à troubler leur concentration.
La rédaction du Soir se trouve au deuxième étage du 100 rue Royale, un plateau d’une centaine de postes de travail, la plupart chargés de montagnes de papiers, de moniteurs, de tablettes, de téléphones portables et de câbles électriques.
Au plafond, des rangées de téléviseurs muets diffusent les images des principales chaînes d’actualité.
Mon bureau se trouve au fond, près de l’écran géant, dans la zone réservée à l’édition en ligne.
Vanessa relève la tête.
— Salut, Fred.
— Salut, beauté.
Vanessa est black, originaire du Congo. Dans la team, nous avons aussi un Alfredo, son grand-père est Portoricain. Avec ces deux, on a le quota pour tourner une série US.
Nous formons une vraie équipe. Quatre nanas, cinq mecs, tous en dessous de trente ans, soudés comme les neuf doigts d’une main. Pas de cavalier seul, pas de diva, pas de tire-au-flanc. On s’entraide, on communique, on échange sans cesse.
Parfois, l’un de nous entame la rédaction d’un article pendant qu’un deuxième cherche des photos, un troisième du factu, un quatrième des liens ou des infos complémentaires.
Pierre sort de sa bulle, retire ses écouteurs.
— Ô grand Fred, quelle joie !
— Salut, Pierrot.
Pierre est le benjamin. Il vient de fêter ses vingt-quatre ans. Je lui ai servi de mentor quand il est arrivé. Depuis, on est super potes. Avec Alfredo, on forme le trio.
Il pointe ma chemise.
— Votre Splendeur s’est parée pour une soirée de gala ?
Je réponds sur le même ton.
— Votre Hilarité s’en va camper ?
Depuis peu, il a adopté le look homme des bois : barbe au carré, chemise de bûcheron et lunettes de Woody Allen. Le résultat est désastreux.
Il s’esclaffe.
— Monseigneur est trop drôle.
— Qu’est-ce que tu as pris pour bouffer ?
— Thaï.
— Encore ?
Vanessa surenchérit.
— Putain, Pierre, on en a marre de ton poulet à la citronnelle ! À choisir, je préfère les pizzas surgelées et les omelettes zarbi de Fred.
J’ai aussi quelques atomes crochus avec Éloïse, une des filles de l’escouade. Il nous arrive d’être sex friends. Elle mérite une place dans le top 5 mondial.
En aparté, on la surnomme la Bomba. La moitié des mâles de la rédaction fantasment sur elle. Un pisseur anonyme lui a dédié un poème dans les chiottes. La sentence occupe le pan au-dessus des urinoirs. Rédigée en anglais, elle affirme qu’une belle femme n’est qu’une belle femme, mais qu’une belle femme avec un cerveau est une arme fatale.
Ce n’est pas la seule citation machiste qui orne les lieux, les murs en sont couverts.
Je réveille mon ordi, ouvre la feuille de route, notre bible. Le document reprend ce qui est lancé, ce qu’il faut développer, la liste des priorités. En fin de page, les sujets de remplissage, au cas où. Chacun y a accès. On ajoute, on modifie, on enlève. Tout change en permanence.
— Tu me fais un topo ?
Sur le papier, je suis le responsable de l’équipe, mais il n’y a pas de hiérarchie. Chacun son rôle, même si la flexibilité prime, surtout en période de crise.
— Calme plat sur Twitter.
Les réseaux sociaux ont remplacé les pompiers, les flics et les scanners de fréquence que mes ancêtres utilisaient. Aujourd’hui, trois personnes sur quatre se promènent avec un smartphone ou une tablette. Autant de reporters en puissance. Lors de l’attaque à Charlie Hebdo, le titre était en ligne un quart d’heure après les faits. Ensuite, on recoupe avec les agences de presse et les grands canards.
— Les prios ?
Choisir parmi tout ce qui nous tombe dessus est un casse-tête. Neuf dépêches sur dix sont zappées. Nous évitons le racolage médiatique. Nous laissons à d’autres les grèves de trois personnes, les chiens écrasés et la vie dissolue des people.
Elle soupire.
— Rien de gras. Le bicentenaire de la bataille de Waterloo, le début du ramadan, Eddy Merckx fête ses septante balais, la conférence de presse de Milquet dans quelques minutes.
Les réponses aux examens de langues modernes qui auront lieu demain sont déjà sur Facebook, comme celles des épreuves de sciences hier. Joëlle Milquet, la ministre de l’Éducation, est priée de s’expliquer.
Même hors des murs, je reste connecté. J’emporte mon ordi et mon iPad partout, en plus de mon iPhone. Le summum du geek.
J’ouvre la page de la RTBF.
— Allons-y pour Milquet.
J’ai à peine fini ma phrase que Christophe, le rédac-chef, surgit et fonce dans ma direction.
— La Libre annonce que les examens de demain sont annulés, pourquoi on n’a pas ça ?
Christophe fonctionne à huit mille tours. Il arrive tôt, part tard et passe ses journées à entrer et sortir de son bureau pour poser des questions, donner des instructions, hurler au téléphone ou convoquer des réunions. Un candidat à l’infarctus. Il maintient la pression, fait monter l’adrénaline. Avec lui, impossible de glander. Nous devons être les premiers, ne pas nous tromper, ne jamais nous faire griller par la concurrence.
Je tourne l’écran vers lui.
Un bureau, quelques micros, une chaise vide.
— Elle n’a encore rien dit. La conférence de presse n’a pas commencé.
Il écarte les bras.
— Sur quoi ils se basent, alors ?
— Je vais me renseigner.
Surtout, ne pas lui dire qu’on n’a aucune idée, que ce n’est pas notre faute, que les autres disent des conneries, qu’ils sont plus rapides ou meilleurs que nous.
— Quand tu sais quoi, tu viens me voir.
Il retourne dans son bureau en grommelant.
Un chroniqueur passe à proximité. Il a capté notre discussion et lève les yeux au ciel. Il est en bermuda et tee-shirt. Le formalisme ne fait pas partie de nos mœurs. Mes chemises futuristes, mes cheveux qui flottent sur mes épaules et ma collection de baskets criardes ne m’ont jamais valu la moindre remarque.
À 18 heures, le plateau commence à se vider. La ministre annonce l’annulation des épreuves du lendemain. Je mets en ligne, préviens Christophe et descends fumer une cigarette.
Avant de remonter, je fais un crochet par la cafétéria pour prendre des munitions. Il ne viendrait à l’idée de personne de se pointer avec un seul gobelet. On ravitaille les équipiers, ceux qui nous ont filé un tuyau, ceux qu’on aime bien.
Quand j’ai commencé, le café était gratuit. L’année passée, George Clooney est venu installer une de ses machines. Il me pique la moitié de mon salaire.
21 heures, l’accalmie.
Il ne reste qu’une poignée de journalistes qui attendent la fin des matchs pour clôturer l’édition, avant 22 h 30. Pour l’équipe Web, le bouclage n’existe pas. Les titres, les rubriques, les articles se chamboulent sans cesse. Entre deux, on poste les dernières actus sur Twitter et Facebook.
Pierre se lève pour mettre notre poulet thaï dans le four à micro-ondes. Pour les repas, c’est chacun son tour. On grignote en continuant à bosser.
Ça pue la bouffe dans tout l’étage.
Vanessa s’esclaffe.
— Le Vagin de la Reine vandalisé au château de Versailles.
— Le vagin de la reine ? Raconte.
Elle lit la dépêche à haute voix.
— Une œuvre imposante du sculpteur britannique Anish Kapoor installée dans le parc du château de Versailles a été vandalisée par des jets de peinture.
— Tu as une photo ?
— Yep.
— Envoie.
22 heures. Le téléphone sonne. En journée, c’est plutôt rare. Tout se fait par portable.
Je décroche.
— Frédéric Peeters.
Je déteste mentionner mon nom. Pas pour sa banalité, parce que c’est celui de mon père.
Une voix d’homme, sourde, lointaine.
— J’aimerais parler à un journaliste.
— Je vous écoute.
— Vous êtes journaliste ?
— Oui, que puis-je faire pour vous ?
— J’ai des informations à vous communiquer.
— De quoi s’agit-il ?
Il semble chercher ses mots.
— Pas par téléphone.
— Dans ce cas, venez jusqu’ici.
Un blanc.
Il reprend.
— Ce n’est pas possible.
Quelques secondes s’écoulent.
Je le laisse mijoter, histoire de voir si c’est un canular ou une info sérieuse. Il y a quelques mois, un cintré a menacé de faire sauter l’immeuble. On s’est tous retrouvés dans la rue en moins de dix minutes.
Je jette un coup d’œil à l’écran. Indicatif de la Belgique. Numéro de portable. De ma main libre, je l’enregistre dans mon iPhone.
— Vous pouvez m’en dire plus ?
— Pas maintenant. Chez moi, demain, à la première heure. Je suis menacé, ils feront tout pour me faire taire. Ils ne veulent pas que cette affaire éclate au grand jour.
Je fais une nouvelle tentative.
— Qui ça, ils ? De quelle affaire parlez-vous ?
— Faites votre métier, venez me voir, vous saurez. Je vous dirai ce qui s’est passé ce jour-là.
— Donnez-moi votre nom et votre adresse.
Vingt euros qu’il va se dégonfler.
— J’habite au Grand-Hez, près de Bouillon. Allez jusqu’à l’hostellerie du Cerf. Après trois cents mètres, prenez à droite. Tout au bout de la route, la dernière maison, avec le lierre et les volets blancs. Ne communiquez cette adresse à personne.
Il raccroche.
Pierre et Vanessa me dévisagent.
— Qu’est-ce que c’était ?
— Au choix : un plaisantin, un taré, ou notre prochain scoop.
JEUDI 18 JUIN 2015
3. Tintin dans les Ardennes
8 heures.
J’entre dans Bouillon. Son air pur, son château fort, son parc animalier.
Je garde des Ardennes le souvenir d’une zone sinistrée. Des routes sinueuses, des sapins, des champs, un trio de vaches. De temps en temps, la traversée d’un village bombardé. Des maisons délabrées, des chiens errants, des carcasses de bagnoles dans les allées.
Je n’ai jamais compris le charme que certains y trouvent. Je préfère les villes, l’agitation, la fureur et le bruit.
Arrivée à destination dans dix-neuf minutes. Le temps de m’en griller une. Je ne sais pas ce que ce type entend par « à la première heure ».
En principe, j’aurais dû refiler ce taf à quelqu’un d’autre. Pierre et Vanessa trouvaient que cet appel avait l’air d’un traquenard, que je prenais des risques.
J’ai balayé l’objection en citant Nietzsche.
« Pour retirer de l’existence la plus grande jouissance, le secret est de vivre dangereusement. »
Ma devise.
Avant de quitter Bruxelles, j’ai envoyé un mail à Christophe pour l’informer. Une façon comme une autre de le mettre devant le fait accompli.
Je longe l’hostellerie du Cerf, parcours quelques centaines de mètres et prends à droite, au lieu-dit Les Quatre Chemins. Des bicoques agonisent de part et d’autre du croisement. La route se rétrécit.
Je me repasse la conversation d’hier.
Quelle information sensible peut détenir un type qui crèche dans un trou pareil ? Pour ma première sortie d’envoyé spécial, je risque le bide complet.
Quand j’étais gamin, mon grand-père m’a offert sa collection de Tintin. Il me l’a remise avec gravité, comme s’il s’agissait des joyaux de la Couronne. Il a précisé qu’on n’avait jamais rien fait de mieux. Je pense plutôt qu’il n’avait rien lu depuis.
J’étais accro à Tomb Raider, je ne voyais pas ses vieilleries d’un bon œil. Finalement, j’en ai feuilleté quelques-uns, quand j’étais privé de PlayStation. Le perso principal n’avait ni le charisme ni la poitrine hypertrophiée de Lara Croft. Il parcourait le monde avec son clebs et le capitaine Haddock de la Tourette. Par miracle, il échappait dix fois à la mort et finissait toujours par arrêter les méchants.
J’ai demandé à mon grand-père ce que Tintin faisait comme job. Il m’a répondu reporter au Petit Vingtième. Selon lui, cette lecture a déterminé de manière subliminale mon choix professionnel.
En cinquante ans, le journalisme a bien changé. Au lieu de visiter le Tibet et les tombeaux des pharaons, je suis cloîtré, derrière mon écran à longueur de journée. Seuls quelques privilégiés ont la chance d’aller sur le terrain.
La route se dégrade. La Golf cahote dans les ornières et les nids-de-poule.
Je m’arrête.
D’un côté, des sapins, de l’autre, une clairière avec les mêmes sapins, décapités.
Que veut dire « tout au bout » ?
Je fais un zoom sur la carte. La frontière française est toute proche.
Je redémarre et parcours quatre kilomètres à faible allure sans rencontrer une seule baraque. Il faut faire gaffe à ne pas oublier d’acheter ses clopes quand on habite dans le coin.
Et si on me menait en bateau ? La voix étouffée, la menace. Je pense aussitôt à Jeremy. Il n’y a que lui pour manigancer un truc aussi foireux.
Je m’apprête à renoncer lorsque j’arrive à un embranchement.
À gauche, Grand-Hez. Tout droit, un panneau « voie sans issue ». Le goudron fait place à un chemin de terre. Le « tout au bout » prend son sens.
Je m’engage sur le sentier. Deux maisons apparaissent sur ma gauche, distantes d’une cinquantaine de mètres l’une de l’autre. Je passe au ralenti devant la première, un taudis dont la partie supérieure est recouverte de bois. Un rideau tremblote à l’une des fenêtres.
La suivante est en retrait. Grande, un corps central et une aile en partie rénovée. Un lierre grimpe le long de la façade, les volets sont blancs.
Je me gare, sors de la voiture, allume une cigarette.
Un gros 4 × 4 Mercedes stationne dans l’entrée. Je pose une main sur le capot. Froid.
Je m’approche de la maison, cherche la sonnette. Une tête de bestiole en bronze pendouille au milieu de la porte. J’actionne l’engin. Les coups résonnent dans le vide.
Je reviens en arrière. Les rideaux sont tirés. Impossible de jeter un coup d’œil à l’intérieur.
Retour au bélier, sans succès. Ni bruit ni mouvement. Je prends mon portable, compose le numéro. Le timbre vibre dans mon oreille, mais rien ne se fait entendre dans la bicoque. Après une dizaine de sonneries, le signal se coupe sans que l’appel bascule vers la messagerie.
Je contourne la bâtisse, accède à l’arrière. Des matériaux de construction traînent de toutes parts, une citerne trône au milieu d’une pelouse rachitique.
Personne en vue.
Je mets mes mains en porte-voix.
— Il y a quelqu’un ?
Au loin, un bruit de serrure me répond. Je me retourne. Un homme sort de l’autre maison. Il reste sur le pas de la porte et m’observe, panse en avant, poings sur les hanches.
C’est comme ça, chez les bouseux, on ne peut pas péter sans qu’un voisin vienne renifler.
Je lui fais signe en grimaçant un sourire.
Il fait demi-tour, rentre chez lui.
Je continue l’exploration des lieux. Quelques marches mènent à une porte. La poignée s’est fait la malle, la gâche a été arrachée. Les suites d’un coup de pied, probablement.
Je passe la tête à l’intérieur.
— Il y a quelqu’un ?
Rien.
Je pousse la voix.
— Vous m’avez appelé, hier soir. Frédéric Peeters, je suis le journaliste.
Nada.
J’entre. Cuisine moderne, rangée avec soin. Une odeur de renfermé et de viande pourrie empeste l’air.
Un couloir s’ouvre à droite. Je le suis et arrive dans le salon.
L’homme avec qui j’ai rendez-vous est assis dans un large divan, la tête en arrière, la bouche grande ouverte. S’il n’y avait les éclaboussures de sang noirci qui salopent le mur et le plafond, on pourrait croire qu’il dort à poings fermés.
Je devrais battre en retraite, sortir de ce merdier et vider mes tripes dans le potager.
Une phrase me revient.
« Ils feront tout pour me faire taire. »
Je reste immobile, fasciné par le cadavre. J’ai besoin d’une cigarette, mais le moment et l’endroit me semblent mal indiqués.
Sans détacher mes yeux de la scène, je glisse lentement une main dans ma poche.
Je marmonne entre mes dents.
— Alors, c’est comment, là-bas ?
4. Une brochette de poulets
En quelques minutes, les flics se sont multipliés comme les petits pains dans la plaine de Magdala.
Les premiers sont arrivés une demi-heure après mon appel, en sautillant sur le chemin dans leur minuscule Škoda blanche. La blondinette qui conduisait portait un flingue trop lourd pour sa frêle stature.
Son équipier arborait un bouc gris-roux et une paire de lunettes des années 1970. L’ensemble évoquait Walter White, le héros de Breaking Bad.
Après lui avoir dit qui j’étais, pourquoi j’étais à Grand-Hez et ce que j’avais découvert dans la maison, il m’a demandé ce que je faisais là.
J’ai répété comme un perroquet.
Il a ensuite cherché la sonnette, puis tapé du poing sur la porte.
Comme il ne recevait pas de réponse, il m’a demandé ma carte d’identité et l’a remise à sa collègue en me priant de ne pas quitter les lieux.
Il a fait le tour de la maison et est réapparu quelques minutes plus tard. Sans un mot, il s’est rendu dans sa bagnole et a passé quelques coups de fil.
Les renforts sont arrivés par vagues successives.
À force de lire les dépêches de l’agence Belga, je savais qui était qui. Quand les premiers intervenants estiment que la situation l’exige, ils font appel à l’officier de garde. Lui-même prend contact avec le magistrat de service. Après avoir ordonné la mise en place d’un périmètre d’exclusion judiciaire, le Labo débarque, suivi par le légiste.
Je connais la procédure, mais j’ai trouvé plus fun de jouer au con et de fumer en assistant au défilé en compagnie de Blondinette.
Je mourais d’envie d’appeler Camille pour lui expliquer ce qui m’arrivait, mais son mari risquait d’être présent.
J’ai fait sa connaissance le 23 octobre 2013, un mercredi. Je m’en souviens comme si c’était hier.
J’avais invité l’équipe chez moi le samedi suivant pour fêter mon anniv. J’avais parié avec eux que je leur préparerais un plat qu’ils n’avaient jamais mangé de leur vie.
J’ai d’abord surfé sur le Web. Le mets le plus pittoresque que j’y ai déniché était le python au lait de coco, mais la viande de serpent coûte un bras et ne se trouve pas chez l’épicier du coin. Deux jours plus tard, alors que je venais d’acheter quelques fringues dans l’Espace Louise, j’ai eu l’idée d’entrer dans une librairie.
Je fouillais dans le rayon cuisine, à genoux dans l’allée, lorsqu’elle s’est approchée.
— Je peux vous aider ?
Je me suis relevé.
La trentaine, grande, brune, une bouche sensuelle, une fossette au menton et des yeux pétillants de malice. Aux antipodes de la libraire maniérée et acariâtre que je m’attendais à trouver.
— J’ai invité quelques amis à manger. Je cherche un livre de recettes originales.
Elle a haussé les sourcils, amusée.
— Dans quel budget ?
— Le prix normal d’un livre. Une vingtaine d’euros ?
— Votre recette.
— Pas trop chère, je suis fauché.
Elle a jeté un coup d’œil aux sacs et boîtes à chaussures éparpillés à mes pieds.
— Je vois.
D’un geste précis, elle a saisi un bouquin sur une étagère et me l’a présenté.
Le titre m’a fait sourire.
Les Recettes inavouables.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Tout ce qu’il faut pour épater vos amis et effrayer votre belle-mère. Des recettes faciles pour réaliser des miracles à partir de sardines en conserve, de légumes sous vide ou de soupes en sachet.
— Vous avez déjà essayé ?
Elle a pris l’air sérieux.
— Bien sûr. Le thon au Boursin, le riz au Coca et le soufflé au Nutella.
J’ai esquissé une moue admirative.
— Je le prends.
Je l’ai suivie à la caisse. J’aimais sa façon de marcher. Elle portait un jeans, un pull à col roulé noir et des boucles d’oreilles fantaisie. Rien d’extraordinaire, une tenue que j’avais vue sur des centaines de filles, mais qui, chez elle, m’attirait de manière troublante.
Au moment de payer, elle m’a demandé si je désirais la carte de fidélité de la maison. J’ai dit « Avec plaisir » et lui ai laissé mes coordonnées.
Elle a incliné la tête, m’a dévisagé de manière curieuse.
— Merci de votre visite. Je suis ravie de vous avoir comme client.
C’était plus qu’une simple formule de politesse.
Je suis sorti de la librairie, déboussolé. Je ne savais quel chemin prendre. J’avais oublié où était garée ma voiture, quel jour on était et ce que j’étais venu faire dans cette galerie commerçante.
Le lundi, j’ai reçu un SMS. Le premier des trois millions que nous avons échangés depuis.
Alors, ce dîner ?
Mon cœur a fait un bond.
J’ai répondu dans la seconde.
Un mort, trois blessés graves.
À 11 heures, le légiste sort de la maison et rejoint le petit groupe qui poireaute devant la Škoda. Il leur souffle quelques mots en aparté.
J’essaie de capter ce qu’il dit en tirant une taffe, le nez pointé vers le sommet des sapins.
S’il a un doute sur les circonstances de la mort, la Crim ne tardera pas à se pointer. Ils prendront le dossier en charge et ordonneront une autopsie. Ensuite, ils commenceront l’enquête de voisinage et l’audition des éventuels suspects. Dont je figure en tête de liste.
Je m’approche.
— J’ai reçu un appel de sa part hier soir.
L’officier semble découvrir ma présence. La cinquantaine, balèze, costard fripé et cravate en tire-bouchon.
Il m’interroge du menton.
— De qui avez-vous reçu un appel hier soir ?
La question me cueille à froid.
— De l’homme qui se trouve dans la maison. Il m’a fixé rendez-vous ici, ce matin.
Il fronce les sourcils.
— Vous prétendez que la personne qui est dans cette maison vous a téléphoné hier soir ?
Je perçois de l’incrédulité dans son ton.
— Oui, je suis journaliste au Soir.
Il me détaille des pieds à la tête, les lèvres pincées. Comme nombre de ses congénères, il n’aime pas les fouille-merde de journaleux qui les empêchent de faire leur boulot.
— Vous venez de Bruxelles ?
Déduction pertinente, je n’arbore pas le look accrocheur de l’Ardennais moyen.
— Oui, je suis parti tôt ce matin. Il m’a dit qu’il avait des informations à me communiquer.
Il se retourne et appelle Walter White en me montrant du doigt.
— Vous avez les coordonnées de ce monsieur ?
Le flic acquiesce.
Il revient vers moi.
— Nous reprendrons contact avec vous pour votre déposition, si nécessaire.
— C’est tout ?
Il me jette un regard caustique.
— Oui, c’est tout.
— Attendez. Hier soir, au téléphone, cet homme se disait menacé et souhaitait me voir au plus vite. Quelques heures plus tard, je débarque chez lui et je tombe sur son cadavre. Vous ne trouvez pas ça suspect ?
Il secoue la tête, soupire avec lassitude.
— Je ne sais pas de quoi ni de qui vous parlez. L’homme qui est dans cette maison est mort depuis trois ou quatre jours.
5. Une affaire de second plan
— Cet appel téléphonique était une prise de contact venant de l’au-delà. En quoi est-ce surprenant ? Tu n’as pas vu Ghost, le film préféré de ma mère ?
Celui de la mienne aussi, avec L’Avventura.
Elle se met à fredonner les premières mesures de « Unchained Melody ».
Camille se lève du bon pied trois cent soixante-cinq jours par an. Enjouée, de nature optimiste, elle est capable de dédramatiser les situations les plus tendues par un trait d’humour.
J’acquiesce.
— Après tout, c’est possible.
Ayant déjà côtoyé la mort, je ne rejette pas l’idée.
Son rire résonne dans le téléphone.
— Bien sûr. Qu’est-ce que ça pourrait être d’autre ?
Je tente une ouverture.
— Peut-être n’était-ce pas le cadavre qui m’a appelé ?
Elle se marre de plus belle.
— Bien joué, Callaghan, bonne déduction. À moins que les flics ne se trompent sur la date de la mort.
— Peu de chance, le légiste est venu.
— Et après ? Tu es sûr qu’ils t’ont dit la vérité ? Tu es peut-être un témoin embarrassant ? Moins ils en disent, mieux c’est.
— En tout cas, ils m’ont prié de me barrer. Je suppose qu’ils ont fait venir la Crim. Pour mon premier reportage en live, je suis servi. Je me demande qui est ce type et ce qu’ils ont trouvé chez lui.
— Qu’est-ce que tu comptes faire ?
— Fourrer mon nez du côté de la maison Poulaga. C’est l’occasion de montrer que je peux faire mieux que recopier des dépêches. De ton côté, quoi de neuf ?
— Néron a tué Madonna.
Camille est sans doute la seule habitante d’Uccle à posséder un coq et des poules. En plus, dans l’un des quartiers les plus friqués de la commune.
Racontées avec sa verve, les tribulations de Néron et de son harem ont autant de saveur qu’un roman de John Irving. Je connais mieux la vie de sa basse-cour que celle de son mari. Elle ne me parle jamais de lui et il ne me viendrait pas à l’idée de lui poser la moindre question. Je sais qu’il bosse dans une grande banque, qu’il est brillant, carriériste, stressé et qu’il s’appelle Bernard, ou Bertrand, je m’en fous. Hormis ces maigres éléments, le seul sujet qui m’intéresse est le planning de ses déplacements à l’étranger.
— Qu’est-ce qui s’est passé ?
Elle adopte un ton dramatique.
— Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a grimpé sur elle comme d’habitude, sauf que, cette fois, il lui a picoré le crâne. S’il me refait le coup, il termine en court-bouillon.
— Les autres poulettes ne se sont pas rebellées contre la dictature ?
— Que dalle. Elles ont fait les belles autour de lui. Je te parie que ces connes ont développé le syndrome de Stockholm.
La légèreté de nos échanges ne laisse pas transparaître la passion qui nous dévore. Nous ne sommes jamais tombés dans le piège des « mon biquet », « ma louloute » ou autres surnoms débiles. Pas plus que nous ne sommes adeptes des envolées lyriques ou des « je t’aime » à répétition. Notre complicité vaut tous les mots d’amour, nos fous rires, les déclarations les plus enflammées.
Elle reprend.
— J’arrive à la librairie. Aurore boréale mercredi soir.
En langage intelligible, elle sera seule la nuit de mercredi à jeudi. Au fil du temps, nous avons créé notre jargon. Nos textos sont truffés de signes cabalistiques qui déstabiliseraient les meilleurs cryptanalystes de la NSA.
— Pas de bol, mercredi, il y a foot.
À part un show case privé des Rival Sons ou de Black Country Communion — et encore —, je ne raterais pour rien au monde une nuit avec elle.
Elle prend un ton détaché.
— Je comprends. Le foot, c’est sacré. Une autre fois, peut-être. Bye.
Dans la foulée, je pioche une clope et appelle Salvatore, le spécialiste high-tech du journal, l’homme le plus mal sapé de la rédaction. Ses jeans ne cachent rien de sa raie des fesses. Il n’est pas rare de le voir une semaine entière avec le même tee-shirt publicitaire à la gloire d’une marque de whisky.
— Salut, Salvo, j’ai besoin de toi.
— Je t’écoute.
— Tu as de bons contacts avec les opérateurs télécom ?
— J’ai des bons contacts avec tout le monde.
— Si je te file un numéro de portable, tu peux me dire qui est l’utilisateur et le géolocaliser ?
— Un jeu d’enfant. Envoie-moi ça par mail.
J’ai peur de lui faire perdre son temps. Il s’agit probablement d’une carte prépayée. Quant à la localisation, elle ne me servira pas à grand-chose.
— Et la liste des appels donnés et reçus, c’est possible ?
Il ricane.
— Pour ça, il me faudrait une demande officielle du procureur du roi ou d’un juge d’instruction. Sauf si je parviens à craquer la facture en ligne, mais c’est illégal.
— Bien sûr. En attendant, je t’envoie le numéro.
Je débarque à la rédaction une heure plus tard et fais irruption dans le bureau du rédac-chef.
— Bonjour, Christophe, tu as deux minutes ?
Il quitte son écran et m’indique une chaise d’un geste nerveux.
— J’ai vu ton mail, assieds-toi, raconte.
Mes péripéties ne semblent pas l’estomaquer. Il en a vu d’autres.
Il met rapidement fin à l’entretien.
— Creuse un peu, mais ne passe pas trop de temps là-dessus, ça m’a l’air d’être une affaire de second plan.
Je rejoins mon poste et salue les forces en présence, Éloïse, Sarah, Marie, Thomas, Loïc, Alfredo.
Hormis la Bomba qui me gratifie d’un clin d’œil, les autres se contentent d’un vague signe de la main.
Je m’assieds et appelle le porte-parole de la police fédérale.
— Bonjour, monsieur Saussey.
Il reconnaît ma voix.
— Bonjour, monsieur Peeters. Que puis-je pour vous ?
— Appelez-moi Fred, pour commencer.
Je ne l’ai jamais rencontré, mais je l’imagine sexagénaire, chauve, vieux garçon, un peu coincé. Il pèse chaque mot et ne donne jamais son avis. En revanche, il joue le jeu et a toujours collaboré avec nous.
— J’aimerais recevoir des informations concernant la découverte d’une personne décédée à Grand-Hez. La police de Bouillon s’est rendue sur les lieux ce matin.
Un silence.
Je présume qu’il note les données de sa plus belle écriture sur une feuille immaculée, comme le ferait une grand-mère sur un pot de confiture.
Je meurs d’envie de fumer.
— Grand-Hez. Bouillon. Ce matin. Je me renseigne et je vous rappelle.
— Je vous remercie.
Direction le sous-sol pour la tournée de café. Avant, je sors et allume une cigarette.
J’aspire longuement la fumée, ferme les yeux, pense à ma prochaine nuit dans les bras de Camille.
On s’écrit, on se parle à longueur de journée, mais nos rencontres sont épisodiques. Nous préférons partager de vrais moments hors du temps plutôt que quelques minutes volées de-ci, de-là.
Loïc me rejoint. Outre sa petite taille et son visage poupin, il a toujours l’air d’avoir aperçu un fantôme. Pour se viriliser, il a planté une dent de léopard dans son arcade sourcilière.
— C’est quoi, ce plan dans les Ardennes ?
Je lui brosse l’historique.
Les yeux ronds, il attend la fin du récit pour me servir sa formule favorite.
— C’est énorme !
— Je ne te le fais pas dire.
Dans deux heures, ce sera oublié.
Sauf rebondissements, plus personne n’en parlera demain, moi y compris. L’affaire sera enterrée, comme le reste. La majorité du contenu du journal d’hier n’a plus de valeur aujourd’hui. Ne parlons pas d’avant-hier, de l’année dernière ou du siècle écoulé.
Ça m’arrange. Le passé ne m’intéresse pas. Seul le présent m’importe, même si le laps de temps qu’il symbolise est flou. Est-ce une journée ? Une heure ? Une minute ? Se limite-t-il à la durée d’un orgasme ou aux poussières de seconde qui séparent le dernier souffle de vie de la morsure de la mort ?
J’arrête de gamberger et remonte avec mes gobelets de café. Je termine la distribution quand Jacques Saussey me rappelle.
Comme chaque fois, je vais devoir lui tirer les vers du nez.
— Qui est l’homme décédé ?
— Régis Bernier, citoyen belge, cinquante-cinq ans, domicilié à Grand-Hez, sans profession.
— Quelles sont les circonstances du décès ?
— Il s’agit d’un suicide. Monsieur Bernier s’est tiré une balle dans la tête.
Je n’en crois pas mes oreilles.
— Un suicide ? Vous êtes certain ? Vos collègues n’ont rien trouvé de suspect ?
D’une voix posée, il m’explique qu’il ne voit rien dans le procès-verbal qui laisserait penser une telle chose. Pareil pour la porte fracturée, rien de tel n’est mentionné. Il présume que cette porte aurait pu être endommagée depuis longtemps.
— À quand remonte la mort ?
— Selon le rapport du légiste, à la nuit de dimanche à lundi, entre 23 heures et 2 heures du matin. Comme il s’agit d’un suicide, notre intervention s’arrête là. La famille a été prévenue.
Suicide égale pas d’autopsie ni de descente de la Crim. Par conséquent, pas d’enquête non plus. Le dossier sera classé dans la poubelle la plus proche.
Je n’en tirerai rien de plus.
J’ai à peine raccroché que Salvatore se matérialise, un papier à la main.
— J’ai ce que tu m’as demandé.
— Carte prépayée ?
— Non. Abonnement chez Proximus. Par contre, pas moyen de localiser l’appareil. Soit il a retiré la carte SIM, soit il a ôté la batterie du téléphone. Le service Voice Mail a été désactivé dimanche dernier, 14 juin, à 19 h 07.
— L’abonnement est à quel nom ?
Il pose le feuillet sur mon clavier.
— Un certain Régis Bernier.
6. Épreuves imposées
Malgré la recommandation de Christophe de « ne pas passer trop de temps sur cette affaire de second plan », je surfe près d’une heure sur la Toile à la recherche de Régis Bernier.
Je trouve des Régis Bernier sur Facebook, Twitter et LinkedIn, mais aucun ne correspond au mien. Le plus illustre travaille à la police de la route, à Sherbrooke, une petite ville du Québec, mais il n’a pas quarante ans.
Chaque membre de l’équipe y va de son scénario, du plus simpliste au plus alambiqué.
Alfredo, qui force sur le mojito autant que moi sur le tabac, est persuadé que le type qui m’a appelé est un cambrioleur surpris par la présence du cadavre dans la bicoque qu’il visitait. Pierre pense que j’ai affaire à un tueur en série qui souhaite engager une course-poursuite avec les flics. Pour Loïc, je trempe dans un vaste complot mondial.
Ne manquent qu’Elvis et les extraterrestres.
Il me paraît évident que l’inconnu qui a téléphoné voulait qu’un journaliste découvre le macchabée avant les poulets.
Pourquoi ?
Autre énigme, depuis dimanche soir, jour de la mort selon le légiste, personne dans l’entourage de Régis Bernier ne semble s’être inquiété de son silence, pas même son fouinard de voisin.
Pour quelles raisons ?
À 16 heures, Vanessa se pointe. Elle est surprise de me voir.
— Tu es déjà là ? Qu’est-ce qui se passe ?
Je lui fais un résumé.
Elle reste plantée au milieu de l’allée, scotchée à mes lèvres.
— Putain ! Pour ta première sortie, tu es servi !
Je désigne son Tupperware pour détendre l’atmosphère.
— Qu’est-ce qu’on mange, ce soir ?
— Poulet yassa.
À 21 heures, les senteurs de l’Afrique envahissent le plateau. Je vide mon assiette, descends fumer et profite de l’inattention pour télécharger la série de photos que j’ai prises avec mon iPhone en attendant l’arrivée de Walter White.
J’affiche la première en plein écran.
Je me trouvais à cinq ou six mètres du corps.
Bernier a opté pour une balle sous le menton. La tête rejetée en arrière laisse apparaître le point d’entrée du projectile.
Selon une dépêche que j’ai lue il y a quelque temps, ce n’est pas la méthode la plus efficace. Si le coup est tiré vers le haut, le recul risque de dévier le canon et la balle peut manquer le cerveau. Dans le fait-divers en question, la bastos était restée coincée dans les sinus du gars. Il avait survécu et racontait que c’était comme se prendre un grand coup de poing dans la gueule.
Au vu des projections sur le mur et au plafond, Bernier n’a pas loupé son rendez-vous.
Je passe à la suivante.
Deux mètres.
Je découvre son visage. Gonflé, la bouche tordue, les yeux ouverts. Le reflet du flash rallume un semblant de vie dans ses prunelles.
La mort me fascine.
J’ai fait sa connaissance un 27 avril, quand j’avais dix ans. Pendant les longues semaines qui ont suivi, je me réveillais au milieu de la nuit. Dans la pénombre, je distinguais une silhouette en partie dissimulée derrière mon armoire. Elle se découpait sur les tentures de la chambre. Elle paraissait immobile mais, quand je plissais les yeux, je la voyais bouger. Ce n’étaient que d’infimes mouvements, à peine perceptibles, une sorte de balancement monotone.
J’étais tétanisé, incapable de crier ou de sortir du lit. Tremblant de peur sous les draps, je gardais les bras croisés sur la poitrine et ne laissais passer que le haut de mon visage. Après une éternité, elle surgissait de sa cachette, filait à toute allure devant moi et disparaissait.
Peu à peu, j’ai fini par connaître son manège et m’habituer à sa présence.
Une nuit, alors qu’elle allait s’échapper, j’ai soulevé la couverture et tendu un pied hors du lit. Elle s’est arrêtée net, m’a attrapé la cheville et a mordu mon gros orteil avant de s’évanouir dans la nuit.
Au réveil, j’ai attendu que mon père parte travailler pour raconter l’histoire à ma mère. Elle m’a écouté, puis m’a ausculté les doigts de pieds. Une marque rouge barrait mon orteil. Un demi-cercle, comme la morsure d’un animal.
Aujourd’hui encore, je reste persuadé que je ne rêvais pas, que mon calvaire commençait.
Je poursuis l’analyse des images en triturant mon briquet. Profil gauche, profil droit, de face, j’en ai pris un paquet.
Je zoome sur quelques plans, obnubilé par l’expression du cadavre.
— Qu’est-ce que tu caches, Régis ?
Pour finir, j’ai mitraillé le salon.
Je referme les fichiers.
Chaque année, plus de deux mille Belges se donnent la mort. Un de plus, un de moins, tout le monde s’en fout. Pourtant, je veux savoir, avant d’y aller à mon tour.
Je chasse cette idée, en appelle une autre.
Dans six jours, ma nuit avec Camille.
Notre histoire n’a pas démarré au quart de tour. Le prologue a été aussi long que délicieux.
Les premiers temps, nous échangions quelques SMS, par intermittence. En règle générale, elle prenait l’initiative. Elle me racontait les anecdotes qui ponctuaient ses journées, les demandes saugrenues des clients, les situations cocasses. La femme qui voulait un bouquin ni trop triste ni trop gai. Celle qui cherchait un ouvrage sur le paranormal parce qu’elle était entrée en communication avec son chat mort, ou encore ceux qui charcutaient les titres, La Somme noire de Zola, Les quatre filles du docteur marchent dans la prairie.
Je me régalais.
Elle maniait humour et tendresse avec brio. Je lui répondais sur le même mode, dans l’instant, ou quelques heures plus tard. Le vouvoiement était de mise.
Je la sentais attirée, sans comprendre pourquoi. Ses relances incessantes et la fréquence de nos échanges m’intriguaient, même si le contenu de ses messages ne laissait en rien supposer qu’elle cherchait autre chose qu’un simple divertissement.
Un jour, je suis retourné à la librairie.
Dès qu’elle est apparue, je me suis mis à bafouiller. Entre deux borborygmes, je suis parvenu à lui proposer un café. Elle a accepté. Au long du quart d’heure qu’a duré l’épreuve, j’ai enfilé banalités et tartes à la crème. Je tentais de lui retracer les aventures tragicomiques vécues à la rédaction, mais ça tombait à plat.
Elle me fixait, l’air amusé.
Je m’entendais chercher mes mots, conscient de sombrer dans l’abîme sans fond de la débilité. Moi qui avais la réputation de n’avoir peur de rien, de braver les pires dangers, de me lancer sans état d’âme à l’assaut des citadelles inviolables, je me prenais un râteau magistral.
Au moment de nous quitter, je n’ai pas osé lui faire la bise. Je lui ai serré la main, persuadé que je ne recevrais plus de ses nouvelles. J’ai fumé clope sur clope pour me calmer.
Une demi-heure plus tard, elle m’a envoyé un texto.
Vous avez été nul. Je vous offre une deuxième chance. Mardi prochain ? Je termine à 19 heures.
Vers minuit, l’agence Belga annonce qu’un acteur a été grièvement blessé lors du spectacle du bicentenaire de Waterloo.
J’hésite à mettre en ligne. Je fais appel à l’équipe.
Vanessa hausse les épaules.
— Pourquoi pas ? On n’a rien de mieux pour l’instant.
Je commence à éditer la dépêche quand mon téléphone vibre. Je le coince contre ma joue et continue à écrire.
Jeremy hurle pour couvrir la techno.
— Je suis à la Mezza avec toute la mif, t’es où ?
— Ne gueule pas comme ça. Je bosse.
— Faut que tu rappliques. C’est full people. Cougars à gogo. Si tu veux t’envoyer une vioque, c’est le moment.
Selon sa pyramide des âges, vioque et cougar, c’est entre trente et trente-cinq ans. Camille, dont il ignore l’existence, en a trente-deux.
Je fais un rapide calcul. Je termine dans une heure. Demain, je reprends l’horaire de jour. Si j’y vais, je peux compter sur deux ou trois heures de sommeil, au mieux.
Je m’apprête à décliner, mais mon iPhone m’échappe des mains, le genre d’incident qui se produit deux ou trois fois par semaine. J’ai un abonnement à l’Apple Store du coin, le responsable du service après-vente est devenu un pote.
Je me penche pour le ramasser.
— Le flingue !
La voix lointaine de Jeremy tremblote sur le plancher.
— Quoi ? Qu’est-ce que tu dis ? Le dingue ?
— Je te rappelle.
Je raccroche, attrape ma souris et rouvre les photos du matin. Je savais que j’avais loupé quelque chose. Si un type se tire une balle à bout portant, l’arme devrait tomber sur ses genoux ou à ses pieds.
Je consulte les images. Rien.
— Bordel de merde, où est passé ce calibre ?
Alertés, Vanessa et Pierre s’approchent.
Elle fait aussitôt un pas en arrière.
— Beurk, c’est dégueu !
Pierre se penche vers l’écran avec un rictus de dégoût.
— Qu’est-ce que tu cherches ?
— Le flingue. Tu le vois quelque part ?
Il parcourt les photos et termine par celles que j’ai prises de la pièce.
Il pointe son index.
— Là.
Le pistolet se trouve sous le bureau, à quelques mètres du macchabée. Sauf tour de passe-passe, je ne vois pas comment il a atterri là.
Vanessa surmonte sa nausée, une main sur la bouche.
— Vous avez vu, sur le bureau ?
Je colle mon nez sur la photo.
— Qu’est-ce qu’il y a ?
— Un écran, un clavier, une imprimante, une station d’accueil, mais l’ordi s’est envolé.
VENDREDI 19 JUIN 2015
7. L’aigle du désert
Après quelques sautillements, l’image se stabilise et Sébastien Mousse apparaît à l’écran.
— Salut, Seb.
Il règle la caméra, élargit le plan. Il entame son petit déjeuner, assis dans sa cuisine.
— Salut, mec.
Je jette un coup d’œil à l’insert vidéo. Je suis dans un triste état, en calcif dans mon canapé, la clope au bec, au milieu du chaos habituel.
Je n’aurais pas dû lui proposer un appel Skype à 7 heures du mat. Quand je l’ai contacté avant de quitter le journal, je ne pensais pas que je succomberais à la tentation et rejoindrais Jeremy. Le jour se levait au moment où je suis rentré.
J’ai la cervelle au point mort et j’affiche la trogne d’un déterré.
Il fait la grimace.
— Tu as bien fait de m’appeler.
Sébastien est thanatopracteur dans la région du Havre. Son job consiste à redonner une apparence respectable aux défunts.
— Nuit sans lune et téquila cannelle.
— Il y a du boulot.
À sa place, je ne la ramènerais pas. Même sans gueule de bois, il a le teint cireux. Il n’a plus un poil sur le caillou et porte de fines lunettes fumées derrière lesquelles ses yeux globuleux bougent par à-coups, comme ceux d’un reptile.
Je tente un sourire.
— Ça ira mieux après quatre cafés.
Je l’ai rencontré à Paris, il y a trois ans. Je suivais une formation sur un logiciel danois, il participait à un colloque consacré à son art. On a sympathisé. Il est l’un des rares à qui je me suis confié, un soir, au bar de l’hôtel.
Nous étions un peu saouls. Après avoir discuté de nos métiers respectifs, il est parti dans une tirade grandiloquente.
« Tu penses, depuis le temps que je fréquente la mort, je commence à la connaître. Les survies miraculeuses et les suicides ratés, ça n’existe pas. Ce ne sont ni des coups de chance pour les uns ni de la maladresse pour les autres. C’est elle qui décide. N’essaie pas de la baiser. Les mecs qui vont clamser savent quand leur heure est arrivée. Ils le sentent dans les genoux ou les dents, quelques jours ou quelques heures avant. Parfois, elle bluffe. Elle entrouvre les portes de son royaume pour te faire miroiter des perspectives prometteuses, comme une pute qui écarte les pans de sa robe. La Faucheuse est une redoutable tentatrice. »
L’alcool aidant, j’ai embrayé. Je lui ai confié ce que je gardais au fond de moi. Je lui ai parlé de Greg, de la silhouette et de l’expérience que j’avais vécue peu après.
J’avais douze ans. Je passais mes vacances avec mes parents, du côté de Royan. Je restais des heures à la plage, seul, au bord de l’eau. Allongé sur mon matelas pneumatique, j’adorais affronter les vagues.
À d’autres moments, quand la mer était calme, je me laissais aller au gré de la marée en admirant les fonds marins à travers la fenêtre en plastique.
Un après-midi, le courant m’a emporté vers le large sans que je m’en aperçoive. Après un temps, je me suis retourné et j’ai constaté que j’avais dérivé. Je discernais les gens au loin, sur la plage, minuscules.
J’ai balisé. J’ai fait de grands moulinets avec les bras pour revenir vers la côte. Je me battais contre les flots en hurlant. Au lieu d’avancer, j’avais le sentiment de m’éloigner à chaque mouvement.
La flotte devenait de plus en plus froide. J’ai compris que je ne m’en sortirais pas. Il fallait que je quitte le matelas. Quand je l’ai abandonné, mes jambes se sont enfoncées, aspirées par le fond.
Je sanglotais, je claquais des dents. J’ai commencé à nager. Une vague a déferlé et j’ai bu la tasse. L’eau était noire, salée. J’ai toussé, craché. Mes poumons étaient en feu. J’étais épuisé. Peu à peu, mes forces m’ont quitté. Une certitude m’a envahi. J’avais douze ans. À mon tour, j’allais mourir.
Une crampe m’a foudroyé la jambe. J’ai avalé une deuxième tasse, puis une troisième.
Avant de couler, j’ai appelé ma mère. Peine perdue, elle somnolait sous un parasol. Quant à mon père, il s’en foutait.
Sans que je puisse l’expliquer, j’ai arrêté d’avoir peur. Une douce léthargie m’a envahi.
Peu à peu, elle a fait place à une sensation de bien-être. Des lumières se sont mises à clignoter devant mes yeux. J’étais bien. Je flottais dans un univers féerique. Mon corps ne m’appartenait plus. Je l’ai quitté. Je l’ai vu sombrer lentement dans les profondeurs de l’océan.
La silhouette est apparue et je me suis laissé aller dans ses bras. Au moment de m’en aller avec elle, j’ai éprouvé un choc et j’ai ouvert les yeux.
Des visages étaient penchés sur moi. J’étais allongé sur le sable, le sol tanguait. Un homme me faisait du bouche-à-bouche. Je sentais ses lèvres chaudes contre les miennes, son souffle envahissait mes poumons.
Debout derrière lui, Greg se moquait de moi.
J’avais la nausée. Mes jambes, mes bras, mon ventre me faisaient mal.
Une pensée dominait.
Pourquoi ne m’ont-ils pas laissé mourir ?
Sébastien m’arrache à ma rêverie.
— Dis-moi, c’est pour pieuter en calbar devant ton écran que tu m’appelles ?
Je secoue la tête, allume une cigarette.
— Excuse-moi.
Il attrape un croissant.
— Alors ?
Je lui raconte l’histoire, depuis l’appel anonyme jusqu’à l’absence de l’ordinateur en mettant l’accent sur le flingue découvert sous le bureau.
Il avale une gorgée de café.
— Envoie les images.
Il disparaît de l’écran. La première photo du cadavre de Régis Bernier prend la relève.
— Les flics ont prétendu qu’il était mort depuis au moins trois jours.
Sa voix résonne en arrière-plan.
— Mouais. L’odeur ? Tu as vu des mouches ?
— Ça puait, mais pas de mouches. À part la porte de derrière, la bicoque était fermée.
— Passe aux suivantes.
J’aligne la série.
— Qu’est-ce que tu en penses ?
— Tir à bout touchant avec explosion de la boîte crânienne. La matière cérébrale a giclé partout, ce qui signifie flagrance importante de l’odeur du sang et de la poudre. En lieu clos, c’est ce qui prédomine. La tache verte abdominale au niveau du cæcum apparaît entre quarante-huit et soixante-douze heures après. Là, nous sommes en départ de putréfaction. Je valide les trois jours.
D’après les bruits de déglutition, il commente les photos en poursuivant son repas.
— Bon ap’. Je te montre le flingue.
Il zoome sur l’image et siffle d’admiration.
— Desert Eagle, pas mal.
Je n’avais pas identifié le modèle, c’est pourtant l’un des rares que je connaisse. Lara Croft en avait fait son arme de prédilection.
— Tu as vu où il se trouve ? Il est loin du macchabée. Ça n’a pas l’air d’avoir troublé les flics.
— Ça peut s’expliquer. Considérant le recul de ce bijou, tu peux être sûr de te le prendre dans la gueule la première fois que tu l’utilises, surtout si tu n’as jamais fait de tir. C’est une des pires armes de collectionneur.
— Donc, plausible ?
Il hésite.
— Si c’était son baptême du feu, le pistolet a pu valdinguer mais, dans ce cas, il se serait probablement loupé. J’en ai un comme ça, dans mon bled. Il a foiré son coup et s’est fait sauter le maxillaire. Maintenant, il se trimballe avec la gueule cassée, genre 14–18. En plus, il a repris goût à la vie. Pour la drague, je te dis pas.
— En deux mots, si le type s’en servait pour la première fois, c’est possible. Si c’était un habitué de la gâchette, il y a une couille dans le potage.
— On peut dire ça.
— Merci, Seb. Je te laisse rafistoler tes viandes.
Je me déconnecte.
Ce mort m’obsède. Si Bernier était novice en matière d’armes, l’affaire s’arrête là. Il s’est tiré une balle dans la tête et a réussi son coup malgré le recul. Le Desert Eagle a rebondi sur ses genoux et est allé se nicher sous le bureau.
Pour l’appel téléphonique et l’ordinateur manquant, une explication doit exister. Enfin, je suppose.
Autrement, la théorie du flingue volant s’écroule.
Ça change la donne. Rien ne dit que le Desert Eagle appartenait à Bernier. Il s’agirait d’un meurtre camouflé en suicide.
Je tente de construire un scénario.
Le tueur se pointe chez Bernier dimanche avant 19 heures.
Il fait péter la porte, le menace et lui pique son téléphone. Il efface les messages vocaux, la liste des appels et les SMS, puis désactive la messagerie à 19 h 07. Ensuite, il cuisine le type. Gentiment. Si le corps de Bernier portait des traces de torture, les flics l’auraient remarqué et la Crim serait venue.
À minuit, le tueur décide d’en finir et lui tire une balle dans la tête, puis file avec l’ordinateur et le téléphone.
Tout tient.
Sauf deux choses.
Pourquoi commet-il l’erreur de mettre le Desert Eagle sous le bureau, alors que le meurtre était parfait ?
Secundo, de qui provient cet appel, trois jours plus tard ?
Ça ne colle pas.
Mes profs m’ont appris que la mission du journaliste était de se documenter, d’observer les faits sans interprétation, de décortiquer l’actualité et d’utiliser ses connaissances pour faire une analyse pertinente.
Si l’on s’en tenait à ce seul principe, sans aller plus loin, sans remuer un peu la fange, il n’y aurait ni affaire Luxleaks ni scandale du Watergate. Silvio Berlusconi et Jérôme Cahuzac seraient blancs comme neige, on ignorerait que les Américains ont mis en place un programme d’espionnage du Web et personne ne saurait qu’il y a du pétrole et des résidus de silicone dans les frites de chez McDonald’s.
Le moment est venu de donner un peu de piment à ma vie professionnelle.
8. Vivo per lei
7 h 55.
Un lingot de plomb brinquebale dans mon crâne.
Pierre et Alfredo sont à pied d’œuvre depuis un bon moment. Ils ont démarré à 6 heures pour parcourir les dépêches de la nuit et lancer les premiers titres.
Alfredo me regarde approcher, l’œil goguenard.
— Viva Brasil.
Je mets un temps avant de faire le lien avec ma chemise jaune et mon pantalon vert.
En guise de réponse, je souffle dans mon poing et imite le bruit d’une vuvuzela.
Je vis en couleurs. Je hais le noir, le blanc et les dégradés de gris cafardeux. La plupart des gens ont l’air de sortir d’un enterrement. J’aime le rouge pétant, l’orange fluo, le jaune citron, le vert pistache. Les couleurs illuminent la vie. Été comme hiver, je ressemble au drapeau de la Gay Pride.
Pierre fait tinter de la monnaie dans sa main et se lève.
— Café ? J’ai l’impression que tu en as besoin.
— Merci, avec deux aspirines et beaucoup de sucre.
Je le regarde s’éloigner.
Ma discussion avec Seb n’a fait qu’embrouiller les choses. Mon imagination me joue des tours.
Simplifions.
Bernier a voulu en finir avec la vie. Il s’est payé un flingue capable d’arrêter une charge de rhino et s’est fait sauter le caisson. Le recul a envoyé son joujou sous le bureau. Trois jours plus tard, le facteur, un voisin ou le laitier a découvert son cadavre. Au lieu de prévenir les flics qui lui auraient posé un tas de questions, le type a préféré téléphoner à un journaliste. Quant à l’ordi, il est cassé ou en réparation.
Point.
Fin du thriller.
Pierre revient avec les jus et la Bomba dans son sillage.
Elle me dévisage, se penche et murmure dans mon oreille.
— Nuit d’ivresse ou nuit d’amour ?
Nos parties de jambes en l’air sont épisodiques. La dernière en date remonte à quelques semaines. Sa vie sexuelle est mouvementée. Elle collectionne les partenaires. Malgré ça, elle aimerait que je sois tout à elle.
Je lui adresse un clin d’œil.
— Curiosité ou jalousie ?
— J’hésite. Passe chez moi demain soir, on va approfondir la question.
À 9 h 58, Christophe se dirige vers la salle de conférences en rameutant les troupes.
— C’est l’heure.
Je prends mon téléphone, mon PC, mon iPad et lui emboîte le pas.
La réunion de rédaction est un moment-clé. Tous les chefs de service y participent. Éloïse et moi devons y rendre compte de l’activité Web et mettre à jour la feuille de route.
Je me dirige vers le fond de la salle et m’affale sur une chaise. Le trajet m’a épuisé. Mes jambes pèsent une tonne, j’ai la bouche sèche et mes oreilles bourdonnent.
La séance est ouverte.
Le score d’audience du Soir en ligne. Stable. En moyenne, nous attirons quelque 250 000 visiteurs par jour.
Les articles les plus consultés. Éloïse énumère les clics et les retweets sur Twitter, le nombre de likes et de partages sur la page Facebook.
Place à la politique intérieure.
Je somnole en faisant tourner mon paquet de cigarettes pendant que la responsable critique l’attitude de la ministre de l’Éducation. Quand l’intervention touche à sa fin, l’écran de mon iPhone s’allume pour m’informer de l’arrivée d’un message.
Camille.
Laquelle ?
Une photo suit.
Robe turquoise. Elle est en équilibre sur un pied, bras tendus au-dessus de la tête, dans la posture d’une danseuse classique.
D’une main, je masque mon sourire.
Deuxième image. Jupe plissée jaune, chemisier à fleurs. Une jambe vers l’avant, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux exorbités. Une expression de terreur déforme ses traits.
Les actu du monde. Les Grecs vident leurs comptes.
J’ouvre la troisième en retenant ma respiration.
Pantalon rouge vif, débardeur bariolé. Elle se tient de profil, le buste tordu, les bras en angle droit, style bas-relief égyptien.
Économie. Le manager de l’année. Ceux qui l’ont précédé ont-ils confirmé le bien qu’on pensait d’eux ? Une enquête sur la question serait judicieuse.
Je la joue discret et lui envoie ma réponse.
Celle où tu es poursuivie par des zombies.
Notre deuxième rencontre a été culte. Nous nous la repassons souvent.
Je voulais éviter de tomber dans le même traquenard que la première fois. Je devais rattraper mon retard et rétablir un semblant d’équilibre.
J’ai longuement réfléchi.
Le mardi suivant, je suis allé au rendez-vous à l’heure fixée, affublé d’une veste mauve et de baskets assorties.
J’ai pris l’air sûr de moi et lui ai fait la bise.
— J’ai réservé une table dans un resto, mais avant, j’aimerais vous montrer quelque chose.
Je l’ai fait monter dans ma voiture, lavée, aspirée et débarrassée de l’odeur de clope et je l’ai emmenée au bar karaoké du Sablon. Nous nous sommes assis côte à côte et j’ai commandé deux verres au serveur avant d’aller au comptoir en roulant des épaules pour sélectionner une chanson.
Elle en a déduit que j’étais un ténor égocentrique et que je l’avais emmenée là pour la faire baver d’admiration.
Quand mon tour est venu de monter sur scène, je lui ai annoncé que j’avais choisi « Vivo per lei », un duo en italien.
Je me suis levé, lui ai tendu la main.
— Vous m’accompagnez ?
Elle a sauté sur ses deux pieds.
— À vos risques et périls.
Les accords de l’intro ont résonné.
L’œil larmoyant, une main sur le cœur, je me suis lancé.
Côté paroles, c’était nickel, ma mère est italienne. En revanche, ça craignait au niveau de la mélodie : je chante comme une corne de brume.
Elle a éclaté de rire. Après le premier couplet, je l’ai prise par la taille. Elle a ébouriffé sa chevelure et a embrayé.
Une catastrophe.
Les premiers sifflets ont retenti. En quelques secondes, la salle entière nous huait. Indifférents aux gens qui gueulaient, nous échangions des regards kitsch-langoureux. Nous vivions notre délire comme des ados de quinze ans.
Depuis, notre jardin secret est fait de rires, de complicité et de moments de grâce.
Culture. La rentrée littéraire se prépare. Qu’ils en finissent, j’ai envie d’allumer une clope. Les Who fêteront leur demi-siècle d’existence au Zénith, le 30 juin.
Quand je pense qu’au début des sixties Pete Townshend hurlait sur scène qu’il espérait mourir avant d’être vieux. Tu manques de cohérence, Pete, mais tu avais raison. Il faut savoir partir au bon moment pour entrer dans la légende. Je ne suivrai pas ta voie.
Éloïse a remarqué mon manège et me lance un regard réprobateur.
Société, vie quotidienne.
Une idée me traverse l’esprit. J’ouvre mon ordinateur et me rends sur la page de Sudinfo, un canard régional qui fait partie du groupe. Onglet Régions. Choisir la province. Luxembourg. Dans le menu déroulant, Nécrologies. Introduire le nom du défunt.
Régis Bernier.
Voir l’annonce.
Elle est courte et anonyme.
On nous prie d’annoncer le décès de
Monsieur Régis Bernier
né à Mons le 29 mai 1959
et décédé à Grand-Hez le 14 juin 2015.
La cérémonie civile de crémation aura lieu dans l’intimité le lundi 22 juin à 8 heures.
Rendez-vous à 9 h 45 au cimetière de Bouillon, 3 route de Florenville, pour la dispersion des cendres.
Cet avis tient lieu de faire-part.
« On » nous prie ? Qui est ce « on » ?
« Dans l’intimité » ? Qui en fait partie ?
Les sports. Chelsea veut Witsel à tout prix. On parle de 25 millions d’euros.
Fin des débats, tour de table rituel du rédac-chef.
— Avez-vous des sujets à proposer qui méritent d’être développés ?
Il termine en me fixant dans les yeux. Il n’est pas dupe, il a remarqué que j’émergeais de la brume. Il apprécie mon travail, mais il sait que ma fiabilité est à géométrie variable.
— Fred ?
J’hésite quelques instants.
— Rien de spécial.
La séance est levée.
Je retourne à mon bureau, consulte les horaires de la semaine prochaine et apostrophe Alfredo.
— Tu pourrais me remplacer lundi matin ? J’ai un truc à faire.
LUNDI 22 JUIN 2015
9. Lexus in memoriam
Je grimpe l’allée qui mène au cimetière de Bouillon sous un fin crachin. J’ai l’impression de jouer dans un film de Gus Van Sant.
Je comptais passer incognito dans la foule compacte, mais moins de douze parapluies attendent l’arrivée du convoi devant la grille d’entrée. Des quinquas pour la plupart, empaquetés dans leur manteau monochrome.
Famille ? Amis ? Curieux ? Accros aux enterrements ? J’ai lu qu’un Brésilien assistait à toutes les funérailles qui se déroulaient dans son bled. Pour être sûr de ne pas en louper, il débutait ses journées par un coup de fil aux hostos du coin.
Je reste à l’écart en faisant les cent pas. Ma présence les intrigue. Je capte quelques regards. Les commentaires vont bon train.
J’allume une cigarette et observe les lieux.
Dans une des allées, une femme rafistole les gerbes de fleurs qui tapissent un monticule de terre fraîche. Plus loin, un homme se recueille sur une tombe, indifférent à la pluie qui lui tombe sur le crâne.
Je jette un coup d’œil à mon téléphone.
9 h 50.
Qu’est-ce qu’ils foutent ?
Samedi soir, j’ai accepté l’invitation d’Éloïse, mais j’ai changé d’avis à la dernière minute, attitude courante que je mets sur le compte de l’intuition du moment. Mes proches appellent ça ma versatilité proverbiale, mon père, mon manque de cervelle.
J’ai préféré rejoindre Jeremy et les autres à la Fête de la musique, au parc du Cinquantenaire. Robbing Millions, Mountain Bike, The Herbaliser. Si mes compétences vocales n’étaient pas ce qu’elles sont, j’aurais fait rock star.
Dimanche, j’ai remplacé Alfredo.
Mon téléphone vibre.
Texto de Camille.
Ton mort ?
J’écrase ma cigarette, en allume une autre.
En retard. Ça n’a pas encore commencé.
Nouvelle vibration.
J’espère qu’il ne lui est rien arrivé.
L’une des pleureuses s’anime.
— Les voilà.
Un fourgon funéraire emprunte la ruelle qui mène au cimetière. Seul un taxi le suit.
Les véhicules passent à ma hauteur et s’immobilisent dans l’allée centrale. Les portières s’ouvrent, les croque-morts descendent.
Derrière, une femme dans la cinquantaine sort du taxi. Imperméable beige, parapluie rouge, le visage accueillant d’une prof d’histoire. Elle a zappé l’uniforme de circonstance. Elle doit être l’ex-madame, la compagne ou la dernière maîtresse du défunt.
D’une main gantée, elle adresse un signe aux gens venus la soutenir dans cette épreuve. Elle est suivie de près par le chauffeur du tacot.
Un des employés des pompes funèbres soulève le hayon du corbillard, s’empare de l’urne funéraire et la remet à la veuve présumée.
Elle amorce un mouvement de recul avant de la prendre du bout des doigts, avec une moue de dégoût, comme s’il s’agissait d’un pot de chambre.
Monsieur Taxi lui lance un regard hostile et la lui retire des mains. J’en déduis qu’il tient un rôle de premier plan dans la tragédie.
Les funérailles sont propices aux règlements de comptes. À Miami, des inconnus armés de fusils d’assaut ont arrosé une foule massée à l’extérieur d’un funérarium. Bilan : deux morts, douze blessés. Je ne compte pas le cadavre dans la boîte.
L’un des fossoyeurs ouvre la voie tandis que son collègue reste près de la camionnette. La procession se met en marche. La femme qui arrangeait les fleurs se joint au mouvement. Plus on est de fous.
Je les suis à distance respectable en observant le porteur de cendres. On peut fumer dans les cimetières ?
J’imagine qu’il pourrait être le rejeton de Régis Bernier. Dans les vingt-cinq ans. Allure fluette, tifs noirs, teint blême. Il flotte dans son jeans et sa veste militaire. Un anneau traverse l’un de ses sourcils. Le prototype du gringalet qui aimerait en imposer, mais n’en impose pas.
Arrivée d’un SMS.
Ilian.
Slt je cherche une polo ou une golf d’occaz ds les 5000 si tu connais qq
Ilian ne met jamais de point final à ses messages. Avec lui, il n’y a jamais de point final. Il est capable d’échanger une centaine de SMS pour expliquer qu’il n’a rien à dire.
Le trio de tête s’arrête au bord d’une pelouse et attend le solde du peloton. Le moutard échange quelques mots avec le croque-mort, avance de quelques pas, ouvre le couvercle et retourne l’urne.
Les cendres s’éparpillent dans le vent et la pluie.
On finit seul, Régis.
Quand mon tour viendra, je léguerai mon corps à la science. Avec un peu de chance, mon cœur, mes poumons et mon foie me survivront. Au pire, je servirai la cause des carabins. Un étudiant en médecine enfoncera mes doigts dans le camembert d’un camarade, un autre glissera mes oreilles ou autre chose dans la poche de sa petite amie.
Une forme attire mon attention.
L’homme qui se recueillait est toujours là, immobile dans la flotte. À la différence qu’il est devant une autre tombe, placée dans l’axe. Grand, costaud, blond, la quarantaine. Bien qu’il ait la tête penchée en avant, il regarde dans notre direction.
J’essaie de discerner ses traits, la distance et l’averse m’en empêchent.
La cérémonie touche à sa fin. La femme n’a pas prononcé un mot, elle ne semble pas rongée par le chagrin. Le gamin a fait un effort pour rester stoïque, mais son visage est marqué.
Ils se retournent et se mettent côte à côte pour recevoir accolades et poignées de main.
Passé le dernier hommage, ils me regardent, l’air interrogateur.
Je fais quelques pas et m’adresse au fiston.
— Je vous présente mes condoléances.
Il m’agresse du menton.
— Vous êtes qui ?
Je sors ma carte de visite.
— Je souhaiterais vous parler. Pourriez-vous prendre contact avec moi ?
Il examine le carton, m’inspecte de haut en bas.
— Pourquoi ?
— Je suis journaliste.
En arrière-plan, le grand blond se dirige vers la sortie en longeant le mur d’enceinte.
Il poursuit d’un ton menaçant.
— Vous êtes journaliste ? Et après ? Vous connaissiez mon père ?
— J’étais chez lui jeudi matin. C’est moi qui l’ai trouvé et qui ai prévenu la police.
— Qu’est-ce que vous faisiez là-bas ?
Je jette un coup d’œil derrière lui.
L’homme presse le pas, jette un coup d’œil vers l’endroit où nous sommes et quitte le cimetière.
— Appelez-moi, je vous expliquerai.
Je tourne les talons et m’élance vers le portail.
J’émerge au moment où l’homme atteint le bas de la ruelle. Il traverse la chaussée, entre dans une Lexus garée en face et démarre en trombe.
10. Cold Case
Retour sur Bouillon. Son air pur, son château fort, son parc animalier.
Ça me rappelle quelque chose. C’était il y a cinq ans, après une teuf d’enfer au Roxy, une boîte branchée d’Anvers où on était venus en force par le train.
À l’aube, bien chargés, on a repris le chemin de la gare. Il nous restait une heure à attendre avant le premier train. Jeremy nous a proposé une visite privée du zoo adjacent à la station. On a escaladé les grilles et entamé le tour du propriétaire, rythmé par les commentaires du maître de cérémonie.
« Une girafe, un gnou, un zèbre. »
À un moment, on s’est retrouvés devant l’enclos des lions.
Une idée a germé.
« Qui veut une photo de moi avec le gros matou ? »
Ils ont réagi au quart de tour.
« Chiche !
— Dix euros la tête. »
Ils ont opiné.
« Sortez vos téléphones. »
En plus de l’aire d’observation, une passerelle surplombait le site. J’ai grimpé dessus, j’ai enjambé le parapet et suis descendu le long des rochers.
Arrivé au sol, j’ai évalué le risque.
Le roi de la jungle était en vue, allongé sur le sable. Il m’a repéré, a ouvert un œil et levé la tête.
Une légende prétend que le lion est un flemmard. Il pionce vingt heures par jour pendant que madame gère la boutique et fait les courses.
Les jambes flageolantes, j’ai traversé la brousse à toute vitesse vers la clique. Appareils en joue, ils s’éclataient. Une étendue d’eau et un mur de roche les protégeaient des fauves.
Je me suis planté face à eux, les doigts en V, et j’ai affiché un sourire crispé. Les flashs ont crépité et ils ont arrêté de se marrer.
Je me suis retourné. Mufasa venait vers moi à pas feutrés. Surgie de l’ombre, sa copine en faisait autant, ventre à terre, prête à bondir.
J’ai plongé dans la mare.
L’eau froide m’a en partie dessaoulé. J’ai pataugé jusqu’à la berge et escaladé la muraille en m’attendant à sentir leurs crocs se refermer sur mes fesses.
Les autres m’ont hissé par-dessus la barrière en hurlant comme les passagers d’un Boeing en flammes.
Je claquais des dents, j’étais trempé. Par chance, ils n’ont pas vu que je m’étais pissé dessus. Alerté par les cris, le veilleur de nuit s’est pointé. Il voulait appeler les flics, mais Jeremy est parvenu à le faire changer d’avis. Il a empoché le pourboire et m’a refilé quelques vêtements puants avant de nous foutre dehors.
Quand mon cœur a retrouvé son rythme normal, j’ai claqué dans mes doigts.
« Maintenant, le fric. »
Je conduis d’une main en envoyant un texto de l’autre.
Il repose en paix.
Camille me répond dans les cinq secondes.
C’était bien ?
Première à droite, direction les flics.
Drôle comme une symphonie de Rachmaninov.
Après notre performance au karaoké, les messages se sont multipliés. Nous continuions pourtant à nous vouvoyer. Cela donnait à nos échanges un côté léger, drôle et délicieusement désuet.
Peu à peu, le ton s’est réchauffé. Malgré la tournure plus intime, je n’osais pas franchir le pas de peur de me ramasser une gamelle.
En décembre, entre deux propos anodins, elle m’a coupé l’herbe sous le pied.
Succombez à la tentation, avant qu’elle s’éloigne — Casanova.
J’étais soufflé. Mon cœur a eu un raté.
Je suis allé retranscrire la citation dans les chiottes avant de lui répondre.
La vie est un mystère qu’il faut vivre — Gandhi.
Le commissariat se trouve dans l’allée de la Paroisse, un bâtiment moderne de briques blanches. Quelques places de stationnement attendent les clients devant l’édifice. Je me gare, en grille une avant d’entrer.
La fliquette à la Škoda est assise à l’accueil.
Elle me reconnaît et semble surprise de me voir débarquer.
— Je passais dans le coin, je souhaite faire ma déposition.
Elle hausse les sourcils.
— Je vais voir si mon collègue peut vous recevoir. Donnez-moi votre carte d’identité.
Elle file dans les coulisses avec le document.
Je fais le tour du hall et admire les affiches. La police recrute. Visites nocturnes au château. Une gamine a disparu. Fête médiévale les 8 et 9 août.
Walter White fait son apparition, pareil à lui-même, raide comme la colonne du Congrès.
— Suivez-moi.
Il me guide vers une salle encombrée de bureaux vides. Seul un autre flic est présent. Allongé dans son fauteuil, il regarde le paysage par la fenêtre, mains croisées derrière la nuque.
WW m’indique une chaise.
— Asseyez-vous. Je vous écoute.
Pas de cendrier sur la table. Une plaquette m’apprend qu’il s’appelle Jean-René Binamé.
— Je viens faire ma déposition au sujet de l’affaire Bernier.
Il me regarde d’un œil mort.
— Pour nous, ce dossier est classé.
Je me recule, effaré.
— Pardon ? Vous avez clos le dossier ? Pourquoi ?
— Pourquoi pas ?
— Comme je l’ai dit l’autre jour à votre supérieur, je suis journaliste au Soir. Mercredi dernier, j’ai reçu un coup de fil de quelqu’un qui m’a fixé rendez-vous le lendemain au domicile de M. Bernier, ce qui expliquait ma présence sur place.
— La personne qui vous a téléphoné vous a dit qu’il était Régis Bernier ?
— Non, il ne m’a pas donné son nom.
Il écarte les bras avec lassitude.
— Alors ?
— Comment cet homme savait que Régis Bernier était mort ?
— Il vous a dit que M. Régis Bernier était mort ?
Soit il a fait ses études chez les jésuites, soit il adore jouer au con.
Je hausse le ton.
— Cet homme avait des informations à me communiquer et prétendait être menacé. Quand je suis allé à l’adresse qu’il m’a indiquée, j’ai trouvé un type tué par balle. Ça arrive souvent dans votre région, ce genre de truc ?
Il reste imperturbable.
— Non.
— Vous n’avez pas l’air de croire à mon histoire. Je peux vous montrer la liste des appels que nous avons reçus ce jour-là. Vous constaterez que c’est bien le numéro de Régis Bernier qui m’a appelé.
— En effet, c’est curieux.
Je l’attaque par un autre angle.
— Vous êtes sûr qu’il s’agit d’un suicide ?
— Qu’est-ce qui pourrait vous faire croire que ce n’en est pas un ?
Ce type mérite l’oscar du dialogue de sourds.
Je me lève d’un bond.
— Dois-je m’adresser au commissariat général ?
Il m’indique la chaise du menton.
— Rasseyez-vous et calmez-vous. Le Labo est descendu sur les lieux. Ils ont trouvé les empreintes de M. Bernier sur le pistolet et des traces de poudre sur ses mains. Le trajet de la balle montre qu’il s’agit d’un coup tiré du bas vers le haut.
— Sauf que le pistolet se trouvait à trois mètres du cadavre.
— Oui, c’est dû au recul.
— Je savais que vous alliez me dire ça. L’arme était un Desert Eagle, un flingue de pro. Avec le recul, il aurait dû se rater.
Je pensais que sa mâchoire allait se décrocher.
Seule l’une de ses paupières frémit derrière ses hublots.
— Tout indique que c’est un suicide, rien que ça pourrait être autre chose. En plus, la famille le disait dépressif.
Tiens, du nouveau.
— Et après ? Si tous ceux qui broient du noir se tiraient une balle dans la tête, nous ne serions plus nombreux sur la planète.
Il tapote son sous-main.
— Nous savons que M. Bernier a envoyé un message électronique à son fils dimanche soir, peu avant de passer à l’acte.
— Il a annoncé à son fils qu’il allait se faire sauter la cervelle ?
— Pas de manière aussi claire. En tout cas, il ne l’a pas compris de cette façon. Vous savez, les histoires de famille, c’est parfois compliqué.
Je reste songeur.
Le problème n’est pas qu’il a écrit à son gamin ni de savoir ce que ce dernier a compris. La question est ailleurs.
Pour envoyer un message électronique, il faut se servir d’un smartphone ou d’un ordinateur.
27 minutes avant l’appel
À bout de souffle, le cœur tambourinant dans sa poitrine, elle arriva sur l’esplanade où un rassemblement se formait. Au centre, mégaphone poussé au maximum, un meneur lançait des slogans auxquels la foule répondait en chœur.
L’espace d’un instant, elle pensa à rebrousser chemin.
Les manifestants lui paraissaient particulièrement nerveux et menaçants. Lorsqu’elle avait remonté l’avenue, un groupe de casseurs armés de bâtons s’attaquait aux panneaux publicitaires et aux voitures en stationnement.
Elle était déjà intervenue dans des situations similaires. À plusieurs reprises, elle avait assisté à ce genre de scènes, mais cette fois, tout lui semblait différent.
Consciente que c’était en elle que les changements se produisaient, elle surmonta sa peur et se fraya un chemin dans l’attroupement.
11. Violation de domicile
Je me gare devant la maison de Régis Bernier.
L’idée n’est pas de moi, elle m’a été inspirée par Jean-René. Avant que je quitte le commissariat, il s’est montré catégorique.
« À toutes fins utiles, je vous informe que vous n’êtes pas autorisé à vous rendre au domicile de M. Bernier. »
L’imposante Mercedes n’a pas bougé.
J’allume une cigarette, observe les alentours.
Rien en vue.
Comme lors de ma première visite, je fais le tour de la maison et entre par la cuisine. Une fenêtre a été ouverte. Malgré le courant d’air, la puanteur s’est à peine dissipée. Où qu’elle aille, la mort laisse des traces de son passage.
Je parcours le couloir, pénètre dans le salon. Les stores ont été remontés, la lumière du jour permet de mieux cerner les lieux.
L’absence du cadavre fait tache. Je m’attendais à le trouver assis dans son canapé, prêt à me raconter son histoire.
Exit Bernier.
J’explore la pièce.
Décor minimaliste, ni tableaux ni photos aux murs. Mobilier tendance, home cinema, chaîne hi-fi haut de gamme. Le genre d’intérieur que l’on trouve chez les connards qui achètent un tas de trucs dont ils n’ont pas besoin. Pour certains, c’est une course à l’armement, le trophée de la frime. Rolex, bagnoles voyantes, tondeuse solaire et gadgets inutiles. Le tout pour impressionner des gens qu’ils détestent.
Un aquarium pharaonique est installé près de la fenêtre. Les occupants flottent à la surface, crevés, morts de faim.
Mon père en a un dans le même genre, en plus petit. Comme il n’a plus de fils, il a reporté son affection sur ses poiscailles. En plus d’être moche, son salon ressemble à un resto chinois.
À part la table basse qui a été déplacée pour transporter le corps, la maison est bien rangée. Pour un supposé dépressif, un tel souci du détail est étonnant. Sauf s’il y avait une meuf dans le parcours, ou s’il faisait appel à une aide-ménagère.
J’avance vers le divan et inspecte le sol à la recherche de la douille meurtrière.
Rien.
Je présume que les flics l’ont ramassée, tout comme le Desert Eagle.
Je contourne la table et m’assieds à l’endroit où se trouvait Bernier. J’inspire, pose mes coudes sur mes genoux et croise les mains, index pointés vers le haut.
Je baisse le menton jusqu’à ce que mes ongles s’enfoncent dans ma peau. J’imagine le contact du métal dans le creux de ma gorge.
Je ferme les yeux.
Qui t’a tué, Régis ?
« C’est elle qui décide. N’essaie pas de la baiser. Les mecs qui vont clamser savent quand leur heure est arrivée. »
Je presse la détente.
Un torrent de feu se répand dans mon crâne. Des lumières multicolores scintillent devant mes yeux.
La douleur s’estompe peu à peu et un sentiment de plénitude m’envahit. Je flotte entre deux mondes, la tête renversée sur le dossier, bercé par le crépitement de la pluie sur les vitres.
Un léger chuintement me sort de ma léthargie. L’ampli est resté allumé, les baffles ronronnent.
Je rouvre les yeux. Mon regard accroche une photo collée au mur, face au divan, dans l’ombre. Je serais passé à côté si je ne m’étais pas assis à la place de Bernier.
Je me lève.
De la taille d’un carton de bière, les bords dentelés comme dans les années 1950, elle est fixée à l’aide d’un bout de scotch. Elle représente une femme entre trente-cinq et quarante ans. Ni belle ni moche, standard. Cheveux noirs, menton volontaire, regard sombre. Elle affiche un sourire hésitant.
Je la retourne. Au dos, une annotation est inscrite à la main, au crayon rouge.
16 квітня 2014
Une date en tchèque, en russe ou je ne sais quoi.
Je la fourre dans ma poche, m’approche du lecteur CD et actionne l’ouverture du volet.
Depeche Mode, Violator.
Je parcours les colonnes de CD posées le long du mur. Montre-moi ta discothèque, je te dirai qui tu es. Led Zeppelin, les Stones, ZZ Top, du rock classique, classé par ordre alphabétique. Testostérone et décibels. Aucun album de California Breed, Rival Sons ou Scorpion Child.
Il faut que tu reviennes, Régis, j’ai des pépites à te faire découvrir.
Je m’approche du bureau. Les tiroirs sont ouverts, le contenu envolé.
Je saisis mon iPhone et consulte les photos. L’opération a été effectuée après ma première visite. La famille doit être en possession du contenu.
Sur le plan de travail, la station d’accueil me fait la nique. L’écran est une bête de course. Ni téléphone ni tablette en vue. Aucun papier, pas de clés de voiture, pas de factures, d’objets personnels, de cartes de visite, de photos de son fils, de Post-it ou de magnets rigolos, comme j’en ai sur mon frigo.
Je poursuis jusqu’à l’angle du salon. L’aile est en rénovation, une cheminée est en construction, des matériaux traînent au milieu de la surface.
J’allume une clope, reviens sur mes pas et monte à l’étage.
Une salle de fitness est installée dans la première pièce. Vélo, rameur, haltères et engins de torture médiévaux. Plus loin, une salle de bains, des chiottes et trois chambres à coucher dont deux sont rangées au carré, comme un dortoir de caserne.
La sienne n’est pas en reste. Le lit est fait. Dans l’armoire, les vestes sont pendues, les pantalons pliés sur des cintres, les chemises réparties par couleur, les piles millimétrées. Un peloton de godasses soigneusement cirées est aligné le long du mur.
À part un réveil réglé sur l’horloge atomique, la table de nuit est déserte. Les tiroirs aussi.
Ce vide sidéral me donne l’impression que Bernier vivait dans cette maison comme un voyageur à l’hôtel ou un moine bouddhiste dans une lamaserie quatre étoiles.
Je redescends, direction le sous-sol.
La porte résiste.
Je file un coup d’épaule. Ma basket vient à la rescousse. Le chambranle émet un craquement sec avant de céder. Les effluves nauséabonds font place à une odeur de renfermé, de poussière et d’humidité.
Je dévale l’escalier en baissant la tête et déboule dans une cave voûtée, basse de plafond.
À ma gauche, un cellier vitré laisse deviner une quantité de bouteilles, culs tournés vers l’avant. Si les crus sont au diapason de l’électronique embarquée, Bernier a de quoi flatter les palais les plus délicats.
La pièce du fond ressemble à l’atelier d’un bricoleur monomaniaque. L’établi est dégagé, les outils agencés sur un panneau perforé : clés, tournevis, pinces, niveau, scie, le tout classé par ordre de grandeur.
Dans la troisième partie, une imposante armoire métallique kaki occupe la largeur du mur.
Je l’ouvre et tombe en arrêt.
Fred 1 — Flics 0.
Je serais incapable d’énumérer les modèles et leur origine, mais on pourrait tenir le siège de Stalingrad avec ce que les rayonnages contiennent de pistolets, revolvers, fusils-mitrailleurs, grenades, munitions et autres machines à tuer.
12. Nos amies les bêtes
Camille tire ses conclusions.
— La théorie du meurtre déguisé en suicide reprend des couleurs. L’arsenal que tu as trouvé devrait pousser les flics à ouvrir une enquête.
— Pour eux, l’affaire est classée et il n’y a aucune raison pour qu’ils reprennent le dossier. Que veux-tu qu’ils fassent ? Qu’ils inculpent Bernier pour détention d’armes ? En plus, ils risqueraient de me coffrer pour violation de domicile.
Pour une fois, nos propos ne partent pas en vrille.
Dans notre monde, nous nous déconnectons de la réalité. Nous fuyons les lamentations, les plaintes, les jérémiades, les disputes et les reproches qui pourrissent le quotidien des couples légitimes.
— Ça prouve en tout cas que ton gars était familier avec les armes. La thèse du recul incontrôlable s’effondre.
— Sans doute, mais les flics s’en foutent, mon boss ne voudra plus en entendre parler et la famille ne semble pas effondrée par sa disparition.
— Tu ne vas pas laisser tomber, j’espère ?
— Non, mais pour l’instant, j’ai une priorité plus réjouissante qui m’attend. Peignoirs, terrasse et fruits de mer, ça nous rappellera Paris.
Il suffit d’un rien pour que nos conversations bifurquent et partent dans tous les sens, conformes à la vie rêvée que nous nous sommes inventée.
Son rire retentit.
— Paris ! J’ai des images. Où es-tu ?
— Devant la maison du mort, je pars maintenant.
— Bonne route, James.
Quelques jours après la citation de Casanova et l’invitation indirecte qu’elle supposait, elle a lancé l’offensive.
Paris, mardi prochain, ça vous dit ?
Elle y allait pour assister à une réunion de libraires. C’était quelques jours avant Noël.
Ma réponse a fusé.
Ça me dit.
Il me restait quelques jours pour me préparer psychologiquement.
Je m’imaginais dans un autre monde, un monde où tout était facile. Je fermais les yeux et mettais en scène notre rencontre.
Je l’attendais au bout du quai. Elle descendait du train, me cherchait du regard et courait au ralenti dans ma direction, sa longue robe blanche flottant dans son sillage. Une envolée de violons accompagnait la séquence. Elle se jetait dans mes bras, je la soulevais du sol et nous virevoltions comme mille soleils en échangeant un long baiser.
L’échéance approchant, mon angoisse grandissait et le scénario idyllique se transformait en film catastrophe.
Nous étions dans un bistrot bruyant, je me penchais pour l’embrasser, elle s’écartait et me flanquait une gifle retentissante.
Une autre fois, j’étais parvenu à entrer dans sa chambre. Elle était nue, allongée sur le lit et m’invitait d’un clignement des yeux à la rejoindre. Je me débarrassais en toute hâte de mes fringues. Mon calbar à peine largué, je subissais les affres de l’éjaculation prématurée et aspergeais la moquette de jets désordonnés.
Dans un autre épisode, je me voyais en panne sèche, balbutiant de vagues justifications, mon attirail inerte entre mes jambes.
Je lance un dernier coup d’œil à la maison de Bernier.
Qui est cette femme ? Quand cette photo a-t-elle été placée sur le mur ? Avant ? Après ? Par qui ? Quel rôle joue-t-elle dans cette affaire ?
J’écrase ma cigarette, m’apprête à prendre la route.
Sans pouvoir en déterminer la raison, j’ai l’impression d’être passé à côté de quelque chose. Un indice tellement flagrant que je l’ai ignoré. Je fais confiance à mon subconscient, il me renverra l’ascenseur en temps utile.
Une idée germe.
Je coupe le contact et sors de la voiture. La pluie a redoublé. Je rabats ma veste en capuchon et me dirige vers la maison du voisin.
J’ai à peine parcouru quelques mètres qu’il fait irruption. J’en déduis qu’il m’observait depuis un bon moment. Il se campe sur le pas de la porte, à l’abri des trombes d’eau sous un auvent vitré.
Je lui adresse un signe amical en m’approchant. Pas de réaction. Arrivé devant la barrière, je le salue d’un mouvement de tête.
Il reste de marbre. L’Ardennais a la réputation d’être réservé et volontaire. En langage courant : taiseux et borné.
Je mets mes mains en porte-voix, lui explique que je reviens des funérailles et lui demande s’il a cinq minutes à m’accorder.
Il brave l’averse et vient à ma rencontre.
— Vous étiez déjà là l’autre jour, non ?
Je prends l’air accablé.
— En effet, c’est moi qui l’ai découvert. Pauvre homme, quel drame. Vous le connaissiez bien ?
Il hésite.
En dehors de ses particularités régionales, l’Ardennais est comme tout le monde : curieux et indiscret.
— Entrez, vous êtes trempé.
Il s’écarte pour me laisser passer.
Il accuse la soixantaine finissante et présente le visage rubicond et le nez boursouflé des amateurs de péquet. Un tablier bleu dissimule en partie sa panse.
L’intérieur de la bicoque est sombre. Une odeur de chien mouillé et de café bouilli imprègne l’air. Le rez-de-chaussée est un tout-en-un. Salon, salle à manger et cuisine en enfilade.
Il m’indique un canapé en similicuir brun. Des napperons blancs protègent les accoudoirs. Prisonnière de son cadre en bois, une femme corpulente me dévisage avec gravité. Un ruban noir traverse l’un des coins. Feu madame la voisine.
— Asseyez-vous. Vous voulez un café ?
— Non merci, je n’en prends jamais.
En revanche, je fumerais bien une cigarette.
Je suis à peine assis que deux clébards se pointent en jappant. Petits, à poils longs, marque inconnue. Ils me grimpent dessus et me lèchent le visage.
L’Ardennais sourit. Il m’assure qu’ils vont se calmer. Ses clebs ne sont pas bien méchants.
Je lui rends son sourire.
— Pas de problème, j’adore les chiens.
Comme promis, ma toilette achevée, ils se couchent sur mes genoux.
Leur maître jette un coup d’œil à l’imposante horloge à balancier qui tictaque en sourdine.
— Une petite goutte ?
— Ce ne serait pas de refus.
Il va dans la cuisine, revient avec deux verres à moutarde et une bouteille sans étiquette. Il s’assied et me verse une généreuse rasade.
Je trempe mes lèvres. De la lave en fusion. Une boule de feu me monte au visage.
Il attaque, bille en tête.
— À ce qu’il paraît, il était mort depuis plusieurs jours.
— C’est ce que la police m’a appris jeudi matin.
Il dodeline en faisant tournoyer l’alcool dans son verre.
Il ne m’en dira pas plus si je ne lâche pas du lest. Autant lui révéler la vérité et faire ami-ami pour qu’il n’ameute pas les flics dès que j’aurai le dos tourné. Je lui déballe l’histoire en omettant l’arsenal trouvé dans la cave.
Il ouvre de grands yeux.
— Dites donc, quelle affaire !
Je profite de l’effet de surprise pour lui redemander s’il le connaissait bien.
Il se recule dans son fauteuil.
Bernier a acheté cette maison trois ans plus tôt, mais il n’était pas souvent là. Il a fait quelques rénovations après avoir emménagé. Il vivait seul et s’absentait tout le temps, parfois pour une durée de trois mois. Il revenait une semaine ou deux et repartait. Il a bien essayé d’entamer la conversation une fois ou deux, mais ça avait l’air de l’emmerder.
— Quand est-il revenu de son dernier voyage ?
Il lève les yeux, consulte son agenda céleste.
— En septembre. Depuis, il n’a plus bougé. Il a même arrêté les travaux qu’il avait commencés dans l’autre partie. Il sortait peu. Parfois, je le voyais passer avec sa voiture. Je suppose qu’il allait faire ses courses.
— Il recevait de la visite ?
— C’était rare.
Rare ne veut pas dire jamais.
— Avez-vous vu quelqu’un chez lui dimanche dernier ?
L’air las, il m’explique que le coin est plein de touristes le week-end. Au carrefour, ils se trompent de route et continuent tout droit au lieu d’aller vers Grand-Hez. Quand ils constatent que c’est un cul-de-sac, ils font demi-tour. C’est comme ça toute la journée.
Quant au mercredi soir, il ne sait pas. Il regarde la télé et va dormir après le journal. En tout cas, il n’a rien entendu.
— Vous avez vu d’autres personnes chez lui ?
— De temps en temps, une voiture était garée devant sa maison.
Je sors la photo trouvée chez Bernier.
— C’était cette femme ?
Il secoue la tête.
— Non, un jeune type, mauvais genre, si vous voyez ce que je veux dire.
Je vois. Il veut dire une petite frappe qui se trimballe en taxi.
— À part lui ?
— Une ou deux fois, j’ai vu une autre voiture. Grise. Je ne sais pas d’où elle venait, mais ce n’était pas une plaque belge. Je n’ai pas vu qui la conduisait.
Je dérange la ménagerie qui roupille sur mes jambes et attrape mon iPhone. J’ouvre le navigateur et recherche le site de Lexus.
Je sélectionne la photo de la RX et tourne l’écran vers lui.
— Ce modèle-là ?
Il écarquille les yeux.
— Comment vous avez deviné ?
13. Intime conviction
Équation à x inconnues.
Bernier connaissait Lexus et Lexus connaissait Bernier, mais le fils de Bernier ne semblait pas connaître Lexus et Lexus ne semblait pas vouloir faire la connaissance du fils de Bernier. Considérant en outre que Lexus aurait pu aller chez Bernier le dimanche de sa mort sans que l’Ardennais le voie et aurait pu s’y rendre le mercredi suivant sans que l’Ardennais l’entende, la RX hybride étant équipée d’un moteur électrique :
Qui est Lexus ?
Est-ce lui qui m’a appelé mercredi, et si oui, pourquoi ?
Est-il l’ami, l’ennemi ou le tueur de Bernier ?
S’il est l’ami, pourquoi ne se manifeste-t-il pas ? S’il est l’ennemi, pourquoi est-il venu au cimetière ? S’il est le tueur, quel est le mobile ?
Les questions ricochent dans ma tête.
Je fonce sur la E411. Entre Namur et Wavre, Jeremy me sort de mes pensées.
— Salut, mec, j’ai une quinzaine d’amateurs pour un passage à niveau. 50 la tête, vidéo en cadeau. Tu es libre après-demain soir ?
J’écrase ma clope, le cendrier déborde.
— Cool, mais impossible demain. Remets ça à dimanche.
— OK, ça devrait aller. Je te confirme.
À propos de cadeau, que vais-je offrir à Camille ?
Lors de nos rencontres prolongées, nous débarquons avec un objet biscornu, inutilement utile ou porteur d’un message subliminal. Une paire de lacets, une bougie, un coquillage, un pot de confiote, un plan de Bruxelles. Imagination et spontanéité. Une pratique née après l’épisode parisien.
Je ne savais pas si je devais lui apporter des bonbons, lui offrir des fleurs ou débarquer les mains vides. J’aurais eu l’air con en lui faisant cadeau d’un livre et je n’avais pas les moyens de faire des emplettes chez Cartier. Au final, j’ai opté pour une brosse à dents électrique. Je tablais sur le fait qu’elle n’avait qu’un modèle standard.
Le rendez-vous était fixé à 15 heures, dans le hall de son hôtel, proche de la gare de Lyon. Je n’avais jamais été autant attiré par une femme, et je n’avais jamais autant craint de ne pas assurer.
Avant de monter dans le Thalys, j’avais été à deux doigts de lui envoyer un message pour lui dire que je ne pouvais pas venir, qu’une priorité me retenait à Bruxelles.
Quand je l’ai vue, assise dans le divan, éblouissante, élégante, sûre d’elle, le rab de décontraction que j’avais arraché à la soirée karaoké s’était évanoui.
Elle est venue à ma rencontre.
— Bienvenue à Paris. Vous avez fait bon vol ?
— J’ai applaudi à l’atterrissage et donné un pourboire au pilote.
Ensuite, je me suis lancé dans un comparatif des météos locales. Elle m’a écouté comme si je lui racontais l’histoire la plus palpitante qu’elle ait entendue.
Encore une fois, je sombrais.
J’ai cherché à me dérober pour reprendre mes esprits.
— Vous voulez qu’on marche un peu ?
Elle a secoué la tête et m’a invité à la suivre.
— Venez.
Nous avons pris l’ascenseur.
Arrivés au septième, elle m’a guidé dans le couloir et a ouvert la porte de sa chambre.
L’estomac noué, je suis allé à la fenêtre pour admirer la vue. Quand je me suis retourné, elle se tenait à deux pas, les yeux brûlants, un sourire malicieux aux lèvres.
Sans un mot, elle a ôté ma veste et l’a envoyée valdinguer à l’autre côté de la pièce. Elle a déboutonné ma chemise, a approché sa bouche de la mienne et m’a tutoyé pour la première fois.
— J’ai envie de toi.
14 h 30.
J’arrive au Soir. Je suis en retard, mais personne ne me le fera remarquer. L’accumulation d’heures supplémentaires nous autorise à faire quelques entorses à la ponctualité.
C’est vis-à-vis de l’équipe que je culpabilise. Ils sont plongés dans leur tâche.
— Hola a todos. Tournée de café ?
Alfredo jette un regard attendri à ma chemise.
— Le rose te va bien, mon chéri.
J’interroge Éloïse avant de descendre.
— Quoi de neuf sur la planète ?
Elle énumère les priorités.
— 400 km de ralentissements sur les routes à cause de la pluie. Avertissement du Conseil d’État à propos de la pension à soixante-sept ans.
— On s’en fout, je serai mort avant.
Elle se penche vers moi, murmure.
— Sale type. Je me réjouissais de passer la soirée de samedi avec toi.
— J’ai quelques idées pour me faire pardonner.
Je descends au café avant qu’elle me propose de les mettre en pratique le surlendemain.
Au passage, je tombe sur Gilbert, l’un de mes tapeurs attitrés.
— Salut, Fred. T’as pas une sèche pour moi ?
Gilbert est le dernier des jeunes gens. Il ne lui reste que quelques mois à tirer. Les mauvaises langues prétendent qu’il était déjà là lors de la fondation du journal, en 1887.
À la fin des années 1960, ils étaient une dizaine à la rédaction. Leur rôle consistait à vider les cendriers — on savait vivre en ce temps-là —, fournir les rames de papier, faire des courses et servir des bières aux journalistes qui les convoquaient en poussant sur un bouton fixé sous leur bureau.
Aujourd’hui, personne ne sait au juste ce qu’il fait.
Il emprunte mon briquet.
— Je vais t’en raconter une bien bonne.
Quand il est de bonne humeur, il me relate les anecdotes qui ont émaillé l’histoire du journal.
Il tire une taffe, recrache la fumée par le nez.
— Un soir, le secrétaire de rédaction s’est retrouvé avec un blanc au milieu d’une page. D’habitude, on a toujours un truc sous la main, sauf que, ce soir-là, le type ne voit rien. Il devait être fatigué ou beurré. Tu sais ce qu’il a fait ?
Il adore entretenir le suspense.
— Non.
— Il a casé la photo d’une vache dans un pré.
Il commence à se gondoler.
— Et tu sais ce qu’il a écrit comme titre ?
— Aucune idée.
— Une vache dans un pré. En plus, on n’y a vu que du feu.
Il se fend la poire pendant une bonne minute.
Il se remet de ses émotions, extirpe un tire-jus grand comme un drap de lit et se mouche en émettant le bruit d’une sirène.
La manœuvre terminée, il indique ma bagnole garée de travers sur la place de Louvain.
— La semaine passée, j’ai croisé un conducteur qui roulait à contresens sur le Ring. J’ai eu la trouille de ma vie. Il avait la même caisse que toi. Si je le retrouve, je lui crève les pneus et je lui fais bouffer son volant.
Je grimace un sourire.
— Le monde est rempli de tarés, Gilbert.
J’écrase mon mégot et remonte avec mes cafés.
Pierre et Loïc nous rejoignent deux heures plus tard.
Vers 21 heures, alors que nous commençons à manger l’incontournable poulet à la citronnelle, un appel arrive sur mon portable.
— Raphaël Bernier, on s’est vus ce matin. Qu’est-ce que vous voulez ?
Le ton est agressif.
— Bonsoir, monsieur. Merci de me rappeler. Comme je vous l’ai dit, j’étais chez votre père jeudi matin.
— Qu’est-ce que vous faisiez chez lui ?
C’est reparti pour un tour. Pendant que je déballe mon histoire, Loïc tend l’oreille, gesticule et articule sans son.
— C’est énorme.
Raphaël m’interrompt avant la fin du récit.
— Vous avez trouvé son téléphone ?
— Non, il n’était pas dans la maison. J’ai appelé, mais la sonnerie n’a pas retenti. Après, j’ai vérifié. C’est bien son numéro qui m’a appelé la veille.
— Et son ordinateur, vous l’avez piqué ?
— Il n’y avait pas d’ordinateur sur le bureau. J’ai pris des photos.
Il ricane.
— Évidemment. Un journaliste.
— Je fais mon métier.
Il relance, ironique.
— Le grand journaliste croit au suicide ?
— C’est la version officielle de la police.
— Mais vous n’y croyez pas, si j’ai bien compris. Qu’est-ce qui vous fait penser le contraire ?
— Je préfère vous en parler de vive voix.
Il reste silencieux un moment.
— J’y crois pas non plus. Quelque chose va pas.
20 minutes avant l’appel
Plusieurs personnes avaient le visage en sang. Un homme vint vers elle en titubant, l’épaule démise, le bras ballant le long du corps. Plus loin, elle aperçut un vieillard allongé au sol.
Les sens en alerte, elle écarta prudemment les gens qui se pressaient autour de lui, s’agenouilla et évalua l’état de la victime.
L’homme avait été atteint par un projectile à la tête. Il avait perdu connaissance, mais sa respiration était calme et régulière. Elle examina la blessure. L’entaille était profonde.
Elle ouvrit sa trousse et constata que ses mains tremblaient. Elle tenta de maîtriser ses gestes, s’empara d’une compresse et l’appliqua sur la plaie.
Au loin, des bruits d’explosion retentirent et des cris fusèrent autour d’elle. Elle fit un effort pour se concentrer sur sa tâche. Malgré cela, elle sentit l’angoisse l’envahir.
MARDI 23 JUIN 2015
14. Trois demis
Raphaël Bernier a la bonne idée de crécher à Bruxelles, la mauvaise d’avoir choisi Molenbeek-Saint-Jean, non loin du parc du Karreveld, endroit que je préfère éviter.
J’y ai connu ma deuxième mort, le 24 décembre 2005, veille de Noël. J’avais dix-neuf ans.
Pendant de longs mois, j’avais économisé l’argent de mes jobs d’étudiant pour pouvoir me payer la moto de mes rêves. La somme réunie, j’avais écumé les petites annonces avant de dénicher une Honda CB 500 d’occasion, machine rapide et agile capable de grimper de 0 à 100 km/h en cinq secondes.
Ce matin-là, je circulais sur la chaussée de Ninove. Certains ont prétendu que j’allais vite. J’étais à une centaine de mètres du Prince de Liège quand un gosse a surgi entre deux bagnoles en stationnement.
J’ai donné un coup de guidon et j’ai percuté une camionnette qui venait en sens inverse. La moto a fait une embardée et est partie dans une longue glissade avant de s’encastrer sous un bus.
Je me souviens d’avoir été éjecté lors de l’impact. Après, c’est le black-out.
Les témoignages sont arrivés plus tard, au compte-gouttes. Ma mère s’obstinait à rester muette et refusait de répondre à mes questions. Mon père n’est pas venu me rendre visite. Il disait que je roulais certainement comme un fou et que j’aurais pu éviter l’accident.
J’ai dû attendre la visite de mes amis. Ils m’ont montré les articles parus dans les journaux.
Le mot « miracle » revenait souvent. Les photos qui accompagnaient la prose parlaient d’elles-mêmes, les restes épars de la moto, l’attroupement de badauds, le bus, la bagnole, le père blême, son gamin de trois ans dans les bras.
Peu à peu, j’ai appris ce qui s’était passé.
Un camion me suivait de près. Après ma chute, je suis resté allongé au milieu de la voie. Le chauffeur n’a pas réussi à s’arrêter. Par chance, je suis passé entre ses roues. Seul l’essieu arrière a percuté mon casque.
L’ambulance est arrivée. Ils m’ont transporté à Érasme où les médecins ont diagnostiqué une fracture de la clavicule et un traumatisme crânien. Quand j’ai repris conscience, une infirmière était penchée sur moi. Greg se tenait derrière elle, avec son sourire en coin.
J’ai réussi à balbutier quelques mots.
— Le gosse ?
La soignante m’a pris la main.
— Il est indemne. C’est un miracle.
Je suis resté une semaine à l’hosto. Les toubibs craignaient l’apparition d’un hématome extradural. La nuit, la silhouette venait me rendre visite. Elle se tenait dans un coin de la chambre, immobile, silencieuse.
Je la questionnais, l’insultais, mais elle ne réagissait pas.
Un matin, à l’aube, elle s’est aventurée jusqu’à mon lit et a soufflé son haleine dans mon visage, un mélange d’éther et de pisse avariée.
Aujourd’hui encore, l’image du gamin qui jaillit entre les bagnoles vient me hanter.
Je remonte le boulevard Louis-Mettewie. De part et d’autre, les immeubles rivalisent de laideur. Le rendez-vous est fixé au Stade, un bistrot d’angle situé entre la rue de Koninck et la rue des Béguines.
Le fils Bernier est assis en terrasse, un verre de bière devant lui. Il porte les fringues et les Adidas qu’il avait aux funérailles. Une nana l’accompagne. Bien en chair, tifs blonds décolorés, maquillage appuyé, même tenue que lui.
Ils me regardent approcher avec hostilité.
— Bonsoir, monsieur Bernier.
Il aboie en retour.
— Laisse tomber les bonnes manières. Moi, c’est Raf.
Il balance la tête en direction de la fille.
— Elle, c’est Gwen. C’est ma copine, tu peux parler devant elle.
Gwen me toise comme un boxeur au premier round.
— D’accord. Moi, c’est Fred.
Je m’assieds, commande trois bières et entre dans le vif du sujet.
Je lui explique que je ne suis mêlé à cette affaire qu’à cause du coup de fil que j’ai reçu et que je ne connaissais pas son père.
Il hausse les épaules.
— Je ne le connaissais pas beaucoup mieux que toi. Ma mère l’a viré quand j’avais sept ans.
— Tu ne le voyais plus ?
Il secoue la tête.
— De temps en temps, quand il se souvenait qu’il avait un gamin. Il débarquait avec une bricole, à Noël ou pour mon anniv. Encore, pas tous. Il était tout le temps parti.
J’en déduis qu’il est fils unique.
— Qu’est-ce qu’il faisait comme boulot ?
Il plisse le front. Gwen ne bronche pas, mais n’en pense pas moins. Elle me dévisage, penchée en avant, bras croisés sur la table. Un tatouage tribal orne son avant-bras.
Le garçon se pointe avec les bières. Dès qu’il a fait demi-tour, Raf attrape son verre et en vide la moitié.
J’en profite pour allumer une clope.
À son tour, Raf sort un paquet de tabac, en roule une avec dextérité et la file à Gwen avant de reprendre :
— Mon père bossait dans la sécurité.
Je me contente d’acquiescer.
— Quand il était encore avec ma mère, il était sous-off paracommando. On habitait à Namur, près de Flawinne, où se trouvait sa caserne. Ça valait la peine, tu parles. Le jour de ma naissance, il était au Rwanda. L’année d’après au Gabon. Pour mes trois ans, en Somalie, et cætera. Il a quitté l’armée il y a une dizaine d’années, après vingt-cinq ans de carrière. Après, il s’est barré à l’étranger.
Je fais un rapide calcul.
Régis Bernier avait cinquante-cinq ans. Moins dix, moins vingt-cinq. Ça signifie qu’il est entré à l’armée à vingt ans. Que faisait-il depuis ?
— Il vivait seul ?
Il hausse les épaules.
— Tu connais beaucoup de meufs qui ont envie de vivre avec un macho psychorigide qui passe son temps à cirer ses pompes et à nettoyer sa bicoque ?
Je commence à cerner le profil de Régis Bernier.
— Pas vraiment.
Gwen ouvre la bouche pour la première fois.
— Ton père, c’était qu’un connard.
Raf lui jette un regard sombre. Il aimerait objecter, mais préfère s’écraser.
J’embraie.
— La police a conclu au suicide. Il n’y aura pas d’enquête, ils ont classé le dossier. Tu crois qu’ils ont bien fait ?
Ma question semble le contrarier.
Comme il ne répond pas, j’ajoute que l’appel venait du numéro de son père, que le type se prétendait menacé et disait qu’il avait des informations à me communiquer. Je lui rappelle également que, lors de ma visite, le téléphone et l’ordinateur de son père avaient disparu.
Il sort de son mutisme.
— J’ai vu ça. Tu crois que ça pue ?
Gwen tire une taffe, crache la fumée vers le ciel.
— Les flics sont des connards. Bien sûr que ça pue, je le dis depuis le début.
Je temporise.
— Disons que c’est étrange. En plus, l’arme qu’il a utilisée se trouvait à quelques mètres de lui. Les flics disent que c’est à cause du recul. J’ai interrogé un expert, le scénario ne tient pas la route si la personne s’y connaissait en armes.
Raf se penche en avant, le regard mauvais.
— Comment tu sais qu’il s’y connaissait en armes ?
Inutile de lui raconter des bobards. Je lui avoue que je suis retourné chez son père après l’enterrement et que je suis tombé sur un arsenal planqué dans sa cave.
Il encaisse l’info sans broncher.
Gwen avale une rasade et fait tournoyer les restes de bière.
— Ben, tiens. Tant qu’à faire, pourquoi se priver ?
Elle commence à me bassiner, la catcheuse.
— Ce n’est pas tout. J’ai aussi trouvé ceci.
Je sors la photo de la femme, la pose devant lui.
Gwen la prend, jette un coup d’œil et la file à Raf.
Il l’examine, la retourne, regarde l’annotation.
— Qu’est-ce que ça veut dire ?
— D’après mes recherches sur le Web, une date en ukrainien, le 16 avril 2014.
— Où elle était ?
— Collée sur le mur, en face du divan. Tu la connais ?
— Jamais vue.
Gwen reprend la photo et la fourre dans son sac. J’aimerais intervenir, mais cette photo ne m’appartient pas. Comme Raf ne bronche pas, je me tais.
Elle termine sa bière et scrute le fond de son verre.
Silence.
Raf reprend, hésitant.
— Il y a quelques mois, il a perdu son job. Il est rentré en Belgique, la queue entre les jambes. Il n’était plus le même.
Il aimerait en dire plus, mais la présence de Gwen le freine. Il appelle le serveur, lui demande de remettre la même chose.
J’en profite pour enfoncer le clou.
— Où travaillait-il ?
Il m’en lâche un peu plus.
Après l’armée, son père est devenu garde du corps à l’étranger. Il assurait la sécurité des journalistes, des mômes de friqués et des diplomates belges, vu que le rapt de mioches est un sport national au Venezuela. Ensuite, il a bossé pour des boîtes installées dans des endroits chauds, mais ne lui a jamais donné plus de détails.
— Tu l’as revu souvent après son retour ?
— Quelques fois. Il insistait pour que je vienne chez lui.
Gwen l’interrompt.
— Il voulait se faire pardonner d’avoir été un mauvais père, mais c’était trop tard.
Raf reprend.
— Il y a trois ans, il s’est acheté cette baraque dans ce trou perdu. Un tas de trucs ont suivi, cette bagnole de m’as-tu-vu, ces équipements de bourge, ce bocal à poissons et toutes ces conneries. Il a dû toucher le gros lot. Ça me foutait le cafard d’aller là-bas.
Gwen le fustige.
— Fallait pas y aller.
Il se rebiffe.
— C’est bon, tu l’as déjà dit.
La tournée arrive.
Deux vieux et leur clebs s’installent à la table contiguë. L’homme lâche un long pet en s’asseyant. L’incident ne déride ni Raf ni Gwen.
J’écrase mon mégot.
— Selon la police, tu aurais déclaré que ton père était dépressif.
Il soupire, m’explique que c’est sa mère qui a raconté ça. Elle ne voyait plus son ex et le détestait, mais trouvait suspect qu’il veuille tout le temps voir son fils. Elle en a déduit qu’il était devenu taré.
Il s’arrête, renifle.
— Le dimanche où ça s’est passé, il m’a envoyé quelques lignes. J’ai lu sans faire attention. Quand j’ai appris sa mort, jeudi dernier, ça m’a fait bizarre. Je me suis demandé ce qu’il voulait me dire.
— Qu’est-ce qu’il avait écrit ?
Il sort son téléphone, me montre l’icône de Telegram Messenger et me demande si ça me dit quelque chose.
Demander à un geek s’il connaît Telegram Messenger, c’est demander à un Italien s’il connaît Ferrari.
Les développeurs de l’appli prétendent avoir créé la messagerie la plus sécurisée du monde. On peut programmer l’autodestruction des envois, comme dans Mission impossible, l’outil rêvé pour les paranos et tous ceux qui ont des choses à cacher : journalistes, avocats, truands, terroristes, amants. Potentiellement, 90 % de la planète.
— Je connais. Je présume que le message s’est effacé après quelques heures ?
Gwen.
— Gagné.
Raf.
— C’est lui qui voulait que j’utilise cette merde. J’aurais aimé garder ses derniers mots. Il disait qu’il aurait préféré que ça se passe autrement entre nous, que certains cauchemars ne s’effacent jamais, qu’on emporte ses démons avec soi où qu’on aille. Pour terminer, il a écrit qu’il m’aimait. C’était la première fois de sa vie qu’il me le disait.
Gwen lève les yeux au ciel, ulcérée.
Silence, clope, bière.
— Malgré ça, tu ne crois pas qu’il s’est suicidé ?
Il me fixe dans les yeux.
— Vendredi, je suis allé chez lui. Ça puait la mort. J’ai vu les éclaboussures de sang sur le mur. Je ne suis pas resté longtemps, le temps de prendre quelques affaires. Entre autres, j’ai trouvé ça.
Il sort un passeport de sa poche.
Je l’ouvre et découvre la photo de Régis Bernier vivant. Visage carré, yeux rapprochés, coupe militaire.
Les pages sont bourrées de coups de tampons, le passeport du grand bourlingueur.
Je termine la lecture et m’apprête à lui rendre le document.
Il pointe son index.
— Regarde derrière.
Je retourne le carnet.
Sur la couverture arrière, quelques mots sont griffonnés au marqueur, en anglais.
L’avertissement est clair.
« Tu fermes ta gueule, sinon tu crèves, et ton fils aussi. »
15. Proxy fighter
— Celle-là.
Une Ice Watch orange devrait en jeter sur sa peau hâlée. Je ne l’ai jamais vue avec une montre. Je n’en porte pas non plus, sauf lors des mariages et des fêtes de famille, pour frimer et marquer ma réussite sociale.
Je sors de la boutique.
« J’ai envie de toi. »
Je l’entends me les murmurer.
Ils me ramènent à notre première fois. On prétend que ce n’est pas la meilleure, mais que c’est celle dont on se souvient toujours.
« J’ai envie de toi. »
Il n’aura fallu que cette phrase pour que mes appréhensions s’envolent. À peine ces mots prononcés, nos bouches se sont happées, nos langues se sont entremêlées. Nous nous sommes déshabillés en moins de deux en éparpillant nos fringues aux quatre coins de la piaule. Chancelants, nous nous sommes précipités sur le lit.
Je me suis emparé de ses seins, les ai mordillés avec avidité. Enivré par son odeur, je me suis aventuré le long de son ventre. Elle a emprisonné ma tête entre ses mains, m’a ramené à elle.
Le regard trouble, elle a cambré les reins.
« Prends-moi. »
Je l’ai pénétrée sans ménagement.
Nous étions déchaînés. Son bassin allait, venait, répondait sans retenue à mes assauts.
Alors que j’approchais de l’explosion, un sentiment étrange m’a parcouru. Pour la première fois, j’étais dans les bras d’une femme mariée. Je croquais le fruit défendu à belles dents. Je m’appropriais un bien qui ne m’appartenait pas. L’espace d’un instant, j’ai oscillé entre orgueil et culpabilité.
Étrangère à mes scrupules, elle m’exhortait.
« Viens. »
Ses ongles plantés dans mon dos, nous avons joui de concert, ma semence se répandant en elle, nos cris libérateurs ameutant l’hôtel.
Nous sommes restés suspendus au milieu de l’univers, muets, nos peaux couvertes de sueur, nos jambes enchevêtrées.
D’un bond, elle s’est levée et m’a tendu les mains.
« Douche. »
Nous avons passé un siècle sous le jet brûlant. Mes mains exploraient les moindres parcelles de son corps. Encore ruisselants, nous nous sommes enveloppés dans les peignoirs et sommes sortis sur le balcon.
Une bande de skateurs tournoyait en contrebas. La température avoisinait zéro, mais nous ignorions le froid.
Collés l’un à l’autre, nous nous parlions sans échanger de mots.
Quelques flocons de neige ont fait leur apparition. Elle s’est agenouillée et m’a pris dans sa bouche. Il n’a fallu que peu de temps pour que je retrouve ma vigueur.
Elle s’est relevée.
« Maintenant, fais-moi l’amour. »
Ce que nous avons fait jusque tard dans la soirée. J’ignorais que le corps humain possédait de telles ressources. Quand l’arbitre a sonné la mi-temps, nous sommes sortis pour plonger dans la première brasserie.
Grand genre. Huîtres et champagne. Ça me changeait des happy hour et des pizzas froides avec mes potes.
Nous avions l’air de ce que nous étions, un couple illégitime au bord de l’épuisement. Les clients nous dévisageaient avec suspicion. Je ne voyais qu’elle. Je ne la quittais pas des yeux. Je n’avais aucune envie de fumer. Pour la première fois de ma vie, j’éprouvais la délicieuse morsure de la passion.
Nous sommes rentrés bras dessus bras dessous en titubant, grisés par le champagne. Elle ne parvenait pas à ouvrir la porte. Elle a tourné la plaquette dans tous les sens avant de constater que c’était sa carte bancaire. Comme des gamins, nous avons été pris d’un fou rire. Les couloirs résonnaient de nos éclats.
La chambre ressemblait à un champ de bataille. Nous nous sommes allongés l’un contre l’autre et avons parlé jusqu’au bout de la nuit.
Quand nos ultimes forces nous ont abandonnés, nous nous sommes endormis au milieu d’une phrase.
« J’ai envie de toi. »
Je remonte la rue du Viaduc.
Il y a deux ans, j’ai récupéré l’appartement d’Alfredo, une sorte de loft miniature niché au dernier étage d’une vieille maison. Vaste terrasse, vue sur le Parlement européen et les toits d’Etterbeek.
Même en hiver, la lumière est au rendez-vous, ça me permet de retrouver mes affaires dans le chaos.
Il m’arrive de tourner des plombes dans le quartier pour trouver où me garer. J’espère avoir de quoi survivre dans le frigo, je n’ai pas envie de ressortir. Au pire, je me taperai une omelette.
Camille n’a jamais mis les pieds ici. Nous changeons d’hôtel à chaque rencontre. Vu le nombre de chambres que nous avons dévastées, nous pourrions publier le guide des amants tumultueux.
Je tourne la clé, entre dans l’appartement.
— Merde !
La porte de la terrasse est restée ouverte.
Nabilla squatte le bureau et observe mon arrivée, le cou tordu, l’œil interrogateur.
Camille prétendait qu’il était impossible d’élever une poule en appartement. À Noël, j’ai insisté pour qu’elle m’offre l’une des siennes. Depuis, Nabilla et moi cohabitons. Elle est épanouie et me procure un œuf par jour.
Je la chasse et installe mon PC. J’allume une clope, connecte mon iPhone et transfère les photos du passeport de Bernier.
La fin de la rencontre avec Raf a été moins crispée.
Après la quatrième bière, Gwen s’est barrée pour aller au taf. Comme je m’y attendais, il s’est détendu. Libéré de sa mainmise, il m’en a lâché un peu plus.
Il travaille pour une compagnie de taxis bruxelloise depuis deux ans. Il préfère bosser la nuit. En plus de la rémunération et des pourboires royaux, il aime la faune nocturne, les fêtards, les bagarreurs, les taiseux et les couples qui se tripotent sur la banquette arrière.
Il a rencontré Gwen il y a un an, elle est serveuse dans un resto grec. Ils ne vivent pas ensemble, mais ils y songent.
Saint Raphaël des Angoisses, héros martyr.
Je ne sais si ce sont les victimes qui attirent les bourreaux ou le contraire. Une chose est sûre, ils finissent toujours par se trouver.
Au moment de nous quitter, il a ravalé ses airs de faux dur.
— Mon père me cachait quelque chose. Je le sentais, mais je ne voulais pas lui poser la question. Maintenant, je veux savoir ce qui s’est passé. Je suis prêt à t’aider, mais ça reste entre nous.
Je fais défiler les photos.
Le document a été émis à Namur, en avril 2011.
Les pages sont surchargées de tampons multicolores, certains apposés les uns sur les autres, dans le plus grand désordre.
Le casse-tête de ma soirée.
Je pioche une feuille dans l’imprimante et cherche un crayon. Je note les destinations et les dates. Certains cachets sont en arabe ou dans une langue qui m’est inconnue. D’autres sont illisibles.
L’inventaire terminé, je dresse une liste en tenant compte de la chronologie.
L’exercice me prend deux heures durant lesquelles je suis interrompu par des appels auxquels je ne réponds pas et l’arrivée de SMS que je parcours d’un œil distrait. Ilian a trouvé une Polo nickel, il aimerait que je l’essaie. Le passage à niveau est fixé à dimanche soir. Arthur me propose de le rejoindre pour une chicha au Gusto Bar.
Je me lève, me dérouille les jambes.
Le frigo est quasi vide. Seules des lasagnes traînent sur une des étagères. Je consulte la date limite de consommation, dépassée, et les jette dans le four. Mon estomac en a vu d’autres.
Je les avale, accompagnées d’une bière brune. La combinaison est pittoresque.
Je reprends la liste.
Régis Bernier a vu du pays.
Le plus ancien tampon remonte au 5 mai 2011. Ce jour-là, il a débarqué à Tunis. Le plus récent est un aller-retour en Ukraine, à Kiev, en septembre 2014.
Entre les deux, il a visité pas mal d’endroits aussi accueillants que touristiques : Abidjan, Djibouti, Beyrouth, Tananarive, Kaboul, Rabat, Tripoli, Douala, Istanbul, Bagdad, Bamako, Amman, N’Djamena ou encore Kinshasa.
Le plus souvent, les séjours étaient courts, quelques jours. D’autres s’étalaient sur plusieurs semaines.
J’ai également trouvé des visas d’entrée sans trace de sortie, ou l’inverse, ce qui suppose des passages de frontière par la route.
La plupart des villes où il est allé ont fait l’objet de dépêches depuis mon arrivée au Soir. À quelques exceptions près, elles font partie des principaux points chauds de la planète depuis quatre ans.
Il s’est également rendu à Zurich et à Montréal, sans compter les capitales européennes où il n’a pas dû présenter de passeport. Entre deux périples, il a réalisé quelques allers-retours aux États-Unis, à San Diego, en Virginie et en Caroline du Nord.
Si j’ajoute les informations concernant Bernier, son passé militaire, son addiction pour les armes, ses missions de protection en territoire hostile, je l’imagine bien dans un rôle de contractant pour une entreprise privée.
Plus communément, on appelle ces gens-là des mercenaires, des soldats de fortune ou des chiens de guerre.
MERCREDI 24 JUIN 2015
16. H
H-10
D’un geste, Robert remonte ses lunettes et se penche vers moi.
— Nous sommes en partie responsables de la situation.
Robert Klein possède plusieurs qualités.
En plus d’être l’un des chroniqueurs les plus brillants du Soir, il est doté d’une mémoire phénoménale. Il se souvient dans les moindres détails des articles qu’il a rédigés depuis trente ans. Cerise sur le gâteau, il a un talent de conteur qui lui permet de transformer une recette de cuisine en un récit d’aventures palpitant.
J’ouvre de grands yeux.
— Comment ça ?
Il se racle la gorge.
— Tu as entendu parler de l’offensive du Têt ?
— Comme tout le monde.
Je comprends à son froncement de nez que ce n’est pas la bonne réponse.
— Je vais te rafraîchir la mémoire.
L’air grave, il m’explique qu’en 1968 les images d’horreur des combats dans Saïgon ont inondé les canards. Les Amerloques ont vu leurs boys tomber dans la pluie, la boue et le sang. Le moindre village US avait un gamin qui rentrait au pays dans un sac à viande.
— Le Vietnam a été la première guerre retransmise en direct et en couleurs à la télé. Le sang était rouge et les cris réels. En l’espace d’un mois, l’opinion publique s’est retournée. Le Têt a marqué le début de la fin du photojournalisme. Ça explique le peu d’images que l’on a reçues des conflits en Irak et en Afghanistan.
En revanche, l’esprit de synthèse n’est pas son point fort. Le lien avec ma question est nébuleux. Près d’un demi-siècle s’est écoulé depuis.
Je tente un raccourci.
— C’est la raison pour laquelle les Américains contrôlent les journalistes et engagent des mercenaires ?
Il soulève un sourcil.
— Tu es pressé ?
Le ton est glaçant.
— Pas vraiment.
Il pointe son stylo dans ma direction.
— Si tu me poses une question et que tu n’as pas le temps d’écouter la réponse, il ne faut pas venir me voir.
Mon iPhone vibre au fond de ma poche. Camille entame les préliminaires virtuels.
Robert reprend, développe. Le mercenariat a toujours existé. Les Français perpétuent une grande tradition dans ce domaine. Selon lui, la Légion étrangère est un corps de chiens de guerre. Aujourd’hui, les contractants sont partout et viennent d’un tas de pays. La Tchétchénie en a fait un produit d’exportation.
— Ils se substituent à l’armée régulière ?
Il plisse les yeux.
— Ils travaillent en parallèle. En principe, ils ne sont là que pour exfiltrer des hommes d’affaires, escorter des journalistes ou protéger des huiles. En pratique, c’est eux qui font le sale boulot. S’ils se font tuer, ils n’apparaissent dans aucune statistique.
Il poursuit sur sa lancée, m’apprend que bon nombre de ces types sont payés entre 7 000 et 15 000 euros par mois par des sociétés privées qui agissent en sous-main pour le compte d’États, ce qui évite les retombées politiques en cas de débâcle.
La plus connue est Blackwater. À Bagdad, en 2007, quatre consultants ont ouvert le feu sur des civils. Dix-sept morts, une vingtaine de blessés. Après cette bavure, la société a changé de nom, elle est devenue Xe, puis Academi. Aujourd’hui, cette boîte est une pièce maîtresse de la machine militaire américaine.
D’après lui, c’est l’armée privée la plus puissante de la planète. Elle est truffée de barbouzes, d’anciens bidasses et d’ex-cadres de la CIA. En plus d’avoir le plus important stock privé d’armes, elle dispose d’une flotte d’avions, d’hélicoptères, de navires et de véhicules blindés.
Il termine en évoquant George Bush. Celui-ci a commencé à faire massivement appel à eux après les attentats du 11 Septembre, entre autres pour traquer les leaders d’Al-Qaïda.
— Retiens une chose, Fred. La privatisation de la guerre est devenue irréversible.
— Tu penses qu’Academi emploie des Belges ?
Il acquiesce.
— Ils ont même une excellente réputation. En Ukraine, on a capté des communications radio en anglais, polonais, français et flamand.
— Merci, Robert.
Il ne compte pas en rester là.
— Pourquoi tu veux savoir ça ?
Je lui adresse un clin d’œil.
— Je songe à réorienter ma carrière. Avec 15 000 euros par mois, je pourrais m’offrir une Porsche.
H-8
Cigarette.
Hasselt. Radisson Blu. Tu parles flamand ?
H-7
Je furète sur le Web. Les infos confirment les propos de Robert. Academi a son siège à Reston, en Virginie, et des antennes à San Diego, Raleigh et Rabat, autant de destinations présentes dans le passeport de Bernier.
Je copie l’adresse de contact des ressources humaines et rédige un mail expliquant que j’aimerais recevoir des informations sur un de leurs employés, Régis Bernier. Je précise que je suis journaliste et que j’agis dans le cadre d’une enquête que je réalise au sujet de sa mort.
Le culot fait partie des qualités intrinsèques du bon reporter.
H-6
Cigarette. Pause sandwich chez Paul.
Éloïse me rejoint et s’assied en face de moi.
— Je peux ?
— Sois la bienvenue.
Elle jette un coup d’œil autour d’elle.
— Après-demain ?
— Ça devrait aller.
Elle ôte sa chaussure, tend son pied sous la table, le glisse entre mes jambes.
— Tu sais pourquoi j’y reviens chaque fois ?
— Parce que je suis beau et intelligent ?
Elle fait une grimace.
— Pas du tout. Ce que j’aime, c’est que tu es complètement barge. Là où les autres mecs sont prévisibles, toi, c’est le feu d’artifice. Je ne sais jamais quelle connerie tu vas inventer. Tu es dingue, Fred, c’est ça qui me plaît, chez toi.
Ses doigts de pied taquinent ma virilité.
— Je dois le prendre comme un compliment ?
Elle approuve d’un hochement de tête.
— À propos de connerie, n’oublie pas ton matos. Mes voisins me parlent encore de la fois où tu es descendu chercher tes capotes dans la voiture.
— Pourtant, j’ai été discret.
— Tu étais à poil, je te rappelle.
H-4
Gilbert me tape une cigarette.
— Je t’ai déjà raconté l’histoire des deux meilleurs joueurs de foot ?
Cent fois.
— Possible.
— Chaque mardi, on publiait le classement des top footballeurs de la division 1. Un jour, le journaliste a changé les prénoms des deux premiers pour déconner. Il pensait que le rédac final le verrait. Le meilleur joueur est devenu Poilalabite Katana et le deuxième Trouducu Okpara.
Il part dans un fou rire.
La tempête passée, Gilbert sort son drap de lit et fait le tour de ma bagnole. Comme d’habitude, elle est garée sur le trottoir, entre les deux entrées de parking.
L’inspection terminée, il se gratte le menton.
— Tu prends souvent le Ring ?
— Jamais, c’est trop dangereux.
H-3
Réponse d’Academi.
Nos registres du personnel ne contiennent aucun dénommé Régis Bernier. Best regards.
H-2
Je me rue vers la sortie, clope au bec, le briquet dans les mains. L’hôtesse m’apostrophe alors que je franchis le bureau d’accueil. Elle a reçu un appel pour moi, en anglais. Le type lui a demandé qui j’étais. Il a raccroché au moment où elle a voulu me passer la communication.
H-1
E314, je frise les 150. Un flash crépite dans mon dos.
H
Je fais irruption dans le hall du Radisson Blu.
Camille se tient devant la réception, carte magnétique et plan de la ville en main. Elle écoute avec attention la litanie que le préposé lui débite en roulant ses r comme un acteur shakespearien.
— Au dernier étage, nous avons le sky lounge, avec une vue fantastique sur Hasselt. Le petit déjeuner est servi au restaurant à partir de 6 h 30 ou dans votre chambre, comme vous le désirez.
Elle me repère, esquisse un sourire et s’adresse au pingouin.
— Monsieur est arrivé. Nous allons déposer nos affaires.
Lesdites affaires se limitent à son sac à main et mes clés de voiture.
Le réceptionniste me dévisage, lèvres pincées. J’ai mis un terme à son numéro de charme.
Pour un type qui passe sa vie à remplacer les piles des télécommandes, je le trouve bien sûr de lui.
Je le salue du menton, attrape le sésame de la chambre et m’adresse à Camille.
— Si Madame veut bien me suivre.
17 minutes avant l’appel
Une violente clameur monta de la foule.
Elle tressaillit, se releva brusquement et suivit le regard des gens qui l’entouraient.
Les cris et les détonations se multipliaient. Une épaisse fumée s’élevait à l’extrémité de l’esplanade.
Saisie d’effroi, elle vit un groupe de contre-manifestants accourir dans leur direction. La plupart étaient casqués et brandissaient des barres de fer. Ils se rapprochaient à toute vitesse en chargeant avec furie. L’un d’eux lança un cocktail Molotov qui explosa non loin d’elle et mit feu à l’une des tentes installées sur le parvis.
Son angoisse se mua en panique. Elle explora l’angle de la place, chercha en vain la présence de policiers, mais ne distingua que des silhouettes mouvantes.
Un haut-le-cœur monta des profondeurs de ses entrailles.
JEUDI 25 JUIN 2015
17. Chute libre
— Il faut que j’y aille, Fred. Je dois être à la librairie pour l’ouverture.
Comme chaque fois, c’est elle qui sonne l’heure du départ.
Je la prends par la taille, contemple dans le miroir les effets de notre nuit. Nos ébats ont été plus torrides que jamais. À part ses yeux engourdis de sommeil, elle a mieux tenu le choc que moi. Je suis blanc comme un albinos, mes jambes me supportent à peine et j’affiche un sourire niais.
— Dix minutes et on y va.
Une ombre obscurcit son visage.
— Il faut que je te dise quelque chose.
Mon instinct m’envoie un signal d’alarme.
— Qu’est-ce qui se passe ?
Elle se blottit contre moi, me souffle à l’oreille.
— C’était une magnifique dernière fois.
J’éprouve une sensation de flottement dans le ventre.
— Qu’est-ce que ça veut dire ?
— Mon mari a accepté un poste à l’étranger. Nous partons à Shanghai dans trois semaines.
Un seau de glace pilée s’abat sur mon crâne.
D’une voix chevrotante, je cherche une sortie de secours.
— Et la librairie ?
— J’ai donné ma démission.
Je bredouille la pire des banalités.
— Ce n’est pas possible.
Je savais pourtant que ce jour viendrait. Nous n’en parlions jamais, je faisais l’autruche, mais je ne me faisais aucune idée. Cette échéance était inévitable, je n’étais qu’une parenthèse dans sa vie.
Elle soupire.
— Je ne voulais pas te l’annoncer avant et gâcher notre soirée. J’avais envie d’une dernière nuit pour nous.
Je tente de garder mon calme.
— Tu pars pour combien de temps ?
— Le premier mandat est de trois ans.
Je croise les bras comme un gosse buté.
— Je t’attendrai.
Elle secoue la tête avec tristesse.
— Dans trois ans, la mission pourrait être prolongée. Ou il sera envoyé ailleurs. Dans trois ans, j’aurai peut-être un enfant ou deux. Ça fait partie de nos projets.
Nos projets.
C’est la première fois qu’elle m’exclut du nous.
— Je prends le risque.
— Ne dis pas ça, Fred. Tu as autre chose à faire dans ta vie que de m’attendre.
Vaincu, je me réfugie dans le silence.
Elle cherche mes lèvres.
J’évite le contact.
— Laisse-moi.
Elle se détache.
— Tu descends avec moi ?
— Non, je reste ici.
Des larmes perlent dans ses yeux.
— J’ai passé de merveilleux moments avec toi. Tu es un homme à part.
Elle fait demi-tour, se dirige d’un pas hésitant vers la sortie.
Dernière tentative, avant qu’elle disparaisse.
— On continue à s’écrire ?
Elle se retourne, le visage décomposé.
— Laisse-moi prendre l’initiative.
— D’accord. Bonne chance, Camille.
La porte se referme sans bruit.
Un vertige m’envahit.
Je contemple la chambre qui était notre chambre quelques instants auparavant. J’ai l’impression qu’elle a doublé de volume. Chaque objet résonne de son absence. Le lit où nous nous sommes endormis, le canapé dans lequel nous avons fait l’amour, les oreillers fatigués, la serviette maculée de mascara.
Je me traîne jusqu’à la fenêtre, allume une clope.
Hasselt s’étale à mes pieds, hostile, grise et froide.
Je mérite le césar de la naïveté. Je pensais que nous formions un duo indestructible. Je croyais que nos rires, notre complicité, nos facéties, nos mots, nos caresses et notre insatiable appétit sexuel nous soudaient inexorablement l’un à l’autre.
J’aimais imaginer que nous étions chacun la moitié d’un tout, que le temps et les circonstances finiraient par nous réunir.
Je n’ai rien vu venir.
Une multitude d’images défilent.
Le karaoké, notre première fois, nos messages, nos baisers volés dans les escaliers mécaniques, nos essayages de chaussures, nos pas de danse, notre étreinte dans la nature automnale, ma cuisse de poulet qui traverse le restaurant, notre cuite mémorable à Spa, la pièce de théâtre durant laquelle nous nous sommes endormis. Son corps, ses cris, ses « encore ».
J’ai le sentiment de remuer un passé déjà lointain.
Les paumes de mes mains deviennent moites.
Depuis combien de temps le savait-elle ? Comme les cocus, je suis le dernier informé.
Étalés sur le lit, les vestiges de notre ultime petit déjeuner me narguent.
Prévert prétend que le bonheur se reconnaît au bruit qu’il fait quand il s’en va.
J’écrase mon mégot sur la moquette, m’empare du plateau et l’envoie valser contre le mur. La vaisselle se fracasse dans un boucan infernal. Le café, le thé, le lait éclaboussent le plumard et le faux Van Gogh.
Elle disait détester les Ucclois. Elle les décrivait comme vivant en vase clos, par petits groupes.
« Ils fréquentent les mêmes clubs de sport, les mêmes restaurants, les mêmes boîtes et ne se mélangent pas à la plèbe. En août, ils se retrouvent sur les mêmes plages du Zoute pour parler de leur fric. Ils baisent entre eux, se marient entre eux, se cocufient entre eux, mais se pardonnent leurs écarts parce que l’intérêt du groupe est supérieur à l’intérêt individuel. »
Dans ce cas, pourquoi en a-t-elle épousé un ?
Je hurle à m’en péter les cordes vocales.
— Connards d’Ucclois !
J’empoigne la lampe de bureau et la balance de toutes mes forces dans le miroir. Il vole en éclats dans un vacarme cristallin. Les débris de verre s’éparpillent autour de moi.
Je saisis le dossier du fauteuil, le soulève à bout de bras et le projette contre la porte.
« Tu as autre chose à faire dans ta vie que de m’attendre. »
— Putain de merde ! Qu’ai-je d’autre à attendre de la vie, à part la mort ?
Je me suspends aux tentures, pèse de tout mon poids. Dans un nuage de plâtre, le support cède, la draperie s’effondre sur la moquette, m’entraînant dans sa course.
Je me relève, fou de rage. Je retourne le matelas, déchire les draps, crève le duvet, m’attaque aux oreillers. Les plumes voltigent dans la pièce.
« Tu es un homme à part. »
— À part de quoi ? De qui ?
Des fourmillements dans le ventre, je plonge dans la salle de bains.
J’arrache le rideau de douche, agrippe le sèche-cheveux et m’en sers comme marteau. Tout y passe, les flacons, le miroir, le carrelage. Tout pète, gicle, éclate.
« Dans trois ans, j’aurai peut-être un enfant. Cela fait partie de nos projets. »
Pourquoi m’a-t-elle laissé espérer ? Pourquoi m’a-t-elle caché la vérité ? Pourquoi m’a-t-elle menti ?
Je reviens dans la chambre, règle le compte de l’armoire à coups de pied.
On tambourine à la porte.
Je gueule à pleins poumons.
— Allez vous faire foutre !
Ma vue se brouille. Je déracine l’écran mural en me servant de mes pieds comme levier.
Les coups redoublent. Quelqu’un m’invective en flamand.
La télévision à bout de bras, je claudique jusqu’au balcon, la brandis au-dessus de ma tête et la projette dans les airs.
Elle s’écrase six étages plus bas et explose dans un bruit d’apocalypse.
18. Entre deux battements
Cette fois, mon arrivée ne passe pas inaperçue. Christophe m’attend, planté au milieu de l’allée, poings sur les hanches, visage fermé.
D’après le regard qu’il me lance, il ne se réjouit pas de m’accueillir.
— Salut, Fred. On peut se voir ?
— Bien sûr.
Je n’ai quitté Hasselt que vers midi.
Le directeur de l’hôtel a appelé les flics pour porter plainte. Je leur ai expliqué que j’étais spasmophile, que ce genre de crise m’arrivait de temps en temps, qu’il ne fallait pas s’inquiéter, que j’allais régler la facture des dégâts.
Ils m’ont cru. Pour la spasmophilie et le remboursement. Le dirlo m’a fait signer une reconnaissance de dettes et m’a laissé partir. Je suis rentré pied au plancher, ce qui m’a valu un nouveau contrôle radar.
Il m’indique son bureau.
J’entre, je m’assieds.
Il ferme la porte et se met à beugler.
— C’est quoi, ce bordel que tu as foutu à Hasselt ?
— Quel bordel à Hasselt ?
Il pointe un doigt accusateur.
— Ne joue pas au con avec moi, Fred. Le directeur du Radisson m’a téléphoné pour m’expliquer que tu as saccagé une chambre. Tu te prends pour Mick Jagger ?
J’aurais choisi Chester Hanks, plus actuel.
— Saccager est un grand mot. Une nouvelle télé, deux miroirs, un petit coup de peinture et on n’y verra plus rien.
Il est apoplectique.
Son poing s’abat sur la table.
— Arrête ton show tout de suite, Fred. Je ne sais pas pourquoi tu étais là-bas, et je m’en fous. Tu gères ta vie comme tu veux, mais tu connais les règles. J’exige que mon personnel soit irréprochable. Les fouille-merdes, les pique-assiettes et les caractériels n’ont pas leur place ici.
Je bous intérieurement, je meurs d’envie de griller une clope. Je lui collerais bien ma démission séance tenante.
Je baisse la voix.
— Je suis désolé. J’ai pété un plomb.
Il renchérit.
— Qu’est-ce qui se passe avec toi ? L’autre jour, tu as failli t’endormir pendant la réunion. Tu avais une tête de déterré et tu puais la gnôle. Fais la java si tu as envie, mais le lendemain, tu dois être impeccable.
— D’accord.
— Je n’ai rien à te reprocher sur le plan professionnel. Tu es un bon journaliste. Ton travail répond aux objectifs. C’est au niveau de ton comportement que j’attends un changement, rapide et à long terme.
— OK, j’arrête les conneries.
Il se calme aussi soudainement qu’il s’est emporté, se lève et pose une main sur mon épaule.
— C’est bon, on n’en parle plus. J’ai dit au type de l’hôtel que tu étais quelqu’un de sérieux, et que tu allais payer les frais. Si tu as besoin d’une avance sur salaire, fais-moi signe. Maintenant, va bosser.
Je sors et traverse le plateau sous les regards embarrassés.
Loïc m’accueille, l’air effaré.
— Houla ! Ça a bardé.
Les autres se contentent d’une grimace de compassion.
— Salut tout le monde.
Je m’installe sans ajouter un mot, ouvre la feuille de route et me mets au boulot.
Bruxelles. Fusion entre Delhaize et Ahold.
Paris. Chauffeurs de taxis en grève.
Éloïse pose un mug de café sur le coin du bureau.
— Tu en as besoin.
— Merci.
L’après-midi me paraît interminable. Une phrase me revient en boucle, comme un écho douloureux.
« C’était une magnifique dernière fois. »
Une lame me cisaille la poitrine. Une première fois peut être magnifique, jamais une dernière.
Je guette l’écran de mon iPhone à intervalles réguliers. Aucun message de sa part. Seulement quelques appels de potes que j’ignore.
Colombie. Une mère et son bébé survivent cinq jours dans la jungle après un crash.
Début de soirée, clope suivie de la moambe avec Vanessa et Pierre.
Ils entament une discussion sur le look hipster. Vanessa trouve qu’il a l’air d’un con avec sa barbe. Pierre argumente, ça lui va bien. En plus, il peut se la raser quand il veut, pas comme les tatoués. Dans quelques mois, ils seront tous has been avec leurs décalcomanies partout. La tendance sera à la peau immaculée, translucide, diaphane. Tête de Vanessa.
En temps normal, j’adore me mêler à ces discussions déjantées. Elles remplissent nos moments creux. J’initie, je relance, je mets de l’huile sur le feu.
Cette fois, je reste silencieux. Ils ont compris qu’il fallait me foutre la paix.
À minuit, ils se barrent. J’en profite pour allumer une cigarette. Une heure plus tard, l’équipe de sécurité débarque et m’informe qu’il est l’heure d’évacuer les lieux. L’un des gars renifle et me dit qu’il est interdit de fumer dans les locaux.
Je retrouve ma voiture, descends la rue Royale comme un automate.
Avenue Louise, les tunnels.
Je branche le système mains libres et appelle ma messagerie.
Vous avez trois nouveaux messages.
23 h 45.
Jeremy hurle au milieu des décibels.
Mezza, vodka, nanas. On t’attend.
Entrée du Bois.
Message suivant.
20 h 47. Ma mère.
Bonsoir, Frédéric, c’était l’anniversaire de ton père aujourd’hui. Je te le rappelle, mais je sais que tu t’en fiches. Passe à la maison un de ces jours, tu me manques.
Ma mère est belle. En tout cas, l’était. C’est ce que j’ai entendu dire des centaines de fois. Una bella ragazza. Ce que la Lombardie fait de mieux. Je ne m’en suis jamais rendu compte. Je ne pense pas que les enfants soient capables d’apprécier les qualités esthétiques de leurs parents. Plus d’une fois, j’ai tenté d’oublier qu’elle était ma mère pour découvrir cette beauté que les autres vantaient.
En revanche, je n’ai jamais dû faire d’effort pour attester que mon père était un con.
Drève de Lorraine.
Dernier message. Dernière cigarette du paquet.
17 h 25. Raphaël Bernier.
Appelle-moi.
Je m’en fous, ça ne m’intéresse plus.
Avenue du Prince d’Orange.
J’éteins les phares, mets au point mort et laisse glisser la Golf jusque devant la maison de Camille.
Je coupe le moteur. Mon cœur bourdonne dans mes oreilles.
Superman est rentré, sa BMW rutilante est garée dans l’allée, protégée des vandales par une grille électrique. Malgré l’heure tardive, une lumière brille au rez-de-chaussée.
Je ferme les yeux, respire profondément.
La savoir à quelques mètres me calme. Mes muscles se dénouent. Mon rythme cardiaque ralentit.
Dans les hostos, ils notent l’heure de la mort à la minute près. Elle est fixée par l’arrêt du cœur. Elle survient dans l’espace-temps qui sépare un battement du suivant, manquant. Moins d’une seconde.
La lumière s’éteint, une autre s’allume à l’étage. Quelques secondes plus tard, elle s’éteint à son tour.
— Tu n’en as pas fini avec moi, Camille. Tu n’as pas idée de quoi je suis capable.
VENDREDI 26 JUIN 2015
19. Vendredi noir
6 h 15.
Les nuits se suivent et ne se ressemblent pas. Avant-hier, dans les bras de Camille, cette nuit, roulé en boule dans ma bagnole.
Je m’arrête à la station-service de Fort-Jaco, achète deux paquets de clopes et avale trois Red Bull. Récemment, des plaignants américains ont traîné la compagnie autrichienne en justice. Malgré une consommation régulière, ils n’ont pas vu d’ailes leur pousser dans le dos. L’affaire serait passée inaperçue s’ils n’avaient eu gain de cause.
La sonnerie de mon téléphone me sort du brouillard alors que je roule au pas dans les bouchons matinaux.
Raphaël Bernier.
— C’est sympa de m’avoir rappelé, je pensais que la mort de mon père t’intéressait. Si tu n’en as rien à foutre, dis-le-moi et j’arrêterai de te faire chier.
— Gwen est avec toi ?
— Non, pourquoi ?
— Alors, baisse d’un ton.
Son côté petit garçon reprend aussitôt le dessus.
— Excuse-moi, j’ai eu une nuit pourrie. Des clients de merde. Je voulais te dire que j’ai du nouveau. J’ai contacté Proximus pour résilier les abonnements de mon père et leur demander de m’expédier une copie détaillée de sa facture.
— Bonne initiative, Raf.
Mon compliment le revitalise.
— J’ai les temps de connexion à Internet, la liste des appels et des SMS envoyés, mais pas celle des appels reçus. Au milieu de tout ça, j’ai quand même trouvé quelque chose.
— Balance.
— Commençons par le Net. Il était connecté à peu près 24 heures sur 24, jusqu’au soir du 14 juin. Arrêt brusque à cette date. Par contre, il n’était pas accro au téléphone, il n’a donné que huit appels en un mois, dont quatre m’étaient destinés. Pas de SMS, rien de surprenant. Trois coups de fil passés le 17 juin, entre 21 h 45 et 22 h 15, à trois quotidiens, Le Soir, La Libre et la DH. À première vue, tu es le seul à avoir réagi.
Mes confrères ont cru à un canular.
Je note que la déconnexion au Web a eu lieu le jour de sa mort, ce qui tend à prouver que les tueurs ont coupé le réseau lors de leur visite. Dans la foulée, la messagerie vocale a été désactivée, mais le téléphone a été utilisé trois jours plus tard.
— Le quatrième coup de fil ?
— Il l’a donné le samedi 6 juin. J’ai rappelé le numéro. Je suis tombé sur un couple de Belges, les della Faille. Il a bossé pour eux au Venezuela en tant que chauffeur et garde du corps pour leurs mouflets. Ils sont rentrés en Belgique depuis plusieurs années et habitent à Genval. Ils sont restés en contact avec mon père, ils ont accepté un rendez-vous avec moi.
— Quand ?
— Demain après-midi.
— Je travaille jusqu’à 14 heures. Tu veux que je t’accompagne ?
— Si tu veux. Je t’envoie l’adresse. J’ai aussi demandé à la Poste qu’ils me transfèrent son courrier. À part sa facture d’eau et quelques pubs, il n’y a rien.
7 h 20.
J’arrive en même temps que l’hôtesse d’accueil. Elle est surprise de me voir de si bonne heure.
— Bonjour, Fred, ça va ?
— On ne peut mieux.
Elle me tend une enveloppe.
— Ton courrier d’hier.
J’en reçois peu. À part un carton d’invitation ou un dossier de presse, tout arrive par mail.
J’empoche la lettre et descends l’escalier pour me préparer deux cafés et fumer.
Au moment de remonter, le miroir de l’ascenseur témoigne de l’étendue du désastre. Je comprends la question de l’hôtesse. Je suis cadavérique. L’odeur que je dégage est assortie à mon teint. J’aurais mieux fait de passer chez moi pour prendre une douche, me changer et donner à bouffer à Nabilla.
Christophe se pointe une demi-heure plus tard.
— Ça va, Fred ?
Je prends l’air affairé.
— Impec.
Il me dévisage, tourne les talons et poursuit sa tournée de poignées de main.
Pierre débarque, il s’est rasé. Vanessa se fiche de lui. Alfredo louche sur les seins d’Éloïse.
La dépêche d’AFP tombe une heure et demie plus tard.
« Attentat en Isère : un corps décapité. »
Mobilisation générale. Alors que nous sommes sur des charbons ardents, un brouhaha parcourt la rédaction.
« Un homme a ouvert le feu dans un hôtel près de Sousse, une station balnéaire dans l’est de la Tunisie, faisant une trentaine de morts. »
Le plateau entre en effervescence.
Des jurons fusent, quelques-uns se lèvent, s’approchent des écrans. D’autres se ruent sur leur clavier. En quelques secondes, la rédaction ressemble à une fourmilière. On s’agite, on passe de l’un à l’autre, on parle, on fait non de la tête.
Ma fatigue s’est envolée.
Je tape à une vitesse ahurissante. Les infos surgissent de toutes parts. Les premières photos arrivent, insoutenables. Les charognards et les voyeurs qui croupissent dans la presse à scandale vont se régaler.
Je fais appel à l’équipe. Ils se regroupent autour de moi. En étroite symbiose, nous ne formons qu’un. Chacun donne son avis. Nous choisissons une image, l’une des moins choquantes, et mettons en ligne.
Coup de tonnerre.
« Koweït : 25 morts et plus de 200 blessés dans un attentat suicide. »
Vendredi noir.
Alfredo grommelle des phrases inintelligibles. Vanessa verse une larme. Éloïse est blême, statufiée devant son écran.
L’émotion l’emporte.
En principe, nous devrions laisser empathie et sensibilité au vestiaire, comme le font les chirurgiens de guerre qui passent d’une victime à l’autre pour évaluer leurs chances de survie et faire une sélection. Les plus anciens de la rédaction y parviennent, même s’ils le déplorent en aparté.
Nous passons le reste de la journée à surfer d’un site à l’autre, à lire les dernières dépêches, à parcourir TweetDeck pour rédiger, éditer, mettre à jour les macabres bilans. Le tout sans boire ni manger.
Vers 22 heures, Christophe vient nous trouver, les traits tirés.
— C’est bon, les gars, on arrête. Vous avez été exemplaires.
Gavés d’adrénaline, tous les sens en éveil, nous pourrions continuer jusqu’à l’aube. J’en ai oublié de fumer.
Éloïse passe derrière moi.
— Je n’en peux plus, il faut que je me change les idées. Je t’attends chez moi.
J’avais oublié notre rendez-vous.
— Vas-y, je te rejoins.
Je consulte mes mails avant d’éteindre mon ordi et jette un coup d’œil à la lettre qui traîne sur mon bureau depuis ce matin.
L’enveloppe est ornée d’un timbre français. D’après le tampon, elle a été expédiée de Paris, le 23 juin. Elle contient une carte postale en noir et blanc qui représente le Christ sur la croix.
Au verso, quelques mots, à l’encre.
« Natasha Sczepanski est née le 7 septembre 1980.
Elle est décédée le 2 mai 2014 dans des circonstances tragiques. »
20. Mourir jeune
La Golf tressaute sur les pavés de la place des Palais.
Je consulte une nouvelle fois mon téléphone. Aucun signe de Camille.
Elle suit l’actualité, elle sait à quel point ma journée a dû être pénible. En temps normal, elle aurait trouvé les mots. Ses messages m’auraient aidé à surmonter l’horreur. Elle m’aurait réchauffé, elle serait parvenue à faire renaître un sourire sur mes lèvres. Nous avions nos codes. Un rien suffisait pour qu’on se comprenne.
En quelques minutes, tout s’est écroulé.
Je n’ai pas dit mon dernier mot. Elle fait fausse route. Elle n’a rien à faire chez les Chinetoques. Je trouverai le moyen de la reconquérir. Ce qu’elle n’a jamais osé imaginer, ce qu’elle croit impossible, ne l’est pas.
Je dois tout lui dire.
Une ambulance me double, sirènes hurlantes.
Les images de la journée défilent.
Les corps criblés de balles sur la plage de Sousse. La mosquée dévastée à Koweït City. La tête décapitée, accrochée au grillage de l’usine.
En regard de ces carnages, le sort de cette Natasha Sczepanski me paraît insignifiant. Je ne sais pas qui elle est, pas plus que je ne sais qui m’a envoyé cette carte. Pour l’heure, je me contrefiche qu’elle soit morte le 2 mai 2014 dans des circonstances tragiques.
Je n’ai aucune envie de rejoindre Éloïse.
Que lui raconter ? Panne de bagnole ? Urgence familiale ? Malaise ?
Je remonte la rue du Trône, prends à droite dans la rue du Viaduc. Le quartier est calme. Un drapeau tunisien flotte sur une des façades.
Je suis épuisé. Deux nuits blanches, une journée en enfer. J’encaisse le contrecoup.
Je grimpe les marches, arrive au dernier étage, essoufflé. La porte de l’appartement est entrouverte. Avant-hier, j’ai dû oublier de la fermer. Nabilla a sans doute chié partout. Si elle ne s’est pas barrée, comme sa maîtresse.
J’entre, tends la main vers l’interrupteur.
Quelqu’un m’attrape le bras, me tire à l’intérieur.
Une tonne s’abat sur mes épaules. Je me retrouve nez à terre. Un étau se referme sur mes mâchoires, m’oblige à ouvrir la bouche. L’agresseur me tord les bras, me ligote les mains dans le dos. Un morceau de tissu s’inserre entre mes dents. Il l’enfonce jusque dans le fond de ma gorge.
Lumière.
Ils sont deux. Un Black, grand et athlétique et un Arabe râblé, tous deux habillés de noir. Ils m’agrippent par les bras, me soulèvent comme une plume et me jettent sur une chaise.
Le cordon qui emprisonne mes poignets entaille ma peau, pénètre dans ma chair.
Un troisième type, installé dans le fauteuil, observe la scène. Crâne rasé, nez de boxeur. Une cicatrice traverse sa joue et fend sa lèvre supérieure. Il me scrute de ses petits yeux rapprochés, enfoncés dans leurs orbites.
Les deux autres se placent derrière moi.
Le balafré leur fait un signe du menton.
Ils font basculer la chaise. L’arrière de mon crâne heurte le sol. L’Arabe pose une de ses pompes sur ma poitrine et pèse de tout son poids. Des points lumineux se mettent à voltiger devant mes yeux. J’ai la sensation que mes côtes volent en éclats.
Le Black se penche, retire le bâillon.
— Parle-nous de Bernier.
Je tousse, expulse un flot de bave.
— Je suis journaliste.
Il me balance son poing dans la figure. Mon nez explose. Du sang s’écoule dans ma gorge.
— Je me fous de ta bio, je te demande de nous parler de Bernier.
Je réfléchis à toute vitesse.
— Je ne le connaissais pas.
— Bien sûr.
Il tend le bras derrière ma tête.
Je tords le cou pour voir ce qu’il mijote. Je roule des yeux comme un animal traqué. Le salopard a préparé son matos. Un seau, plein à ras bord.
Il plonge une main dans la flotte et me balance un torchon sur la figure. L’eau dégouline sur mon visage, pénètre dans mon nez et ma bouche.
Je bloque ma respiration. La godasse revient à la charge, s’enfonce dans ma cage thoracique. Je me débats, pousse un cri qui s’étrangle dans ma gorge. Mes poumons se remplissent d’eau.
Le Black me cloue au sol et continue à verser la flotte.
D’un coup, il retire le chiffon. J’ouvre grand la bouche, exhale un vagissement et vomis un mélange d’eau et de sang.
— Je répète. Parle-nous de Bernier.
— J’ai reçu l’info au journal. Je ne sais rien, je vous jure.
Il prend le chiffon, le plonge dans le seau.
Je glapis.
— Attendez !
Il ne tient pas compte de mon offre, presse le torchon contre ma bouche.
Cette fois, il rallonge le supplice. Le sol se met à tanguer, un vertige m’envahit. Asphyxié, à court d’oxygène, je tombe en syncope.
Après ce qui me paraît une éternité, je reprends conscience. Je suis avachi sur la chaise, hébété, une loque humaine.
Le balafré me fait face, debout, jambes écartées. Il admire l’œuvre de ses sbires, un rictus haineux au coin des lèvres.
— Je te donne une dernière chance.
Voix rauque, accent indéfinissable.
Je bégaie.
— Je suis allé sur place. J’ai parlé aux flics. Je ne sais rien de plus.
Il pose un doigt sous mon menton, relève ma tête, me fouille du regard.
— Il est mort comment ?
Malgré l’embrouillamini qui ravage mon cerveau, la question me surprend.
— Il s’est suicidé.
Il approche son visage jusqu’à toucher le mien. Son haleine empeste la bière et le tabac. Il jette un coup d’œil aux autres et m’attrape par le cou.
— Comment ?
Je ne comprends pas le sens de sa question. Il devrait savoir comment il est mort. Sauf s’il veut être certain que les flics ont cru au simulacre de suicide.
— Il s’est tiré une balle dans la tête. La police est formelle. Ils ont classé l’affaire.
Son pouce s’enfonce dans ma glotte.
— Des nouvelles de son fils ?
— Je l’ai vu. Il ne sait rien, il s’en fout, il le détestait.
— Pourquoi tu remues la merde, alors ?
— J’espérais trouver quelque chose dans son passé pour faire un papier, mais il n’y a rien.
Il relâche la pression, pose sa joue contre la mienne, me murmure à l’oreille.
— Comme tu dis, il n’y a rien.
Il se redresse, adresse un signe à ses acolytes. Ils me prennent par les bras et me traînent jusqu’à la salle de bains. Mes dernières forces m’ont abandonné. Mes jambes sont inertes, mes pieds raclent le sol.
La baignoire est pleine.
Je grelotte. Ils me forcent à m’agenouiller au pied de la baignoire.
L’Arabe m’agrippe par les cheveux.
Une chaleur parcourt mon bas-ventre. Ma vessie me lâche. J’ai perdu une bataille, pas la guerre.
Je m’égosille.
— Allez-y, bande d’enfoirés, terminez le job.
Il plonge ma tête dans l’eau.
J’ouvre la bouche. La flotte envahit ma gorge, mon nez, mes poumons, mes oreilles.
Je résiste, secoue les épaules. Mon corps refuse cette mort que je n’ai pas programmée.
Camille, j’ai encore tellement de choses à te dire.
Des voix lointaines bourdonnent. Un voile sombre s’abat devant mes yeux. De minuscules étoiles jaillissent, se multiplient, explosent tel un feu d’artifice.
Mes muscles se détendent.
J’entends la voix de Greg.
— Ça va bien se passer, tu verras.
Des mains me tirent vers l’arrière. Je m’affale sur le carrelage.
Une porte claque.
Le silence ronfle dans mes oreilles.
Peu à peu, je reprends vie. Ils ont libéré mes poignets avant de quitter les lieux. Je me redresse sur les coudes et me mets à ramper comme un ver de terre. J’entre à plat ventre dans le salon. Un bruit me parvient. Un cliquetis circule dans la pièce.
Je relève le menton.
Un mouvement attire mon attention.
Nabilla passe devant moi en zigzaguant. Elle s’écrase contre le mur, se couche sur le flanc et continue à agiter les pattes dans le vide.
À l’endroit où se trouvait sa tête, des flots de sang jaillissent par à-coups.
21. Le grand bleu
Jeremy soupire.
— Tu fais chier, Fred.
Appeler le numéro d’urgence m’aurait valu une invasion de pompiers et de flics. Pour leur dire quoi ? Un home jacking ? Des chicken killers ? En plus, si les baraqués planquaient dans la rue pour guetter ma réaction, j’aurais risqué leur come-back.
L’espace d’un instant, j’ai pensé contacter Raphaël Bernier, mais j’ai renoncé pour les mêmes raisons.
Au bout du compte, j’ai téléphoné à Jeremy.
Il ne semble pas catastrophé.
— Tu aurais vu la meuf, un avion de chasse. J’étais à deux doigts de me la faire.
Je suis allongé dans le canapé, atone, emmitouflé dans une couverture, un récipient à portée de bouche. À intervalles réguliers, je suis secoué par des spasmes et de violentes quintes de toux.
Il continue à râler en me préparant un café.
— Râpé, le coup du siècle. Tout ça parce que tu as avalé un peu d’eau de travers.
Entre deux vomissements, je compatis d’un signe de tête.
Jeremy est de taille moyenne, plutôt rondouillard. Des restes d’acné juvénile parsèment son visage et il se coltine une coquetterie dans l’œil. Aux antipodes du physique du tombeur qu’il croit être. Les autres l’ont surnommé JD, ses initiales. En hommage à James Dean, d’après lui.
Une voix caverneuse résonne dans ma gorge.
— Va la rejoindre et laisse-moi crever.
Il se calme aussitôt.
— À l’heure qu’il est, c’est naze. Un autre va se la taper. Je m’en remettrai. De toute, elle avait des nichons en berne et le QI d’une agrafeuse. Qu’est-ce qu’ils te voulaient, ces types ?
— Une séance privée de Grand Bleu.
Il s’esclaffe.
— Putain, le trip. Tu te souviens ?
L’histoire remonte à l’été 2011.
Sa conquête du moment nous avait invités chez le copain d’un copain d’une copine, un fils à papa qui squattait la villa de ses parents dans la baie de Sainte-Maxime. Une vingtaine de pique-assiettes avaient envahi les lieux, en majorité des mâles, plus quelques nanas issues de sa dynastie, prénom composé et particule nobiliaire.
Atmosphère décadente, alcool, lignes de coke à gogo et baise à tous les étages. Le soir, on prenait la navette qui traverse le golfe pour passer la nuit dans les boîtes branchées de Saint-Tropez. À l’aube, on rentrait fin saouls par le premier bateau en emmenant le produit de notre pêche. On refaisait surface en milieu d’après-midi pour s’affaler autour de la piscine.
Nicolas, le mec en question, « appelez-moi Nico », faisait venir des pizzas et des sushis qu’on mangeait avec des mojitos en écoutant de la deep house ou le hit d’une nana qui avait avalé une cornemuse.
Cet après-midi-là, la température avoisinait les 40 degrés. Pour mettre un peu d’ambiance, Nico a fait son numéro de G.O. En général, il annonçait un concours de fléchettes, un match de water-polo ou une partie de boules, mais il avait une autre idée.
Il est monté sur une chaise et s’est mis à beugler.
— Cinquante euros à celui qui restera le plus longtemps sous l’eau.
Hormis les quelques parasites acquis à sa cause, les autres n’en avaient rien à foutre.
Piqué au vif, il a fait le tour de la piscine pour haranguer les troupes. Les écouteurs dans les oreilles, je n’ai pas fait attention. Le dernier album en date des Rival Sons venait de sortir et je me le passais en boucle.
Il s’est mis à gesticuler devant moi.
J’ai mis sur pause.
— Qu’est-ce qu’il y a encore ?
— Tu en es, Fred ?
Et de m’expliquer de quoi il s’agissait.
J’ai vu l’opportunité de soutirer du pognon à tous ces cons.
— J’en suis, mais à mes conditions.
Vexé, il m’a défié du regard.
— C’est quoi, tes conditions ?
— Tout le monde pose un billet de cinquante sur la table, le gagnant rafle le pot. Si je perds, je double la cagnotte.
Il n’appréciait pas que je lui vole la vedette, mais les meufs ont commencé à hurler comme des pom-pom girls. Sa proposition n’encensait que le gagnant, la mienne offrait aux spectateurs la possibilité de se foutre de la gueule des perdants.
Magnanime, il a accepté.
En moins de deux, une dizaine de candidats se sont déclarés.
Jeremy s’est penché vers moi, inquiet.
— Tu n’as pas ce fric, qu’est-ce que tu branles ?
J’ai désigné les concurrents du menton.
— Tu as vu ces mecs ? Avec trois grammes d’alcool dans le sang et de la coke plein les narines, ils ne tiendront pas trente secondes. Je vais rafler le gros lot.
— Tu n’es pas plus clean qu’eux.
— T’occupe, je gère. Excite-les, je me prépare.
Il ignorait que j’en connaissais un bout sur l’apnée. À plusieurs reprises, j’avais essayé de reproduire les sensations que j’avais éprouvées lors de ma noyade.
Il a pris les choses en main et est parti négocier avec Nico. Ce dernier voulait que chacun plonge tour à tour pour que l’on chronomètre sa performance. Jeremy a balayé l’idée et décrété que ce serait tout le monde en même temps sous peine que je retire ma proposition.
Deuxième gifle pour Nico.
Il a cédé. J’ai connecté mon iPod à la sono et on s’est tous jetés à la baille.
Le doigt sur la touche Play, Jeremy a entamé le décompte.
— Dix, neuf, huit…
Au contraire des autres qui prenaient une grande inspiration, j’ai commencé à respirer de manière saccadée, jusqu’à ce que ma tête se mette à tourner.
Au top départ, le riff a retenti et tout le monde a plongé.
Tête sous l’eau, je me suis laissé flotter, bras écartés, sans faire le moindre mouvement, en me concentrant sur la musique qui vibrait en sourdine, entrecoupée par les cris hystériques des nanas. Les joues dilatées, je lâchais de l’air par petites bouffées.
Le premier héros n’a pas tenu trente secondes. Après ce premier forfait, je les ai vus remonter à la surface, un par un.
Quand il ne restait qu’une paire de jambes dans le bassin, mon cortex a disjoncté. Je ne savais plus où j’étais ni ce que je faisais. Ils sont venus me chercher et m’ont allongé au bord de la piscine. Jeremy hurlait à pleins poumons. Il s’est accroupi, m’a flanqué quelques gifles et a agité la liasse de billets.
— On a gagné, mec.
J’avais tenu jusqu’à la dernière note. Trois minutes et vingt secondes. Plus tard, j’ai appris que j’étais cramponné aux barreaux de l’échelle. Les types qui sont venus me repêcher ont dû me forcer à les lâcher.
Jeremy me tire de ma rêverie.
— Tu t’endors ou tu meurs ?
Retour au présent. Les images de la journée se remettent à ricocher dans ma tête.
J’ouvre un œil.
— Ça va. Tu peux y aller.
— Tu es sûr ?
J’acquiesce d’un mouvement des paupières. J’aimerais allumer une clope, mais j’en suis incapable.
Je referme les yeux. Mon esprit part à la dérive. Je revois la silhouette dans ma chambre.
Bonsoir, la Mort.
Les humains savent qu’ils vont mourir. Cette nuance les différencie des animaux. L’échéance les fait avancer. Dès le départ, ils savent que leur temps est compté, qu’ils doivent se grouiller pour construire leur château de sable ou détruire celui du voisin.
Si les singes en étaient conscients, ils seraient au même niveau que nous. Ils se bougeraient le cul au lieu de pieuter sur leurs branches et de bouffer des bananes.
Mon téléphone me tire de mes divagations.
Éloïse s’impatiente.
— Ça fait une heure que je t’attends, qu’est-ce que tu fous ?
Je déglutis, toussote, crachouille un filet de salive.
— Je me suis fait agresser.
Elle explose.
— Tu t’es fait agresser ? C’est tout ce que tu as trouvé ? Je t’ai connu plus créatif.
SAMEDI 27 JUIN 2015
22. Goûter au bord du lac
Assis du bout des fesses, nous faisons tache dans le canapé fleuri. Raf a enfilé un pantalon de cuir et affiche son air buté. Mon coquard et ma tête de zombie n’améliorent pas le tableau.
Françoise della Faille minaude.
— Thé ou café ?
— Café.
Raf me suit.
— Café pour moi aussi.
Ce matin, j’ai rassemblé les restes de Nabilla et les ai fourrés dans un sac en plastique. Ensuite, j’ai nettoyé les traces de son agonie. Je m’étais habitué à sa présence. Même l’odeur de merde qu’elle charriait ne me dérangeait plus.
Quand elle m’apercevait, elle venait frapper à la vitre et caquetait d’impatience. Je sortais pour lui refiler de vieilles croûtes de pain, des restes de pâtes, tout ce qui me tombait sous la main. Elle picorait mes godasses, attrapait mes lacets.
Elle était un lien vivant entre Camille et moi, un de nos sujets d’hilarité.
Une boniche old school débarque avec un plateau chargé de vaisselle en porcelaine.
Les della Faille habitent un manoir digne de Gatsby le Magnifique, avec vue sur le lac de Genval. Ma mère dirait qu’ils forment una coppia armoniosa.
Jean-Charles, la cinquantaine fringante, est grand et élancé. Son air sérieux, ses tempes grisonnantes et ses lunettes d’intello feraient fureur sur une affiche électorale.
Françoise paraît dix ans de moins que lui. Pantalon blanc, allure zen, mensurations avantageuses, elle semble perdue sur son nuage. Je l’imagine donnant des cours de watsu à des wonder women stressées.
Rompus à l’hypocrisie sociale, ils ont déclaré se réjouir de nous accueillir. Raf m’a présenté comme un ami de longue date. Il leur a appris la mort de son père lors de son appel téléphonique, ce qui a permis d’écourter la séance de condoléances.
Jean-Charles attend que la soubrette ait terminé de trancher le cake au citron pour s’adresser à Raf.
— J’ai connu votre père en 2009. À l’époque, je dirigeais la filiale d’une société américaine à Caracas. Nous proposions des services informatiques articulés autour d’une architecture basée sur un cloud hybride unifié.
Il s’arrête, confus.
— Pardonnez-moi, l’habitude. Je suppose que ça ne vous dit rien ?
Raf secoue la tête.
— Je n’y connais rien en informatique.
Piece of cake pour moi, mais il ne m’a pas demandé mon avis.
Il poursuit, magnanime.
Régis Bernier a travaillé pour eux pendant deux ans, jusqu’à leur départ du Venezuela. Il était leur chauffeur et leur garde du corps. L’air grave, Jean-Wikipédia della Faille nous explique que Caracas est une des villes les plus dangereuses du monde et que le Venezuela enregistre près de quatre mille meurtres par an plus un millier de kidnappings avec demande de rançon.
Raf n’en a rien à battre.
— Comment l’avez-vous connu ?
— Par le bureau diplomatique de Belgique. C’est eux qui m’ont donné son nom. Pour des raisons de sécurité et de langue, nous préférions engager un compatriote.
Françoise acquiesce.
C’est elle qui a insisté. Ils ont eu une expérience malheureuse quand ils étaient à Shanghai.
Elle parle à voix basse en mesurant ses mots, comme si elle nous confiait un secret inavouable. Je redoute qu’elle ne se lance dans le compte rendu de leur expérience malheureuse.
Par chance, Jean-Charles embraie.
— Votre père occupait un appartement dans les dépendances. En dehors de ses heures de travail, il sortait rarement de la propriété. Malgré cela, nous le voyions peu. Il avait accès à la piscine, mais il n’y est jamais venu. Le matin, il me conduisait au bureau et déposait les garçons à l’école ou au sport. L’après-midi, il accompagnait ma femme. De temps en temps, il travaillait le soir, quand nous avions une invitation.
Raf aligne quatre cuillerées de sucre dans sa tasse de café.
— Il était comment avec vous ?
Jean-Charles verse un nuage de lait dans son Earl Grey et le mélange avec délicatesse.
Bernier était taiseux, secret. Ils l’ont convié plusieurs fois à partager leur repas, mais il a toujours refusé. En revanche, sur le plan professionnel, il était irréprochable.
— Il avait une copine ?
— Je ne sais pas. En tout cas, je ne l’ai pas vu avec une femme. En 2010, il a fait la connaissance d’un confrère qui travaillait pour un diplomate français. Ils ont sympathisé et se rencontraient assez souvent.
— Pourquoi avez-vous gardé le contact avec lui ?
Sa question jette un froid.
Le couple épatant échange un regard entendu.
On lui dit ou pas ?
Il se racle la gorge, signe qu’il va cracher le morceau.
— L’incident a eu lieu en mars 2011. Nos garçons avaient quinze et treize ans. Ils allaient assister à la fête de l’école. Françoise était avec eux. Votre père était au volant. Quand ils sont sortis de la propriété, deux voitures les ont pris en filature. La première les a dépassés et s’est mise en travers de la route. Deux hommes ont surgi, armés et cagoulés. La voiture qui se trouvait derrière les empêchait de faire demi-tour.
Raf pose sa tasse, le fixe dans les yeux.
— Et après ?
JC reprend sa respiration.
— Votre père a réagi à une vitesse incroyable. Il a jailli à l’extérieur, a dégainé son arme et a tiré deux coups. Le premier homme a été touché aux jambes, le deuxième à l’épaule. Quand il s’est relevé, il s’est trouvé nez à nez avec un troisième acolyte, sorti de l’autre voiture. Il était à deux mètres de lui. Votre père a pointé son arme entre ses yeux. C’était un adolescent. Ma femme a vu la scène. Ça n’a duré qu’une fraction de seconde, mais elle s’en souvient comme si c’était hier.
Raf se fige.
— Il l’a tué ?
— Non, il a tiré en l’air.
Raf se détend, soulagé. Apprendre que son paternel a flingué un môme n’aurait pas amélioré sa mémoire.
— Putain de merde !
Françoise a un mouvement de recul, scandalisée par la grossièreté du vocabulaire.
Elle reprend le flambeau.
Le gamin a été assourdi par la détonation et a pris ses jambes à son cou. Un autre homme, qui se trouvait dans la voiture derrière eux, s’est également enfui. La police est arrivée et a emmené les deux blessés. Le père de Raf était le héros du jour. Le soir, on a parlé de lui à la télévision. Le lendemain, il avait sa photo dans le journal.
Jean-Charles soupire.
— Mais votre père n’a pas vécu cet événement comme une victoire.
Françoise prend des airs de conspiratrice.
— Pour lui, cet épisode n’a pas été un acte de bravoure, mais un drame. Après cela, j’ai observé des changements dans son comportement. Une question le torturait.
Elle lève les yeux vers le plafond, adopte un ton théâtral et confie qu’un jour, alors qu’il la conduisait en ville, il l’a regardée dans le rétroviseur et lui a demandé : « Et si j’avais tiré ? »
Raf tripote son piercing. Ses postures de yoga commencent à l’énerver.
— Bon, il n’a pas tiré. Et après ?
Elle encaisse l’affront sans broncher.
— Petit à petit, j’ai compris qu’il s’était façonné un personnage. Au fil des années, il a adopté le système de référence de sa persona et a fini par se prendre pour le dur insensible qu’il voulait être aux yeux des autres. En fait, je pense qu’il ne savait plus qui il était au fond de lui.
Les œuvres de Lacan doivent encombrer sa table de nuit.
Raf balaie l’interprétation psychanalytique.
— Qu’est-ce qui a changé chez lui ?
Elle redescend sur terre.
— Sa façon de se comporter, de réagir, même s’il n’a pas communiqué davantage avec moi.
Jean-Charles vient à son secours.
Après cet événement, Bernier a commencé à discuter avec leurs fils. Ceux-ci ont réalisé ce qui aurait pu se passer s’il n’était pas intervenu. Il est devenu leur idole. Un jour, il leur a parlé de Raf. C’est comme ça qu’ils ont appris son existence.
Françoise se penche vers Raf, les yeux mi-clos, façon Sarah Bernhardt.
— Je pense qu’il a fait une projection entre ce gamin et vous. Il vous aimait beaucoup.
Raf marmonne entre les dents.
— Merci pour l’info.
Elle arbore une mine doucereuse.
— Ne le prenez pas comme ça. Je pense qu’il regrettait de ne pas parvenir à vous le dire.
Raf se décompose.
J’en profite pour m’adresser à Jean-Charles.
— Il a continué à travailler pour vous ?
Il opine.
L’incident s’est produit trois mois avant leur départ. Bernier est resté chez eux jusqu’au dernier jour.
Après le Venezuela, son ami lui a proposé de se mettre en relation avec la société de sécurité pour laquelle il travaillait. Ils lui ont trouvé un poste.
Bernier ne leur a pas donné de détails sur sa destination, mais ils ont gardé le contact. Leurs fils voulaient discuter avec lui, le revoir, savoir ce qu’il devenait. Il leur envoyait un mail de temps en temps. Parfois, ils se téléphonaient, mais il était difficile à joindre.
Une idée me vient.
— À quoi ressemblait son ami ?
— Grand, costaud, le physique de l’emploi.
— Blond ?
— En effet. Il s’appelait Marc. Je ne connais pas son nom de famille, mais ça ne devrait pas être compliqué à retrouver. Il était le chauffeur du consul de France.
Raf revient à la charge.
— De quoi avez-vous parlé lors de vos derniers contacts ?
— Je l’ai eu au téléphone en fin d’année. Il m’a appris qu’il avait perdu son job. Il n’a pas donné de précisions, mais il m’a paru déprimé. Je l’ai rappelé au printemps, mais il n’a pas répondu. Fin mai, j’ai réessayé et laissé un message. Il m’a rappelé seulement une semaine plus tard.
— Qu’est-ce qu’il vous a dit ?
Il hausse les sourcils.
— Il n’avait pas le moral. Quelque chose le tracassait. Il m’a dit qu’il avait repris contact avec vous, mais que ça ne se passait pas bien. À la fin de la conversation, il est revenu sur les événements de Caracas et sur le gamin qu’il avait failli abattre. Avant de raccrocher, il a eu une réflexion étrange, une phrase un peu philosophique du genre : « Faut-il voir mourir des gens pour devenir humain ? » Je n’ai pas compris ce qu’il a voulu dire.
12 minutes avant l’appel
La manifestation tournait à l’émeute. Dans quelques instants, la situation deviendrait incontrôlable.
Elle devait fuir à tout prix, penser à elle, à eux.
Les assaillants atteignirent le rassemblement et se mirent à frapper sans discernement, ignorant les appels au calme. Cernés par la horde déchaînée, les gens refluèrent malgré eux vers l’entrée du bâtiment, seule issue leur permettant d’échapper au déluge de coups.
Elle se mit à hurler, mais ses cris se perdirent dans le tumulte. Prise de vertige, le cœur défaillant, elle fut entraînée par la marée humaine.
23. Cherchez la femme
— Une Yam XT 660, rien que ça ?
Je n’avais pas repéré son taxi devant la maison des della Faille. Il était arrivé avant moi et j’ignorais par quel moyen il était venu. Quand je l’ai vu récupérer son casque et son blouson, j’ai compris qu’il espérait m’impressionner.
Un sourire apparaît sur ses lèvres.
— C’est ce que je voulais. Un mono, naked, avec un couple énorme, qui arrache, pas un quatre-pattes de tapette. Sinon, autant se traîner en scooter.
— Tu dois être secoué comme une noix, là-dessus ?
— Pas faux.
Le café-restaurant tea-room est situé au bord du lac de Genval, à quelques centaines de mètres de chez Jean-Charles et Françoise. À la table contiguë, quelques mémés prennent le thé en déblatérant sur leurs belles-filles. Elles pallient leur surdité en braillant comme des fans d’AC/DC.
Le loufiat apporte nos bières en slalomant. Il est raccord avec le patelin, veston taillé dans une carpette de bain, air guindé et gestes faussement désinvoltes.
— Ça fait longtemps que tu es au gros cube ?
— Cinq ans. Une bande de potes m’a filé le virus. Les mecs étaient fans du Prince noir et de Ghostrider, les bikers de légende qui ont établi le record du tour du périf parisien à plus de 200 de moyenne. Avant d’avoir ma propre bécane, je montais derrière l’un d’eux. Ils m’ont offert les plus belles chaleurs de ma vie. De temps en temps, on s’éclatait sur le Ring, au milieu de la nuit. Des tarés, quoi.
— Vous rouliez dans le bon sens ?
Il me dévisage quelques instants, hausse les épaules.
— Non, en sens inverse, c’est malin.
Nos voisines baissent le ton, se penchent l’une vers l’autre. La plus sénile, chignon strict et joues flasques, ne remarque pas que son collier trempe dans sa tasse de thé.
Je capte des bribes de leur conversation. Les pronostics vont bon train.
« Ils n’ont pas dormi de la nuit. Tu as vu leurs têtes ? Tu crois que ce sont des… »
Raf avale la moitié de son verre, le pose d’un geste sec et lance un regard agressif aux bourgeoises.
Il aimerait leur clouer le bec, mais n’ose pas.
Je saisis l’opportunité pour marquer des points.
— Ne fais pas attention à ces momies.
Murmures stupéfiés des mémères.
À mi-voix, je lui raconte ma soirée mouvementée. Je ne lui en avais touché que quelques mots par téléphone. Je lui retrace le fil des événements, depuis mon mail à Academi jusqu’à la décapitation de Nabilla.
Il plante ses coudes sur la table dans la position d’un lutteur de foire.
— Putain, dans quelle merde on a mis les pieds ? Si j’en crois la menace sur le passeport, je risque d’être le prochain sur la liste.
— Je leur ai juré que tu ne savais rien et que tu t’en fichais.
— C’est le cas. Du moins en partie. Ils ont gobé ton histoire ?
— Ils cherchaient à me foutre la trouille. En deux mots, ils m’ont dit que j’avais intérêt à laisser tomber.
— Qui sont ces mecs ?
— À mon avis, d’anciens camarades d’armes de ton père.
— Tu penses que c’est eux qui l’ont buté ?
Même si tout porte à le croire, un doute subsiste dans mon esprit. Pourquoi ces types ne se sont-ils pas intéressés à mon ordinateur et à mon téléphone, au contraire de ce qui s’est passé chez Bernier ? Ils n’avaient qu’à ouvrir mon sac, mon matos s’y trouvait.
Je me rends compte que je ne lui ai pas parlé de l’inconnu du cimetière. Je lui explique de quoi il retourne, sa présence, ses déplacements incohérents, son départ précipité.
Il ne l’avait pas repéré. Il avait autre chose à faire et ignorait qui étaient les autres participants.
— Ça pourrait être ce Marc, le type dont ils nous ont parlé, celui que ton père a connu à Caracas. Il cadre avec la description : grand blond, costaud.
Je reviens sur ma rencontre avec le voisin.
— D’après lui, il venait de temps en temps. Le modèle de bagnole correspond.
Il me dévisage, admiratif.
J’ai pris l’ascendant.
— Tu vois un lien entre tout ça ?
— Pas encore. J’ai envisagé plusieurs scénarios, mais aucun ne colle avec l’ensemble.
Je lui livre mes convictions.
Le nœud de l’affaire se situe entre le départ de Caracas et le moment où son paternel a perdu son job. Pour moi, il a participé à quelque chose et il fallait le faire taire. Ce Marc est la piste à creuser, même si rien ne dit qu’il a un rapport avec tout ça.
Il s’incline.
— OK, tentons le coup. Mon père emportera peut-être son secret dans sa tombe, mais on aura essayé.
Les confidences des della Faille l’ont marqué.
Il sait à présent qu’un cœur battait sous la cuirasse de papa. Il imaginait qu’il voulait qu’il soit comme lui, un Rambo psychorigide.
— Quand j’étais gamin, il insistait pour que je m’inscrive dans un club de judo, que je fasse de la muscu, que je casse la gueule à ceux qui m’emmerdaient. Pas de chance, j’ai hérité de la morphologie de ma mère.
Je comprends mieux son look, sa moto et ses airs rebelles, de maigres ersatz pour compenser sa carrure rachitique.
Il devrait savoir qu’on s’en tape, des aspirations paternelles.
Je reviens sur la phrase testamentaire.
— Faut-il voir mourir des gens pour devenir humain ? Qu’est-ce que ça peut vouloir dire ?
Il est songeur.
— Aucune idée. Je ne le vois pas dire un truc comme ça.
Nous terminons nos bières en contemplant le jet d’eau qui jaillit au milieu de la mare, copie brabançonne de son grand frère genevois.
Les mamys se sont désintéressées de nous et s’en prennent à leurs gendres. Des idiots, stressés, maladroits, pas foutus de repasser une chemise, à se demander ce qu’ils feraient sans une femme.
Mon esprit part en roue libre.
Cherchez la femme, pardieu ! Cherchez la femme !
Je fixe Raf, assommé par l’évidence.
— Merde ! Cherchez la femme. Alexandre Dumas. Les Mohicans de Paris. Tu as encore la photo que j’ai trouvée chez ton père ?
Il jette un coup d’œil à mon verre, inquiet.
— Elle est chez moi. Qu’est-ce qui te prend ? Tu as pété un câble ?
Je me lève, me dirige vers la table des ancêtres. D’un geste, j’attrape un quartier de tarte qui traîne sur une des assiettes et l’enfourne en entier dans ma bouche.
Les vioques se figent, pétrifiées, tremblantes, mains jointes sur la poitrine.
Je bafouille entre deux bouchées.
— Merci, mesdames. Tu viens, mon chéri ?
En sortant, nous croisons le serveur qui arrive à la rescousse.
Une fois dehors, Raf m’apostrophe.
— Tu m’expliques ?
— Hier, j’ai reçu une carte postale de Paris, anonyme.
Il me contemple avec curiosité.
— Et alors ? De quoi ça parlait ?
— D’une certaine Natasha Sczepanski.
DIMANCHE 28 JUIN 2015
24. Haute tension
J’ai l’impression d’avoir une chasse déglinguée dans les poumons. À chaque inspiration, des gouttelettes d’eau remontent dans ma gorge. J’ai beau tousser, expectorer, rien n’y fait.
Hier, après avoir quitté Raf, je me suis effondré sur mon lit sans parvenir à trouver le sommeil. La fièvre s’en est mêlée. Des cauchemars m’ont poursuivi jusqu’à l’aube.
Pour tout arranger, j’entame ma troisième journée sans nouvelles de Camille.
Je déteste les dimanches. Les horloges tournent au ralenti. Les gens se terrent chez eux. Hormis quelques bagnoles qui lambinent, les rues sont désertes. Seules les sirènes épisodiques des ambulances maintiennent Bruxelles en vie.
En temps normal, je me lève au milieu de l’après-midi pour m’avachir devant ma PS4. Je récupère de ma virée de la veille en sillonnant Los Santos ou Chicago au volant d’une muscle car, mon lance-grenades à portée de main. Quand j’en ai marre de décimer les bandes rivales ou les hordes de flics, je prends le highway en sens inverse et je m’offre un frontal.
Nous devrions tous bénéficier de plusieurs vies. Nous pourrions aller au bout de nos fantasmes, revivre nos meilleurs moments, apprendre de nos erreurs. Tu serais encore là. Nous aurions fait de grandes choses.
Je sors du plumard comme un grabataire, allume une clope et me traîne jusqu’à la fenêtre. J’ouvre les tentures, jette un regard à la cage vide de Nabilla.
Il est 8 heures, mais il fait noir comme en pleine nuit. Le tonnerre gronde au loin. Un éclair enflamme l’horizon.
L’orage est un spectacle dont je ne me lasse pas. Il m’arrive de m’envelopper dans un imper et de m’installer sur la terrasse. Balayé par les vents et la pluie, je contemple les éléments en fureur en me remémorant mon passage sur la chaise électrique.
Pour le lancement d’un jeu vidéo, une boîte de marketing avait placé une monumentale prise de courant dans le hall de la gare Centrale. Les badauds devaient planter leurs doigts dans les orifices et résister à une décharge électrique.
Un tas de mecs faisaient la queue. Rien d’étonnant. Selon un psy, « les prises de risques corporelles ont une grande capacité communicationnelle et génèrent une forme particulière de lien social chez les jeunes ».
J’ai réussi l’épreuve sous les vivats de Jeremy et les applaudissements des spectateurs.
La semaine suivante, Jeremy m’a emmené dans un bar mal famé, derrière la Bourse. L’endroit ressemblait à un stamcafé ordinaire, sauf que les clients bravaient l’interdiction et fumaient comme des cheminées.
Nous avons longé le comptoir et sommes entrés dans l’arrière-salle. La pièce était bourrée à craquer. On se serait cru dans un sauna. Ça puait la bière et la transpiration. Pas une meuf dans les parages. Les mecs étaient massés autour d’une table et gueulaient à s’en péter le larynx.
Quatre types étaient cramponnés à des poignées fixées aux accoudoirs de leurs chaises, reliées par des câbles électriques à une boîte métallique équipée d’une manette et d’un compteur. Les spectateurs refilaient des billets à un rouquin affublé d’un tablier en caoutchouc.
Jeremy a hurlé dans mon oreille.
— Ça te tente ?
Le brouhaha a cessé et les regards se sont tournés vers les joueurs. Le roux a abaissé la manette. Cloués sur leur siège, les électrocutés se sont mis à gigoter, les yeux injectés, les traits déformés.
J’observais la scène, subjugué. Après quelques secondes, les deux premiers ont abandonné. Ne restaient qu’un gringalet tatoué de partout et un chauve au physique de sumo qui encaissait la décharge en gonflant ses joues comme Dizzy Gillespie.
Le rouquin a descendu la manette d’un cran supplémentaire et le maigrichon a bondi de sa chaise. Il a fait le tour de la salle en se tortillant, les cheveux dressés sur la tête, secoué de spasmes comme une marionnette désarticulée.
Jeremy s’est approché de l’organisateur. Ils ont discuté un moment. Pendant ce temps, le champion en titre me fouillait du regard.
Jeremy m’a proposé le marché.
— Seul contre l’obèse, à cinq contre un.
— Tenu.
Le rouquin a ouvert les paris pendant que je m’installais en face du mastodonte. J’ai agrippé les électrodes encore humides de la sueur du tatoué.
Le mec en tablier a balancé le jus et une tronçonneuse m’a découpé dans le sens de la longueur. Mille millions de picotements se sont propagés dans mon corps et ma vessie s’est mise à cramer. Les gens hurlaient de tous côtés en me regardant tressauter comme un taulard de Sing Sing.
J’ai craqué.
Bibendum s’est fendu d’un rire sonore et je me suis enfui comme un voleur. J’ai tiré la gueule à Jeremy pendant deux semaines.
Je me recouche, attrape mes clopes et mon iPhone, consulte les textos.
Des conneries, du vent.
Aucune nouvelle de Camille.
La mémoire de mon téléphone est saturée par ses milliers de messages. Souvent, ses mots étaient accompagnés d’une photo. Elle paparazzait ses clients, assortissait le cliché d’un adjectif. L’image s’animait, devenait une caricature vivante.
Elle courait les boutiques, faisait des selfies dans les cabines d’essayage avec les trucs les plus moches qui lui tombaient sous la main, des chapeaux, des robes, des perruques, des colliers, de la lingerie de grand-mère.
D’autres fois, elle m’envoyait des gros plans de sa bouche, de ses oreilles, de ses cheveux, de son nombril, de ses pieds dans des positions acrobatiques. Je possède des centaines de photos de nous deux, la plupart floues, où nous sommes méconnaissables, défigurés, hilares.
Le best of est notre collection de portraits à lunettes. Je prétextais une myopie naissante pour subtiliser les paires de mes collègues le temps d’une prise. Nous passions des soirées à nous envoyer des grimaces. On s’arrêtait quand l’un de nous s’endormait, surpris par le sommeil, entre deux messages d’amour déguisé.
Tu as ouvert un gouffre dans ma vie, Camille.
Je balance mon téléphone à travers la pièce.
Un soir, Jeremy m’a téléphoné pour s’excuser. Tout était sa faute. Il aurait dû me prévenir, il a été con, nous n’étions pas bien préparés. Par bonheur, il avait trouvé la solution, j’allais devenir imbattable.
Il m’a fait rencontrer un matheux, un jeune gars boutonneux qui savait tout, crâne dégarni, lunettes en bocal de poissons. L’air hautain, le prix Nobel m’a parlé de cage de Faraday, d’induction, d’isolation, des trucs du genre. Au final, il m’a refilé une tenue d’homme-grenouille et des pompes spéciales.
Le samedi, nous sommes retournés dans le bistrot. J’avais passé la combinaison sous mes fringues et enfilé les godasses magiques, sans oublier d’emporter ma pièce d’échecs porte-bonheur. Comme me l’avait conseillé le bigleux, je n’avais rien bu de la journée et m’étais séché de la tête aux pieds avant d’entrer.
Quand il m’a aperçu, le sumo a exulté. Ses gloussements se mêlaient aux sifflements des spectateurs. Jeremy me coachait comme un boxeur en hurlant qu’ils allaient voir ce qu’ils allaient voir.
Je me suis assis et j’ai dévisagé le monstre avec un sourire en coin.
Le rouquin a envoyé la sauce et j’ai ressenti un délicieux fourmillement dans les mains. Après quelques secondes, je me suis mis à vibrer. Mes bras sont devenus insensibles, mes yeux clignotaient comme des lampions de Noël.
En face, le gros inspirait par petits coups, les bajoues hypertrophiées, prêtes à craquer.
L’arbitre a augmenté le voltage. Mes tripes ont commencé à griller. Une morsure de feu a irradié dans ma nuque avant de redescendre le long de ma colonne vertébrale jusqu’au bout de mes orteils. Malgré la douleur, j’étais persuadé que ma tenue me rendait infaillible. J’allais enterrer ce con. Jamais, jamais, jamais, je ne cèderais avant lui.
À un moment, il a ouvert la bouche, mais aucun son n’est sorti. Il a lâché les poignées et a fait basculer la table.
J’ai essayé de me lever, la bave aux lèvres.
Ensuite, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé dans le couloir des urgences, à l’hôpital Saint-Pierre, allongé sur une civière.
Après coup, Jeremy m’a appris que ma victoire avait viré en bagarre générale. Il a dû me charger sur ses épaules pour me faire sortir du chaos et m’a jeté dans la bagnole, persuadé que j’étais mort.
Bien plus tard, lors d’une grosse teuf, il m’a avoué la supercherie.
Fin saoul, il a pris l’air sarcastique.
— Tu veux savoir pourquoi tu as gagné ce soir-là ?
Il a tapoté sur mon front avec son index.
— Il n’y avait aucune astuce. L’apprenti Einstein, le body, les pompes, c’était du flan. Tout se passe dans la tête. Une simple programmation psychologique.
Il avait raison. L’homme croit ce qu’on lui dit et ne voit que ce qu’il veut voir. La tapée d’images bidon qui inondent le Web le prouve.
La sonnerie du téléphone retentit.
— Salut, Jerem, je pensais justement à toi.
Une voix d’outre-tombe me répond.
— Je rentre à l’instant. Nuit d’enfer. Tu nous as manqué, mec. Tu n’as pas oublié le passage à niveau, ce soir ?
J’avais zappé l’épisode.
— Endroit habituel, 22 heures ?
— OK.
Une idée germe dans mon esprit.
— Prends deux caméras en plus de la GoPro, on va se faire la totale.
— Qu’est-ce que tu mijotes ?
— Tu verras.
Accroche-toi, Camille. Si tu ne viens pas à Fred, Fred ira à toi.
25. Le choc des photos
Un tintement.
J’ouvre un œil. 14 h 25. Je me suis rendormi, téléphone à la main. Ma clope a cramé un coin de la couette.
Raf me relance par SMS.
Tu as trouvé quelque chose sur cette Natasha ?
Je m’assieds dans le lit. L’eau recommence à glouglouter dans mes poumons.
Ma soif d’en savoir plus fonctionne sur courant alternatif. À certains moments, je brûle de découvrir le fin mot de l’histoire, à d’autres, je m’en tape.
Il en va de même pour un tas de choses dans ma vie. Les bouquins que j’ai commencés sans jamais les terminer, les films dont je n’ai vu que la moitié, les mots croisés incomplets, les puzzles inachevés, les filles que j’ai laissées tomber avant même de conclure.
Les sports tiennent une place de choix dans ma liste d’objectifs avortés. J’en ai expérimenté une flopée. Il suffit que je regarde quelques images à la télé ou qu’un pote m’en parle avec passion pour que je m’emballe. Illico, je m’inscris dans un club et achète le matériel haut de gamme. Tennis, hockey, squash, badminton, krav-maga. Après quelques séances, j’abandonne. Pour le rugby, j’ai capitulé avant de fouler le terrain.
J’installe mon ordi sur mes genoux, ouvre le navigateur et entre Natasha Sczepanski dans la fenêtre de recherche.
Aucun résultat, Mister Google est formel. Il m’invite à essayer Natacha Spaczynski. Je tente le coup et parcours quelques pages en anglais. Rien de probant.
Sur Facebook, personne de ce nom-là.
Pas mieux sur Twitter.
À toutes fins utiles, je vérifie l’orthographe sur la carte postale.
J’expédie ma réponse à Raf.
Rien trouvé. Je continuerai demain, quand j’aurai récupéré quelques neurones.
Sa réaction ne se fait pas attendre.
Tu as regardé où ?
Il me prend pour un débutant ?
Sur le Web.
La sonnerie retentit dans la seconde.
Il est survolté.
— Tu es sûr que tu as bien regardé ?
Sa muse ne doit pas être loin.
— Pourquoi ?
— Gwen a trouvé quelque chose. Nous savons qui est cette Natasha. Je peux te dire où et comment elle est morte. Tape son nom sur Google et clique sur images.
Je rouvre Chrome, Natasha Sczepanski, onglet Images.
Une galerie de photos dégringole sur l’écran. Des types dans des postures diverses, en pied, assis, barbus, chauves, lunettés, souriants, sérieux, une Asiatique, une affiche Peace and Love, une montre rectangulaire, quelques graphiques.
Je scrolle. En bas de page, je reconnais la femme de la photo. Je clique. Consulter le site.
Je débarque sur un blog chargé de caractères cyrilliques. La photo de Natasha est centrée, encadrée de noir et surmontée d’un titre en gras. Un long texte suit.
Raf s’impatiente.
— Alors ?
— Gwen connaît le russe ?
— C’est de l’ukrainien. Nous sommes dessus depuis ce matin. J’ai fait appel à un collègue qui m’a aidé à décrypter. Elle est morte à Odessa, le 2 mai 2014. Ça te dit quelque chose ?
— Oui.
Le 2 mai 2014. Un vendredi. Je m’en souviens, on travaillait en équipe réduite à cause du pont du 1er mai.
La première alerte est venue des réseaux sociaux en début d’après-midi. Des affrontements opposaient des groupes de séparatistes pro-russes à des pro-Ukrainiens dans le centre-ville. On parlait de jets de pierres, de bâtons, de boucliers, de chaînes, de cocktails Molotov, de coups de feu.
Dans les minutes qui ont suivi, un tas de dépêches contradictoires sont tombées. Selon les sources, elles affirmaient une chose ou son contraire, chaque camp pointant l’autre du doigt. Informations et démentis se sont succédé jusqu’en début de soirée.
Les heurts se sont soldés par la mort d’une quarantaine de personnes, principalement des pro-Russes qui s’étaient retranchés dans un bâtiment officiel. Un incendie de cause indéterminée s’était propagé. Les victimes s’étaient fait piéger dans le brasier. Plus tard, on a parlé de liquide inflammable trouvé dans les décombres. Certains cadavres étaient mutilés. Des témoins ont déclaré avoir vu des tireurs sur le toit, bien qu’aucune arme n’ait été retrouvée.
En fin de compte, personne ne sait ce qui s’est réellement passé. La tragédie a été relayée par les médias, mais aucune enquête sérieuse n’a été entreprise par la suite. Deux jours plus tard, plus personne n’en parlait.
Le petit Raf remonte dans mon estime.
— Que dit le texte ?
Il pavoise.
— Le blog est tenu par un Ukrainien. En temps normal, il cause zik, bouquins, cinoche. Sur le coup, il a changé de registre. Il connaissait cette Natasha. Elle était médecin et habitait à Odessa. Elle n’en avait rien à foutre du pourquoi des combats, elle était allée porter secours aux victimes.
— Quel rapport avec ton père ?
— Le mec du blog était sur les lieux. Il a tout vu. Il dit que ce massacre a été organisé. Il prétend que des casseurs d’extrême droite et des mercenaires étaient mêlés aux manifestants.
— Rien ne dit que ton père était à Odessa ce jour-là. D’après son passeport, il a fait un aller-retour à Kiev, mais c’était plus tard, en septembre 2014.
Gwen fulmine dans son dos. Elle lui demande si je le fais exprès, si je suis journaliste, si je me fous de leur gueule.
Il pose une main sur le téléphone. Je perçois les vibrations de leur échange d’insultes.
Après quelques instants, il reprend.
— La photo de cette femme était chez lui. J’ai trouvé un message de menace dans son passeport. Toi-même, tu penses que sa mort est suspecte. Des mercenaires ont débarqué chez toi pour une baston. Sans compter la carte postale. Ce ne sont pas des coïncidences.
— Peut-être.
Gwen l’a chauffé à blanc.
Il s’égosille.
— Putain, Fred, je sais que la mort est ton quotidien. Tu as l’habitude d’aligner les macchabées sur les pages de ton canard.
Cette fois, il me gonfle.
— Raf ?
— Quoi ?
— Maintenant, tu fermes ta gueule.
Il se calme aussitôt.
— D’accord, mais quand même, c’est vrai, quoi. Bon, je t’envoie une autre photo.
Le mail arrive dans la foulée.
J’ouvre le fichier JPG. La photo est prise dans un bureau. La pièce baigne dans la pénombre. Un écran d’ordinateur, un tas de papiers, un pot de fleurs en morceaux et des débris jonchent le sol. Une femme est allongée sur la table, tête en arrière. Le bas de son corps est dénudé. La blancheur de sa chair contraste avec l’obscurité ambiante.
Je reçois chaque jour des images d’horreur. Avec le temps, je commence à me blinder. J’enfile ma carapace de journaliste pour me livrer à une analyse factuelle.
Je zoome sur la photo, à la recherche de détails.
Rien n’est moins fiable que les images qui sortent de nulle part. Des montages audacieux ou des photos truquées ont réussi à berner certains de mes prestigieux confrères. Le cliché du prétendu cadavre de Ben Laden a fait le tour des médias avant d’être retiré.
Si l’on se base sur certains documents, Armstrong n’aurait jamais marché sur la Lune, la scène aurait été tournée en studio, et aucun avion ne se serait écrasé sur le Pentagone, le 11 septembre 2001.
Je poursuis l’examen, Raf commente.
— Ils lui ont passé un câble électrique autour du cou et elle a été violée. Quand ils en ont eu assez, ils l’ont étranglée.
J’agrandis le plan sur le cadavre.
— Elle était… ?
— Enceinte, oui, de six mois.
— Son visage est dans l’ombre. Rien ne dit que c’est cette Natasha ni qu’elle a été violée. Ni même que cette photo a été prise à Odessa.
Gwen a l’oreille collée à l’écouteur. Elle murmure quelques mots qui suscitent un sursaut de virilité de son chérubin.
— Tu te fous de moi ? Dis-moi que c’est un souvenir de vacances, tant que tu y es. Tu as vu, dans le fond, contre le mur ? Une masse. D’après toi, c’est un outil de bureau ordinaire ?
Il est paumé, déchiré entre Gwen et mon scepticisme.
— Demain, j’irai fouiller dans les archives du journal et j’interrogerai notre spécialiste de la question ukrainienne. Il devrait pouvoir m’en dire plus sur la présence hypothétique de mercenaires.
— Merci, Fred.
Une inspiration me vient.
— Tu es libre ce soir ?
Il hésite.
— Gwen travaille jusqu’à minuit, mais moi, je suis en congé. J’ai encore rien prévu. Pourquoi ?
— Tu aimes les films d’action ?
LUNDI 29 JUIN 2015
26. Ultimatum
Le plateau est désert. Seul le ronronnement de l’air conditionné trouble le silence. Je me suis levé au chant du coq pour peaufiner le final cut de la vidéo enregistrée cette nuit.
Un chef-d’œuvre.
Action.
Je sors de la bagnole, ferme la portière, descends le talus d’un pas souple en faisant tournoyer ma pièce d’échecs entre mes doigts. Je m’approche, m’arrête à cinq mètres. Clope au bec, je glisse mes Ray-Ban sur le bout du nez et nargue l’objectif.
Zoom avant.
Cadrage serré sur mon visage. Regard martial, air de défi. Je m’efforce de ne pas sourire, malgré la douzaine de spectateurs hors champ qui se trémoussent derrière Jeremy. Certains se marrent en douce. Ils ont reçu pour ordre de fermer leur gueule. Pas un mot, pas un bruit.
Raf est parmi eux, exsangue. Il ne sait pas ce qui l’attend.
Je reste immobile quelques instants, impassible, héroïque, impérial.
Lent zoom arrière.
J’écrase ma clope et me dirige vers la voie ferrée. À mi-distance, je me retourne, jette un dernier coup d’œil sur ma vie et poursuis mon chemin.
Passage sur la caméra 2, fichée dans le ballast. Contre-plongée. Je m’accroupis, m’allonge entre les rails. Au premier plan, ma tête. En arrière-fond, à trois cents mètres de mes pieds, le tunnel et son gouffre abyssal.
Un grondement enfle. Le sol se met à trembler et le train surgit du néant. Le monstre grossit à vue d’œil, fond sur moi dans un vacarme effrayant. Je pousse un hurlement.
Retour à la caméra 1. En off, mon cri s’étouffe pendant que je disparais sous le convoi. J’ai ajouté un léger écho pour sublimer mon agonie.
Clap final.
Des frissons parcourent ma nuque. Le spectacle est jouissif. Il ne manque que le déplacement d’air et l’odeur de graisse brûlée.
J’adore cet exercice. Je l’ai souvent pratiqué, mais je ne m’en lasse pas. Jeremy le vend avec maestria pour appâter les pigeons. La motrice qui me charcute, le crochet métallique qui pendouille et m’arrache les tripes, des trucs du genre.
Dans les faits, le risque est limité. En Russie, les zatseperi, les surfeurs du rail, des gamins de quinze ans, en font autant. Certains, en équilibre sur le toit des trains, se suspendent à la caténaire et sautent d’un convoi à l’autre quand ils circulent côte à côte.
Je poste la vidéo sur YouTube, en partage privé. Titre : Une magnifique dernière fois.
Je copie le lien et l’envoie à Camille.
— Tiens, tu es là ? Quelle surprise !
Je sursaute.
Éloïse est plantée devant moi et m’observe avec malice.
— Salut.
— Tes ravisseurs t’ont autorisé à venir au bureau ?
— Mon papa a payé la rançon.
Sûre d’elle, elle s’assied à califourchon sur mes genoux, attrape mon menton et examine mon coquard.
— Beau boulot, on dirait un vrai.
Elle colle sa bouche contre la mienne et entame un lent mouvement du bassin. Après quelques ondulations suggestives, elle me libère, se lève et contemple mon entrejambe.
— Je remarque que je te fais encore de l’effet. C’est dommage, tu devras faire une croix sur la question. Café ?
— S’il te plaît. Avec deux Lexomil.
J’ouvre la feuille de route pendant qu’elle s’éloigne.
Inauguration de la zone piétonne à Bruxelles. Embouteillages monstres. Portrait du tueur de Sousse.
Comme chaque lundi, les journalistes arrivent au compte-gouttes. Vanessa débarque, suivie de près par Alfredo et Robert-l’Encyclopédie-vivante.
Dès qu’il est installé, je m’empare du premier papier qui me tombe sous la main et me dirige vers son bureau, l’air affairé.
— Bonjour, Robert, tu as deux minutes ?
Il ferme les yeux, croise les mains sur sa poitrine, geste que je prends pour un accord.
J’en profite pour contrôler l’écran de mon téléphone.
Énième message de Raf. Il est bluffé. Je lui en ai mis plein les yeux. Il me kiffe grave, je suis la nouvelle star, il en reveut. Il m’a promis de ne rien dévoiler à Cruella.
— Tu te souviens des événements d’Odessa, l’année passée ?
Il opine.
— Le vendredi 2 mai. Pourquoi ?
— À ton avis, est-il possible que des mercenaires aient été mêlés au massacre ?
— Tu es de nouveau là avec tes mercenaires. Qu’est-ce que tu cherches ?
— J’aide une copine pour son mémoire.
— Je vois. Si tu n’as que deux minutes, la réponse est oui.
Il fait mine de retourner à son travail.
— Deux minutes, c’était façon de parler.
Il soupire.
— Tu sais ce qui se passe là-bas ?
— Dans les grandes lignes.
Il se penche en avant. C’est parti pour une plombe.
— En 2008, Poutine a menacé d’annexer la Crimée et l’est du pays si l’Ukraine était admise à l’OTAN. En 2013, alors que la signature d’un accord avec l’Union européenne approchait, il a convoqué Ianoukovitch pour lui annoncer que la Russie comptait investir 15 milliards en titres du gouvernement ukrainien pour contrer les propositions du FMI. Son but était de convaincre les Ukrainiens que le partenariat avec la Russie était la meilleure option.
Il s’arrête, me dévisage, suspicieux.
— Tu t’es battu ?
— Je me suis fait agresser par une porte vitrée.
— C’est joli. En plus, c’est assorti à ta chemise.
Mon téléphone vibre. Texto de Jeremy. Il prend de mes nouvelles. Fausse alerte.
— Sauf que les Ukrainiens n’y ont pas cru.
Il pointe un index sur mon coquard.
— Bien vu, le borgne. La sortie des étudiants sur le Maïdan a démontré que cette génération avait d’autres idéaux. Malgré la répression, les manifestants ont marché jusqu’au siège du gouvernement pour en déloger Ianoukovitch. Le type est parti se réfugier à Moscou où il a demandé à son pote Vladimir de rétablir l’ordre dans son pays.
Je prends la balle au bond.
— Mais Poutine ne pouvait pas envoyer son armée, sous peine d’être accusé d’ingérence.
Il m’adresse un clin d’œil.
— Tout à fait. C’est pour ça que l’invasion progressive de la Crimée s’est faite par des troupes non identifiées. Tu vois où je veux en venir.
— Des mercenaires ?
— Des Russes, des Serbes et des membres de l’Alpha Group, une sorte de navy seals russes. Les Russes ont toujours nié, mais un convoi de camions qui rapatriait des cadavres de mercenaires a prouvé leur implication.
— Et dans le camp ukrainien ?
— Même topo. Des centaines de contractants étrangers ont participé à des opérations contre les séparatistes aux côtés des soldats, de la police ukrainienne et du régiment Azov, une unité paramilitaire d’inspiration néonazie.
— Qui paie tous ces gens ?
— Bonne question. Le gouvernement ukrainien est au bord de la faillite. Tu connais l’adage ? Chercher à qui le crime profite.
— En conclusion, à Odessa, il y en avait des deux côtés ?
— Plus les titouchki, des jeunes, fêlés, ultraviolents qui travaillent avec les forces de l’ordre pour semer la merde. En principe, ils ne s’en prennent qu’aux opposants, mais ils sont aussi capables d’attaquer la police pour la pousser à réagir.
— Merci, Robert.
Il sourit.
— De rien, passe le bonjour à ta copine.
Je fais demi-tour et me retrouve nez à nez avec Christophe. À sa tête, je comprends qu’il est là depuis un moment.
— C’est quoi, cette connerie, Fred ?
Il ne me laisse pas le temps de trouver une réponse. Il tourne les talons et me fait signe de le suivre dans son bureau.
Mon téléphone se manifeste alors que je lui emboîte le pas.
Un SMS.
Camille.
Mon cœur fait une cabriole.
C’est quoi, ce cirque, Fred ?
4 minutes avant l’appel
Lorsqu’ils pénétrèrent dans le hall de l’immeuble, les manifestants ralentirent leur course.
Hébétée, elle posa une main sur son ventre et tenta de reprendre son souffle, mais le répit ne fut que de courte durée. Surgissant du sous-sol, un groupe d’individus cagoulés fondit sur eux. Les coups se mirent à pleuvoir dans un vacarme assourdissant, entre cris de haine et hurlements de douleur. Des tirs éclatèrent de toutes parts tandis que les matraques s’abattaient sans pitié sur les têtes, les nuques, les épaules.
27. La cigarette du condamné
Avec Christophe, l’expression « en prendre plein la gueule » revêt tout son sens. Après m’avoir rappelé, décibels à l’appui, combien il déteste les démarches égocentriques, les cavaliers seuls, les narcissiques et la dissimulation d’informations, il me soumet à un interrogatoire serré sur l’affaire Bernier.
Je crache le morceau, jusqu’à la dernière miette.
Il m’écoute en triturant sa baballe antistress. Même la visite amicale des mercenaires ne semble pas l’émouvoir.
Mon récit terminé, il redémarre.
— Merde, Fred ! À chaque réunion, je pose la question. Avez-vous des sujets qui méritent d’être développés ? Tu aurais dû te manifester.
Avant que j’aie le temps de répondre, il me signifie que l’entretien est terminé.
Je sors du bureau à moitié sonné.
Plutôt que de retourner à ma place pour y subir les regards compatissants de l’équipe, je descends m’en griller une.
Fidèle au poste, Gilbert m’attend, la main tendue.
— T’as une sèche pour ton ami ?
Je sors mon paquet.
— Il ne m’en reste qu’une.
— C’est con. On la fume à deux ?
Avec ce que je viens de déguster, je risque de ne plus avoir de quoi m’en acheter. Tout dépend s’ils me virent pour faute grave ou si je bénéficierai d’indemnités.
— Prends-la.
Il ne proteste pas, allume ma dernière clope.
— Merci, Fred, c’est sympa. Je t’ai raconté le jour où le roi est venu visiter Le Soir ?
Je m’en fous.
— File-moi une taffe.
J’aspire une bouffée interminable pendant qu’il continue son historiette.
— Tu parles d’un stress. Pendant une semaine, on a dû ranger, vider les bureaux et mettre de l’ordre à tous les étages, jusqu’aux archives. On a même planqué le téléphone du boss pour éviter qu’il sonne pendant qu’Albert était dans son bureau.
Je joue la montre, m’offre une seconde dose.
— Et alors ?
— Tu sais quelle a été la première question de Sa Majesté ? « Comment faites-vous pour travailler sans papiers et sans téléphone ? »
Et de se plier en deux.
Son rire se termine en quinte de toux. Tout en faisant semblant de me marrer, je cherche une réponse à expédier à Camille. Que lui dire ? Que je suis mort hier soir ? Que je vais me faire lourder dans les minutes qui suivent ?
À court d’inspiration, j’abandonne. Cette fois, la chance m’a quitté. Il fallait que ça arrive un jour. Aujourd’hui, je cumule. Je vais enterrer le mince espoir que j’avais de la reconquérir et perdre mon job dans la foulée.
Je remonte et jette un coup d’œil chez Christophe. La porte est fermée. Par la vitre, je constate qu’il a convoqué le boss, le Petit Robert illustré et le directeur financier.
Je vais m’asseoir et tente de retrouver mes esprits en attendant le verdict.
Éloïse se penche vers moi.
— On en a discuté entre nous. S’il nous interroge, on prend ta défense. On lui dira que nous étions au courant, mais que nous t’avons conseillé de monter un dossier solide avant de le présenter en réunion.
Je grimace un sourire.
— Je vous adore, mais c’est un peu tard. Mon sort se joue à l’instant.
De fait, le comité quitte le bureau. Christophe les regarde s’éloigner puis se tourne vers moi.
— Fred, tu viens ?
Je me lève, avance d’un pas traînant dans le couloir de la mort.
Il referme la porte, m’indique une chaise.
— Tu as fait une connerie, Fred.
Son entrée en matière me surprend. S’il avait l’intention de me virer, il l’aurait déjà annoncé. Il va me laisser une dernière chance. La pire option. Fred en sursis.
Avant ce soir, tout le monde sera au courant. Les journalistes me parleront avec tact et douceur, comme à un type qui vient d’apprendre qu’il a un cancer généralisé. Ils arrêteront de discuter quand j’arriverai, ne se ficheront plus de mes fringues, s’abstiendront de la moindre confidence. Demain, je ne serai plus des leurs.
— Je sais. Qu’est-ce que tu comptes faire ?
— J’ai organisé une réunion impromptue pour valider l’idée à laquelle j’ai pensé.
— Quelle idée ?
Il soupire.
— J’aurais dû tenir cette affaire à l’œil et revenir dessus pour que tu m’en parles. Moi aussi, j’ai fait une connerie.
J’en ai le souffle coupé.
Où veut-il en venir ?
— Je ne comprends pas.
Il balaie l’air d’un geste.
— Regardons le futur. Je te donne cinq jours. Pas un de plus.
— Cinq jours ?
Il se penche en avant, plisse les yeux.
— Tu pars à Kiev. Nous avons un correspondant là-bas. Je l’ai contacté. Il te conduira à Odessa. Il te servira de chauffeur, de guide et d’interprète. Tu as cinq jours pour me ramener du concret. Pour être clair, je me fous de ce Bernier, ce qui m’intéresse, c’est ce qui s’est passé là-bas l’année dernière. Jusqu’à présent, aucun canard n’est parvenu à démêler le vrai du faux.
Mes jambes se mettent à trembloter. Ma voix aussi.
— Pourquoi moi ? Robert est mieux qualifié.
— C’est ton sujet, c’est ton enquête, c’est à toi de la mener à terme.
Des fourmillements de plaisir remontent le long de mon dos.
Je la joue panache.
— J’ai toujours dit que ma place était sur le terrain.
Il sourit.
— Tu n’as pas encore le prix Albert-Londres pour autant.
— Merci, Christophe, je ne sais pas quoi dire.
— Alors, ne dis rien. Ça fait un bout de temps que je te tiens à l’œil, Fred. Le moment est venu de prouver tout le bien que je pense de toi. Ne me déçois pas. Prépare ton dossier et arrange-toi avec la compta pour ton billet d’avion.
Je m’extirpe de la chaise, retourne à mon bureau en posant un pied devant l’autre comme un automate.
La team est là. Ils épient ma réaction, les oreilles dressées, l’air catastrophé.
Éloïse lance les hostilités.
— Alors ?
J’ai la bouche sèche.
— Je pars en Ukraine. Il me donne cinq jours pour pondre un papier valable.
Loïc exulte.
— Putain, c’est énorme !
Ils se lèvent, me tapent dans le dos, m’embrassent.
— T’es le meilleur, Fred.
— Montre-lui de quoi tu es capable.
— On t’aime, Fred.
— Tu veux un café ?
Alfredo semble se souvenir de quelque chose.
— J’allais oublier, Fred, quelqu’un t’attend à la réception.
— Quelqu’un ? Qui ? Je n’attends personne.
Et si ?
Je fonce vers l’ascenseur, écrase le bouton d’appel. Merde ! Occupé. Je plonge dans la cage d’escalier, descends les marches quatre à quatre, déboule au rez-de-chaussée.
Camille est installée dans l’un des canapés.
Elle feuillette un magazine, les jambes croisées, l’air détaché, comme si elle attendait son tour chez le coiffeur.
28. L’aveu
— Décidément, on ne peut pas te laisser seul cinq minutes.
Je ne sais ce qui est le plus bluffant : qu’elle se soit pointée au journal en prétextant que nous avions rendez-vous, qu’elle ose s’afficher à mes côtés sur un banc public dans l’allée centrale du Parc royal ou qu’elle parvienne à faire preuve d’humour.
— J’en avais marre d’attendre un signe de ta part.
Elle hausse les épaules.
— Quelle imagination ! À part ton pseudo-suicide ferroviaire, tu as autre chose à m’annoncer ?
— Je me suis fait tabasser, Nabilla a été décapitée et je pars en Ukraine.
Elle fronce les sourcils.
— C’est tout ?
Je lui retrace mon vendredi apocalyptique, mes dernières découvertes et ma réunion matinale.
Elle esquisse un sourire.
— Je vois au moins trois points positifs. Cet œil au beurre noir te donne un petit air de Rocky, tu vas devenir un grand reporter et j’ai douze poules à caser.
Une manière détournée de me rappeler son départ.
Je ne parviens pas à lui rendre son sourire. Je suis mal à l’aise comme lors de notre première rencontre. Pour ajouter à la déconfiture, je m’embourbe dans les banalités.
— Et toi, quoi de neuf ?
— Ma vie n’est pas aussi palpitante que la tienne. Nous avons mis la maison en location, j’ai passé mon week-end à recevoir la visite d’un tas de gens.
— Je sais, tu te barres chez les Chinetoques, pas besoin de me le rappeler à tout bout de champ.
Elle accueille ma pique avec détachement.
— Oui, Fred, je pars en Chine, rien n’a changé.
— Pourquoi es-tu venue ?
— Pour savoir à quoi rime cette mise en scène.
— Ce n’est pas une mise en scène, c’est mon quotidien. Mon kif, c’est l’adrénaline. Je roule à contresens sur le Ring, je saute d’un immeuble à l’autre, je m’envoie des décharges électriques, je participe à des concours d’apnée. Je suis une star dans le microcosme des fêlés.
Elle secoue la tête, faussement admirative.
— Pas mal.
— Je fais aussi des trucs avec des bestioles. Je laisse des scorpions me grimper dessus, je joue avec des mygales, je danse le slow avec des serpents. Je me suis promené dans la fosse aux lions. Et encore, je ne te donne qu’un aperçu.
— Tu en as fait des choses en trois jours. Tu vises le Guinness Book ? Empiffre-toi plutôt de hamburgers, c’est moins risqué.
— Je suis sérieux. Ce Fred-là, c’est moi.
Elle prend soudain conscience que je ne plaisante pas, adoucit sa voix.
— Pourquoi tu ne m’as jamais parlé de ça ?
— Parce que nous n’avons jamais parlé sérieusement.
C’est le moment que choisit Éloïse pour franchir la grille du parc. Sa clope à elle, c’est une bouffée de chlorophylle. De temps à autre, il m’arrive de l’accompagner. Un soir, elle a profité de la pénombre pour me témoigner son attachement dans une contre-allée. Elle m’aperçoit, me jette un coup d’œil explicite et poursuit son chemin.
Camille a capté notre échange et la regarde s’éloigner avant de reprendre.
— Qu’est-ce que tu attends de moi, Fred ?
— Que tu me dises pourquoi tu as commencé cette histoire avec moi.
La sentir proche et inaccessible me remue jusqu’à la moelle. Je crève d’envie de passer un bras autour de ses épaules et de l’embrasser dans le cou, comme au bon vieux temps.
Elle inspire.
— D’accord, je vais t’expliquer, mais je ne suis pas sûre que ça va te plaire.
D’une moue, je l’encourage à poursuivre.
Elle plonge son regard dans le mien.
— Jean-Bernard n’a pas toujours été l’homme qu’il est aujourd’hui. Ces dernières années, il s’est investi dans son job. Petit à petit, il a gravi les échelons professionnels avec son cortège de contraintes : stress, réunions tardives, voyages imprévus, week-ends avortés, vacances minimales. Je pensais que c’était un mal nécessaire. Un jour, je me suis réveillée et je me suis rendu compte qu’il n’était plus le même. Je vivais avec un guerrier d’entreprise, impitoyable, irascible, absent. Notre principal sujet de conversation se limitait à lui, à son business plan, à ses KPI, à son mid-year review, et toutes ces conneries.
Un sans-abri arrive à notre hauteur, la main tendue.
— Une petite pièce, les amoureux ?
Elle ouvre son sac, lui file un bifton de cinq euros et continue sur sa lancée.
— Un jour, il me parlait des gens qu’il voulait virer, le lendemain, des gens qu’il avait virés. Je me suis éloignée. Je me suis sentie larguée et malheureuse de l’être. Je me suis réfugiée dans mon travail, mes poules, mes copines, mes livres, mon imaginaire. Pourtant, je croyais le connaître. Nous allions à la même école. Nous habitions dans le même quartier. Quand j’ai eu quinze ans, il a été mon premier. Ça n’a duré que quelques semaines, mais je ne l’ai jamais oublié. Quelques années plus tard, je l’ai retrouvé à l’univ. Nous nous sommes mis ensemble. Nous nous sommes mariés, nous avons fait construire une maison. J’étais heureuse. Ma vie était réglée. Je ne me posais pas de questions. En plus, tout le monde le trouvait parfait. C’était l’homme de ma vie. Et puis, tu es arrivé.
J’ironise.
— Mesdames et messieurs, le bouffon du roi.
Elle me regarde sans me regarder, comme si elle ressassait un vieux souvenir.
D’un geste, elle passe une main dans mes cheveux.
— Non, pas le bouffon du roi. Toi, Fred, ta manière nonchalante de débarquer dans ma vie, ton sourire craquant, ta maladresse, tes tifs dans la figure, ta chemise catastrophique, ta façon de me regarder, ton charme. J’ai tout de suite été attirée.
Je bafouille.
— Tu ne me l’as jamais dit.
Elle se lève, replie une jambe sous elle et se rassied dans sa position favorite.
— Je n’avais pas besoin de te le dire.
Elle se penche, fait courir son pouce le long de mes sourcils.
— Tu as fait renaître un pan de ma vie que j’avais enfoui. Le rire, la complicité, le plaisir d’être deux. Avec toi, je pouvais être moi-même, me laisser aller, dire ce que je pensais, me moquer de tout, partager mes délires. Tu m’as comblée, Fred.
— Alors, ne pars pas, reste avec moi.
Elle tente un maigre sourire.
— Ce n’est pas possible.
— Merde, Camille, tu as trente-deux ans ! Tu parles comme si tu en avais soixante. Tu ne vas pas passer ta vie avec un type que tu n’aimes plus.
— Je n’ai pas dit que je ne l’aimais plus. J’ai dit qu’il avait changé. Tout change.
— Tu crois qu’au fin fond de la Chine vous allez revivre une lune de miel ?
— Je ne sais pas.
J’aimerais lui livrer le fond de ma pensée. Son Jean-Bernard est un connard arriviste et arrogant. Bientôt, sa vie se résumera à des parties de gin-rummy avec les bobonnes d’expats, à des cocktails mondains et à des dîners où le principal sujet de conversation sera le cours de la Bourse et les prospectives économiques.
La fontaine glougloute tristement. Une mamy remonte l’allée en poussant un landau qui semble peser une tonne. Un clebs qui bave promène un homme en survêt.
Je soupire.
— Je comprends.
Tout est dit. Dans quelques instants, elle se lèvera et notre histoire prendra fin. Je voulais savoir, je sais. J’ai entendu ce que je ne voulais pas entendre. J’aurais dû me contenter de cette magnifique dernière fois.
Elle se redresse d’un coup.
— Toi non plus, je ne te connais pas. Tu viens de m’en donner la preuve. J’ignorais tes trips de barge. Qu’est-ce qui te pousse à faire ces trucs ?
Il me reste un infime espoir de faire vaciller son choix. Tout se joue dans les quelques secondes qui vont suivre.
Je me lance.
— Avec toi, je pourrais chasser la silhouette.
Elle dodeline de la tête.
— La silhouette ?
— Je dois t’avouer quelque chose, Camille.
Elle me fixe droit dans les yeux, comme quand elle s’amusait à deviner mes pensées.
Je prends son visage entre mes mains.
— Promets-moi de ne rien dire, de m’écouter jusqu’au bout, sans m’interrompre.
Elle saisit mes mains avec douceur, les tient serrées dans les siennes.
— Promis. Je t’écoute, Fred.
Impossible de faire marche arrière.
Je déglutis.
— J’avais un frère, il s’appelait Greg. Je l’ai tué.
29. Les poissons rouges
Je quitte Le Soir peu après 21 heures.
Il fait encore clair. L’air est doux. J’aime les longues journées d’été, quand Bruxelles reste éveillée. Les gens boivent un dernier verre avec leurs collègues avant de rentrer chez eux. Les bistrots sortent leurs tables. Certains quartiers prennent des allures de Paris.
Christophe m’a libéré de mes tâches quotidiennes pour me laisser préparer mon voyage. J’ai commencé par réserver mon billet d’avion et trouver un hôtel qui cadre avec le budget qui m’est alloué.
Je pars demain, à 14 heures. Mon retour est prévu samedi, en fin de matinée. Les cinq jours fatidiques n’en seront que trois. Le minitrip risque de virer en marathon.
Le correspondant local s’appelle Tadeusz Quelquechoseski. Il m’attendra à l’aéroport, à Kiev. Robert a eu l’occasion de le rencontrer. Selon lui, le gars est un peu particulier, il ne m’en a pas dit plus.
Un PV est glissé derrière mes essuie-glaces. Je l’ajouterai à ma collection. J’allume une cigarette, démarre en douceur, remonte la rue Royale.
David Bowie pleurniche dans les haut-parleurs. « Where are we now ? »
Je longe le parc, jette un coup d’œil au banc qui a accueilli nos confidences.
Camille m’a écouté, sans m’interrompre. À la fin de mon récit, elle s’est levée, la gorge nouée.
« Merci de t’être confié à moi. »
Elle a posé un baiser sur mes lèvres et est partie sans se retourner.
Lui parler de Greg m’a ébranlé. Je me suis entendu raconter l’histoire, notre histoire, sans émotion, comme si je n’avais été qu’un témoin anonyme.
En repartant vers le bureau, je ne sais si j’étais soulagé ou si mon mal avait empiré. Éloïse a vu que ça n’allait pas.
Elle s’est penchée vers moi.
« Tu as bon goût. Elle est mariée ? »
L’intuition féminine me surprendra toujours.
J’ai acquiescé.
Elle a posé une main sur la mienne.
« Ça va aller, tu verras. »
Une formule passe-partout. De simples mots, mais ils m’ont réconforté.
Elle a raison, ça va aller. Je m’en remettrai. Je ne suis pas naïf. Entre l’homme de sa vie, un businessman plein aux as et son amant épisodique, un pisse-copie fauché, le choix n’est pas cornélien.
Place Poelaert. Le Palais de Justice. Je plaide coupable.
The next day. David ressuscité.
J’ai passé l’après-midi à étoffer le dossier. J’ai retracé le déroulement chronologique de l’affaire, depuis le coup de fil du 17 juin jusqu’à la bio pathétique de Natasha. J’ai souligné les incohérences, le Desert Eagle baladeur, la porte fracturée, la disparition du téléphone, l’ordi envolé, la photo.
C’est en listant les éléments factuels que j’ai pris conscience du détail qui m’avait échappé lors de ma deuxième visite.
Les poissons rouges.
Ils flottaient à la surface, crevés. Je me suis souvenu que mon père racontait qu’ils pouvaient rester plusieurs jours sans bouffer. En cherchant sur le Net, j’ai appris que leur organisme leur permettait de faire face à un jeûne prolongé. Un type hospitalisé pendant un mois a retrouvé ses poiscailles en pleine forme quand il est rentré chez lui.
J’en ai déduit qu’ils étaient clamsés depuis belle lurette ou que quelqu’un avait mis un poison dans l’aquarium.
Qui ?
En toute vraisemblance, les tueurs.
Pourquoi ?
En son temps, le cartel colombien avait la réputation de pratiquer ce genre de réjouissances. Quand ils suspectaient quelqu’un de les avoir trahis, ils débarquaient chez lui et massacraient tout ce qu’ils trouvaient : femme, enfants, pépé, mémé, chiens, chats, canaris. Si le gus avait des poissons, ils foutaient de l’eau de Javel dans le bocal.
Dans ce cas-ci, ça n’a aucun sens. À moins qu’ils n’aient été tués entre ma première et ma deuxième visite.
Par qui ? L’ex-Mme Bernier ? Raf ? Je ne peux l’imaginer. Restent les flics, ce qui accréditerait la thèse du complot.
Je parcours l’avenue Louise, entre dans le bois de la Cambre.
Quelques couples sont allongés sur la pelouse. Des jeunes jouent au foot.
En fin d’après-midi, j’ai planché sur les faits qui se sont déroulés à Odessa. J’ai fouillé les archives et visité une multitude de sites.
Les versions diffèrent selon les sources. Pour certains, tout a commencé par un affrontement de supporters en marge d’un match du championnat national de foot entre le Metalist, un club pro-Kiev, et le Tchornomorets, l’équipe locale à vocation pro-russe.
Pour d’autres, les événements ont débuté lorsqu’un rassemblement pacifique d’opposants au régime de Kiev s’est vu attaqué par des groupes de nervis fascistes. Une troisième source parle d’un tragique enchaînement, les uns répondant à la violence des autres.
Le reste est à l’avenant. Même le bilan est contesté. Quarante-deux morts d’après les rapports officiels, plus de deux cents pour certains observateurs.
À moi de faire le tri.
Je prends l’avenue de la Belle-Alliance, descends l’avenue Defré. Je coupe la musique.
J’ai mangé avec l’équipe de nuit. Certains journalistes se sont joints à nous. Je suis la star du jour.
Comme d’habitude, Pierre a lancé un sujet de première importance.
Qui est le meilleur James Bond ?
Pour Vanessa, Daniel Craig est le plus emblématique, ce que Pierre a aussitôt contesté. Il lui reproche de porter des costumes XXS et estime qu’une salopette correspondrait mieux à son look de plombier zingueur. La discussion est partie en vrille. Timothy Dalton ? Trop froid. Pierce Brosnan ? Trop pédant. Roger Moore ? Un vieux minet efféminé.
Alfredo, qui n’est pas un cinéphile averti, a mis tout le monde d’accord. Personne n’a jamais égalé Clint Eastwood dans ce rôle.
Je passe au ralenti devant l’ambassade de Russie et me gare une centaine de mètres plus loin, à proximité de la Haute École de Bruxelles.
Mon cœur s’emballe. Les rares fois où je m’aventure dans cet endroit me plombent le moral. J’en ressors anéanti, en me jurant de ne jamais y revenir.
Je traverse la voie, m’arrête au bord du trottoir. Je ne peux m’empêcher de le chercher des yeux.
Greg est mort ici. Le 27 avril 1996.
Il avait douze ans.
30. Greg
Tu étais fêlé, Greg.
Je me suis souvent demandé s’il te manquait une case à la naissance, ou si ça t’était venu au fil des ans.
Je devais avoir quatre ans quand je t’ai vu braver le danger pour la première fois. C’était en été, on jouait dans le jardin. Tu t’es assis sur la balançoire et tu as entamé un long mouvement de va-et-vient. Tu lançais tes jambes de toutes tes forces, tu allais de plus en plus vite, de plus en plus haut.
J’ai d’abord pensé que tu allais t’éjecter pour aller le plus loin possible. L’exercice n’avait rien d’exceptionnel, tu l’avais déjà pratiqué, mais ta dernière performance s’était soldée par une entorse à la cheville.
Arrivé au sommet de la courbe, tu as lâché les cordes et tu as basculé en arrière pour exécuter un saut périlleux. Tu as mal calculé ton coup et tu as terminé ta cabriole sur le dos. Ton atterrissage a produit un sale bruit. Tu es resté immobile un bon moment. J’ai cru que tu étais dans les pommes.
J’ai voulu appeler maman à la rescousse, mais tu t’es relevé et tu m’en as empêché. Tu t’es plié en deux et tu t’es mis à tousser comme un tubard avant de remonter sur la balançoire pour une nouvelle tentative.
J’étais tétanisé.
Tu t’es cassé la gueule quatre ou cinq fois avant de réussir à retomber sur tes pattes.
Après les saltos et les acrobaties aériennes, tu es entré dans ta période vélo. Nos vieux avaient eu la mauvaise idée de t’offrir un mountain bike pour ton anniv. Au lieu de te promener dans la forêt, tu t’élançais du haut des escaliers. Au plus périlleux, au mieux.
Comme tes potes en faisaient autant, tu t’es mis en tête de réaliser la manœuvre en marche arrière. Là aussi, tu t’es payé quelques gadins avant de réussir.
Jour après jour, tu as peaufiné ta technique. Tu parvenais à rester en sur-place sur la roue avant pour franchir les marches. Le mercredi, tu allais au bois de la Cambre pour dévaler les ravins, debout sur la selle ou assis en sens inverse, ton cul sur le guidon.
Est venue ta folie de la vitesse. Tu te postais aux feux rouges et tu t’accrochais aux bennes des camions pour remonter la chaussée à toute blinde.
J’étais ton cadet de deux ans, je devais me contenter d’assister à tes délires, impuissant.
En mon for intérieur, je rêvais de former un duo avec toi, mais je n’avais pas le cran de rivaliser avec le maître. En plus, tu aurais rejeté ma candidature.
Pour ajouter à ma frustration, tu te foutais de ma gueule à tout bout de champ. Tu m’appelais « Zanzara », le moustique, en italien.
Petit à petit, l’information a circulé et ta réputation est née.
Les grands venaient te défier. « Chiche que tu n’oses pas. » Et de te proposer des trucs de plus en plus barges.
Un après-midi, alors que tu avais invité quelques cops, tu t’es attaqué à la façade de la bicoque pour te hisser sur le toit. Comme ça ne suffisait pas, tu as escaladé la cheminée et tu es resté de longues minutes, juché sur la crête, sous les yeux effarés de tes potes. Peu après, je t’ai vu faire le tour du pâté de maisons en sautant d’un toit à l’autre.
Un dimanche, tu as grimpé sur le clocher de l’église et tu as attendu la sortie de la messe pour être sûr d’avoir un public. Tu as sifflé dans tes doigts pour attirer l’attention des bigots. Ils ont levé la tête et se sont mis à hurler. Pendant qu’ils invoquaient saint Antoine, tu as parcouru la longueur de l’édifice en galopant sur le faîte de la toiture, les bras écartés, en équilibre.
Planqué dans la foule, je te regardais chanceler avec l’impression d’avoir un aspirateur dans le ventre.
Quand les flics se sont pointés, tu t’étais volatilisé.
Ensuite, tu t’es intéressé aux sommets. Tu parcourais les rues à vélo pour repérer les chantiers. Quand ils étaient déserts, tu convoquais ton fan-club et tu partais à l’assaut des grues. Certaines culminaient à près de cinquante mètres. Après avoir atteint la cime du mât, tu rampais sur la flèche.
Quand les gars pensaient avoir tout vu, tu te suspendais dans le vide à la force des poignets ou tu te mettais sur un pied au bout d’une poutrelle.
J’en étais malade.
Le numéro terminé, tu redescendais sur terre, tu prenais l’air dégagé et tu narguais tes potes avec ton sourire en coin et ton regard de myope. Pour parfaire ton look de meneur, tu portais rarement tes lunettes.
À ta façon, tu étais un précurseur. La GoPro n’était pas encore née. Tu aurais immortalisé tes exploits et tu serais devenu une star sur YouTube.
Tu n’avais peur de rien. Tu faisais ça sans contrepartie. Tu ne pariais jamais, le spectacle était gratuit. Tu voulais être reconnu. Tu aimais te faire traiter de dingue, tu jubilais quand on te dévisageait avec un mélange de respect et de crainte.
Seul dans mon coin, je rêvais de te montrer de quoi j’étais capable, mais je ne voyais aucun terrain sur lequel j’aurais pu te défier.
L’idée m’est venue d’instinct, un samedi, quand on rentrait de la piscine du Longchamp. Trois membres de ta bande nous accompagnaient. Le trafic était dense sur l’avenue Defré. Comme d’habitude, les Ucclois roulaient à tombeau ouvert.
J’ai flairé l’aubaine.
J’ai visualisé la trajectoire à suivre. À un moment, je me suis décidé. J’ai pris mon élan et j’ai traversé. J’ai failli me faire choper par une Polo qui descendait, puis par une Merco qui remontait plein pot. Dans un concert de klaxons, je suis arrivé de l’autre côté. Mon cœur palpitait dans mes oreilles. J’avais la poitrine en feu et les jambes flageolantes.
Sur le trottoir d’en face, tu m’observais, ahuri. Tu en avais le souffle coupé.
Je tenais ma revanche.
J’ai commencé à danser d’un pied sur l’autre, en te faisant des pieds de nez.
Piqué au vif, tu as jeté un coup d’œil à gauche, puis à droite, les yeux plissés. Tu ne pouvais pas en rester là devant tes aficionados. Tu t’es penché en avant, tu as attendu qu’un bus passe et tu as bondi.
Au moment où tu allais franchir la deuxième bande, tu as disparu de mon champ de vision. J’ai fermé les yeux. J’ai entendu un hurlement de freins et un grand choc.
1 minute avant l’appel
Mue par son instinct de survie, elle s’élança dans l’escalier qui menait aux étages. Parvenue au troisième, elle s’engouffra dans un bureau et referma la porte à la hâte. Trois hommes et deux femmes se trouvaient dans la pièce, terrorisés. Elle bafouilla quelques mots et se réfugia dans un coin. Les mains tachées de sang, elle fouilla sa poche et en extirpa son téléphone portable.
Elle dut s’y prendre à plusieurs reprises avant de parvenir à composer le numéro. Une fois la communication établie, elle éclata en sanglots.
MARDI 30 JUIN 2015
31. Quelques nuances de gris
Tadeusz tend un bras et pointe le panneau de signalisation qui apparaît dans le faisceau des phares.
— Odessa.
Son premier mot depuis deux plombes.
Comme prévu, il m’attendait à l’aéroport de Kiev, une ardoise à mon nom dans les mains. La cinquantaine, longs cheveux gris-jaune, barbe clairsemée, visage marqué par la désolation.
D’emblée, j’ai saisi l’allusion de Robert. La suite n’a fait que confirmer mon impression, Tadeusz est drôle comme une veillée funèbre dans un hospice.
Une fois installé dans sa Suzuki Vitara en ruine, nous avons pris la direction d’Odessa. Pour occuper les cinq heures de route qui nous attendaient, j’ai tenté une anecdote personnelle pour le dérider.
— Quand je suis rentré à l’univ, je me suis acheté une Suzuki Vitara décapotable d’occasion.
Il s’est contenté de tourner la tête et de me dévisager en silence.
J’ai changé de tactique et l’ai questionné sur la canicule ambiante, les éphémérides, l’heure des marées, ce genre de choses. J’ai eu droit à deux phrases lapidaires débitées d’un ton monocorde.
À l’arraché, j’ai appris qu’il était né à Lviv, que ses grands-parents faisaient partie des rares Polonais restés là-bas et qu’il avait suivi ses études à Bruxelles. J’ai remarqué qu’il portait une alliance, mais je ne me suis pas penché sur le CV de l’heureuse élue.
Avec naïveté, j’ai pensé qu’il serait plus loquace si je l’interrogeais sur la situation politique de son pays.
Il a reniflé et hoché la tête.
— C’est compliqué.
Un moyen détourné de me signifier qu’il préférait que je lui foute la paix.
J’ai battu en retraite et me suis plongé dans la contemplation des champs à perte de vue et des affiches publicitaires qui vantaient des produits obscurs à grand renfort de Ф, de Ж et de П.
À défaut de radio, le ronronnement du moteur et sa respiration sifflante assuraient le fond musical. Par à-coups, il émettait de petits raclements de gorge qui me laissaient penser à tort qu’il allait m’adresser la parole.
La plupart du temps, il roulait à allure modérée sur la bande de gauche, ce qui semble être la norme ukrainienne.
À un moment, son téléphone a sonné. Il s’est rangé avec prudence sur le bas-côté, a fiché des écouteurs dans ses oreilles et a répondu. Après plusieurs minutes, il a grommelé un ou deux mots avant de raccrocher.
Hormis cette péripétie, il lui arrivait de malmener les commandes de la climatisation, faisant alterner fournaise et pôle Nord dans l’habitacle.
Après Ouman, alors que le jour commençait à décliner, il s’est arrêté pour faire le plein et acheter des sandwiches.
J’en ai profité pour griller deux clopes coup sur coup.
À sa tête, j’ai compris qu’il n’aimait pas les fumeurs. Comme le reste de l’humanité d’ailleurs. J’ai failli lui demander à quel moment il s’était fait opérer du sourire, mais mon humour n’aurait pas été bienvenu.
Une heure plus tard, il a ouvert la bouche pour se plaindre de l’état de la route et des camions qui déboîtaient sans mettre leur clignotant. Je n’ai cessé de tripoter mon briquet en espérant qu’il m’autorise à en griller une. Peine perdue.
Les premières maisons d’Odessa apparaissent. Elles semblent dans le même état que la chaussée, délabrées.
— Où allons-nous, Tadeusz ?
— À l’hôtel.
Bonne idée, il est près de minuit et ces longues discussions m’ont épuisé.
Nous approchons du centre. La circulation s’anime quelque peu. Il freine à un croisement pour laisser passer un tram antédiluvien qui brinquebale dans un bruit de ferraille.
— Vous êtes déjà venu à Odessa, Tadeusz ?
— L’année dernière, en mai.
— Vous avez couvert les événements du 2 mai ?
— Si on veut.
Comme la plupart des correspondants, je présume qu’il travaille pour plusieurs médias : journaux, radio ou télé. Certains exercent un métier à côté. L’un de nos contacts est plafonnier.
Il tourne à droite, emprunte une rue pavée. La Suzuki tressaute et grince de toutes parts. Il ouvre la fenêtre, aventure sa tête à l’extérieur pour repérer les plaques de rues et prend à gauche. Après une centaine de mètres, il s’arrête devant un immeuble qui aurait pu abriter l’ambassade d’URSS du temps de Berlin-Est.
— Londonskaya. Votre hôtel. À demain, 8 heures.
— Vous ne logez pas ici ?
— Trop cher.
Dans mes souvenirs, la chambre la plus luxueuse plafonne à 1 500 hryvnias, l’équivalent de 50 euros.
Je risque une ultime tentative.
— Vous avez eu l’occasion de jeter un coup d’œil au dossier que je vous ai envoyé ?
— Oui.
— Vous avez un programme à me proposer pour demain ?
— Oui.
— Merci, Tadeusz, bonne nuit.
Il démarre dès que j’ai refermé la portière. Je regarde la voiture s’éloigner, soulagé. Repose en paix, Tadeusz.
Le hall du Londonskaya a été décoré par un adepte du mouvement kitsch. Tapis bariolé à dominante bleu électrique, colonnades de faux marbre rose, lustre à pendeloques et cage d’escalier vert olive.
Par chance, le réceptionniste de l’hôtel baragouine quelques mots d’anglais.
— Welcome to Odessa.
Ma chambre ressemble à un bordel oriental, moquette orange, rideaux vaporeux et lit à baldaquin. Il manque le miroir au plafond. Je jette ma valise sur le pieu, ouvre mon ordi et me connecte au réseau.
Une centaine de mails m’attendent. Pour l’essentiel, des échanges entre membres de la team où je suis en copie. Le buzz du jour est la sortie de Apple Music, le service de streaming musical de la marque à la pomme.
Entre deux, je repère le message de Raf.
J’ai une nouvelle importante.
Appelle-moi.
Amitiés.
MERCREDI 1er JUILLET 2015
32. Trompe-l’œil
À mes pieds, l’escalier de Potemkine, majestueux, emblématique.
De fait, l’illusion d’optique est impressionnante. Je ne peux m’empêcher d’imaginer le landau qui dégringole, ou Greg en marche arrière sur son vélo.
J’ignorais qu’il se trouvait à une centaine de mètres de l’hôtel. En me voyant débarquer à 4 heures du mat, le concierge de nuit m’a refilé le tuyau. L’aube est le meilleur moment pour le photographier, quand il n’y a personne sur les marches. En outre, il m’a informé que la journée s’annonçait moins caniculaire qu’hier. Comme j’ai fait ami-ami avec lui, il m’a autorisé à utiliser l’imprimante de l’hôtel pour tirer le portrait de Lexus que Raf m’a envoyé.
Je l’ai appelé directement après avoir lu son message.
Il était dans son tacot, entre deux courses, enjoué.
— Salut, Fred, ça se passe bien, tes vacances ?
Il devait détenir une info de premier plan pour se permettre une telle légèreté.
— Je m’éclate. Je me suis fait un nouveau copain, un boute-en-train grave. C’est quoi, ta nouvelle importante ?
— Celui que tu appelles Lexus s’appelle Marc Lekieffre.
Je le sentais triomphant.
— Comment as-tu fait ?
— J’ai été convoqué chez un notaire, à Bruxelles. Mon père a rédigé un testament, en janvier. Preuve qu’il avait la trouille.
Il a marqué une pause pour actionner le klaxon.
— Et la priorité à droite, enfoiré, c’est pour les chiens ?
Après avoir martyrisé la boîte de vitesses, il a repris.
— En deux mots, j’hérite de tout mais, vu ses dettes, il ne me restera pas grand-chose, autant dire rien. L’idée m’est venue d’un coup. J’ai raconté que mon père s’était lié d’amitié avec un Français au Venezuela, que j’aurais aimé lui léguer une bricole, mais qu’il me manquait ses coordonnées. J’ai expliqué qu’il s’appelait Marc et qu’il était le chauffeur du consul de France à Caracas en 2009 ou 2010.
— Bien joué, Raf ! Il a lancé une recherche ?
Il exulte.
— Fissa. Il n’a pas perdu de temps. J’ai eu le résultat hier après-midi. Marc Lekieffre. J’ai même un scan de son badge, avec sa tronche. Dernier domicile connu, Paris, mais il n’y habite plus. Disparu sans laisser d’adresse.
— Lekieffre, c’est mieux que Dupond pour retrouver sa trace.
— Sans doute. Je t’envoie le doc dans une heure. C’était cool dimanche. Tu remets ça bientôt ?
— Je te préviendrai. J’ai d’autres trucs en stock. Rien à voir, c’est toi qui as tué ses poissons ?
— Ben non, pourquoi ? Qu’est-ce que j’en ai à cirer de ses lézards ?
Je m’assieds sur le socle de la statue du duc de Richelieu et embrasse la vue. En contrebas, le port, le yacht-club et la mer Noire. Je fais quelques prises avec mon iPhone.
Camille adorait les escaliers roulants.
Dès qu’elle en apercevait, elle s’y précipitait. Cela faisait partie de nos rituels. Plus ils étaient longs, plus on jubilait. Je me plaçais sur la marche inférieure pour que nos visages soient proches. Si la voie était libre, on se bécotait comme des collégiens. Si elle craignait une rencontre, on s’adressait des microgrimaces. Elle haussait un sourcil, j’écarquillais les yeux, elle louchait, je tordais un coin de ma bouche.
Parfois, notre complicité n’était que tactile. Elle enfonçait un doigt dans mon ventre, je la pinçais en retour. Le jeu consistait à rester impassible.
J’écrase ma cigarette, je me relève et reprends le chemin de l’hôtel.
Le soleil commence à chauffer. Je m’installe dans la cour intérieure. Arbres séculaires, fontaine rococo et portrait d’un inconnu, moustache tombante et chapeau à plumes, le même que sur certains billets de banque.
À cette heure, je suis le seul client. Je pose la photo du badge de Lekieffre sur la table. Blond, la petite quarantaine. Je n’ai que son visage, mais je l’imagine grand et costaud.
Quel rôle joue-t-il dans cette affaire ?
6 heures.
Un serveur surgit. Thé ou café ? Café.
J’allume une clope. Il me reste deux heures à tirer.
Je parcours les photos de l’escalier. J’en sélectionne une et l’envoie à Camille.
Illusion d’optique. D’en haut, on ne voit que les paliers, d’en bas, que les marches, pourtant je ne vois que toi.
Je suis débile. Je me rends ridicule, mais je n’ai plus rien à perdre.
À 7 h 45, Tadeusz fait son apparition.
Même tête de déterré, même chemise à carreaux qu’hier. Il a troqué son futal contre un bermuda. Il traîne les pieds et porte des chaussettes blanches dans ses sandales en caoutchouc.
— Bonjour, Tadeusz, vous avez bien dormi ?
Il grommelle, s’affale sur une chaise et se perd dans la contemplation des troncs d’arbres.
Une longue journée de rigolade en perspective.
— À quelle heure a lieu notre premier rendez-vous ?
— Neuf heures, c’est en dehors de la ville.
— D’accord. Et le suivant ?
— Cet après-midi.
— C’est tout pour aujourd’hui ? Seulement deux rendez-vous ? Et demain ?
Il hausse les épaules.
— Demain, rien.
Je rêve.
J’ai fait trois heures de vol et cinq heures de bagnole avec ce débris pour rencontrer deux personnes ? Deux clampins qui auront vraisemblablement un discours différent.
Il se fout de moi. Je meurs d’envie de l’empoigner, de le secouer, de lui allonger quelques gifles. Son premier témoin va me dire que ce sont les pro-Russes qui ont commencé, le deuxième que ce n’est même pas vrai, que les pro-Ukrainiens sont responsables.
L’arrivée d’un message m’empêche d’exploser.
Camille.
Mon cœur bondit. J’ouvre la photo jointe. Au premier plan, son index. Il indique une valise posée au sol.
Quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt.
Un rébus dont elle a le secret. Je lui ai tendu un fil invisible et elle l’a saisi. Un rien suffit à le rompre, mais nous sommes à nouveau reliés l’un à l’autre.
J’en grille une pour garder mon calme.
— Dites-moi, Tadeusz, en quoi les personnes que nous allons rencontrer sont-elles plus fiables que les centaines de déclarations contradictoires que j’ai piochées sur Internet ?
Il agite sa main pour balayer la fumée.
— Sur Internet et dans la presse, ce sont des victimes ou des gens qui étaient sur place qui ont donné leur version des faits.
Sans blague ?
— En effet, Tadeusz, c’est ce qu’on appelle un témoin. Qu’est-ce que les vôtres ont de particulier ?
Il ne se laisse pas démonter.
— Ce matin, vous allez connaître le point de vue des tueurs.
33. Virage à droite
L’interminable ligne droite se perd à l’horizon.
— Où allons-nous, Tadeusz ?
— À la frontière moldave.
La Vitara cahote sur la route cabossée. Un maquis d’arbustes desséchés borde la chaussée. Pas âme qui vive. Ni panneau publicitaire ni champs de blé. Au mieux, à l’approche d’un hameau, un chien errant ou une femme qui pousse un chariot rempli de pommes de terre.
Disneyland.
Une pompe à essence apparaît sur notre gauche, au sommet d’une côte. Fait insolite, elle est flambant neuve et semble avoir été implantée durant la nuit.
Tadeusz se redresse sur son siège.
— C’est là.
Malgré la circulation inexistante, il actionne son clignotant et s’engage au ralenti dans l’allée. Une vieille Fiat est garée sous le portique de la station. Assis sur le capot, deux types surveillent notre arrivée, l’air méfiant.
Tadeusz coupe le moteur.
— Je vais leur parler.
Il sort de la voiture, remet sa chemise dans son bermuda et s’approche des deux gars. Ils doivent être frères, même gueule cassée, nez aplati et front buté.
Tadeusz entame les pourparlers. Ils répondent tour à tour en gesticulant. À intervalles réguliers, ils m’indiquent du menton et lancent leurs battoirs dans ma direction.
J’en profite pour allumer une cigarette en prenant soin de cracher la fumée à l’extérieur.
Après une dizaine de minutes, Tadeusz revient vers la Suzuki et passe sa tête dans l’habitacle.
— Il veut 500 000 hryvnias.
— Il veut ? De qui parlez-vous ?
— Andrei, leur frère, il est d’accord pour vous dire ce qui s’est passé contre 500 000 hryvnias.
— 500 000 hryvnias ? Ça représente combien en euros ?
Il lève les yeux au ciel, effectue un rapide calcul.
— Autour des 20 000.
Je tapote ma poche.
— C’est idiot, je n’ai pas de monnaie.
Ça ne le fait pas rire.
— Je pense qu’il y a moyen de négocier. L’année passée, il a contacté plusieurs journaux pour essayer de vendre son histoire. À l’époque, il demandait la moitié.
— Dans ce cas, je n’ai qu’à lire l’article.
Il secoue la tête.
— Personne n’a voulu payer.
— Parce qu’il raconte des salades ?
Il semble embarrassé.
— C’est une grosse somme. En plus, je ne crois pas que les quotidiens ukrainiens avaient envie de revenir sur le sujet.
J’explose.
— Putain, Tadeusz, vous me dites ça maintenant ? Comment je le trouve, ce fric ?
Il écarte les bras.
— Je ne sais pas, moi. Téléphonez à Christophe.
Je bondis hors de la bagnole, furibard.
— Bonne idée, je vais l’appeler. Bonjour, Christophe, c’est Fred. Je suis chez les Moldaves, j’ai besoin de 20 000 balles pour arroser quelques indics. Tu peux m’envoyer ça fissa. Merci, Coco, à plus.
Il ne bronche pas.
Les frères Dalton non plus.
— OK, j’ai compris.
Je prends mon portable et m’éloigne de quelques mètres. Par chance, Christophe n’est pas coincé dans une réunion. Je zappe les épisodes précédents et lui explique l’embrouille.
Il rugit.
— Tu rigoles, Fred ? Tu ne bosses pas chez Paris Match ou au Washington Post. Nous n’avons pas de caisse pleine de pognon pour acheter des scoops.
— Je m’en doute. Je laisse tomber ?
Il pousse un soupir d’exaspération.
— Je te rappelle.
Je descends jusqu’à la route, allume une clope. Le soleil cogne dans mon dos. Les autres m’épient. Le pompiste est sorti de sa cahute et observe le manège. Un fiasco. Je vais rentrer bredouille.
J’allume une deuxième cigarette avec le mégot de la première. Une troisième avec le mégot de la précédente.
Mon téléphone grésille.
— 5 000 euros, maximum. Que Tadeusz se porte garant. On lui enverra le fric sur son compte. Bonne chance, Fred.
Il raccroche avant de me laisser le temps de réagir.
Je fais signe à Tadeusz d’approcher. Ses tongs raclent le sol.
— Proposez-leur 100 000 nianias, pas un rond de plus. S’ils ne sont pas d’accord, on rentre.
Il grimace.
— Bon, je vais essayer, mais je ne pense pas que ça va marcher.
— À prendre ou à laisser.
Vaincu, il remonte l’allée et se rend auprès des sbires.
Les types s’égosillent, lui gueulent dessus, agitent les poings. Pour toute réponse, il hausse les épaules en signe d’impuissance. Ils vont le lyncher et me décapiter dans la foulée.
Le show dure un quart d’heure.
Tadeusz se repointe, dégoulinant.
— C’est bon. Remontez dans la voiture, on va les suivre.
Nous prenons la Fiat en filature et parcourons quelques kilomètres en direction d’Odessa.
À un croisement, ils tournent à droite et s’arrêtent devant une petite baraque en béton recouverte de tôle ondulée. Une dizaine de scooters en décomposition sont alignés sous un auvent.
Celui qui doit être Andrei est assis à l’ombre d’un arbre, sur une chaise en plastique. Même profil que les autres, une trentaine de kilos supplémentaires. Il doit être lutteur de foire à ses heures perdues. Ses frangins viennent le trouver et parlementent avec lui. À sa tête, il ne semble pas ravi du résultat qu’ils ramènent.
D’un geste nerveux, il nous invite à les rejoindre.
Nous sortons de la bagnole et prenons place autour de la table. Andrei me dévisage avec animosité. Il a le mérite d’afficher ses convictions. Il s’est fait tatouer une croix gammée dans le cou.
Après quelques secondes, il s’adresse à Tadeusz. La tête penchée, les mains sur les genoux, ce dernier l’écoute avec respect.
Il attend la fin de la tirade d’Andrei et murmure entre ses dents.
— Il dit que si vous ne lui donnez qu’une partie de l’argent, il ne vous donnera qu’une partie des informations.
Je repense au sumo électrique, j’en ai terrassé un plus costaud que lui. J’esquisse un sourire pour lui montrer qu’il ne m’impressionne pas.
— Répondez-lui que je ne suis pas venu de Bruxelles pour jouer les marchands de tapis. Avec ce fric, il peut ouvrir une multinationale du deux-roues. En passant, dites-lui que je n’aime pas sa gueule.
Tadeusz écarquille les yeux d’effroi et traduit mes propos en langage diplomatique.
Le nazillon me jauge et se met à parler d’un ton grave. De temps à autre, il marque une pause pour permettre à Tadeusz de me retracer l’historique.
Le 2 mai 2014, il a reçu un coup de fil. On lui demandait de venir à Odessa pour exécuter un travail. Des provocateurs pro-russes avaient installé un campement devant la Maison des syndicats. Ils étaient quelques centaines. La mission était de les déloger et de leur faire plier bagage.
J’interromps.
— Qui est le on qui lui a téléphoné ?
Tadeusz fait l’aller-retour.
— Il ne sait pas.
Il sait, mais la question vaut une rallonge de 50 000.
— Ensuite ?
Le récit reprend, relayé par mon interprète.
Il est arrivé en ville en fin de matinée. Le rendez-vous était fixé à l’arrière d’un immeuble, près de la place Sobornaya. Ils étaient une bonne trentaine. Quelqu’un leur a donné les directives.
Andrei s’arrête de parler, hésite.
Je retiens ma respiration.
Il hoche la tête, lâche le morceau.
On leur a distribué des bâtons, des couteaux et des chaînes puis on les a conduits à la Maison des syndicats. Un homme les a fait entrer par l’arrière du bâtiment. Ils se sont cachés dans les sous-sols et aux étages supérieurs.
Il baisse les yeux, contemple ses pompes, continue.
En début d’après-midi, un groupe de professionnels les a rejoints. L’un d’eux parlait ukrainien, les autres étaient étrangers. Le chef d’équipe leur a expliqué ce qu’on attendait d’eux. Un assaut allait être lancé contre les manifestants pro-russes sur l’esplanade. Leur seule issue serait de se réfugier dans la bâtisse. Une fois à l’intérieur, on fermerait les portes. Ils étaient chargés de leur « donner une leçon ».
Il laisse passer un instant, baragouine quelques mots.
Tadeusz baisse le ton.
— Il dit qu’il ne savait pas que ça allait dégénérer. Il n’a rien pu faire.
Comme tous les tortionnaires, il va nous raconter qu’il n’est pas responsable, qu’il n’a fait qu’obéir aux ordres. Pour peu, il se poserait en martyr. Le fait qu’il cherche à monnayer ses exploits décuple le dégoût qu’il m’inspire.
Je ne compte pas en rester là.
— Demandez-lui ce qui s’est passé après.
Bref flottement.
Reprise.
Certains pro-Russes étaient armés. Un échange de tirs a eu lieu. L’un des étrangers en a abattu un, puis un autre. Une folie meurtrière s’est emparée d’eux. Ils ont perdu le contrôle de la situation. Les provocateurs se sont fait massacrer. Hommes, femmes, enfants. Il n’est pas fier de ce qui est arrivé, mais c’est arrivé.
Un silence écrasant ponctue son aveu.
Je reste muet, la nuque crispée. La réjouissante perspective de ramener un scoop est loin, supplantée par l’horreur. La photo de Natasha apparaît.
Hommes, femmes, enfants.
« Une folie meurtrière. »
Ces mots alimentent les dépêches que je reçois tous les jours.
« L’homme était courtois, poli, réservé. Il a basculé dans la folie meurtrière et a massacré toute sa famille. » « Folie meurtrière à Marseille, un adolescent viole et tue une femme de quatre-vingt-huit ans. » « Folie meurtrière à Saint-Quentin-Fallavier, un homme décapité. » « Folie meurtrière au Rwanda, un million de morts. » « Folie meurtrière en Syrie, en Afghanistan, au Nigeria, en Irak, dans le Connecticut. »
En tout homme sommeille un barbare qui attend son heure. Les morts d’Odessa ne sont pas les victimes collatérales d’une manifestation qui a mal tourné, ni d’un malheureux concours de circonstances ou d’une montée de violence incontrôlée. Tout a été préparé, planifié, organisé. Des pros ont encadré l’action. Les flics sont restés à l’écart, les pompiers ont mis un temps fou avant de se pointer.
Tadeusz me tire de la torpeur.
Il est blême.
— Si vous ne le payez pas ou si vous citez son nom, je suis mort.
— Rassurez-le. Il aura son fric. Je tairai son nom, ainsi que le lieu et la date de cette rencontre.
Je sors la photo de Bernier, la pose sur la table.
— Demandez-lui si cet homme faisait partie des mercenaires.
Conciliabule.
— Il n’a pas dit que c’étaient des mercenaires.
Une manière de botter en touche.
Je déplie celle de Lekieffre.
— Et celui-ci ?
J’observe Andrei pendant qu’il jette un coup d’œil au papier. Il plisse les lèvres, fronce les sourcils. Il ferait un piètre joueur de poker.
Tadeusz confirme son mensonge.
— Il ne sait pas.
Je me lève, la rage au ventre.
Bluff pour bluff.
— Dites-lui que les types sur ces photos sont morts. Le chef des mercenaires, celui avec une cicatrice sur la joue gauche aussi. Le mois dernier, il s’est fait émasculer avant d’être aspergé d’essence et immolé. Les meurtres ont été revendiqués par un groupuscule d’extrémistes pro-russes.
Fais de beaux rêves, Adolf.
34. Basé sur des faits réels
— Là.
Tadeusz colle son doigt sur l’écran.
J’appuie sur pause, effectue un zoom.
— Vous avez raison, ça pourrait être lui.
Une fois de plus, j’ai dû lui tirer les vers du nez. Après avoir quitté les pieds nickelés, il s’est emmuré dans le silence, visage fermé, mains cramponnées au volant.
Il n’a pas aimé la manière avec laquelle j’ai géré la situation. Si j’avais adopté la sienne, nous serions encore occupés à frayer avec l’extrême droite ukrainienne.
À l’entrée d’Odessa, il a daigné desserrer les dents.
— Vous ne m’avez pas envoyé cette photo.
— Laquelle ?
— Celle du deuxième homme.
— Je l’ai reçue hier soir.
— Vous avez un ordinateur ?
— Bien sûr. Pourquoi ?
— Vous verrez.
Il a accepté de m’en dire plus quand nous sommes arrivés à l’hôtel.
De nombreuses vidéos ont été réalisées durant la journée du 2 mai 2014, la plupart de piètre qualité, souvent de courtes séquences captées à l’aide d’un smartphone. Certaines ont circulé sur le Net par la suite. Au moment des faits, il en a visionné des dizaines sans parvenir à démêler l’imbroglio. En début de semaine, il s’en est repassé quelques-unes pour préparer ma venue.
L’un des vidéastes amateurs a filmé deux individus sur le toit du bâtiment, peu avant l’assaut. Un des types semble brandir un flingue. La scène ne dure que quelques secondes. L’image est floue, instable. On ne peut jurer de rien, mais l’homme ressemble à Marc Lekieffre. Reste à confirmer l’hypothèse, ainsi que la présence de Bernier, ce que la tête de faux cul d’Andrei laissait supposer.
— On a bien avancé, Tadeusz, bravo.
Le compliment ricoche sur sa chemise à carreaux.
Il consulte sa montre.
— On y va ?
Retour dans son tacot.
Il emprunte une avenue sur laquelle slaloment des bus jaune citron. De part et d’autre, des arbres fourchus ploient sous le poids des branches et menacent de s’abattre sur la chaussée.
Arrivé à la gare, il prend à gauche. Après une centaine de mètres, il s’engage dans un parking et s’acquitte du montant auprès du gardien. Nous sortons de la Suzuki et parcourons une large allée piétonnière bordée de sapins avant de déboucher sur une vaste esplanade. Un drapeau aux couleurs de l’Ukraine flotte au milieu d’un mât.
La Maison des syndicats se dresse devant nous, un bloc massif de cinq étages d’inspiration stalinienne. Au centre de l’édifice, un fronton supporté par d’imposantes colonnes lui donne une fausse apparence de temple grec. Le bâtiment semble abandonné. Une palissade de bois peinte en jaune et bleu en interdit l’accès. Bon nombre de fenêtres sont occultées. Quelques traces de l’incendie subsistent sur la façade.
Le parvis est désert. Seul un type de taille moyenne, la trentaine, l’air d’un savant fou, poireaute en plein cagnard. Une épaisse tignasse noire le grandit d’une dizaine de centimètres.
Tadeusz part à sa rencontre.
Ils se serrent la main, échangent quelques mots. Les civilités terminées, l’homme s’approche de moi et m’adresse la parole en français.
— Je m’appelle Iouri Chevchenko, je suis le mari de Natasha Sczepanski.
Frissons d’excitation. Après les tueurs du matin, un autre témoin-clé. Tadeusz a fait du bon boulot.
— Je vous remercie d’être venu, monsieur Chevchenko.
Il pointe le bâtiment.
— Ma femme a été assassinée dans cet enfer.
— J’ai appris cela. Je suis désolé.
Il passe une main dans ses cheveux. Ses yeux s’humidifient.
Son deuil n’est pas encore achevé. Il va se le coltiner jusqu’à la fin de ses jours.
— Tadeusz me dit que vous êtes journaliste et que vous voulez savoir ce qui s’est passé le 2 mai.
— C’est la raison de ma présence à Odessa.
Il acquiesce.
— Marchons un peu.
Il se dirige d’un pas lent vers la palissade.
— Natasha travaillait à l’hôpital régional. Elle était en congé ce 2 mai. Une de ses collègues l’a appelée pour lui dire que des affrontements avaient lieu au centre-ville et que de nombreuses personnes étaient blessées. Comme nous n’habitions pas loin, elle a pris sa trousse pour aller donner un coup de main. J’ai voulu l’en empêcher. Ce n’était pas prudent dans son état. Elle était enceinte.
D’un geste nerveux, il ébouriffe sa chevelure.
— J’aurais dû l’accompagner.
Tadeusz et moi gardons le silence.
Il se dirige vers la droite de l’édifice.
— Elle m’a téléphoné une heure plus tard. Elle était hystérique, sa voix était méconnaissable. Elle qui était toujours calme. Elle soignait un blessé sur l’esplanade au moment de l’attaque et avait dû se réfugier dans le bâtiment. Elle s’était cachée dans une pièce du troisième étage avec d’autres personnes. Elle avait vu des gens se faire massacrer à coups de hache et de machette. Dans le téléphone, j’entendais des cris, des explosions, je devenais fou. Je lui ai demandé dans quelle pièce elle se trouvait et j’ai dit que je venais la chercher.
Il marque un temps d’arrêt, secoue la tête.
Il revit ce jour maudit.
— Quand je suis arrivé, c’était la fin du monde. Des gens affolés couraient partout, le visage en sang. Des tentes brûlaient. Des crapules lançaient des cocktails Molotov contre la façade. Le rez-de-chaussée était en flammes. Des personnes essayaient de s’échapper par les fenêtres. J’ai vu une femme sauter du troisième et s’écraser au sol. C’était horrible. J’ai essayé de joindre Natasha, mais elle ne répondait plus.
Un groupe de touristes fait irruption sur la place, appareils photo en bandoulière, cannettes de soda à la main. Ils échangent des plaisanteries, soufflent à cause de la chaleur.
Iouri modifie la trajectoire pour les éviter.
— Venez.
Nous longeons le côté de l’immeuble.
— Je tremblais de peur et de colère. Je pensais à elle, à notre enfant. Il fallait que j’aille la chercher. J’ai fait le tour. Des policiers étaient rassemblés derrière la Maison.
Tadeusz tombe des nues.
Il l’interrompt.
— Excusez-moi, Iouri. Vous dites que des policiers étaient à l’arrière du bâtiment ? Vous êtes certain que c’étaient des policiers ?
Il opine.
— Une cinquantaine, en tenue de combat, casqués, équipés de gilets pare-balles, armés de matraques et de boucliers.
— Que faisaient-ils ?
— Ils avaient l’air d’attendre. Ils discutaient avec une bande de pro-ukrainiens qui voulaient ouvrir la grille pour entrer par l’arrière. Je les ai suppliés de me laisser entrer, mais ils m’ont repoussé. J’ai profité de la confusion pour escalader le mur. Je suis arrivé sur un parking. Un gardien marchait avec son chien de l’autre côté de la cour. Je me suis dirigé vers le bâtiment en me cachant derrière les arbres. Un homme se tenait devant la porte. Il m’a repéré. Il a sorti une arme et m’a menacé. Je lui ai dit que ma femme était à l’intérieur et qu’elle n’avait rien à voir avec tout ça. Il ne comprenait pas l’ukrainien. J’ai répété en anglais, puis en français. Il m’a demandé de ne pas approcher et m’a prévenu qu’il allait tirer. Je n’avais pas peur de mourir. La vie de ma femme et de mon enfant importait plus que la mienne. J’ai levé les bras et j’ai continué d’avancer. Quand je suis arrivé près de lui, je me suis mis à genoux et j’ai sorti une photo de Natasha. Il ne savait pas quoi faire. Il semblait dépassé par les événements.
Je transpire à grosses gouttes, mais la température n’y est pour rien.
— Après un moment, il a rangé son arme. Je lui ai expliqué que des pauvres gens étaient en train de se faire massacrer, que ma femme était médecin, qu’elle attendait un enfant, qu’elle se cachait au troisième étage.
Tadeusz est exsangue.
— Il parlait anglais ou français ?
— Français. Il a pris la photo de Natasha et m’a demandé de rester là. Il m’a dit qu’il allait essayer de la trouver et est entré. Après quelques minutes, j’ai entendu une cavalcade dans les escaliers et une dizaine de personnes sont sorties, mais Natasha n’était pas parmi elles. Quand les manifestants ont vu ce qui se passait, ils se sont rués et ont forcé les grilles. Les policiers les ont laissés faire. Les salopards ont couru à la rencontre des gens qui fuyaient et ont commencé à les tabasser. Ils ont d’abord cru que j’en faisais partie et m’ont roué de coups. Ils m’auraient lynché si un de mes élèves ne m’avait pas reconnu. Je suis professeur à l’université Mechnikov.
Nous arrivons de l’autre côté de l’édifice. Le mur d’enceinte mesure plus de deux mètres, les grilles sont fermées, attachées par une chaîne munie d’un lourd cadenas.
Iouri s’arrête le long de l’allée, prend un mouchoir, s’éponge le front.
— Ils m’ont amené ici. J’avais perdu connaissance. Personne ne s’est occupé de moi. Plus tard, on m’a transporté à l’hôpital juif. Le carnage a duré jusque tard dans la nuit. À 6 heures du matin, j’ai appris que Natasha et mon enfant avaient été tués.
Il se retourne, s’éloigne de quelques pas.
Je le laisse se remettre de ses émotions.
— Je suis navré, Iouri. Si vous le permettez, j’aimerais vous montrer quelque chose.
Je sors la photo de Bernier.
— Vous reconnaissez cet homme ?
Il écarquille les yeux.
— Oui, c’était lui. Francis, il s’appelait Francis.
5 minutes après l’appel
Recroquevillée sous la table, elle se boucha les oreilles pour échapper aux cris d’épouvante qui résonnaient dans le bâtiment, colportant la folie d’un impitoyable carnage.
Elle perçut un violent craquement, et la porte s’ouvrit à toute volée. Trois individus firent irruption dans la pièce. L’un d’eux vociférait. L’une des femmes poussa un hurlement qui s’étrangla dans le fracas d’une détonation.
Au bord de la syncope, elle assista impuissante à une boucherie sans nom.
Au moment où ils s’apprêtaient à sortir, l’un des hommes la repéra et la mit en joue.
JEUDI 2 JUILLET 2015
35. Haute voltige
Point final.
D’habitude, je ponds un article en deux ou trois minutes. Une fois en ligne, je complète si nécessaire ou je corrige les éventuelles coquilles. Il m’arrive de changer des trucs en fonction de l’arrivée de nouvelles dépêches.
Cette fois, ma matinée y est passée. Trois heures sans sortir de ma chambre, à peaufiner, choisir le bon verbe, l’adjectif le mieux adapté, la tournure de phrase la plus fluide. La moitié de mon paquet est partie en fumée.
J’ai relaté les faits, rien que les faits, sans interprétation. En ce qui concerne les témoignages, j’ai respecté les précautions d’usage.
« Selon. D’après. Aux dires de. »
Iouri a accepté d’être cité. J’ai ajouté une photo de lui, une autre de la Maison des syndicats. Pour le reste, je taperai dans les archives.
Le texte compte près de 10 000 signes. Je devrai resserrer. Quitte à passer en feuilletonage. Tout dépendra de l’accueil que Christophe lui réservera.
Reste à trouver le titre. Il pose parfois plus de problèmes que le contenu. Il doit être accrocheur sans verser dans le sensationnalisme ou le sordide. Au Soir, en tout cas. D’autres canards en font leur fonds de commerce. Certains tentent un jeu de mots, mais les traits d’humour ne sont pas toujours bien perçus par les lecteurs, surtout si l’article concerne un drame.
Je choisis la sobriété, l’équipe d’édition validera.
« Le massacre d’Odessa était planifié. »
Christophe a été clair, seuls les événements du 2 mai 2014 l’intéressent. Il se fout de l’affaire Bernier.
Ce qui ne m’empêche pas d’avancer des hypothèses.
Si Lexus et Lekieffre ne font qu’un, ce qui semble se confirmer, on le retrouve avec Régis Bernier à trois moments : en 2010, lorsqu’ils ont fait connaissance au Venezuela, à Odessa en mai 2014 et à Bouillon, en juin de cette année.
Si je me fie à mon intuition, Bernier n’était pas un tueur. Un gros bras, sans doute, un assassin, certainement pas. Son malaise lors de la tentative de rapt des enfants della Faille le laisse à penser. Le fait que Iouri le sente dépassé par la situation et la réaction qu’il a eue en partant à la recherche de Natasha confortent cette impression.
Que Régis soit devenu Francis ne m’embarrasse pas.
Je présume que les mercenaires ne déclinent pas leur véritable identité au premier venu. La Légion étrangère obligeait les recrues à adopter un autre état civil à l’engagement. En moins de deux, les gars changeaient de nom et de nationalité en toute légalité. De plus, Iouri m’a confirmé que la photo de Natasha trouvée chez Bernier était bien celle qu’il lui avait remise.
Que faisait Bernier dans cet enfer ? Était-il au courant de ce qui se tramait ? Qu’a-t-il fait après être entré dans le bâtiment ? A-t-il assisté au massacre ? Mon pote à la cicatrice faisait-il partie de l’équipe qui a encadré les tueurs ? Bernier a-t-il voulu le dénoncer, ce qui expliquerait la menace trouvée sur son passeport ?
Un tas de questions restent ouvertes.
Le téléphone préhistorique qui trône sur ma table de nuit se met à grelotter. La préposée m’informe que M. Tadeusz m’attend à la réception.
— Dites-lui que j’arrive dans cinq minutes.
Après quelques transactions, je suis parvenu à dégotter une place sur le vol de demain matin. Tadeusz me déposera à Kiev où je logerai cette nuit. Cinq heures de déconnade m’attendent.
J’ouvre en grand les fenêtres pour aérer la tabagie et fais un dernier tour sur ma messagerie avant d’éteindre mon ordi. Une vingtaine de mails tombent dans ma boîte de réception. Parmi eux, un nom familier.
Mon cœur joue de la deep house.
Camille.
Ça, tu le fais ?
J’ouvre la pièce jointe.
La photo est prise en vue plongeante. Elle est moulée dans une robe de soirée et porte des talons hauts. Un long balancier entre les mains, elle marche en équilibre sur un câble tendu entre les tours jumelles du WTC. Sous elle, un vide de quatre cents mètres. Tout en bas, les microscopiques taxis new-yorkais déambulent sur Greenwich Street.
Ce n’est pas le premier montage qu’elle m’envoie. J’en possède quelques-uns d’anthologie. Dans le best of, elle apparaît en bikini sur les genoux du pape, chassant l’ours avec Vladimir Poutine ou recevant l’oscar de la meilleure actrice des mains de Leonardo di Caprio.
Je tape ma réponse à toute vitesse.
Checked. En roller, les yeux bandés. Je rentre demain midi.
Je descends, règle la note et sors de l’hôtel.
Tadeusz est assis dans la voiture, moteur en marche. Il est pressé d’en finir. Nos adieux ont peu de chance d’être déchirants.
J’attends que nous soyons hors de la ville pour lui adresser la parole.
— Merci pour votre aide, Tadeusz.
Il grommelle quelques mots inintelligibles.
Je surenchéris.
— Grâce à vous, je tiens un bon papier. Cette fois, la preuve est faite que cette tuerie était préparée.
Il hausse les épaules.
— Ça, je le sais depuis longtemps.
— Ah bon ? Dans ce cas, pourquoi n’en avez-vous pas parlé dans votre journal ?
Il lève une main, fait tournoyer son alliance autour de son annulaire.
— Je suis marié, j’ai deux enfants.
— Quel rapport ?
Il rétrograde, met son clignotant et se gare sur le bas-côté. Sans un mot, il sort de la bagnole, ouvre le coffre et revient avec un porte-document.
— Tenez.
Il redémarre après s’être assuré qu’aucune poule ne traverse la chaussée.
Je m’empare de la serviette. Elle contient une liasse de photocopies de coupures de presse. Je compulse les papelards. Aucun n’est en français ou en anglais.
— Vous m’expliquez ?
Il jette un regard oblique sur la pile.
— Le premier. Oles Buzina.
Une photo coiffe le texte. Un homme gît sur le sol, la chemise maculée de sang. Des policiers entourent le corps. L’un d’eux est agenouillé et semble remplir un formulaire.
— Qui est-ce ?
— Un journaliste. Il était connu pour ses déclarations acides sur le gouvernement ukrainien. Continuez.
Je saisis un autre article.
Un cadavre recouvert d’une bâche bleue.
Tadeusz commente.
— Sergey Sukhobok, un journaliste, abattu le même jour, il y a dix semaines.
Je poursuis.
Le portrait d’une femme.
— Et elle ?
— Olga Moroz, une journaliste. Assassinée à la même date. Ces morts suivent de près celle d’Oleg Kalachnikov, tué de onze balles, devant chez lui, le 15 avril. Vous comprenez pourquoi je n’ai pas écrit d’article ?
— C’est dingue, je n’ai pas le souvenir d’avoir reçu de dépêches annonçant cette hécatombe.
Haussement d’épaules fataliste.
Au fond de la pochette, je dégotte la couverture du Elle, édition ukrainienne. Nulle trace de cadavre. Un mannequin blond, pose glamour, une main dans les cheveux, le sourire enjôleur. Dans sa tenue, elle ressemble à Maya l’abeille.
Il soupire.
— Les couleurs de sa robe. Identiques au ruban de Saint-Georges que portent les milices pro-russes. Le magazine a été boycotté, des affiches ont été arrachées. On a parlé de provocation.
— Je peux les prendre ?
— Elles sont pour vous. Un conseil, si vous sortez à Kiev ce soir, changez de chemise, l’orange n’est pas très indiqué.
VENDREDI 3 JUILLET 2015
36. 308
L’avion se pose à Zaventem à 13 heures précises.
Le temps d’avaler un sandwich à l’aéroport, de récupérer ma voiture, et je file au journal. J’ai hâte de faire mon rapport à Christophe.
Je traverse le hall, salue les douaniers et débouche dans l’espace public. La ribambelle habituelle est massée derrière les barrières. Des maris guettent l’apparition de leur femme, des femmes celle de leur mari. Rassemblés à proximité des portes coulissantes, les chauffeurs de taxi font le pied de grue en bavardant, une pancarte au nom de leur client mise en évidence.
Je m’arrête net.
Camille se trouve parmi eux, le corps déhanché, le regard lointain derrière des lunettes pailletées. Elle semble attendre l’arrivée de quelqu’un. Avec un peu de malchance, je vais tomber sur son connard.
Je m’apprête à changer de direction lorsque j’aperçois le panonceau qu’elle tient dans les mains.
Mister Zanzara
Elle capte mon regard et détourne les yeux.
Je m’approche, mal à l’aise.
— Qu’est-ce que tu fais là ?
Elle relève ses lunettes de manière théâtrale, joue la surprise.
— Toi ici ? Quelle coïncidence ! Tu as un peu de temps ou ta maman t’attend pour manger ?
— Je comptais aller au bureau, pourquoi ?
— Suis-moi.
Elle tourne les talons, se dirige vers la sortie d’un pas alerte, moi et ma valise dans son sillon. Parvenue dehors, elle se fraie un chemin dans la cohue, se faufile entre les taxis en stationnement et traverse la voie.
Au lieu de filer vers le parking, elle vire à droite et entre en trombe dans le Sheraton. J’accélère l’allure pour soutenir son rythme. Elle passe en coup de vent devant la réception, continue vers les ascenseurs.
Je me précipite. Nous nous retrouvons face à face dans la cabine. Elle me dévisage en silence, droite comme un I, appuie sur l’un des boutons.
Elle soulève un sourcil, prend l’air machiavélique et brandit une carte magnétique.
— Ta-tam !
Muet, je contemple le bout de plastique.
La voix mécanique annonce « troisième étage ». La porte coulisse. Elle plonge dans le couloir. Je la suis à la trace. Elle pile devant la chambre 308, actionne la serrure.
Une fois à l’intérieur, elle se jette à mon cou.
Je tente de prononcer un mot. Sa bouche cherche la mienne, sa langue en force l’accès. Elle déboutonne ma chemise et défait ma ceinture d’une main tout en se déshabillant de l’autre.
Je bafouille.
— Je ne comprends pas.
— Moi non plus.
Elle dégrafe son soutien-gorge.
Ses seins jaillissent, pointes dressées, offertes. Mon trouble s’évanouit, balayé par un violent désir.
Le cerveau en ébullition, le sexe au zénith, je me débarrasse de mon pantalon et l’expédie à l’autre bout de la pièce.
Elle me fixe dans les prunelles, s’assied au bord du lit, fait glisser son string le long de ses jambes et s’ouvre à moi. Dévoré d’envie, je m’agenouille, passe mes mains sous son bassin et enfouis mon visage au cœur de sa féminité. Les joues humides, je me repais de son nectar, m’enivre de ses saveurs.
Elle gémit, empoigne mes cheveux, exerce une pression pour écourter la caresse.
— Viens.
Elle s’allonge. Je la rejoins, soude mes lèvres aux siennes.
Son ventre est brûlant. Je la pénètre avec fougue, l’envahis pleinement. Elle agrippe mes fesses, ses doigts s’enfoncent dans ma chair. Nos peaux se retrouvent, fusionnent. Rien ne compte plus que de la posséder.
Nos corps ondoient, vibrent en harmonie. Mon désir grandit, le sien s’épanouit au creux de ses reins. Des fourmillements parcourent mes jambes.
Elle bascule la tête en arrière.
— Maintenant.
Un orgasme vertigineux nous emporte. Nous jouissons en chœur, dans un concert de râles et de cris.
Je m’affale, vidé, repu.
— Je t’aime, Camille.
Ses yeux s’emplissent de larmes.
Elle passe une main dans mes cheveux.
— Je ne sais plus où j’en suis. Dis-moi de partir au bout du monde, de chasser ce rêve impossible, de t’oublier à jamais.
37. Peut mieux faire
Mon arrivée inattendue produit l’effet escompté.
L’équipe me réserve un accueil triomphal. Ils m’embrassent, me bombardent de questions. Je me contente de répondre dans le vague, oui, tout s’est bien passé, j’ai obtenu ce que je voulais, vous en saurez plus très bientôt.
Mes cheveux sont encore trempés et j’ai les jambes en compote.
Pas dupe, Éloïse me détaille de la tête aux pieds.
— Ça a l’air chaud, l’Ukraine.
— Torride.
Après les derniers potins et la tournée de café, je débarque chez Christophe.
Il lève les yeux, contrarié.
— Tu es déjà là ? Je t’attendais demain.
— J’ai zappé la visite des musées. L’article est bouclé.
— Envoie-le-moi, je le lirai tout à l’heure.
Son manque d’enthousiasme me refroidit. Je n’ai sans doute pas choisi le bon moment. Je retourne à mon poste, lui expédie le document et me mets au travail.
Il me convoque quelques minutes plus tard. Mon texte est ouvert sur son écran. Il veut en savoir plus sur les conditions dans lesquelles j’ai obtenu les témoignages, les dates, les noms et la logique que j’ai suivie pour tirer mes conclusions.
Il m’écoute, imperturbable, prend quelques notes.
— Merci, je te fais signe.
Je ressors et tente de me rassurer. Mon reportage est solide, je lui ai fourni des réponses concrètes.
Dans la foulée, je téléphone à Raf.
Il décroche après un siècle, la voix éraillée.
— Salut, Fred. Tu es rentré ?
Plutôt que de lui raconter mon trip, je lui propose un rendez-vous demain soir, avant qu’il prenne son service.
Il insiste.
— Mon père y était ?
— Un témoin l’a reconnu, mais son rôle n’est pas clair.
— Merde !
— Ne t’emballe pas. D’après ce que j’ai appris, il n’a pas participé au carnage.
— Tu dis ça.
Je le sens abattu.
— Qu’est-ce qui se passe, Raf ?
— Je ne dors pas. J’ai mal au bide. En plus, Gwen me tire la gueule. Je ne sais pas ce qu’elle a. Elle pense que je suis sur une autre meuf.
Tombeur comme il est, ça ne m’étonnerait pas.
— C’est comme ça, les nanas. Ça change d’humeur et d’avis tout le temps.
— Elle dit aussi que tu as une mauvaise influence sur moi.
— Ce ne serait pas la première.
— Pourtant, je ne lui ai rien dit, je te promets.
J’abrège avant qu’il me raconte sa vie sentimentale.
— On en parle demain.
Je raccroche et jette un coup d’œil vers le bureau de Christophe. Il est en grande conversation avec Damien, le rédac-chef adjoint. Ce dernier hausse les épaules, lance les bras au ciel. À coup sûr, mon article est au centre du débat.
Je descends fumer une clope pour me calmer.
Camille vient aussitôt me tourmenter. Je ressens l’empreinte de son corps dans le mien. Son parfum emplit mes narines, le souvenir de notre orgasme vibre encore dans mes muscles.
Sa dernière phrase résonne dans ma poitrine comme une menace ou une promesse avortée.
« Je ne sais plus où j’en suis. »
Les nanas, ça change d’humeur et d’avis tout le temps.
Un appel de Jeremy m’arrache à mes pensées. Comme de coutume, il est surexcité. Il me propose la soirée du siècle au Doktor Jack. Gin premium, murge et tétrachiée de meufs assurés. Je lui promets de le rejoindre vers minuit et remonte à la rédaction.
Christophe et Damien m’attendent, l’air préoccupé.
— Allons dans la salle de réunion.
Je leur emboîte le pas, les tripes tenaillées par un mauvais pressentiment. Ils s’asseyent d’un côté de la table, je m’installe en face.
Christophe ouvre le feu.
— Nous ne pouvons pas publier ton article.
Un poulpe glacial se pose sur ma tête, déploie ses tentacules sur mon visage.
Damien embraie, le ton cassant.
— Tes sources ne sont pas fiables. Si ce que tu avances est vrai, ton enquête doit être mieux bétonnée.
— Qu’est-ce que tu reproches à mes témoins ?
— Le premier est une sorte de nazi dont on ne peut pas citer le nom. On lui a donné un coup de fil, on lui demandait, quelqu’un lui a transmis des instructions, un homme les a fait entrer, rien de précis. Rien ne prouve qu’il était sur place. Pire, tu as allongé 5 000 euros pour qu’il te raconte cette histoire. Pour la moitié, je peux te trouver dix guignols qui jureront avoir fait partie des tueurs du Brabant.
— Il a parlé de mercenaires, il en a reconnu deux sur les photos.
Il secoue la tête.
— Non, Fred. Il t’a semblé qu’il reconnaissait ces hommes sur ces photos, c’est différent. Pour ce qui est du type sur le toit, la séquence dure trois secondes. Comment peux-tu garantir que c’est ce Lekieffre, par ailleurs inconnu au bataillon ?
— Tadeusz est catégorique.
Christophe intervient.
— Soyons sérieux, Fred. Ces images sont floues. Même si ce type était mon frère, je n’oserais pas certifier que c’est lui.
Je n’abandonne pas la partie.
— Ce que dit Iouri ne vous va pas non plus ?
Damien reprend le flambeau.
— Ton Iouri n’est pas un témoin objectif. Sa femme a été tuée ce jour-là. Son rapport ne vaut pas grand-chose. Il n’était pas présent dans la Maison. Il a vaguement parlé à quelqu’un.
— Il a parlé à Régis Bernier, il l’a identifié.
— Sur une photo qui date de 2010. En plus, il cite un Francis, pas un Régis. Et le Bernier en question ne peut pas confirmer.
— Pour cause, il a été assassiné le 18 juin.
— Non, il s’est suicidé, la police est formelle.
Ils se foutent de moi.
Je hausse le ton.
— Deux témoins directs qui ne se connaissent pas affirment la même chose. De plus, ils sont dans des camps opposés. Tout a été planifié, organisé. Des mercenaires encadraient les voyous, des flics étaient groupés à l’arrière du bâtiment et n’ont pas bougé le petit doigt. Une centaine de personnes se sont fait massacrer, et on va fermer notre gueule ?
Christophe temporise.
— Tu as fait du bon boulot, Fred, mais tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Tu es resté en surface, tu n’apportes pas de preuves tangibles pour dénoncer un complot. Le moindre chroniqueur démolirait ton texte en deux minutes. Pas de faits avérés, pas de noms, pas de documents. Sans compter que nous aurions des comptes à rendre au ministre des Affaires étrangères qui nous suspecterait de vouloir provoquer un incident diplomatique avec l’Ukraine.
— Qu’est-ce qui vous manque ?
— Du solide. On marche sur des œufs. De toute façon, on a assez perdu de temps avec cette affaire.
Je désigne Damien du menton.
— Si tu penses que mon nom n’en impose pas assez, tu n’as qu’à signer l’article.
Il soupire.
— Je ne tiens pas à devenir le Dan Rather belge.
Joli raccourci. Dan Rather était une sommité à la télévision américaine. Quelques semaines avant l’élection présidentielle, il avait fait paraître un reportage démontrant que George Bush avait bénéficié de pistons pour ne pas partir au Vietnam. La presse concurrente lui est tombée dessus, contestant l’authenticité des documents publiés. Il a été grillé à vie.
Je me tais, à court d’arguments.
Christophe se lève.
— Merci, Fred.
Ils ressortent de la salle.
Je reste prostré sur ma chaise.
Je jette un coup d’œil autour de moi. La table, les meubles, l’écran. Je repense à la chambre du Radisson. J’ai une furieuse envie de tout saccager et de leur caler ma démission.
Éloïse passe sa tête par la porte.
— Ça va, Fred ?
— Pas vraiment. Je dois approfondir le sujet.
Elle a compris ce que ça veut dire.
La page est tournée. Tout se déglingue. Mes ambitions professionnelles sont réduites à néant. Je vais retourner derrière mon écran et mettre en ligne les textes des vrais journalistes.
Quand Camille sera partie au bout du monde et m’aura oublié à jamais, je me bourrerai la gueule avec mes copains immatures et culbuterai des filles faciles. De temps en temps, je ferai le con sur le Ring, je passerai sous un train ou me taperai des décharges meurtrières.
Je continuerai à jouer à être toi pour te sentir vivant.
6 minutes après l’appel
Elle ferma les yeux et joignit les mains dans un geste de prière.
— S’il vous plaît, pitié, j’attends un bébé.
Une voix tonna derrière son bourreau.
— Attends !
Une main se referma sur ses poignets et l’arracha à sa cachette de fortune. Elle se retrouva face à un géant couvert de sang. Une longue balafre lui barrait la joue.
L’homme esquissa un rictus haineux.
— N’aie pas peur, je vais m’occuper de toi.
SAMEDI 4 JUILLET 2015
38. Delirium
Vanessa se tord le visage en mimant une grimace de douleur.
— Houla !
Je balbutie, la voix rocailleuse.
— Ça se voit tant que ça ?
Nuit d’apocalypse au Doktor Jack.
Le cahier des charges de Jeremy a été respecté. Cracheur de feu et serveuses sur des échasses en prime. J’ai troqué le gin premium pour de la téquila flambée. Je traîne l’une des plus belles gueules de bois de ma vie. Un javelot me transperce les tempes de part en part, une enclume se trimballe dans mon estomac et un bourdonnement sourd me taraude les tympans.
Elle semble affolée.
— Tu es translucide.
— Une dizaine de cafés et je serai nickel.
Elle est seule, mais le reste de la troupe ne va pas tarder.
Le jour était levé quand j’ai quitté la boîte. Que je sois arrivé en vie chez moi tient du miracle, surtout à l’allure à laquelle je suis rentré. Ma nuit de sommeil se résume à trois heures de coma nauséeux.
Je m’affale sur la chaise, allume mon ordi. La feuille de route ondule sur l’écran. J’attends que le sol se stabilise pour la déchiffrer. Rien n’est pire que de devoir affronter l’ouverture les lendemains de veille.
« Premier grand départ en vacances sous la canicule. » « Un vaccin contre le sida expérimenté sur des singes donne des résultats encourageants. » « Tupou VI couronné roi des Tonga. »
Pas d’exclus à l’horizon.
Je zigzague jusqu’à l’ascenseur, descends à la cafétéria et en profite pour prendre un bol de nicotine. Les rayons du soleil me transpercent les rétines. Je respire en gardant les yeux fermés.
Je consulte mon téléphone.
Noyé dans la brume éthylique, j’ai envoyé un message à Camille vers 5 heures du mat. Mes doigts ont ripé sur les touches, le correcteur automatique s’en est mêlé.
Je ne vous pas que yu parles, je ne vois pas pue tu m’obnubiles.
Un désastre, fond et forme.
Ma mère a laissé une tartine sur mon répondeur. Elle aimerait que je vienne leur rendre visite demain midi, si je ne travaille pas, bien sûr, ça fait tellement longtemps, ça lui ferait tellement plaisir, elle ferait une lasagne verde, ou des bucatini, comme je préfère, ciao, Frédéric.
Elle ressemble de plus en plus à une mamma italienne. Si mon père ne s’en était mêlé à ma naissance, je me serais appelé Federico, Massimo ou que sais-je encore.
J’en veux à ma mère de ne pas avoir touché à la chambre de Greg. Elle est telle qu’il l’a laissée en partant, comme s’il allait rentrer de l’école. Un sanctuaire. Rien que de l’approcher me file le cafard.
Je n’y ai mis les pieds qu’une fois, quelques jours après sa mort, pour récupérer son amulette, la pièce d’échecs qu’il prenait toujours avec lui quand il partait en expédition. Un fou blanc en ivoire, acheté pour une croûte de pain au marché aux puces. Ce samedi-là, il ne l’avait pas pris.
Mon père ne dira pas que ça lui ferait tellement plaisir de me voir. Il ne m’a jamais pardonné. Quand il m’adresse la parole, ce qui est rare, il ne me regarde pas dans les yeux, la pire forme d’humiliation. Il contemple la nappe ou fixe un point imaginaire au-dessus de ma tête.
Chaque jour, il s’arrangeait pour me faire sentir le poids de ma faute. Il commençait des phrases, s’interrompait, soupirait. Les plus banales de mes paroles étaient accueillies par un pincement de lèvres ou un dodelinement de tête exaspéré. S’il avait un reproche à me faire, il passait par ma mère.
« Dis-lui de. » « Demande-lui de. » « Explique-lui que. »
Depuis le 27 avril 1996, il n’a plus prononcé mon prénom.
À mes dix-huit ans, il est allé trouver ma mère pour négocier mon départ. Il était prêt à me payer un loyer et mes études, pourvu que je foute le camp. J’ai accepté.
Le jour venu, j’ai préparé mes affaires. Ma mère était partie faire les courses. Elle ne voulait pas assister à ça. Je me suis arrêté sur le pas de la porte pour lui dire au revoir. Il m’a ignoré, le nez dans son Aquamag.
J’ai pété un câble. J’ai posé ma valise et je suis descendu au garage. Je suis remonté avec un marteau, j’ai traversé le salon devant lui et l’ai balancé de toutes mes forces sur son aquarium.
La vitre a explosé. Quatre cents litres d’eau se sont répandus sur le plancher. Ses voiles de Chine et autres bestioles hors de prix se sont mis à frétiller sur le sol, la bouche ouverte. Il s’est levé, s’est dirigé vers moi. Il avait sans doute l’intention de me flanquer une raclée, mais j’avais encore le marteau dans la main. Il s’est ravisé et est parti chercher une bassine pour sauver les rescapés.
Après quoi, nos contacts se sont rafraîchis.
Je fais couler cinq expressos et tombe nez à nez sur Pierre, rasé de frais.
Il écarquille les yeux.
— Aïe !
— C’est bon, je sais.
Loïc et Alfredo sont arrivés, l’équipe du samedi est au complet. Ils ne disent pas un mot, Vanessa les a briefés.
Le café me tord les tripes. J’exhale des relents d’arabica aromatisé à la téquila. Le menton dans une main, je rédige un premier article pendant qu’Alfredo commente une dépêche d’un ton ironique.
Le point positif d’une biture est qu’elle occulte toute préoccupation. Seul importe l’espoir d’une mort rapide ou d’une résurrection miraculeuse.
En revanche, le cerveau continue à travailler en arrière-plan, les rouages lubrifiés par la gnôle. Malgré lui, il décortique, analyse, synthétise, crée de nouvelles dimensions. La défonce est le meilleur vecteur d’inspiration. Les œuvres majeures de la littérature ont vu le jour alors que leur auteur était sous l’emprise de la dope et de l’alcool. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Faulkner, Bukowski, Hemingway, tous des poivrots ou des camés notoires.
Je lève la tête.
— Répète.
Alfredo se redresse, surpris.
— Quoi ? Le truc de l’Espagnol ?
— Ouais.
Il replonge dans son écran.
— « Barcelone. Un homme de quarante-cinq ans s’est suicidé en se tirant un coup de chevrotine en plein visage. Avant de commettre son acte, il a bâché les meubles et recouvert les murs de la chambre d’un film plastique. » C’est sympa pour le service de nettoyage.
Il se marre.
Je ferme les yeux.
L’appel angoissé, la porte fracturée, le flingue baladeur, la disparition de l’ordi, le téléphone, Lexus, le cimetière, la carte postale, la photo de Natasha. Les pièces se mettent en place sans que je sollicite mon cortex.
Je me précipite sur mon iPhone.
— Raf, il faut que je te voie tout de suite.
Il chuchote :
— Gwen est là. Qu’est-ce qui t’arrive ?
— On s’est plantés depuis le début. Je suis au Soir, raconte-lui n’importe quoi et pointe-toi sur-le-champ.
Je raccroche.
Un SMS de Camille déboule dans la foulée.
J’en capte sans effort la signification.
Kf u’bjnf
39. Élémentaire
Je tourne en rond sur le trottoir en grillant clope sur clope, les neurones en fusion.
La trame a jailli comme une révélation, complexe, mais logique, incontestable. Je ferme les yeux, me la repasse en boucle de peur qu’elle ne se barre avec l’évaporation de mon taux d’alcoolémie.
Raf se pointe au journal dans la demi-heure.
Je l’escorte jusqu’à l’ascenseur.
Arrivé dans la cabine, il m’ausculte, atterré.
— Putain, Fred, ta tête.
À sa place, je ne la ramènerais pas. Il a enfilé un vieux jogging troué et a l’air d’émerger d’une rave de trois jours. Ses cheveux semblent plus noirs, sa peau plus blanche.
J’ai prévenu les autres de sa venue. Ils ne peuvent s’empêcher de l’ausculter des pieds à la tête avant de replonger dans leur travail.
— On sera plus tranquilles dans la salle de réunion.
Il me suit sans discuter.
Je le place devant le tableau de papier, lui tends un marqueur et me dirige au fond de la pièce.
— Note ce que je te dis tant que les choses sont claires dans ma tête. Tu es prêt ?
— Plus ou moins.
Je lâche de but en blanc.
— Ton père s’est suicidé.
Il écarquille les yeux.
— Tu déconnes ?
— Écris.
Il se retourne, penaud, note « suicide ».
— Tu m’expliques ?
— Plusieurs personnes l’ont déclaré dépressif. Les della Faille nous l’ont décrit solitaire, introverti, renfermé, emmuré dans sa persona fictive, comme disait l’autre tarte. Ça ne datait pas d’hier. Ta mère l’avait foutu dehors et il ne te voyait plus. Ajoute « dépressif ».
Il écrit « dépressif » en dessous de « suicide » et ajoute un point d’interrogation.
— Enlève le point d’interrogation. D’après ce que nous avons appris, trois événements ont accéléré les symptômes. D’abord, ce qu’il a vécu à Caracas. Je suis sûr que, pour lui, il a failli flinguer son fils. Ensuite, la tuerie d’Odessa et la perte de son job. Il est rentré en Belgique, délaissé, sans boulot, paumé. Il a essayé de renouer avec toi, sans succès. En désespoir de cause, il a décidé d’en finir. Il s’est donné la mort dans la soirée du 14 juin.
Il est loin d’être convaincu par ma démonstration.
— Je peux poser des questions ?
— Vas-y.
— Commençons par la photo de Natasha.
Je lui relate le témoignage de Iouri.
— Je ne sais pas ce qui s’est passé quand ton père est entré dans la Maison des syndicats. Je suppose qu’il n’a pas trouvé Natasha ou qu’il est arrivé trop tard. Cet épisode l’a achevé. Il a gardé la photo.
Il note les données au tableau, selon sa méthode, chaotique.
Je marque des points, mais il reste sceptique.
— Ensuite ?
— Il t’a envoyé un mot d’adieu et a coupé sa messagerie. En bon psychorigide, il a rangé la bicoque, de la cave au grenier avant de passer à l’acte. Il a plié ses vêtements, ciré ses godasses, passé un coup de balai. Dans le même ordre d’idée, il a versé un produit dans l’aquarium pour éliminer les poissons rouges. Demande qu’on fasse une analyse de l’eau, je te parie qu’on y trouvera une saloperie.
— C’est possible, mais ça ne veut pas dire que c’est lui qui a foutu le poison dans l’aquarium.
Je balaie d’un geste.
— Je continue. Le ménage terminé, il a passé le CD qui lui rappelait ton enfance, il a pris son Desert Eagle et s’est tiré une balle dans la tête.
Il hausse ses maigres épaules.
— Ça n’explique pas le flingue à trois mètres, la porte pétée, le PC envolé et le reste.
Je l’attendais.
— J’y viens. Fin du premier acte. Deuxième acte, Marc Lekieffre entre en scène.
Je commence à l’intéresser.
Il retourne la feuille, inscrit un « 2 ».
— Vas-y.
— Trois jours plus tard, le mercredi 17, le gars se pointe chez ton père. Soit par hasard, soit parce qu’ils avaient rendez-vous, ou parce qu’il était sans nouvelles de lui. Il sonne. Pas de réponse. Il fait le tour de la bicoque, force la porte de la cuisine et découvre le corps de son ami Régis.
Il visualise la scène, devient transparent.
— Après ?
— Il comprend ce qui est arrivé, mais décide de ne pas appeler les flics.
— Pourquoi ?
— Parce qu’il est impliqué dans le massacre d’Odessa et ne veut pas être mêlé à la mort de ton père. Pour être certain qu’on ne trouve pas de traces de lui, il pique le téléphone et l’ordi. Il sait que les flics concluront au suicide et qu’il n’y aura pas d’enquête.
— Si tu le dis. Ensuite ?
— C’est là que lui vient l’idée de mettre un journaliste sur la piste.
Il secoue la tête.
— Je ne vois pas pourquoi.
— Il veut que la vérité éclate au grand jour, mais qu’elle soit dévoilée par une source neutre et fiable, à l’issue d’une enquête en bonne et due forme et sans qu’il soit cité. Il en essaie trois, je suis le seul à tomber dans le panneau.
Mon raisonnement le dépasse.
— Il doit bien se douter qu’un journaliste tombera sur lui, tôt ou tard.
— Comment ? Il n’apparaît nulle part. Nous avons eu un sacré coup de chance avec les della Faille. Sans eux, nous n’aurions jamais trouvé sa trace ni son nom.
Il reste dubitatif.
— Je veux bien, mais pourquoi un journaliste s’intéresserait à cette histoire ?
— C’est là qu’il joue bien le coup. Pour appâter sa proie, il va rendre les choses louches. Il commence par éloigner le Desert Eagle. En bon pro, il sait que l’indice ne sera pas suffisant pour que les flics concluent à un meurtre déguisé en suicide. Ensuite, il m’appelle. Il prend un ton affolé, se fait passer pour ton père et se dit menacé. Je suis son scénario. Le lendemain, je vais sur place et je contacte les flics. Comme prévu, ils concluent au suicide. Sauf que j’ai remarqué le vol du PC, du téléphone et la disparition de tout papier ou photo, voulu de sa part. Bref, je pars dans son trip.
— Comment a-t-il su que tu marchais dans sa combine ?
— C’est pour ça qu’il est passé au cimetière. Comme il l’espérait, j’y étais. Bingo, il a compris que j’avais mordu à l’hameçon.
— Ah bon ? Comment il savait que c’était toi ?
— Je lui ai donné mon nom au téléphone et ma trombine est en ligne, affichée sur la photo de l’équipe de rédaction. Mais ça ne suffisait pas. Pour s’assurer que je ne laisse pas tomber, il m’a envoyé une carte de Paris avec la piste Sczepanski, histoire de relancer l’enquête.
— Dans quel but ?
— Pour que je découvre le complot, l’implication au plus haut niveau de membres du gouvernement dans le massacre. Il a tout bon, j’ai fait ce qu’il m’a dit.
Il s’assied, à court d’objections.
— Ta théorie tient la route, mais il reste pas mal de trucs pas clairs. Il sort quand, ton article ?
— Jamais. Le rédac-chef l’a refusé. Pas assez solide. Il veut plus de viande.
Il pousse un soupir.
— Merde ! Il te manque des trucs que seul Lekieffre pourrait confirmer. Et là, good luck pour le loger.
Je bénis la téquila flambée, la solution m’apparaît.
— Lekieffre ignore que mon reportage a été blackboulé. Je n’ai qu’à bluffer et lui tirer les vers du nez.
Il prend un air blasé.
— Bonne idée. Juste une question, comment tu vas le contacter ?
— C’est simple. Je vais lui envoyer un mail.
DIMANCHE 5 JUILLET 2015
40. Parti en fumée
Combattre le mal par le mal. La vaccination et l’homéopathie s’appuient sur ce bon principe. Selon mon expérience, il en va de même pour se remettre d’une biture.
J’ai rejoint Jeremy en sortant du Soir. On a commencé par se faire un bowling. J’ai fait équipe avec lui, contre Ilian et Arthur, tous deux sains de corps et d’esprit. Ils nous ont flanqué une raclée monumentale. Pour fêter leur victoire, nous avons enchaîné un resto tex-mex et un before chez Ilian avant de piquer une tête aux Jeux d’hiver.
Je suis resté à la téquila flambée, le mal par le mal.
Au milieu de la nuit, Jeremy m’a présenté à Pauline, une fan inconditionnelle. Je ne l’avais jamais remarquée. Vingt-cinq ans, blonde, maquillée, pomponnée, sapée classe. Elle me suit depuis mon premier Ring, a assisté à mon dernier passage à niveau, aime beaucoup ce que je fais.
Ses yeux papillonnaient. Elle n’attendait qu’un signe de ma part pour me donner son accord.
Je ne pensais qu’à Camille.
Cette fois, je me suis abstenu de lui envoyer un message. Tout a été dit. Qu’elle s’en aille en Chine et que j’en finisse avec mes faux espoirs.
Au final, je n’ai pas dormi plus que la nuit précédente.
Ma mère est inquiète.
— Tu n’as pas l’air en bonne santé, Frédéric. Tu es pâle et tu as les traits tirés.
— Je travaille trop.
Après le départ de Greg, elle ne m’a plus parlé en italien. Quand j’assiste à une conversation dans ma langue maternelle, je comprends ce que les gens racontent, mais je dois chercher mes mots pour m’exprimer.
Elle ne l’a pas fait de façon délibérée. Je sais qu’elle m’aime pour deux. C’est le moyen qu’elle a trouvé pour prendre une certaine distance et afficher sa solidarité avec l’autre.
L’autre contemple ses pâtes. Il n’en a rien à foutre de ma gueule de déterré et de mon surmenage.
Autour de moi, la bicoque est figée dans l’immobilisme. Les bibelots, les tableaux, l’aquarium, tout est à la même place. J’ai pourtant l’impression qu’elle se délabre. Les photos jaunissent, les tapis s’éliment, la peinture se ternit, les meubles tombent en désuétude.
Des changements se font aussi sentir chez mes parents. Les hanches de ma mère s’épaississent. Le crâne de l’autre se dégarnit, son dos se voûte.
— Tu aimes mes lasagnes ?
— Elles sont délicieuses.
De temps à autre, je consulte ma messagerie à la dérobée, le téléphone posé sur ma cuisse.
J’ai longuement réfléchi au contenu du mail destiné à Lekieffre. Le message devait être nébuleux et le faire réagir. Tout indiquait qu’il voulait rester dans l’ombre. Je devais l’obliger à en sortir, sans lui en dire trop, en taisant les données incertaines.
En fin de compte, j’ai opté pour la simplicité.
Objet : votre collaboration
Cher monsieur Lekieffre,
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les précieuses informations que vous m’avez fait parvenir. L’enquête que j’ai menée à Odessa m’a permis de les confronter aux faits réels.
L’article relatif aux événements du 2 mai 2014 paraîtra dans quelques jours dans Le Soir.
À ce titre, pourriez-vous m’envoyer une photo récente de vous. Il me tient à cœur que vous apparaissiez en rubrique.
Dans l’attente de votre réponse.
Bien cordialement,
Une bombe à retardement.
Le simple fait que je connaisse son nom devrait le faire bondir. Je lui ai également filé mon numéro de portable, pour autant qu’il intercepte ce mail un jour.
Bernier avait laissé son téléphone allumé dans l’espoir de recevoir une réponse de Raf à son message d’adieu, ce qui a permis à Lexus de l’utiliser pour m’appeler.
Comme il voulait à tout prix qu’on ne trouve aucune trace de lui, il l’a piqué, ainsi que le PC. Il devait s’assurer qu’aucun mail entrant ne le compromettrait. Pour ce qui est du mot de passe, au cas où Bernier aurait éteint son ordi, Lekieffre connaissait à coup sûr un hacker qualifié pour le craquer.
La théorie tient la route.
Je n’ai plus qu’à croiser les doigts pour qu’il consulte la messagerie de Bernier de temps en temps. Mon dernier espoir. Si je parviens à le convaincre de témoigner aux côtés de Iouri et d’Andrei, mon article refera surface.
Coup d’œil furtif sur l’écran.
Rien.
Seul le cliquetis des couverts trouble le silence embarrassé.
Ma mère relance.
— Tu es toujours content de ton travail ?
— Je reviens d’Ukraine, j’ai fait mon premier reportage sur le terrain.
Elle s’extasie.
— Tu as entendu, André ?
André s’en tape. Il avale une gorgée de chianti pour se donner une contenance.
J’en ai marre de ses airs hypocrites, de ses silences accusateurs, de son indifférence, de sa rancœur tenace. Je sors mon paquet de clopes, en allume une sous le regard effaré de ma mère.
Mon père s’étrangle avec son pinard.
— On ne fume pas dans cette maison.
Je m’adresse à ma mère.
— Dis-lui qu’il ne devra plus me supporter longtemps, j’ai un cancer des poumons. Si tout va bien, je serai parti avant Noël.
Elle ouvre grand la bouche, cherche l’air.
— Non, Frédéric, ce n’est pas vrai ?
Je me lève, jette ma serviette dans l’assiette, hurle à pleins poumons.
— Tu as entendu, André ? Je vais crever.
Je quitte la pièce, tremblant de rage. Je traverse le hall, attrape mon portefeuille et mes clés sur le buffet et sors de la maison, ma mère sur les talons.
— Fred, attends.
J’arrive à ma voiture, ouvre la porte, me retourne.
Elle est défigurée, le visage ravagé par les larmes. Une vieille femme au bord du désespoir.
Je la prends dans mes bras, la serre contre mon cœur.
— Tout va bien, maman, je suis en bonne santé. Je ne reviendrai plus dans cette maison.
Je n’ai pas besoin d’en dire plus. Elle sort un mouchoir de sa manche, s’essuie les yeux.
Elle bredouille, chancelante, soulagée, meurtrie.
— Mon petit, mon petit, je suis tellement désolée.
J’entre dans la voiture, referme la porte.
D’un geste désespéré, elle me fait signe d’ouvrir la fenêtre. Elle pose une main contre sa bouche, m’envoie un baiser.
— Ti amo, il mio piccolino.
LUNDI 6 JUILLET 2015
41. Le jour et l’heure
Gilbert tire une dernière bouffée.
— Je t’ai raconté celle du commissaire en chef de la police ?
Ses anecdotes d’ancien combattant commencent à me gonfler.
— Me souviens pas.
Il se frotte le nez.
— On était encore au 120. Je ne sais pas en quelle année, mais il n’y avait ni mail ni téléphone portable. Les types des infos générales avaient installé un scanner-espion pour écouter les conversations des flics, histoire d’avoir un scoop avant tout le monde. Le truc crépitait toute la journée dans leur bureau.
J’anticipe pour écourter.
— Un jour, le chef des poulets est venu dire bonjour.
J’espérais lui couper ses effets.
— Exact. Quand il a débarqué, les types ont balancé dare-dare un paquet de journaux sur l’appareil, mais le bazar s’est mis à crachoter. Incendie chaussée de Neerstalle, feu rouge en panne rue de la Loi, ce genre. Tu sais ce qu’il a fait, le flic ?
— Aucune idée.
— Rien. Il était habitué à entendre ce blabla et il n’a rien remarqué.
J’écrase ma cigarette.
— C’est marrant. Bon, je te laisse.
Je passe au café et parcours pour la énième fois le message de Camille. J’en connais chaque mot, mais mon cœur se contracte à chaque lecture.
Départ de bonne heure le 15 juillet, par Hainan Airlines. J’ai appris quelques phrases de survie : Bonjour Honorable Hôtesse, puis-je avoir des couverts normaux ?
Jusqu’à présent, l’échéance était floue. Dans trois semaines, bientôt. Elle tournait autour du pot pour reculer le moment fatidique. Cette fois, les choses sont claires, le 15 juillet. Une date qui marquera la signature de notre protocole de rupture.
Je n’ai pas répondu.
Qu’attend-elle ? Que je lui envoie la vidéo de mon immolation par le feu ? Que je lui souhaite un bon voyage ? Que j’aille agiter mon mouchoir à l’aéroport ?
Adieu, Camille.
Je tourne la page. Retour aux affaires. Tour de France, William Bonnet s’est viandé à 60 km/h, entraînant une trentaine de coureurs dans sa chute. Les photos sont impressionnantes.
Un sport de tarés. À fond en permanence. Ça ne m’étonne pas qu’ils s’en fourrent plein les narines. En son temps, je me suis acheté un vélo de compète, un truc en carbone qui pesait moins lourd qu’un mug. Je l’ai revendu après avoir perdu un poumon dans une montée un peu raide.
L’alliance franco-allemande durcit le ton face à la Grèce. Un astéroïde va frôler la Terre.
Il devrait corriger sa trajectoire, histoire de mettre tout le monde d’accord.
En revanche, Lexus n’a pas réagi. Aucune nouvelle depuis quarante-huit heures. Raf me téléphone à tout bout de champ. Il a fini par semer le doute dans mon esprit. Si je m’étais trompé ?
En attendant, je jette un coup d’œil quand je traverse la rue et j’ai collé un cheveu sur la porte de mon appart, comme dans les films d’espionnage.
Éloïse s’est trouvé un nouveau mec. Elle échange des SMS à tour de bras, le sourire béat. Vanessa a prévu un poulet au gingembre pour tout à l’heure. Pierre a l’air d’un premier communiant sans sa barbe.
Personne n’est revenu sur mon échec ukrainien, mais je le sens planer comme un vautour. Ils guettent mes réactions, m’observent l’œil en coin, comme si j’étais en quarantaine. Les plaisanteries sont rares. On ne parle que business.
À 21 heures, on marque la pause.
Vanessa me hèle d’une voix mal assurée.
— Tu manges avec nous, Fred ?
— Bien sûr.
Je m’installe autour de la table.
— Indochine passe aux Ardentes ce soir. C’est con, je vais rater ça.
Ils mettent un moment pour capter que je lance la vanne du jour.
Pierre embraie.
— Je chante plus juste que lui, c’est dire.
Vanessa réplique.
— Au moins, on l’entend, pas comme Daho.
C’est parti.
Ils se détendent. L’atmosphère se réchauffe. Les chanteurs français y passent, tour à tour, Johnny, Cabrel, Mitchell, Polnareff, tous en prennent pour leur grade. Les papys épuisés, place à la nouvelle génération, Kendji, M Pokora, Maître Gims, Christophe Maé, les paroles insipides, les musiques inexistantes, ça vole de tous côtés.
Pierre se lève, part dans une parodie, les bras croisés sur la poitrine, l’air inspiré.
— Dis-moi que tu m’aimes comme moi je t’aime, car moi que je t’aime que si tu m’aimes.
On l’accompagne en tapant des mains, pliés de rire. Je suis de retour parmi eux. Mon iPhone vibre au moment où Vanessa part dans un numéro clownesque, la bouche tordue.
Numéro masqué.
Ma nuque se raidit.
— Monsieur Peeters ?
Je reconnais la voix dès la première syllabe.
Je m’éloigne de quelques pas.
— Bonsoir, merci de me rappeler.
— Vous êtes à Bruxelles ?
Le ton est sec, autoritaire.
— Je suis au Soir, je travaille.
— Restez dans le coin. Je vous contacterai vers minuit. Arrangez-vous pour que Raphaël Bernier soit avec vous.
Il raccroche.
Les rires se sont tus. Je contemple l’écran de mon téléphone, les paumes des mains glacées.
42. Retour vers l’enfer
Il est minuit passé, Raf et moi sommes seuls à la rédaction. Dans quelques minutes, l’agent de sécurité nous priera de quitter les lieux.
Raf parcourt le plateau de long en large, passe d’une vitre à l’autre, guette les bagnoles dans la rue.
Pour tuer le temps, il m’a raconté ses derniers déboires avec son dragon. Le torchon brûle.
— Putain, elle me prend pour un gamin, elle me traite comme si j’étais sa chose. Je commence à en avoir marre.
Il est temps.
Je n’ai pas commenté.
Il gesticule au milieu de la rédaction.
— Tu es sûr qu’il va rappeler ? À cette heure, je devrais bosser. Chaque minute me fait perdre du fric.
Mon téléphone se manifeste à point nommé.
Numéro masqué.
— Raphaël Bernier est avec vous ?
— Nous sommes tous les deux au Soir, nous attendions votre appel.
— Montez dans une voiture, allez vers le Palais de Justice.
Terminé.
Raf m’interroge du regard.
— Oui, c’était lui. On prend ton tacot. Je ne sais pas où il va nous emmener.
Nous descendons à toute allure, grimpons dans son taxi, direction place Poelaert. De temps à autre, je me retourne et jette un coup d’œil vers l’arrière, persuadé que Lekieffre nous suit. Rien en vue.
Au parvis, nouvelle sonnerie.
— Gare du Midi.
Raf obtempère, se faufile dans le goulet de l’avenue Louise et descend le boulevard de Waterloo.
Lekieffre reprend contact au moment où nous arrivons à la gare.
— Entrez, faites quelques allées et venues. Assurez-vous de ne pas être suivis. Je vous attends au Pullman dans vingt minutes.
Il raccroche.
Nous nous garons et pénétrons dans la station. Hormis les derniers voyageurs et les habituels sans-abri, l’endroit est désert. Nous traversons le hall, consultons les panneaux horaires, revenons en arrière, repartons vers la place Horta.
Le champ est libre.
À l’heure dite, nous poussons la porte du Pullman.
Marc Lekieffre est assis dans l’un des fauteuils, non loin de la réception. Il nous observe quelques instants, se lève et s’approche sans un mot. Il est plus grand et massif que dans mon souvenir. Plus impressionnant aussi.
Il glisse une main le long de mon torse, la passe dans mon dos, puis fait face à Raf qui se laisse contrôler, livide.
L’inspection terminée, il nous indique les fauteuils.
— Coupez vos téléphones et posez-les sur la table.
Nous nous exécutons et prenons place.
Il cloue son regard dans le mien.
— Quand sort votre article ?
— La parution est suspendue.
— Pourquoi ?
— Il me manque des éléments.
La réponse semble lui convenir.
Il se tourne vers Raf.
— Je suis désolé, Raphaël. Votre père était un de mes amis, un des rares à qui je pouvais faire confiance. Il vous aimait beaucoup.
Secoué, Raf reste sans voix.
Lekieffre revient vers moi.
— Comment m’avez-vous trouvé ?
— J’ai eu de la chance.
Je lui explique le relevé téléphonique, l’appel des della Faille, notre visite à Genval, le notaire, la recherche auprès du consulat de France à Caracas.
Il reste de marbre, mais mon cheminement l’épate. Ses yeux parcourent mes tifs, ma chemise rouge, mon futal blanc, mes baskets. Il se demande comment un allumé dans mon genre a pu réussir une telle prouesse.
— Mon nom apparaît dans votre enquête ?
— Pas précisément. Le journaliste ukrainien qui m’accompagnait à Odessa a cru vous reconnaître sur une photo, quand vous étiez sur le toit.
Il enregistre l’information, médite quelques instants.
— Que savez-vous de la mort de Régis ?
Je reprends depuis le début.
Il m’écoute sans me quitter des yeux.
— Qu’est-ce que vous en avez conclu ?
— J’ai d’abord cru qu’il s’agissait d’un meurtre camouflé en suicide.
— Et après ?
— J’ai compris que c’était le contraire, un suicide camouflé en meurtre.
Je lui livre mes déductions.
Il remue la tête.
— C’est presque ça, à part le flingue. Il faisait noir, je l’ai déplacé involontairement, en prenant un objet sur la table. Je savais que les flics concluraient au suicide. J’ai pensé qu’un journaliste essaierait d’en savoir plus si cette mort lui paraissait suspecte.
— En savoir plus sur quoi ?
Il répond par une autre question.
— Qu’avez-vous appris à Odessa ?
Je décide de jouer cartes sur table.
— J’ai parlé à plusieurs personnes. Le massacre était planifié.
Je lui relate mon trip ukrainien, depuis mon face-à-face avec Andrei jusqu’au récit de Iouri.
Il se recule.
— En effet, il vous manque des éléments.
— Dans ce cas, donnez-les-moi.
— Si j’avais l’intention de vous les communiquer, j’aurais pris rendez-vous avec vous après avoir découvert Régis.
— Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ?
Il pointe un doigt accusateur.
— En aucun cas, je ne dois apparaître dans votre enquête. Si mon nom est cité dans votre article, je suis mort, et mon fils aussi.
Les pièces se mettent en place. Je cerne les enjeux, je comprends les raisons de son anonymat et le jeu de piste qu’il a manigancé.
J’indique Raf du menton. Son visage blêmit aussitôt de deux tons.
— Raphaël a trouvé des menaces de mort sur le passeport de son père.
Un couple fait irruption dans le hall, jette un coup d’œil dans notre direction et poursuit son chemin vers les ascenseurs.
J’attends que les portes de la cabine se referment.
— Vous êtes soumis au même chantage ?
Il acquiesce.
— Régis mort, je suis le seul à savoir ce qui s’est réellement passé. Même mes boss ignorent la vérité.
Un silence pesant s’installe.
Il n’en dira pas plus. Il a un flingue braqué sur lui. Mon article signe son arrêt de mort et celle de son fils.
Autant lâcher le morceau.
— Pour tout vous dire, j’ai abandonné l’enquête. Mon journal n’en veut plus. Les preuves ne sont pas suffisantes, les témoins ne sont pas fiables. L’article ne sortira jamais. Mon fichier sera à la poubelle demain matin. Vous avez ma parole.
Son expression change.
Il me fixe dans le blanc des yeux.
— La parole d’un journaliste.
Raf intervient pour la première fois.
— Vous avez aussi la mienne.
Lekieffre le considère un moment, se penche en avant.
— Je vais vous en dire plus, Raphaël. J’ai connu votre père à Caracas. Nous faisions le même boulot, nous parlions la même langue. Comme lui, je suis divorcé et mon fils a votre âge. Quand il a quitté le Venezuela, je lui ai trouvé un poste dans la boîte pour laquelle je travaille. Il a accepté, mais plus question de l’envoyer dans les zones de combat. Il voulait se limiter au convoyage et à l’exfiltration d’hommes d’affaires. Ce n’était pas le job le mieux payé, mais ça lui a permis de s’acheter une maison et de vous laisser quelque chose.
Je m’immisce dans le dialogue.
— Vous l’avez revu souvent ?
Il opine.
— Nous faisions souvent équipe. Je partageais son dégoût pour les sales boulots. On faisait appel à nous quand il fallait un chauffeur ou un garde du corps baraqué, le gabarit sécurise le client. Nous avons fait la Côte-d’Ivoire, le Liban, l’Irak, la Libye, le Mali, l’Ukraine. Après Odessa, son état a empiré. Il ne voulait plus porter d’arme, il ne participait plus aux séances de tir et refusait la plupart des missions. Il s’est fait virer.
Je laisse planer un court silence avant de reprendre.
— Vous avez gardé contact après ça ?
— On s’écrivait. Je suis venu lui rendre visite de temps en temps. Il menait un combat perdu d’avance. Pas moyen de trouver un job. Plus de repères. Plusieurs fois, il m’a parlé d’en finir. Les dernières semaines, je l’ai senti au bout du rouleau. Comme il ne répondait plus à mes mails, j’ai débarqué chez lui ce soir de juin. Je n’ai pas été surpris.
Il retourne vers Raf.
— Il avait peur pour vous. D’une certaine façon, sa décision de se donner la mort vous mettait hors de danger.
Il glisse sa main dans sa veste, en sort une photo.
— Elle se trouvait sur la table.
D’un geste maladroit, Raf s’empare du cliché.
Il accuse le coup, reste figé sur son siège, droit comme un I.
— Je m’en souviens. Il l’a prise devant chez lui, à Noël. Il a dû insister pour que j’accepte. Je tire une gueule pas possible, là-dessus.
Il tente de masquer son trouble et reprend d’une voix mal assurée.
— Qui le menaçait ? Qu’est-ce qu’il a fait pour mériter ça ?
Les yeux de Lekieffre filent de gauche à droite. Il hésite entre passer le reste sous silence ou aller jusqu’au bout.
Il soupire.
— Votre père n’a commis aucun crime. À Odessa, il a eu une conduite exemplaire.
Raf se lève d’un bond et se met à hurler.
— Putain, si vous arrêtiez de tourner autour du pot ? J’en ai marre qu’on me parle comme si j’étais un demeuré ! Je n’ai pas envie de passer le reste de ma vie à me demander si mon père a été impliqué dans cette tuerie.
Je jubile intérieurement. Le moustique prend son envol.
Lekieffre reste de marbre. Réfléchit. Pèse le pour, le contre.
Prend sa décision.
— Asseyez-vous, Raphaël. Je vais vous dire ce qui s’est passé.
Raf se laisse tomber dans le fauteuil, les jambes coupées par son coup de gueule héroïque.
— Merci.
Lekieffre jette un coup d’œil autour de nous.
— Nous étions à Kiev. Nous avons été contactés pour une intervention ponctuelle. Ils avaient besoin d’un chauffeur et d’un convoyeur à Odessa le lendemain. Ils nous ont présenté l’opération comme une simple mission d’encadrement. Ils devaient monter une équipe en dernière minute et ils leur manquaient des candidats. De nombreux types étaient rentrés chez eux pour les quelques jours de congé. Les autres étaient sur le front. Ils nous ont offert un beau bonus, sans en dire plus. On ne s’est pas méfiés, on a accepté. C’était une erreur.
Il s’arrête, nous dévisage.
— Nous avons rejoint Odessa le 2 mai où nous avons fait connaissance avec les autres membres de l’équipe. Le responsable était un Autrichien. Deux types le secondaient. Ils formaient le noyau, nous étions en support. Il m’a envoyé sur le toit avec un gars pour surveiller les environs et empêcher qui que ce soit de monter. Régis devait protéger une entrée au rez-de-chaussée. Nous avons pensé que notre rôle était de sécuriser le bâtiment. Nous ne savions pas ce qui se tramait.
Il marque une pause.
— Quand l’assaut a eu lieu sur l’esplanade, j’ignorais qu’une trentaine d’hommes étaient planqués dans la maison. Au moment où les pro-Russes sont entrés, j’ai entendu des coups de feu et des explosions. Je suis descendu et j’ai découvert le massacre. L’Autrichien était aux commandes. J’ai vu beaucoup d’horreurs dans ma vie, mais là, ça dépassait l’imagination. J’ai tenté de m’interposer, mais je me suis fait tabasser et ils m’ont enfermé dans une pièce. Plus tard, Régis m’a appris qu’il était monté peu après moi, à la demande d’un homme qui recherchait sa femme. Il a vu les exécutions, les tortures, les viols. Il a eu la même réaction que moi et a subi le même sort. Au milieu de la nuit, quand l’opération touchait à sa fin, l’Autrichien et ses deux acolytes nous ont à nouveau passés à tabac pendant de longues minutes. Il a menacé de nous tuer ainsi que nos enfants si nous ne fermions pas notre gueule.
Il a un geste de dépit.
— Nous avons fermé notre gueule. Nous sommes retournés à Kiev. Nous avons repris le boulot. Régis a tenu le coup pendant quelques semaines, puis il s’est effondré.
J’enchaîne.
— Cet Autrichien ? Un balafré ? Les deux mecs, un Black et un Arabe ?
Il est estomaqué.
— Oui. Comment vous le savez ?
— J’ai envoyé un message au QG, leur expliquant que j’étais journaliste et que je cherchais des informations sur Régis Bernier. Sans le vouloir, j’ai déclenché l’alarme. Il est venu me rendre visite chez moi avec les deux autres. J’ai passé un sale moment.
Il secoue la tête.
— Vous avez eu de la chance. S’il n’avait pas de comptes à rendre, vous ne seriez plus de ce monde, et moi non plus. La boîte n’aime pas être mêlée à la mort de civils. Encore moins si c’est un journaliste qui enquête sur la mort d’un de leurs employés. Pour Odessa, il a rédigé un rapport bidon disant que les titouchkis avaient fait le coup et qu’il avait été dépassé par les événements.
— Vous en savez plus sur lui ?
— Non.
Je n’en crois pas un mot.
Dopé par sa subite éruption de testostérone, Raf reprend le flambeau.
— Si vous ne dites rien, si rien ne filtre, si aucune enquête n’aboutit, tous ces salopards resteront impunis et mon père sera mort pour rien.
Lekieffre plisse les yeux.
Un éclair de haine s’allume dans ses prunelles.
— Pas tous. En septembre, une dizaine d’hommes ont été abattus à Kiev, Odessa et Moukatcheve. Pour la plupart, c’étaient des voyous ou des membres du Secteur droit qui se trouvaient à Odessa le 2 mai. On suppose qu’un commando pro-russe a fait le ménage.
Septembre, le dernier voyage de Régis Bernier.
Un aller-retour à Kiev.
MARDI 7 JUILLET 2015
43. Un cocktail exotique
J’imprime la photo de Régis Bernier et la pose sur mon bureau.
Même visage gonflé, même bouche tordue, mêmes yeux grands ouverts. Rien n’a changé sur le papier, mais tout est différent dans mon regard.
L’amour et la mort sont comme de vieux amants. Ils n’ont plus grand-chose à se dire, mais ne restent jamais loin l’un de l’autre.
C’est ce qui t’a le plus manqué, Régis. À force de passer à côté de l’un, tu t’es jeté dans les bras de l’autre.
Greg est parti depuis près de vingt ans. Je ne lui ai jamais dit que je l’aimais. Pas un jour ne s’écoule sans que je le regrette. J’aurais dû le crier à Camille bien plus tôt, au lieu de me prêter à ce badinage imbécile.
Christophe me tire de mon rêve éveillé.
— Tu viens, Fred ?
Je lui emboîte le pas. À ma surprise, il passe devant son bureau et poursuit vers les ascenseurs.
— Où allons-nous ?
Il répond sans se retourner.
— Chez Jean-Pierre.
Jean-Pierre est le boss du Soir. Être convoqué chez lui est plutôt inquiétant. Je repense à mes dernières frasques, la chambre d’hôtel ravagée, mes gueules de bois successives, mon enquête foireuse.
Autant anticiper.
— Qu’est-ce qui se passe ?
— Tu verras.
Nous montons au troisième et entrons dans l’antre directorial. Tout en continuant une conversation au téléphone, Jean-Pierre nous fait signe de fermer la porte et de nous asseoir.
Il met fin à l’appel, me salue de la tête.
— Bonjour, Fred. J’ai suivi tes pérégrinations ukrainiennes.
— J’ai raté mon coup, je suis désolé.
Il se renverse dans son fauteuil, croise les mains derrière la nuque.
— Bienvenue dans le journalisme de terrain. 10 % de réussite, 90 % de frustration.
— Je m’en suis rendu compte. Je vais m’en remettre.
Il grimace un sourire.
— J’espère bien. Qu’est-ce qu’il t’aurait fallu pour obtenir de meilleurs résultats ?
— De l’expérience, du temps. Je me suis contenté de deux témoignages, je n’ai pas posé les bonnes questions, je ne suis pas allé au fond des choses.
Il acquiesce.
— En effet.
Il laisse passer un silence hitchcockien avant de poursuivre.
— D’après une étude, les journalistes Web sont des types de seconde zone, déconsidérés par leurs directions et leurs collègues des médias traditionnels. Tu ressens ça aussi chez nous ?
— Pas du tout.
Il hoche la tête en direction de Christophe.
— Dis-lui.
Christophe se racle la gorge.
— Qui pourrait te remplacer, si tu quittes le Web ?
Qu’ils arrêtent de tergiverser.
— Vous comptez me foutre dehors ?
Regards entendus de leur part.
Christophe reprend.
— D’une certaine façon. L’EIC, l’European Investigative Collaborations, ça te dit quelque chose ?
— Jamais entendu parler.
— Logique. L’initiative a été lancée par quelques journalistes du Spiegel et Stefan Candea, le cofondateur du Centre roumain pour le journalisme d’investigation. L’idée est de créer un réseau européen dans lequel seraient impliqués des médias de plusieurs pays. Le but est de s’associer pour collaborer à des enquêtes en profondeur.
Jean-Pierre enchaîne.
— Nous avons décidé de rejoindre le réseau. En plus du Soir, des titres comme Newsweek, Mediapart et El Mundo ont déjà donné leur accord.
Retour de Christophe.
— De notre côté, Alain sera le coordinateur, mais il aura besoin de quelqu’un pour l’assister. Nous avons pensé à toi.
Des fourmillements de satisfaction se propagent dans ma nuque.
— Cool. Je signe où ?
Ils sourient, se lèvent, me tendent la main.
— Bienvenue à l’EIC.
Je me lève à mon tour, avec le sentiment d’avoir grandi de dix centimètres.
Je leur serre la main.
— C’est super, merci, je ne sais pas quoi dire.
Jean-Pierre se rassied.
— Pour l’instant, l’info est confidentielle. Nous ferons l’annonce officielle aux équipes début août. En ce qui concerne les lecteurs, nous attendrons la publication d’une première enquête d’envergure.
Christophe se penche vers moi.
— Dans l’immédiat, tu vas prendre deux semaines de congé. Tu n’es pas parti en vacances depuis un bon moment et tu en as besoin, surtout avec ce qui t’attend au retour. Dans un deuxième temps, on parlera de ton remplaçant. Pour finir, il faut que tu arrêtes les conneries. Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois.
— Bien sûr. Vous pouvez compter sur moi.
Le téléphone sonne. Jean-Pierre nous signifie d’un mouvement du menton que l’entretien est terminé.
Je redescends au deuxième, le pas léger, le sourire béat. J’ai l’impression de flotter sur le sol.
Frédéric Peeters, journaliste d’investigation, membre éminent du prestigieux réseau EIC.
Camille serait fière de moi.
Éloïse et Alfredo guettent mon arrivée.
— Ça va ?
Je prends l’air dégagé.
— Un truc administratif. Je dois me taper deux semaines de congé si je veux toucher mon pécule de vacances.
Alfredo brandit son mug.
— Mazel tov ! Saint-Tropez ? Marbella ?
Éloïse hausse les épaules.
— Qu’est-ce-que tu racontes ? Alfredo ? Il n’y a que les beaufs qui vont encore à Saint-Trop. Et Marbella, c’est pour les ploucs. Le top, c’est Shikoku, Ispahan ou le Cachemire.
Je m’installe, tends les jambes sous le bureau.
— J’irais bien au soleil. Farniente sur la plage, baignades en mer, cocktails exotiques.
Je jette un coup d’œil aux derniers mails. Mon regard est attiré par un nom. Marc Lekieffre. Il a tenu parole.
Son message ne contient qu’un mot.
Todtnauberg.
— Et pour ça, rien de mieux qu’un petit village isolé dans la Forêt-Noire.
MERCREDI 15 JUILLET 2015
44. Une belle journée
8 h 30. Je me lève, ouvre les rideaux, sors sur le balcon.
Air frais, ciel bleu, soleil radieux.
J’entame mon sixième jour à Todtnauberg, un petit village de montagne encaissé dans une vallée verdoyante, à une trentaine de kilomètres de Fribourg. Mille mètres d’altitude, forêt de sapins, pentes douces et ruisseaux argentés. Un enterrement de première classe.
J’attrape mes jumelles, les pointe vers la maison de Double K.
Dans quelques minutes, ils sortiront pour prendre leur petit déjeuner sur la terrasse. À force de les observer, je connais leurs rituels.
Lao-Tseu, Confucius ou un autre Chinois a dit que la vérité ne vient qu’au troisième pourquoi.
Au moment de nous quitter, Lekieffre a été pris d’un remords, d’un doute, ou du besoin d’en finir. Devant mon insistance à savoir qui était le balafré, il a fini par cracher le morceau.
— Je l’ai revu à Kiev. Son nom est Kurt Krüger, mais on l’appelle Double K. C’est un exécuteur de sales besognes, un tueur à gages, un tortionnaire. Il a commis une série d’exactions en Irak et dans le Donbass, plus quelques meurtres commandités à gauche et à droite, tous grassement payés. Entre deux contrats, il se terre avec sa garde rapprochée dans un petit village de la Forêt-Noire. Sa tête est mise à prix par plusieurs organisations, mais il semble intouchable.
Intouchable est le bon mot.
Seule une longue route en lacet accède au bled. Avant d’y monter, j’ai loué un Ford Kuga à Baden-Baden. Une Golf équipée de plaques belges aurait attiré l’attention. Hormis les amoureux de la flore locale et des bouses de vache, il ne viendrait à l’idée de personne de passer ses vacances ici.
Selon Flavio, le serveur de l’hôtel avec qui j’ai sympathisé, c’est bondé en hiver. Quelques pistes de ski pour les nuls drainent les familles économes.
Pour ce que je suis venu y faire, le Mangler remplit bien son rôle. Quatre étoiles, chambres rustiques, un spa bien équipé et un resto qui tient la route. Avantage non négligeable, il est situé sur le versant opposé au chalet de Kurt Krüger.
La patronne a été surprise de me voir débarquer. Je dois être leur plus jeune client depuis l’ouverture. Étranger et célibataire de surcroît. J’ai baragouiné que je sortais d’une dépression, que j’avais besoin de repos, que je comptais faire quelques randonnées au grand air et profiter de la piscine. Je n’y ai jamais mis les pieds.
En revanche, j’ai fait quelques balades exploratoires, affublé d’un sac à dos, d’un chapeau tyrolien et de lunettes de soleil. Le reste du temps, je suis resté dans ma piaule à étudier les allées et venues du quatuor.
En plus de Double K, du Black et de l’Arabe, un géant blond occupe les lieux. Il quitte rarement le nid. Je l’imagine gardien-cuisinier-homme à tout faire.
Je règle les jumelles, balaie du regard la maison de haut en bas.
Kurt a bien choisi son repaire. Le chalet surplombe le village. Murs blancs, toit de bardeaux, comme dans la chanson. Un jardin ceinture la bicoque. Une terrasse sur pilotis donne sur le sud.
L’endroit est difficile d’accès et offre une vue dégagée sur la route. En cas de coup dur, la France et la Suisse ne sont pas loin. Cela dit, un sniper installé sur le toit de l’hôtel ferait carton plein, ce qui dément l’affirmation de Lekieffre à propos d’un contrat placé sur la tête de Double K.
Un mouvement. La porte s’ouvre. Les quatre hommes sortent, suivis par les deux meufs recrutées hier soir à Fribourg. Côté sexe, ils font plutôt preuve de modération. Ils ne partouzent qu’un jour sur deux.
J’ai un peu plus de deux heures devant moi. Je me douche, m’habille et descends dans la salle du restaurant.
Flavio virevolte d’une table à l’autre. Des couples âgés pour la plupart, un trio de randonneuses retraitées et un veuf solitaire qui tremblote de partout.
— Guten Tag, Herr Fred, café ?
— Jawohl, très fort, bitte.
En principe, ils ramèneront ces demoiselles à Fribourg après le petit déjeuner et remonteront vers 11 heures, après avoir fait le plein de bouffe et d’alcool.
J’avale trois tasses de café, mais ne parviens pas à manger quoi que ce soit, un airbag de camion s’est ouvert dans mon estomac.
Flavio s’inquiète.
— Keinen Hunger ?
— Nein, trop mangé hier soir.
Je remonte et retourne à mon poste d’observation.
Le blond débarrasse la table. Le Black consulte son iPad, les doigts de pieds en éventail.
Quelques minutes plus tard, les deux nanas escortées par Double K et l’Arabe descendent l’allée et se dirigent vers l’un des deux gros pick-up Toyota. Les mecs devant, les femmes derrière, des gentlemen.
Je suis passé plusieurs fois à proximité du chalet pour prendre quelques photos à la dérobée. Une salle de fitness se trouve au rez-de-chaussée. Ils y vont à tour de rôle.
L’après-midi, quand il ne pleut pas, ils tapent le carton ou font un tournoi de fléchettes dans le jardin, hard-rock à fond les manettes. Le soir, ils s’empiffrent, regardent des DVD et se beurrent la gueule, avec ou sans putes.
Dans quelques jours, au mieux dans quelques semaines, ils retourneront travailler. Dure, la vie d’ange de la mort.
Je consulte mes mails. Lekieffre ne sait pas ce que je mijote. Il m’a fait parvenir un message auquel je n’ai pas répondu.
Hier, Raf m’a envoyé le scoop de l’été. Lui non plus ne sait pas ce que je magouille. Il pense que je me repose, que j’ai laissé tomber l’affaire.
J’ai largué Gwen. Je suis soulagé. Ça fait un moment que j’en avais marre, mais je n’avais pas le courage de le lui avouer. J’ai pensé à toi et au train. Sans le savoir, tu m’as aidé. Je te paie un pot pour fêter ça quand tu rentres de vacances.
À 10 h 15, j’éteins mon ordi et me mets en marche. Avant de refermer la porte, je jette un coup d’œil à l’intérieur. Ma valise est ouverte sur le sol, mes vêtements traînent de tous les côtés. Je me regarde dans le miroir de l’entrée. Ma tête de déterré contraste avec la semaine que je viens de passer en altitude.
Je salue la patronne en sortant. Elle stagne derrière son bureau à la réception, jour et nuit. De temps en temps, elle engueule le personnel à distance.
Je grimpe dans le Kuga, descends au village, remonte l’autre versant et passe à hauteur du chalet de Krüger. Je poursuis et me dirige vers la sortie de Todtnauberg. Après trois cents mètres, je m’engage sur le parking aménagé pour les visiteurs de la chute d’eau, vantée comme la plus haute de la Forêt-Noire.
Je me range à l’extrémité, au bord du précipice, d’où je peux observer la route en contrebas.
Je coupe le moteur. Il me reste à attendre.
Une heure s’écoule, interminable. Enfin, le pick-up apparaît. Mon cœur s’emballe. Au moment où je mets le contact, le signal sonore de mon téléphone retentit.
SMS de Camille.
L’avion est parti.
Pourquoi m’envoie-t-elle ça ? Pourquoi maintenant ? Je me fous que son avion ait décollé. Je m’apprête à éteindre mon iPhone quand un doute m’envahit.
Depuis quand les avions chinetoques sont-ils équipés de wifi ? Des picotements se répandent dans mes jambes, mes bras, ma nuque. Un deuxième message arrive dans la foulée.
Sans moi.
Je commence à trembler comme le vioque de l’hôtel.
Que lui répondre ? Que j’ai un truc à terminer ? Qu’elle aura bientôt de mes nouvelles ?
Je regarde l’écran de mon téléphone, persuadé que le coup de grâce va arriver.
Gagné.
Je t’attends.
45. Et faire un beau cadavre
Je démarre sur les chapeaux de roues, les nerfs à vif, et dévale la route à toute allure. Virage à gauche, épingle à droite. Les pneus du Kuga gémissent. J’entre dans la longue ligne droite au moment où le pick-up apparaît au bas de la côte.
Quatre cents mètres nous séparent. D’un côté, la paroi rocheuse, de l’autre, le précipice.
— Il faut que je te dise un truc, Zanzara.
Je jette un coup d’œil au siège passager.
Greg est installé de travers et m’observe en jouant avec son fou blanc.
— Plus tard, Greg ! Là, je suis occupé.
Il continue à me dévisager, l’air grave.
— Non, maintenant.
Je me déporte lentement vers le milieu de la route. Double K remarque ma manœuvre, lance un appel de phares.
— Balance, mais vite.
— Ce jour-là, j’ai voulu faire plus fort que toi. Mes potes me regardaient, tu ne m’as pas laissé le choix. J’ai évité la première bagnole, mais au lieu de continuer sur ma lancée, je me suis arrêté au milieu de l’avenue. Je voulais sauter sur le capot de la caisse qui arrivait pour m’en servir comme tremplin. Tu en aurais bavé. J’aurais réussi si ce connard n’avait pas freiné. Tu m’as bien eu, mais il s’en est fallu de peu.
Je me rabats.
— Tu déconnes ?
— J’ai l’air ?
— C’est maintenant que tu me dis ça ?
— Tu vas faire une connerie. Tu vois bien que tu n’as aucune chance.
Je reviens au centre.
Nouveaux appels de phares, répétés, rageurs. J’appuie sur le champignon, plonge sur lui.
Une chance sur deux.
Lui ou moi.
Greg se met à beugler.
— Merde, Zanzara !
Je hurle de plus belle.
— Putain, laisse-moi faire !
Kurt est au volant, main enfoncée sur l’avertisseur. L’Arabe est à ses côtés. Vingt mètres. Je fais un brusque écart puis reviens vers lui. La manœuvre le surprend. Mû par un réflexe, il donne un coup de volant pour m’esquiver. Sa roue avant mord l’accotement.
Mauvais choix, Kurt.
Dans un rugissement de métal, le flanc de la Kuga racle celui de la Toyota. Krüger arrive à mon niveau, fenêtre ouverte. Il me lance un regard, me reconnaît. Un éclair de haine illumine ses prunelles. Je donne un coup de volant à droite, la Kuga chasse de l’arrière. Je récupère l’embardée, jette un œil dans le rétroviseur.
Le pick-up décroche, bascule dans le vide.
Je suis en nage. Je fonce, prends le virage suivant à la limite de la rupture et poursuis la descente dans la ligne droite.
Je suis aux premières loges.
Le spectacle est grandiose.
Comme dans une séquence au ralenti, la Toyota dégringole la pente rocheuse, flotte dans les airs, part en tonneaux, s’envole à nouveau.
Je freine pour éviter la collision. Le pick-up continue sur sa lancée, traverse la route devant moi en lâchant des pièces de toutes parts, une roue, une portière, le capot. Après une dernière cabriole, il s’écrase trente mètres plus bas contre une rangée de sapins.
Je suis trempé de la tête aux pieds.
Je tourne la tête.
Greg est exsangue. Il me fouille du regard avec fierté.
— Bien joué, Fred. Tu es meilleur que ton frère. Moi, je n’aurais jamais osé.
Des larmes inondent mon visage.
Cette fois, il m’a pardonné. L’élève a dépassé le maître.
Tu peux t’en aller, Greg. Prends ta copine la silhouette avec toi. Je te rejoindrai au paradis dans vingt, trente ou cinquante ans. La vie me démange, Camille m’attend.
Au moment où j’arrive à hauteur de la carcasse, le réservoir explose.
Une gerbe de flammes monte vers le ciel.
Je baisse la vitre et brandis mon majeur.
— Enfoirés.
Basé sur des faits réels
Les événements qui se sont déroulés le 2 mai 2014 à Odessa entreront sans doute dans les mystères de l’Histoire.
Si les nombreuses photos et captures vidéo prises ce jour-là sur l’esplanade permettent, avec approximation, de cerner le déroulement des faits, il n’en va pas de même pour la genèse de l’affrontement.
Les analyses que l’on trouve dans les médias sont incomplètes ou contradictoires, certains parlant d’un dérapage regrettable, d’autres d’un massacre programmé.
Quant à ce qui s’est réellement produit à l’intérieur de la Maison des syndicats, seules des accusations, des hypothèses ou des présomptions sont avancées.
Le bilan même reste contesté, allant d’une quarantaine de morts, selon la version officielle, à plus de deux cents, d’après plusieurs témoins.
Remerciements
Je tiens à remercier l’équipe du Soir qui m’a accueilli à bras ouverts lorsque j’ai évoqué mon projet.
Les journées que j’ai passées au sein de leur rédaction m’ont permis de mieux comprendre les rouages de leur métier et d’apprécier leur professionnalisme et leur enthousiasme.
Je leur suis également reconnaissant d’avoir bien voulu me confier quelques-unes des anecdotes qui ont émaillé l’histoire de leur journal. Mon imagination n’aurait pu les concevoir.