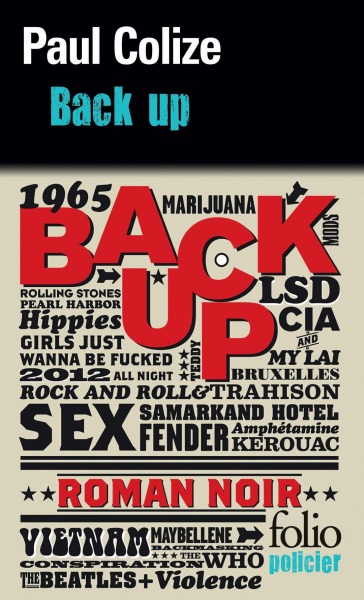
Quel rapport entre la mort en 1967 des musiciens du groupe de rock Pearl Harbor et un SDF renversé par une voiture à Bruxelles en 2010 ? Lorsque l’homme se réveille sur un lit d’hôpital, il est victime du , incapable de bouger et de communiquer. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, il tente de reconstituer le puzzle de sa vie. Des caves enfumées de Paris, Londres et Berlin, où se croisent les Beatles, les Stones, Clapton et les Who, à l’enfer du Vietnam, il se souvient de l’effervescence et de la folie des années 1960, quand tout a commencé…
Paul Colize est né en 1953 et vit près de Bruxelles. Quand il n'écrit pas, il est consultant, amateur de badminton et joue du piano.
Paul Colize
Back up
Playlist
Voici la bande son, par ordre d’apparition, pour accompagner et prolonger votre lecture.
CREAM, Spoonfull
CHUCK BERRY, Maybellene
GRAND FUNK RAILROAD, Paranoid
THE ROLLING STONES, The Last Time
CHUCK BERRY, Sweet Little Sixteen
CHUCK BERRY, Roll Over Beethoven
CHUCK BERRY, Johnny B. Goode
LITTLE RICHARD, Tutti Frutti
BILL HALLEY & THE COMETS, Rock around the Clock
JERRY LEE LEWIS, Great Balls of Fire
THE EVERLY BROTHERS, Bye Bye Love
ELVIS PRESLEY, Hard Headed Woman
ELVIS PRESLEY, Baby, Let’s Play House
CHUBBY CHECKER, Let’s Twist Again
THE BEATLES, Love me Do
THE SHADOWS, Apache
THE SHADOWS, Blue Star
THE SHADOWS, Nivram
THE SHADOWS, Little B
THE BEATLES, Please Please Me
JIMMY REED, You’ve got me Dizzy
JIMMY REED, Down in Virginia
MEMPHIS SLIM, Every Day I Have the Blues
LITTLE RICHARD, Lucille
EDDIE COCHRAN, Summertime Blues
THE BEATLES, Twist and Shout
THE BEATLES, I Want to Hold Your Hand
THE BEATLES, She Loves You
THE YARDBIRDS, For Your Love
THE ROLLING STONES, Satisfaction
THE ROLLING STONES, She Said Yeah
U2, Get On Your Boots
THE BEATLES, Norwegian Wood
THE WHO, My Generation
THE WHO, The Ox
THE ROLLING STONES, Paint It Black
U2, One
U2, With or Without You
CREAM, Steppin’ Out
THE BEATLES, Strawberry Fields Forever
PINK FLOYD, Arnold Layne
CREAM, Sunshine of Your Love
PEARL HARBOR, Girls Just Wanna Get Fucked All Night
THE BEATLES, A Day in The Life
PROCOL HARUM, A Whiter Shade of Pale
THE MOODY BLUES, Nights in White Satin
THE ROLLING STONES, Sympathy for The Devil
PINK FLOYD, Astronomy Domine
PINK FLOYD, Interstellar Overdrive
TOTO, 99
À ma mère,
qui savait si bien danser le rock’n’roll
C’est la CIA et l’armée qui ont lancé le LSD pour contrôler les gens et en fait, ils ont réussi à nous donner la liberté. Il ne faudrait pas oublier de les remercier. Le LSD a des façons mystérieuses de faire des merveilles, en tout cas ça marche foutrement bien. Si on lit le rapport du gouvernement sur l’acide, les seuls qui sont passés par la fenêtre étaient des militaires. Je n’ai jamais connu quelqu’un qui s’est jeté par une fenêtre ou qui s’est suicidé à cause du LSD.
Je ne suis pas seulement là pour faire des disques et de l’argent. Je suis là pour dire quelque chose, et toucher les autres, et parfois, c’est un appel désespéré.
1
Un joli petit oiseau
Larry Speed débarqua à l’aéroport de Majorque le samedi 18 mars 1967 en milieu d’après-midi.
À la sortie de l’avion, il cligna des yeux, chaussa ses lunettes noires et ôta son blouson de cuir. Lorsqu’il avait quitté Tempelhof, quelques heures plus tôt, Berlin se perdait dans la brume et la température ne dépassait pas cinq degrés.
Le lendemain de l’enregistrement, il avait suggéré aux trois autres membres de Pearl Harbor de s’offrir quelques jours de vacances. Avec trois mille marks dans la poche et quinze mois de travail dans les jambes, il estimait que c’était plus que mérité. De plus, la cohabitation et la promiscuité prolongées avaient entraîné l’inévitable lot de tensions et de tiraillements. Il les avait convaincus qu’un peu de recul leur serait bénéfique.
Les autres avaient acquiescé.
Dans l’après-midi, il s’était rendu dans une agence de voyages sur le Kurfürstendamm. La gérante lui avait proposé Majorque, la Grèce ou Istanbul.
Goguenard, il lui avait adressé un clin d’œil et lui avait demandé de sa voix éraillée où il y avait le plus de putes à baiser.
La femme était restée de marbre et lui avait recommandé les Baléares, destination pour laquelle il restait des places disponibles dans l’avion du samedi.
Le jour venu, il avait empilé quelques affaires dans une valise, glissé sa Fender dans son étui et commandé un taxi pour l’aéroport. Il avait également pris soin d’emporter son tourne-disque portatif Teppaz et quelques 33 tours dont Fresh Cream, l’album du power trio qui tournait en boucle dans la chambre depuis trois mois.
Larry Speed, de son vrai nom Larry Finch, était le fondateur et le leader de Pearl Harbor, le groupe de rock qu’il avait formé trois ans auparavant, alors qu’il vivait encore à Battersea, un quartier de la banlieue sud de Londres.
Enfant illégitime, il n’avait pas connu son père, un coureur de jupons qui avait disparu du jour au lendemain, peu avant sa naissance. Il avait passé son enfance et la majeure partie de son adolescence au second étage d’une modeste maison de Queenstown Road, choyé par une mère omniprésente qui l’idolâtrait. Durant près de vingt ans, les quatre gigantesques cheminées de la centrale électrique construite sur le versant de la Tamise lui avaient servi d’horizon.
À l’inverse du mythe qui veut qu’un bassiste de rock soit un bagarreur intrépide, prompt à passer à tabac le premier contradicteur venu, Larry était un blanc-bec chétif, au visage émacié, au teint maladif et au courage limité.
Sous l’impulsion de sa mère, il avait suivi des cours de solfège et appris le piano à l’âge de huit ans. Quatre ans plus tard, il était passé à la guitare jazz, pour rapidement basculer vers la basse et suivre les pas de son modèle de l’époque, Charlie Mingus.
De sa formation classique, il avait conservé la rigueur et la précision. Il affirmait avec le plus grand sérieux que les lignes de basses les plus abouties avaient été composées par Jean-Sébastien Bach deux siècles auparavant et que personne ne l’avait surpassé depuis, sauf Jack Bruce.
Introverti, taciturne, misanthrope, il masquait son mal de vivre derrière un sourire cauteleux et des sarcasmes assassins.
Il subissait néanmoins de saisissantes métamorphoses lorsqu’il entrait en scène. Il devenait alors excentrique, enjoué et se mettait à gesticuler comme un forcené.
Peu avant seize heures, il arriva au Punta Negra, un hôtel flambant neuf perché sur une petite péninsule de la Costa d’en Blanes, à une vingtaine de kilomètres de Palma.
Il prit possession de sa chambre, ouvrit sa valise et en étendit le contenu sur le sol.
Une demi-heure plus tard, il fit son apparition à la piscine de l’hôtel où sa peau fatiguée, ses longs cheveux noirs et sa chemise à franges, ouverte sur son torse décharné, détonnèrent avec le hâle et les rondeurs des vacanciers allongés sur les chaises longues. Pour ajouter au contraste, ses bras étaient chargés de tatouages dont le plus explicite louait les bienfaits d’une fellation.
Les clients de l’hôtel échangèrent des propos à mi-voix en l’épiant du coin de l’œil. Indifférent aux regards suspicieux, Larry s’accouda au bar et commanda une bière qu’il vida d’un trait. Déconcerté par le prix dérisoire qui lui fut réclamé, il décida de passer à la vitesse supérieure et relança au gin coca.
Vers dix-huit heures, alors que le soleil commençait à décliner, il avait avalé assez d’alcool et offert suffisamment de pourboires au barman pour s’enquérir des possibilités de divertissement plus pimentées. Ce dernier lui apprit que Majorque disposait au quinzième siècle d’un bordel public dont la dextérité des pensionnaires attirait les marins à vingt mille lieues à la ronde. D’après ses dires, l’attachement au travail bien fait s’était conservé au fil du temps. Il lui vanta entre autres le Mustang et le Bora Bora.
Larry remonta dans sa chambre et passa commande d’un demi-poulet rôti, de pommes frites, de petits pois et d’une bouteille de rosé frais.
Selon les déclarations que firent ses voisins, il avait pris son repas devant la télévision en parodiant à tue-tête le discours du commentateur espagnol. Il avait ensuite écouté quelques LP en sautant dans la pièce.
Un taxi vint le chercher à vingt-trois heures et le déposa au Mustang Ranch, à Bajos, dans le centre de Palma.
Dans le night-club, il fut approché par plusieurs entraîneuses et jeta son dévolu sur une femme aux cheveux noir jais et aux formes généreuses, plus âgée que les nymphettes qu’il avait écartées. Il lui offrit une coupe de champagne et fit quelques pas de danse avec elle. Ils se mirent ensuite d’accord sur la somme de dix mille pesetas en contrepartie de ce qu’elle nommait le grand vertige.
Vers deux heures trente, il commanda un taxi. Ils s’y engouffrèrent et prirent la direction du Punta Negra.
Le portier de nuit de l’hôtel les vit entrer vers trois heures du matin. Il déclara par la suite que le couple semblait dans un état d’ébriété avancé.
Vers cinq heures du matin, la femme se présenta à la réception et demanda au portier de lui appeler un taxi. Elle titubait quelque peu, mais ne semblait ni affolée ni anxieuse.
Interrogée plus tard, elle affirma que Larry dormait paisiblement lorsqu’elle l’avait quitté.
Comme chaque dimanche, l’employé chargé d’entretenir les jardins commença son travail à six heures trente. Lorsqu’il entama le nettoyage de la piscine, vers sept heures quarante-cinq, il discerna le corps d’un homme dans le fond. Il appela aussitôt à l’aide et deux cuisiniers assistés d’un serveur vinrent à la rescousse. Les hommes hissèrent Larry Finch hors de l’eau, mais ne purent que constater son décès.
Le médecin légiste dépêché par la police conclut à une mort par asphyxie ayant entraîné un œdème pulmonaire traumatique. Il situa l’heure de la noyade aux alentours de six heures du matin.
La prostituée, Marta Rego, précisa dans sa déclaration à la police que Larry avait beaucoup bu et qu’il s’était enfermé à plusieurs reprises dans la salle de bain durant quelques minutes.
Hormis la bordée d’obscénités dont il l’avait abreuvée pendant leurs ébats, elle l’avait trouvé plutôt gentil. À sa surprise, il avait fait preuve d’une sexualité à la normalité consternante.
En plus des trois grammes d’alcool présents dans son système sanguin, les analyses dépistèrent la présence de codéine, de diazépam, de morphine et d’acide lysergique, un hallucinogène de synthèse plus connu sous l’acronyme LSD.
La police en conclut que Larry Finch était en toute vraisemblance descendu pour se baigner et avait été victime d’une hydrocution.
Lorsque la mère de Larry apprit son décès par téléphone, quelques heures plus tard, elle fit couler un bain chaud, s’y plongea avec une photo de son fils et s’ouvrit les veines.
Pendant que la vie quittait son corps, elle fredonna les couplets de Hush Little Baby, la berceuse qu’elle lui chantait durant les premières années de sa vie.
Hush, little baby, don’t say a word,
Mama’s gonna buy you a mockingbird
Chut, petit bébé, ne dis pas un mot
Maman t’achètera un joli petit oiseau
2
Dans la brume
Dieu me pardonnera-t-il ce que j’ai fait ?
Lui connaît la vérité. Il sait que je n’ai pas voulu cela. Ce qui est arrivé n’est qu’un malheureux concours de circonstances.
Dieu croira mon histoire, cette histoire dont les hommes n’ont pas voulu, cette histoire dont les pages ont disparu et que je retourne sans cesse dans ma tête pour éviter que les détails ne s’évanouissent dans la brume.
3
X Midi
L’appel arriva au service d’urgence à 18 h 12.
Une femme signala qu’un piéton avait été renversé par une voiture sur l’avenue Fonsny, à proximité de l’entrée de la gare du Midi.
Le préposé lui posa les quelques questions susceptibles d’évaluer la gravité de la situation.
— Y a-t-il d’autres blessés ?
— Non.
— Est-il conscient ?
— Je ne pense pas.
— Est-ce qu’il bouge ? Est-ce qu’il remue les jambes ou les bras ?
— Pas à première vue.
Il déclencha aussitôt le dispositif d’intervention.
Une ambulance se rendit sur les lieux. L’hôpital Saint-Pierre fut averti que l’envoi d’une équipe du SMUR était requis.
Les informations furent relayées au central de la police. Une patrouille mobile prit aussitôt la direction de la gare du Midi. À grand renfort de hurlements stridents, la voiture se faufila dans le trafic, monta sur le terre-plein et se gara tant bien que mal devant l’entrée de la gare.
Les policiers coupèrent la sirène, mais laissèrent tourner les gyrophares. Ils sortirent, ajustèrent leur tenue et se dirigèrent d’un pas nonchalant vers l’attroupement.
Une vingtaine de personnes se tenaient en demi-cercle autour d’un taxi. Le véhicule gênait le passage, ce qui engendrait un concert d’avertisseurs.
Un homme se détacha du groupe et vint à leur rencontre.
Il était affolé.
— Je ne sais pas ce qui lui a pris, il a traversé d’un coup. Il s’est jeté sous la voiture, j’ai freiné dès que je l’ai vu, mais c’était trop tard.
L’un des policiers fit reculer les badauds pendant que son collègue se risquait sur l’avenue pour résorber l’embouteillage.
À intervalles réguliers, des fournées de passagers sortaient de la gare et s’éparpillaient sur le trottoir. Certains venaient grossir les rangs des curieux, d’autres pressaient le pas, indifférents au drame qui se déroulait sous leurs yeux, impatients de retrouver leur foyer ou de décompresser dans l’un des cafés avoisinants. Quelques étudiants jetèrent un vague coup d’œil à la scène, les écouteurs fichés dans les oreilles, détachés de la réalité dans leur bulle de musique.
L’ambulance apparut quelques instants plus tard, suivie par le 4 x 4 jaune du SMUR.
Le médecin se précipita et s’accroupit auprès de l’homme qui gisait en partie sous le taxi. Il se pencha, guetta sa respiration, inspecta ses yeux. Il lui glissa quelques mots à l’oreille, attendit une réaction. Il examina ses bras, ses jambes, lui prit le poignet.
Son assistant vint aux nouvelles.
— Alors ?
— Le pouls est bien frappé, mais il a un Glasgow à 4.
— Qu’est-ce qu’on fait ?
— On va le taper dans le camion. Il y a trop de monde ici et il fait presque noir. En plus, il commence à dracher.
L’infirmier leva les yeux vers le ciel. Quelques gouttes de pluie s’écrasèrent sur son visage.
— Ok, je vais chercher le scoop.
Le médecin dégagea précautionneusement la tête de la victime et lui plaça un collier cervical. Il découvrit une plaie sur le haut du crâne.
L’infirmier revint muni d’une civière métallique.
Le médecin saisit les bras de l’homme et les croisa sur son ventre. Il posa ensuite une main sous l’omoplate de la victime, l’autre sous l’une de ses fesses et le décolla du sol en le tirant vers lui.
L’infirmier glissa la première partie de la civière sous le corps de l’homme et soupira.
— Putain ! Qu’est-ce qu’il fouette ! C’est mon deuxième SDF de la semaine.
L’homme à terre portait une barbe embroussaillée et de longs cheveux poisseux gonflés d’eau et de sang. Il était vêtu d’un épais manteau informe, troué en de nombreux endroits.
Les curieux s’étaient multipliés. Les témoins de l’accident livraient en aparté leur version des faits aux nouveaux venus. La pluie s’était mise à tomber et quelques parapluies s’étaient déployés. Des ados en jeans et blouson de cuir fendirent la foule en jouant des coudes. L’un d’eux franchit le périmètre délimité, considéra la scène et toisa le policier.
— Font chier, ces clodos ! Qu’il crève, ce con !
Le policier le dévisagea sans sourciller. Le face-à-face se prolongea durant quelques instants. Le meneur roula un crachat, l’expulsa puis rebroussa chemin, suivi comme son ombre par sa clique.
Les urgentistes transportèrent l’homme dans l’ambulance. Lorsqu’il fut à l’abri dans l’habitacle, le policier en faction s’approcha.
— Vie en danger ?
Le médecin acquiesça.
— Je vous donne ses papiers dans une minute.
Il pénétra dans l’ambulance, prit une paire de ciseaux, découpa les vêtements de l’homme et fouilla ses poches. Il en sortit deux mégots, un briquet jetable, deux ou trois billets de banque et des pièces de monnaie.
Il héla le policier et lui présenta les objets.
— C’est tout. Pas de papier.
Le médecin ausculta le thorax et les poumons de l’homme et fit part de ses observations à l’infirmier.
— Abdomen souple, bassin stable.
— Les jambes ?
— Pas de fracture à première vue, mais sa tête a heurté le sol ou une autre bagnole, il saigne un peu. Je checke la neuro.
Il pinça l’homme au niveau des deltoïdes.
— Pas de réaction. Il n’ouvre pas les yeux.
— Pas de flexion des bras, pas de mouvements des jambes non plus.
— Mets-lui une perf, on va l’intuber.
L’infirmier prépara l’anesthésie pendant que le médecin appliquait des électrodes sur les épaules et le ventre de l’homme. Il ajusta le saturomètre sur l’un des doigts et referma le brassard du tensiomètre autour d’un des biceps.
D’un geste assuré, le médecin ouvrit la bouche de l’homme et inséra le tube endotrachéal.
Il jeta ensuite un coup d’œil aux instruments.
— Tu as raison, il pue la rage. Il devait être bourré, c’est un vrai tonneau de gnôle.
Le médecin prit contact avec le service de réanimation de l’hôpital.
— Jacques ? C’est Guy, j’arrive avec un trauma crânien intubé et ventilé.
— Ok, je te prépare ça.
Les véhicules s’ébranlèrent et descendirent l’avenue Fonsny en direction de la rue Haute et de l’hôpital Saint-Pierre, distant de moins de deux kilomètres. En convoi serré, ils se faufilèrent dans les embouteillages de fin de journée, franchirent le portail de l’hôpital et s’engouffrèrent dans l’entrée des urgences.
Deux internes vinrent leur prêter main-forte. Ils posèrent l’homme sur un brancard et l’emmenèrent dans un box de déchoquage. L’un des infirmiers le déshabilla et ne put réprimer une grimace.
— Vous l’avez trouvé dans une décharge ?
Il brancha le monitoring, replaça le saturomètre et le tensiomètre.
Le médecin fit la moue.
— Je n’ai pas trouvé de papiers, tu as quelque chose ?
— Rien.
Ils pratiquèrent un scanner de la colonne cervicale et du cerveau suivi d’une injection de produit de contraste pour explorer l’abdomen et le thorax.
Le médecin émit son diagnostic.
— Contusions cérébrales, deux côtes cassées, une plaie à la tête. Il y a un peu de sang dans le tube. Il est stable, regarde s’il y a de la place aux soins intensifs.
À 18 h 57, l’homme fut transféré au service des soins intensifs. L’équipe de garde le réexamina complètement. Deux aides-soignantes le lavèrent des pieds à la tête, mais l’odeur nauséabonde qu’il dégageait s’estompa à peine.
Le neurochirurgien lui rendit visite en milieu de soirée, consigna ses observations et se rendit chez le responsable du service.
— Arrêtez les médocs, on va voir s’il se réveille.
Aux environs de minuit, un policier vint aux nouvelles. Aucun papier n’avait été trouvé. Seule l’une des aides-soignantes avait relevé un indice, quelques données griffonnées au marqueur sur sa main gauche : A20P7.
Le policier haussa les épaules.
— Avec ça, on n’ira pas loin. On va attendre quelques jours pour voir s’il y a un avis de disparition qui correspond, à part ça, il n’y a pas grand-chose à faire.
Le lendemain, à l’ouverture du secrétariat, l’employée administrative remplit la fiche d’enregistrement et mentionna que le sujet avait été admis à l’hôpital le jeudi 11 février 2010, à 18 h 45.
À l’emplacement du patronyme, elle inscrivit X Midi.
4
Il faut que je reprenne le fil
Je ne pensais pas que Grand Funk serait de la partie. Le chaos, les sirènes. Paranoid. L’entrée de la guitare, pédale fuzz à fond, le grondement de la basse et l’entrée de la batterie monolithique de Don Brewer.
Grand Funk, c’était du bon bruit.
À présent, il faut que je me prépare, que je remonte le cours des événements. J’expliquerai à Dieu le pourquoi de ces morts. Il comprendra que c’est le destin qui m’a envoyé dans cette cave à Berlin, en cette nuit d’apocalypse.
Hiroshima.
C’est là que tout a commencé. C’est de là qu’il faut que je reprenne le fil.
5
Un sans-abri
Une semaine après son admission à l’unité de soins intensifs, l’homme n’avait pas repris connaissance.
L’équipe médicale avait suspendu l’administration de substances anesthésiques et s’était livrée à une surveillance rapprochée. Aucune réaction n’avait été observée et les résultats de l’exploration électrophysiologique ne laissaient espérer aucune évolution favorable à court terme.
Le rapport de l’examen tomodensitométrique cérébral mentionnait la présence d’une hémorragie sous-arachnoïdienne limitée dans la région sylvienne droite, sans œdème cérébral ni déviation du système ventriculaire.
La résonance magnétique avait détecté des lésions axonales diffuses dans le mésencéphale et une lésion stratégique touchant les deux pédoncules cérébraux.
Enfin, les analyses sanguines avaient indiqué que l’homme était dans un état de santé satisfaisant. Seuls des signes de diabète avaient été dépistés. Le tensiomètre avait établi qu’il souffrait d’un peu d’hypertension et les stigmates d’une ancienne blessure avaient été relevés sur son épaule gauche.
Assez curieusement, il ne présentait aucune avitaminose, comme c’était souvent le cas chez les SDF.
Avant que l’équipe de nuit ne s’en aille pour laisser place au personnel de jour, le médecin-chef s’empara du rapport médical de X Midi, appela les infirmières et se rendit avec elles au chevet de l’homme.
Il consulta le document et s’adressa à l’infirmière de nuit.
— Avez-vous observé une réaction au cours des dernières heures ?
Elle répondit par la négative.
— Non, aucune réaction. Pas de sueur, pas d’agitation non plus.
Le médecin se pencha et examina les pupilles de l’homme.
— Il est stable, je vais l’extuber.
L’opération prit moins d’une minute. Lorsque le tube fut retiré et le masque à oxygène mis en place, il s’adressa à la seconde infirmière.
— Prenez contact avec la neuro et demandez-leur de préparer une chambre. Nous allons le garder ici ce matin et s’il n’y a pas de complications, nous le monterons en fin de matinée.
— Bien, Monsieur.
— Surveillez-le pendant la prochaine heure. Refaites un Glasgow avant de le transférer. En attendant, continuez la Fraxiparine et le Perfusalgan.
Elle approuva d’un mouvement de tête.
La seconde femme jeta un coup d’œil au patient et baissa le ton.
— Il faut que je vous parle, Monsieur.
Le médecin suivit la direction de son regard et prit l’air surpris.
— Vous le connaissez ?
La veille, deux policiers étaient venus prélever les empreintes de l’inconnu. Ils avaient également pris quelques photos dans l’espoir de pouvoir l’identifier. Jusque-là, aucune famille ne s’était manifestée pour signaler la disparition de quelqu’un répondant à son signalement.
L’infirmière esquissa un maigre sourire.
— Non, ce n’est pas ça.
Il la prit à part.
— Je vous écoute.
— Avant d’entrer ici, j’ai travaillé à César De Paepe pendant trois ans. Pendant l’hiver, ils organisaient un service de soins pour les SDF. Le soir, les sans-abri pouvaient recevoir des soins gratuitement. J’ai été plusieurs fois affectée à ce service.
— J’en ai entendu parler.
— Les hommes que j’ai soignés là-bas présentaient des caractéristiques similaires. Quel que soit leur âge ou leur état de santé général, ils avaient les dents gâtées et les ongles des pieds en très mauvais état. Ils développaient une sorte de seconde peau sur tout le corps. Il fallait les laver quatre ou cinq fois pour avoir un début de résultat. En plus, ils présentaient des symptômes liés aux carences vitaminiques. Un autre indicateur nous permettait de repérer les SDF de longue durée.
Elle s’arrêta, chercha ses mots.
Le médecin intervint.
— L’hygiène intime ?
Elle acquiesça.
— Oui, les SDF perdent les réflexes élémentaires d’hygiène intime.
— Qu’est-ce que vous en concluez ?
— Malgré les apparences, je suis sûre que cet homme n’est pas un sans-abri.
6
Le sourire de ma mère
Hiroshima.
Ma mère disait que ma naissance avait mis fin à la guerre. Elle disait cela en souriant. J’étais assis dans la cuisine. Je la regardais. Je ne savais pas ce que ces mots voulaient dire. Sans doute étais-je heureux.
Elle préparait le repas, se séchait les mains sur son tablier et me souriait de plus belle.
Je suis né le 6 août 1945.
Plus tard, j’ai appris que ce jour-là, Little Boy avait tué près de cent mille personnes. Cent mille innocents, assassinés, massacrés, brûlés vifs en l’espace de quelques minutes pendant que je sortais du ventre de ma mère. Je n’ai jamais compris que quiconque ait pu se réjouir d’une telle ignominie. Je ne suis jamais parvenu à entrevoir les perspectives optimistes qui étaient liées à cet événement, mais seulement le tribut expiatoire qui en résultait.
De mon enfance, je ne conserve que des impressions diffuses et quelques souvenirs aux contours incertains. De temps à autre des images, des odeurs ou des sensations surgissent du trou noir qui a comblé ma vie.
L’espace d’un instant, elles émergent, gesticulent. Je les perçois avec une acuité saisissante. Je pourrais en décrire chaque détail.
Ensuite, elles s’éloignent. Certaines reviennent pour me harceler, m’ensorceler ou m’émouvoir. D’autres agissent tel un flash, elles m’éblouissent et disparaissent à tout jamais. Des pans entiers de ma vie se sont ainsi estompés dans les miasmes du temps.
Il faisait chaud. Peut-être était-ce la chaleur qui émanait de ma mère qui me laisse cette impression ? La radio diffusait de la musique classique. Les choses semblaient simples, la réalité était accessible.
Nous habitions dans un petit appartement situé au-dessus d’un garage, dans l’avenue de la Couronne, non loin de la caserne de la gendarmerie.
J’étais assis dans la cuisine, je dessinais des mondes nouveaux à l’aide de mes crayons de couleur. Avec mes camions Dinky Toys, mon Meccano et le jeu de cartes que j’avais gagné à la tombola, ils formaient l’ensemble de mes jouets, mon univers.
Le passage de la cavalerie constituait la principale attraction de la journée. Dès que j’entendais le bruit des fers sur les pavés, je me ruais à la fenêtre. Tout le monde en faisait autant. Les voisins apparaissaient aux balcons et aux fenêtres.
Nous regardions les escadrons. Les chevaux marchaient au pas, à deux, trois, ou cinq de front. Les voitures se rangeaient pour les laisser passer.
Les gens avaient le temps.
Les jours de pluie, les cavaliers étaient couverts d’un long manteau qui se déployait sur la croupe du cheval. Parfois, ils défilaient dans leur tenue d’apparat. Ils avaient une sacrée allure avec leur étendard et leur bonnet à poils noir.
Personne ne semblait importuné par les monceaux d’excréments que les chevaux abandonnaient derrière eux.
Lorsqu’ils partaient encadrer une manifestation au centre-ville, les gendarmes s’équipaient d’un casque et d’une longue matraque.
En fin de matinée, je guettais l’arrivée de la carriole verte de l’Union économique. Ma mère et moi descendions pour acheter le pain du jour. Je m’approchais du cheval, mais n’osais le caresser. Il portait des œillères. Je me penchais et tentais en vain de capter son regard. Il me faisait peur.
Vers midi, nous entendions la cloche du marchand de soupe. Je courais à la fenêtre et regardais les gens s’affairer à l’arrière de la camionnette, une casserole à la main. Dès qu’ils avaient disparu, je retournais dans la cuisine.
Je m’asseyais et je regardais ma mère aller et venir. Je garde la sensation d’avoir passé mon enfance à contempler ma mère dans la cuisine.
Les après-midi, je faisais un somme. Je m’allongeais sur mon lit, ma mère tirait les tentures. Je m’endormais aussitôt.
Le grésillement du moulin me réveillait. L’arôme du café emplissait mes narines. Je me levais et allais rejoindre ma mère. Une tranche de pain beurrée, couverte de sirop de Liège m’attendait. Je l’avalais goulûment.
Une fois par semaine, le vendredi, elle cirait le parquet. Elle étendait la cire, la laissait reposer, puis polissait le bois avec une lustreuse manuelle qui pesait une tonne. L’odeur de la cire d’abeille me renvoie à ces vendredis heureux. J’étais bien. Le temps prenait son temps.
Ma mère m’aimait. Je pense qu’elle a été la seule femme qui m’ait aimé, avec Mary, sans doute. Mon père rentrait tard, bien après que mon frère aîné était revenu de l’école. Mon frère s’amusait à me terroriser. Il disait que des bêtes féroces et des extraterrestres se cachaient sous mon lit et attendaient la nuit pour m’attaquer.
Quand mon père arrivait, il sentait la bière et le tabac. Je devais m’éclipser dans ma chambre. Il était de mauvaise humeur. Il avait eu une sale journée. Il descendait chercher un sac de charbon à la cave et chargeait la chaudière. Ensuite, il disait à ma mère qu’il voulait une bière et qu’il fallait que les moutards lui fichent la paix.
Ma mère obtempérait.
Mon père était rarement de bonne humeur. Quand cela lui arrivait, il pinçait les fesses de ma mère, ou il passait derrière elle, se collait contre elle et lui attrapait les seins. Ma mère riait, prenait un air faussement offusqué, mais je voyais que cela ne lui plaisait pas.
Je ne sais pourquoi, ce geste me dérangeait. Je disparaissais dans la chambre. Je fulminais. J’aurais aimé pouvoir le défier, mais je ne disais rien.
Un jour, la terre a tremblé sous mes pieds.
C’était la fin de l’été. Ma mère m’a annoncé que je devais aller à l’école le lendemain. C’était une bonne nouvelle, j’allais apprendre un tas de choses.
Je ne voulais pas, j’ai pleuré, j’ai crié. Mon frère jouait le vieil habitué et se moquait de moi. J’ai donné des coups de pied dans les meubles. Mon père m’a donné une gifle et je me suis calmé.
Le lendemain, j’ai opposé une résistance héroïque. Arrivé à l’école, j’ai de nouveau pleuré. Je ne voulais pas que ma mère s’en aille. Je tremblais de rage. Je voulais rentrer à la maison avec elle, m’asseoir dans la cuisine avec mes crayons de couleur et la regarder sourire.
J’ai tenté de transiger. Je voulais bien rester à condition que ma mère puisse s’asseoir à mes côtés, sur le banc voisin. Ils n’ont pas accepté.
Mon instituteur s’appelait Père Martin, mais il fallait que je l’appelle Mon Père. Je devais lever le doigt pour pouvoir parler. J’ai boycotté la procédure, je n’ai jamais rien dit.
Lors des dictées, il surgissait dans mon dos et se penchait vers moi. Je sentais son souffle dans ma nuque. Les muscles de ma main fondaient. Je n’étais plus capable d’écrire, je ne pouvais plus tenir mon porte-plume ni le tremper dans l’encrier.
Je voulais rentrer chez moi, retrouver le sourire de ma mère.
C’est à peu près tout.
De mon enfance, il me reste le sourire de ma mère.
7
Et c’est tout
J’avais une dizaine d’années lorsque j’ai entendu prononcer le mot rock’n’roll pour la première fois.
La disquaire à chignon chez qui nous allions de temps à autre l’avait lâché avec dédain en me tendant le disque de Chuck Berry. Les lèvres pincées, elle avait déclaré que c’était nouveau, qu’on appelait cela du rock’n’roll.
Je n’ai jamais su qui a été le premier vrai rocker ou quelle a été la première chanson rock. Je ne me suis jamais mêlé à ce genre de débat.
Pour moi, le premier rock, c’est Chuck Berry et Maybellene.
Et c’est tout.
8
105 kilos
L’accident s’était produit dix jours auparavant et la police dut reconnaître que les recherches n’avaient pas avancé. Malgré les efforts fournis, ils étaient toujours au point mort.
L’enquête de voisinage menée par les inspecteurs de quartier n’avait rien donné. Les riverains avaient déclaré n’avoir jamais vu X Midi. Les SDF qui erraient dans la gare avaient été interrogés sans succès.
À toutes fins utiles, un avis d’identification avait été envoyé au BCN d’Interpol, le Bureau central national, à Bruxelles. Les empreintes digitales de X Midi avaient été envoyées et analysées par le SIJ, le service d’identification judiciaire, mais elles ne figuraient pas dans leur base de données.
Les annotations A20P7 trouvées sur la paume de la main de l’inconnu avaient été soumises à un cryptanalyste de la police. Plusieurs options avaient été retenues, mais aucune n’avait débouché sur une piste convaincante.
Une équipe de policiers était venue à l’hôpital et avait demandé que l’on rase l’homme pour réaliser de nouvelles photos. Les résultats qu’ils obtinrent ne leur laissèrent que peu d’espoir, les traits relâchés et les yeux clos de l’homme dénaturaient l’expression de son visage et le rendaient difficilement reconnaissable.
Ils avaient également pris ses mensurations. X Midi était une force de la nature. Il mesurait 1,92 m et pesait 105 kilos.
9
En riant aux éclats
J’étais l’un des plus petits et des plus chétifs de la classe. Monsieur Christian, un laïc bilieux aux nerfs à fleur de peau, avait remplacé Père Martin, parti à la retraite.
Les professeurs fumaient en classe, exhalaient la fumée dans les narines des gamins et flanquaient des gifles à ceux qui ne marchaient pas droit.
Il ne serait venu à personne l’idée de s’offusquer ou de contester cette méthode. Elle avait toujours fait ses preuves et on n’en connaissait pas d’autres. Ces pratiques étaient d’autant mieux admises qu’elles servaient de fondement à l’éducation dispensée dans le giron familial.
Seules les culottes courtes étaient autorisées. Même au plus fort de l’hiver, la vue des cuisses bleuies des élèves ne semblait pas émouvoir le corps professoral.
L’un de mes condisciples dépassait d’une tête le reste de la classe. Nous l’appelions le Taureau. Il exhibait une impressionnante paire de jambons qui rougeoyaient hiver comme été. Ses cuisses étaient prolongées par des mollets de catcheur et des chevilles de percheron qui disparaissaient dans des bottillons militaires. C’était le chef incontesté de la cour. Il nous inspirait le plus profond respect.
Le bougre prétendait savoir comment se fabriquaient les enfants, mais n’acceptait de le confier qu’aux membres de sa bande. Les airs mystérieux qu’il prenait pour avancer cette thèse auguraient d’une révélation sacrilège chargée d’odeur de soufre.
Pour ma part, j’en étais resté au chou et à la rose, et ce scénario me convenait.
Les latrines attribuées aux élèves étaient nichées au fond de la cour de récréation. C’était une rangée de petits box cloisonnés, construits contre le mur d’enceinte. Elles étaient pourvues de portes ajourées qui laissaient apparaître les pieds et la tête de l’usager lorsqu’il se tenait debout. Les crochets métalliques censés servir de verrous avaient pour la plupart été déracinés par des cancres revanchards.
Pour prétendre à un semblant d’intimité, il fallait glisser un pied sous la porte pour l’immobiliser et produire son effort en même temps, ce qui nécessitait une attention particulière et une bonne coordination des mouvements.
Ce matin-là, le Taureau avait eu maille à partir avec l’un des fayots de la classe. Ils avaient échangé quelques mots acides et le fayot avait eu le dernier mot.
Ça aurait pu en rester là, mais c’était mal connaître le Taureau.
Pendant la récréation, il a épié le gaillard et a attendu qu’il s’enferme dans l’une des loges. Pour je ne sais quelle raison, il est venu vers moi, m’a agrippé par le col de ma veste et m’a ordonné d’aller ouvrir la porte à toute volée pour que tout le monde puisse voir le cul du petit merdeux.
Il a interpellé sa smala. Ils se sont pointés et se sont postés devant la porte des gogues.
J’étais pris entre deux feux, partagé entre la peur de me faire pincer par l’un des surveillants et celle, viscérale, d’avoir à subir la vindicte du Taureau si je lui désobéissais.
Je suis resté tétanisé, balbutiant, incapable de prendre une décision.
Le Taureau a rappliqué, s’est planté devant moi, jambes écartées, a posé ses poings sur les hanches et m’a demandé ce que j’attendais.
J’ai bredouillé des mots, je ne pouvais pas faire cela, nous allions avoir des ennuis.
Il m’a décoché un coup de pied dans le tibia et s’est acquitté lui-même de la tâche.
Le pauvre gars accroupi sur la cuvette, stupéfait, la chair exposée aux yeux de tous, s’est mis à hurler comme un goret. Le Taureau et sa bande crevaient de rire.
Un surveillant est arrivé en courant. Il a évalué la scène et a fustigé l’assistance. Avant qu’il ne réclame le nom du responsable, le Taureau m’a montré du doigt, me désignant comme le coupable des faits. Le pion m’a flanqué une paire de gifles et m’a envoyé chez le directeur.
Lorsque ce dernier m’a demandé pourquoi j’avais fait une chose pareille, j’ai dit que je n’étais pas le fautif, sans en dire davantage et sans dénoncer le vrai responsable, ce qui m’a valu une nouvelle paire de gifles.
Il m’a renvoyé en classe en m’informant que je devrais rester à l’école le samedi suivant, après les cours, et que j’étais sommé d’écrire mille fois que je ne devais pas ouvrir la porte des latrines quand elles sont occupées.
Lorsque ma mère est venue, le directeur l’a convoquée. Il lui a relaté les faits et a déploré ce revirement d’attitude de la part d’un élève jusque-là exemplaire.
Ma mère l’a écouté sans dire un mot, l’a remercié et a déclaré qu’elle savait ce qui lui restait à faire. Elle a demandé à mon frère de rentrer seul à la maison, m’a pris par la main et m’a entraîné dans une autre direction.
Dès que nous avons tourné le coin de la rue, elle m’a pris dans ses bras. Elle savait que je n’étais pas capable de faire une chose pareille.
Je fulminais. Je tremblais de colère. J’aurais voulu pleurer, tuer le Taureau, le surveillant et le directeur. J’aurais voulu lui expliquer ce qui s’était passé, me perdre dans ses bras, tout oublier.
Je n’ai pas pu. Pas un mot, pas une larme ne sont venus.
Elle m’a proposé d’aller chez la disquaire, m’a promis que j’allais pouvoir me choisir un disque rien que pour moi, m’a dit que ce n’était qu’un mauvais moment à passer, que je devais oublier.
La disquaire a dit qu’on appelait cela du rock’n’roll.
Nous sommes rentrés à la maison avec le disque de Chuck Berry. Ma mère a déclaré qu’elle n’allait rien rapporter à mon père, qu’elle lui raconterait que j’étais invité chez un copain samedi après-midi et que nous écouterions le disque le jeudi suivant.
Je n’étais pas conscient du risque qu’elle prenait en taisant mes mésaventures à mon père.
Mon père ne parlait que de la guerre. Il n’évoquait pas celle à laquelle j’avais mis fin en naissant, mais celle, imminente, qui allait opposer les Russes aux Américains et détruire la planète à coups de bombes atomiques.
De son côté, mon frère se fichait de la prochaine guerre et de la musique. Le feu aux joues, les yeux exorbités, il compulsait un magazine qu’il dissimulait sous son oreiller dès que je faisais irruption dans la chambre.
Quelques jours plus tard, je suis allé à confesse, comme nous étions tenus de le faire chaque semaine. Nous y allions par grappes de cinq, pendant les cours. L’église était adjacente à l’école.
Après m’être délivré de mes péchés véniels, j’ai interpellé le curé dans la pénombre. Je lui ai raconté ce qui m’était arrivé. Je voulais savoir pourquoi Dieu n’était pas venu à mon secours, parce que Dieu voit tout, parce que Dieu est juste et que Dieu punit les méchants.
Il a perçu ma question comme une offense au nom du Seigneur et a émis des réserves quant au salut de mon âme si je m’enferrais dans de tels blasphèmes. Il m’a chassé en rajoutant à ma pénitence quelques Notre Père.
Le soir, j’ai attrapé ma Bible et l’ai envoyée valdinguer sous mon lit, geste par lequel je livrais mon éducation catholique et mes restes de foi en pâture aux bêtes féroces et aux extraterrestres. Cette semaine-là, j’ai tourné la page d’un chapitre de ma vie. La confiance aveugle que j’avais en l’Humanité et en l’Église s’était envolée.
Le jeudi suivant, nous avons sorti le disque de sa cachette. Nous sommes allés dans le salon, ma mère et moi, et avons ouvert le tourne-disque.
C’était un meuble monumental qui combinait une radio et un tourne-disque. Il sentait le bois frais et la cire d’abeille. La platine était équipée d’un système qui permettait de déposer plusieurs 45 tours l’un sur l’autre pour éviter de devoir faire des allées et venues. Un écusson métallique était fixé sur le couvercle, avec un chien-assis devant un vieux phonographe.
Nous avons déposé le disque et enclenché le mécanisme.
Dès les premiers accords, un fourmillement a parcouru mon corps. J’ai ressenti une irrésistible envie de me lever, de bouger, de gesticuler, de remuer mon cul et tout ce qu’il y avait moyen de remuer. Je ne comprenais pas pourquoi ces quelques notes provoquaient un tel effet.
C’était cela, le rock’n’roll.
J’ai monté le volume. La guitare de Chuck m’emportait.
Ma mère s’est mise, elle aussi, à remuer le derrière. Mon frère est arrivé, l’air ébahi, en se demandant ce qui se passait. Il s’en est mêlé.
Nous nous sommes retrouvés tous les trois au milieu du salon, à danser comme des sauvages. Nous avons poussé le volume au maximum. Nous riions, nous criions, nous en avions mal au ventre.
Ce jour-là, le rock est entré dans ma vie pour ne plus en sortir.
De cet après-midi-là, je garde l’un des plus beaux souvenirs de ma vie, Maman dans sa jolie robe jaune qui dansait le rock’n’roll en riant aux éclats.
10
Au milieu de la foule
Personne n’aurait imaginé que Steve Parker finirait par passer à l’acte. Ses tendances suicidaires étaient pourtant connues de son entourage et des membres de Pearl Harbor qui le pratiquaient au quotidien. Elles faisaient partie des aspects sombres de sa personnalité qui lui avaient forgé une réputation de névropathe.
À la moindre contrariété, une divergence de vue sur le choix d’un accord suffisait, il partait dans d’interminables crises de colère, maudissait la terre entière et menaçait de se faire sauter le caisson si l’on ne se soumettait pas à ses exigences.
Ce genre de débordement faisait partie de son mode de fonctionnement. Les gens qui le côtoyaient s’étaient habitués à ses excentricités et considéraient ses mises en garde comme de simples caprices d’enfant gâté.
Au fil du temps, plus personne n’y prêtait attention ni ne lui attribuait le moindre crédit.
La stupéfaction fut d’autant plus grande qu’aucune information ne laissait présumer qu’il avait appris la mort de son ami Larry, survenue la veille.
Larry Finch était le fondateur et le leader incontestable de Pearl Harbor, mais Steve Parker en était l’éminence grise. C’est lui qui prenait les décisions qui engageaient l’avenir du groupe. Après réflexion, il les communiquait en aparté à Larry. Ce dernier en prenait acte et les transmettait aux personnes concernées en leur adressant la sommation de se plier aux directives, à commencer par le choix insidieux du nom du groupe que Steve Parker avait imposé aux autres membres.
Viscéralement antiaméricain, Steve affirmait que le plan Marshall avait fait de l’Allemagne le gagnant économique de la guerre. En Angleterre, certaines denrées avaient nécessité des tickets de rationnement jusqu’en 1953. Ces années de disette avaient engendré une génération d’adolescents de petite taille, maigres, boutonneux et violents, comme les redoutables Teddy Boys qui avaient semé la terreur pendant les années cinquante. Pendant ce temps, le peuple allemand prospérait grâce aux dollars que les Américains injectaient dans leur économie.
Selon lui, la déferlante des groupes de rock britanniques qui avaient envahi le marché US et s’étaient emparés des premières places au Billboard constituait la seconde défaite de l’Oncle Sam depuis ce dimanche de décembre 1941.
Ignorants du sarcasme qui les visait, les soldats américains, qui constituaient le public assidu de Pearl Harbor à Berlin, voyaient en ce nom de scène un hommage à leur grandeur dans l’adversité.
Dès ses huit ans, Steve Parker avait commencé à jouer de la guitare. À la mort d’un de ses oncles, amateur de jazz, il avait hérité d’une Fender Telecaster et d’un ampli Estimer à lampes.
Il avait d’emblée montré des dispositions pour l’instrument et avait rapidement progressé, sans pour autant connaître une note de musique ni avoir suivi le moindre cours.
À l’âge de treize ans, il s’était mis à écrire des textes qu’il mettait en musique et chantait en s’accompagnant de sa guitare. Pour la plupart, le contenu de ses compositions était haineux et acerbe. Il s’attaquait à la Couronne, au système scolaire, au gouvernement conservateur d’Harold Macmillan et à ce qu’il appelait la soumission aveugle du peuple britannique.
Aux critiques que ses détracteurs lui adressaient, il répondait par des propos orduriers et déclarait ne pas communiquer avec les gens normaux.
À quinze ans, il était affligé de nombreux tics. Des spasmes nerveux lui contractaient le visage. Il se grattait, se tirait les cheveux et se triturait les mains de manière convulsive. Les élèves de l’école qu’il fréquentait commencèrent à l’éviter, le traitèrent ensuite de névrosé et d’homosexuel.
Ses parents, inquiétés par son agressivité, son asocialité et ses sautes d’humeur, le forcèrent à consulter le médecin de famille.
Le praticien l’aiguilla vers un psychiatre qui décela la présence d’un désordre bipolaire et lui prescrivit un traitement à base d’antidépresseurs. En plus de ses symptômes maniacodépressifs, Steve souffrait d’une scoliose qui le faisait souffrir au plus haut point.
À dix-sept ans, il était devenu dépendant d’un cocktail chimique fait de neuroleptiques et d’antidouleurs dont il dépassait régulièrement les doses prescrites.
Steve Parker avait rejoint Larry Finch au printemps 1963.
À cette époque, il habitait à cinq kilomètres de Battersea, non loin du Hammersmith Odéon, la prestigieuse salle de concerts qui avait accueilli Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Il avait arrêté ses études et entamé un travail de nuit dans une boulangerie.
Un matin, il était tombé sur la petite annonce que Larry avait fait paraître dans le Jazz News. Ce dernier lançait un appel à des candidats désireux de former un groupe de rock. Sans trop y croire, Steve lui avait envoyé quelques démos.
À sa surprise, Larry l’avait convoqué la semaine suivante. Ils s’étaient vite entendus et avaient recruté un troisième guitariste pour former The Weapons, leur premier groupe. L’ensemble ne comptait pas de batteur, aucun n’ayant répondu à l’annonce, ce qu’ils avaient présagé, au vu du prix élevé de l’instrument et du peu d’amateurs qui s’y adonnaient.
Après quelques semaines, le troisième membre s’était fait congédier pour incompatibilité d’humeur et The Weapons avait été dissous.
Plutôt que de se mettre à la recherche d’un autre guitariste pour assurer la rythmique, Steve avait eu l’idée de réunir un groupe constitué d’une batterie, d’une basse et de deux guitares solos au lieu de se conformer à la structure classique dans laquelle la guitare rythmique soutenait le solo. Ces deux guitares solos se donneraient la réplique et établiraient une sorte de dialogue.
Deux ans plus tard, lorsqu’il découvrit The Last Time, le hit où Keith Richards et Brian Jones entremêlaient le son de leur instrument, Steve estima que les Rolling Stones leur avaient volé son idée. L’espace d’un instant, il envisagea de leur intenter un procès.
Ils mirent trois mois pour trouver un guitariste à la hauteur, quatre de plus pour dénicher un batteur et constituer en mai 1964 le line-up définitif de Pearl Harbor, avec Larry à la basse, Steve au chant et à la guitare, Jim à la seconde guitare et Paul à la batterie.
Steve, qui avait dix-huit ans à ce moment, avait commencé à fumer ses premiers joints.
Comme son dos le faisait de plus en plus souffrir, il avait passé un examen radiographique qui avait révélé un déplacement d’un disque intervertébral. Le médecin qui le soignait avait estimé que la position debout et le poids de la guitare aggravaient la pathologie. Il avait reçu pour consigne d’arrêter de jouer ou de ne jouer qu’en position assise.
Il s’était alors tourné vers les drogues dures pour lui permettre de supporter la douleur et de pouvoir jouer sans avoir à réprimer sa fougue.
À vingt ans, peu avant que Pearl Harbor ne décroche le contrat pour Berlin, il avait fait une fausse tentative de suicide en avalant vingt comprimés de Benzédrine.
La police mit quelques jours pour reconstituer l’emploi du temps de Steve Parker depuis son départ de Berlin, le vendredi 17 mars, jusqu’à sa mort à Hambourg, dans la nuit du 19 au 20 mars 1967.
Steve avait quitté Berlin en fin de matinée, après avoir acheté au marché noir des places pour le concert de Jimi Hendrix qui avait lieu au Star Club, le dimanche 19 mars.
Il avait pris le train et était arrivé à Hambourg en début de soirée. Il s’était installé à l’hôtel Kastanien, au cœur du quartier Saint-Pauli, dans une rue parallèle à la Reeperbahn, la célèbre artère de la ville où la fête battait son plein vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Durant la nuit du vendredi au samedi, de nombreux tenanciers de bars l’avaient vu entrer et sortir de leur établissement après avoir avalé un verre. L’un d’eux déclara que Steve donnait l’impression de chercher quelque chose. Un autre présuma qu’il voulait simplement visiter le plus d’endroits possible.
Il avait terminé sa virée nocturne à l’hôtel Luxor, une maison de passe bien connue. Friand d’Asiatiques, il s’était fait administrer une fellation par une jeune Thaïlandaise qui se souvenait de lui grâce au généreux pourboire qu’il lui avait laissé.
Il avait passé la journée du samedi dans sa chambre et avait quitté l’hôtel vers quinze heures.
En fin d’après-midi, il avait eu une brève altercation dans un bar avec un homme éméché qui l’avait bousculé. Des mots, ils en étaient venus aux insultes, des insultes, ils en étaient venus aux mains. L’empoignade s’était soldée par quelques coups de poing qui lui avaient laissé un œil au beurre noir.
Après s’être fait soigner dans une pharmacie, il s’était rendu dans un restaurant italien. Il avait ensuite consommé plusieurs bières au Top Ten Club et avait terminé la nuit dans une boîte de strip-tease.
Le portier de son hôtel l’avait vu rentrer vers cinq heures du matin.
Le dimanche, il n’était sorti de sa chambre que pour se rendre au concert de Jimi Hendrix. Après le spectacle, il était allé à l’Eros Center. La prostituée qui s’était occupée de lui déclara qu’il semblait dans un état second et qu’il n’était pas parvenu à éjaculer.
Il était rentré à l’hôtel à six heures trente.
L’un des résidents était descendu à la réception vers dix heures et avait déclaré avoir entendu une détonation aux environs de sept heures, sans pouvoir donner plus de précisions quant à sa provenance.
Les femmes d’étage qui s’étaient fait rabrouer les jours précédents vinrent frapper à la porte de Steve vers midi. Habituées à recevoir des insultes en retour, elles s’étonnèrent de son mutisme.
Devant la porte fermée, et sans réponse aux appels qu’elles lancèrent, elles s’étaient tournées vers le gérant de l’hôtel.
Celui-ci avait ouvert la porte.
Steve Parker était assis à même le sol, le dos contre le lit, la tête rejetée en arrière. Le plafond de la chambre était maculé de sang.
L’enquête de police conclut à un suicide.
Steve Parker s’était tiré une balle dans la bouche à l’aide d’un fusil de chasse de gros calibre. La police avança que le fusil avec lequel il s’était donné la mort provenait du commerce clandestin et qu’il était aisé de se procurer un tel modèle dans une ville comme Hambourg.
Les analyses sanguines établirent que le taux d’héroïne présent dans son flux sanguin était de 1,52 milligramme par litre.
Deux mois plus tard, les parents de Steve Parker, accablés par sa mort, engagèrent un détective privé. Ils l’informèrent des événements qui entouraient la mort de leur fils et lui firent part de leur scepticisme quant aux conclusions tirées par la police allemande.
Celui-ci se rendit à Hambourg et mena une enquête au terme de laquelle il mit en avant quelques éléments qui discréditaient la thèse du suicide.
Le premier indice était la quantité de drogue trouvée dans le sang. Selon le détective, une telle dose d’héroïne l’aurait rendu incapable de se suicider.
En deuxième lieu, le canon du fusil qu’il avait utilisé était à ce point long qu’il aurait dû actionner la détente à l’aide de son orteil. Or, Steve portait des chaussures lorsqu’on l’avait retrouvé. De même, la provenance de l’arme restait une énigme. Il était avéré que Steve ne l’avait pas emmenée de Berlin. Même s’il était facile d’acheter une arme à Hambourg, comme le prétendait la police, il fallait connaître les filons. Or, Steve n’était jamais allé à Hambourg auparavant.
En troisième lieu, la faible quantité d’empreintes trouvées dans la chambre, et surtout sur l’arme, rendait la mort de Steve suspecte aux yeux du détective.
Enfin, les quelques mots qu’il avait griffonnés sur le bout de papier laissé sur la table de nuit étaient équivoques et semblaient lui avoir été dictés.
Les parents de Steve firent part de ces observations à la police. Malgré cela, le rapport et les conclusions qui avaient été tirées ne furent pas modifiés, la police classa l’affaire en actant que Steve Parker était mort des suites d’un coup de feu qu’il s’était tiré dans la tête.
Le message énigmatique d’adieu de Steve Parker disait qu’il valait mieux exploser en plein vol que de s’écraser au milieu de la foule.
11
Cet inconnu
Le 25 mars 2010, six semaines après l’accident, la direction des opérations de la police judiciaire sollicita le procureur du Roi pour lancer un avis de recherche au travers des médias.
Deux photos de l’homme, l’une avec barbe, l’autre sans, furent diffusées quelques minutes avant le journal télévisé du soir sur les deux principales chaînes nationales, la Une et la VRT.
La diffusion des photos de l’homme ne provoqua que peu de réactions.
Hormis les quelques appels fantaisistes habituels, trois pistes furent retenues. Après vérifications, l’une concernait un habitant de Furnes décédé en 1999, aucun doute ne pouvant être émis quant à son décès. Les deux autres pistes menaient à des hommes en vie, rapidement identifiés.
Les photos de X Midi et la description des faits furent également affichées sur le site Internet de la police judiciaire, sous la rubrique des personnes inconnues.
Malgré cela, les chances d’aboutir à une identification s’amenuisaient de jour en jour.
Lors de la réunion de débriefing, l’inspecteur chargé de l’enquête délivra sa conclusion en haussant les épaules.
— Si vous voulez mon avis, à part lui-même, s’il se réveille un jour, personne ne sait qui est cet inconnu.
12
Le plus brillant de la planète
Après Maybellene, les disques se sont succédé, Sweet Little Sixteen, Roll over Beethoven, Johnny B. Goode, et d’autres encore. Tout mon argent de poche y passait.
La disquaire chez qui je me rendais de plus en plus fréquemment me présentait les nouveaux titres et me pressait de les acheter. Selon elle, ils auraient bientôt déserté les rayons de sa boutique. Elle pronostiquait que cet élan d’enthousiasme pour le rock’n’roll ne durerait pas et qu’un autre courant ne tarderait pas à prendre la relève.
En attendant l’avènement hypothétique de son successeur, Chuck Berry était devenu mon dieu. Ses disques tournaient en boucle dans l’appartement les jeudis après-midi et les dimanches, lorsque mon père rejoignait ses amis au café.
En plus de scander ses rythmiques implacables en remuant les fesses, je mimais son jeu de guitare, armé d’une latte en bois. Je le secondais dans ses solos épileptiques, les jambes en canard, les cheveux rabattus sur le visage.
Un jour, alors que j’étais dans la cuisine et que Chuck officiait dans le salon, l’idée m’est venue de l’accompagner en tapotant sur un verre avec un crayon. Le résultat était convaincant. J’ai pris un second crayon et me suis mis à tambouriner en cadence.
J’ai remarqué que la hauteur du son s’élevait à mesure que le niveau du liquide baissait. Pris d’une subite inspiration, j’ai pris plusieurs verres et les ai remplis de manière inégale pour varier les timbres.
Par la suite, j’ai peaufiné ma technique en ajoutant quelques ustensiles de cuisine. J’ai placé un saladier, une casserole et une poêle en demi-cercle autour des verres, le couvercle de la casserole étant posé en équilibre précaire sur un bougeoir.
Au début, c’était une belle cacophonie, mais ma dextérité s’est développée au fil des semaines, stimulée par les encouragements de ma mère et ceux, quelque peu hypocrites, de mon frère à qui mon occupation offrait l’opportunité de s’enfermer dans la chambre avec sa nouvelle petite amie.
À Noël, le cœur battant, j’ai découvert une batterie au pied du sapin. Les yeux de ma mère brillaient. Ceux de mon père aussi, mais pour des raisons différentes. Il m’a pris à part et m’a ordonné de ne jamais en jouer, en tout cas jamais en sa présence.
C’était une batterie de fabrication italienne destinée aux enfants. Le tabouret était fourni dans le lot. Elle était composée d’une grosse caisse, d’une caisse claire et d’une espèce de cymbale ride.
Ignorant du jargon adéquat, je les avais baptisées boum, tchac et dzing. Le son qu’elles produisaient était calamiteux, mais je m’en accommodais, eu égard aux ersatz dont je faisais usage jusqu’alors.
Je me suis rapidement familiarisé avec les caractéristiques propres à chacune des pièces. À force d’exercices, j’ai commencé à réaliser certaines boucles. Je m’appliquais, je ne voulais pas jouer n’importe quoi, n’importe comment, contrairement à l’un de mes camarades de classe qui possédait une batterie identique.
Ce devait être le jouet à la mode cette année-là. Il m’avait invité chez lui pour comparer nos compétences. Nous jouions à tour de rôle, en accompagnant Elvis Presley, son dieu à lui, dans Tutti Frutti, une chanson qu’il avait piquée à Little Richard.
Quand c’était à mon tour de jouer, je cherchais à me démarquer du tintamarre qu’il générait et m’efforçais de produire des effets aux bons moments.
Autour de moi, on parlait de plus en plus de cet Elvis Presley. Pour moi, ce n’était qu’un camionneur aux cheveux gras qui se dandinait de manière obscène en faisant mine de jouer de la guitare. Je n’imaginais pas un instant qu’il eut pu se présenter comme la relève de Chuck Berry, d’Eddie Cochran ou de Buddy Holly.
Je répétais dès que l’occasion se présentait, principalement le jeudi et le dimanche, mais aussi à la faveur des maux de tête que je m’inventais pour rester à la maison.
Mes progrès étaient encourageants. Ma vitesse d’exécution et ma précision en épataient plus d’un, même s’il me restait de la maîtrise à acquérir pour obtenir une plus grande régularité dans l’intensité des battements. Jour après jour, j’assimilais les notions essentielles que sont le contrôle, la coordination et l’indépendance des membres.
En plus de ma mère, mon fan base comptait mon cousin et l’une de mes tantes qui s’amusait en m’écoutant, tapait des mains et trouvait que j’avais un certain talent. Mes détracteurs les plus assidus étaient les locataires de l’étage supérieur. Plus d’une fois, ma mère a dû parlementer avec eux.
Pour ce qu’il en était de l’étage inférieur, nous habitions au-dessus d’un garage, ce qui nous assurait une certaine tranquillité. En contrepartie, l’appartement était de temps à autre envahi de gaz d’échappement. J’ai encore dans les narines l’odeur de graisse et d’huile de vidange.
Parfois, venus de mon inconscient, le crissement des pneus et les exclamations des ouvriers retentissent dans mes oreilles.
Ma discothèque s’est progressivement enrichie. Je possédais quelques hits de Fats Domino, de Jerry Lee Lewis et de Little Richard. J’étais également fasciné par un titre plus ancien de Bill Haley et ses Comets, intitulé Rock Around the Clock, une face B oubliée, revenue au premier plan après qu’elle avait été choisie pour faire partie de la bande originale d’un film qui passait sur les écrans.
J’ai quelque peu déchanté lorsque j’ai découvert Bill Haley à la télévision. Plutôt grassouillet, il affichait un sourire mécanique, présentait un regard vide et portait sur le front une mèche de cheveux gominée en forme de croissant de lune. À l’opposé du rocker terrifiant et bagarreur que j’imaginais.
Pour faire face à cette arrivée de 45 tours et garder en tête les arrangements que j’avais conçus, j’ai commencé à écrire mes partitions.
Les premières moutures étaient rudimentaires et se contentaient de reprendre sur une ligne les instruments que je devais solliciter. Boum tchac tchac, boum tchac tchac, boum tchac tchac, dzing. Les limites de ma méthode n’ont pas tardé à se manifester.
Petit à petit, j’ai appris à écouter, à compter, à identifier les mesures et les temps qui les composaient. J’ai sophistiqué mes partitions.
Elles contenaient trois lignes parallèles identifiées par les initiales B, T et D. Je les avais découpées en mesure, elles-mêmes subdivisées en sections. La majorité des rocks étaient écrits en quatre-quatre. Sur chaque temps, je cochais d’une croix les sons à combiner.
Plus tard, lorsque j’ai potassé des livres de solfège et découvert les tablatures, je me suis rendu compte à quel point mon intuition m’avait servi.
Plus mon jeu à la batterie s’affermissait, plus mes résultats scolaires déclinaient. Je passais plus de temps à imaginer mentalement de nouvelles variations qu’à réviser mes leçons. Ma passion liée à la méfiance grandissante que je nourrissais à l’égard de la nature humaine commençait à inquiéter mes professeurs.
Je m’isolais dans mon monde intérieur, je fuyais le contact avec mes condisciples, je répondais évasivement aux questions qui m’étaient posées. Pendant les récréations, les surveillants me voyaient m’éloigner, gagner les confins de la cour ou arpenter l’allée centrale d’un pas saccadé en hochant la tête.
Ils ont convoqué ma mère. Complice de mon inclination et préoccupée par les fréquentes incartades de mon frère qui vivait une adolescence difficile, elle leur a répondu qu’elle savait ce qu’il lui restait à faire.
Quand je ne jouais pas de la batterie, je m’enfermais dans la lecture.
Le Journal d’Anne Frank faisait partie du programme scolaire de mon frère. Je l’ai lu en quelques heures. J’en suis sorti incrédule. Mes réserves concernant la nature humaine se confirmaient.
Pour ce qu’il en était de mes lectures de détente, j’étais distant des inepties que lisaient mes camarades, Enid Blyton et son Club des cinq ou Bob Morane et ses improbables aventures. Je me plongeais dans des textes classiques que j’empruntais à la bibliothèque communale en prétextant qu’ils étaient destinés à ma mère. Salinger, Dostoïevski, Hugo en faisaient partie.
Je ne comprenais pas tout. Loin de là. Des tournures, des mots, des situations m’échappaient, mais je sentais intuitivement que le contact avec cette écriture m’enrichissait.
Désireux de progresser à la batterie, je me suis acheté une méthode. Il n’existait pas encore de cours spécifique pour jouer du rock, mais une méthode rigoureuse pour le jazz a fait l’affaire.
J’avais aussi commencé à freiner l’achat de disques dans le but de compléter ma batterie, en commençant par un tom, ustensile qui me manquait cruellement.
La méthode devant les yeux, j’ai commencé à exécuter quelques fills, tout simples au début. Ensuite, j’ai appris à réaliser mes premiers flas.
Pour perfectionner ma régularité, je me suis offert un métronome. J’étais un peu honteux de devoir faire appel à un tel subterfuge pour assurer le tempo. J’ai appris plus tard que nombre de pointures jouaient avec un métronome vissé dans l’oreille.
Mes camarades voulaient devenir pompier, pilote de chasse, médecin, coiffeur ou comme leur père.
Pour ma part, je rêvais de devenir batteur. Mais je ne voulais pas devenir n’importe quel batteur. Je rêvais d’être le batteur de rock le plus doué, le plus ingénieux et le plus brillant de la planète.
13
Locked-in syndrome
X Midi avait été transféré au sixième étage de l’hôpital Saint-Pierre, dans une chambre à quatre lits au service de neurologie.
Son voisin le plus proche était un septuagénaire hospitalisé à la suite d’une attaque cérébrale qui l’avait laissé hémiplégique. L’homme souffrait de troubles du langage et éprouvait de grandes difficultés à s’exprimer. Il passait ses journées à explorer le ciel ou les allers et venues dans la chambre. Il recevait peu de visites et tirait prétexte de tout pour appeler les infirmières.
En fin d’après-midi, alors que les derniers visiteurs quittaient la chambre, il actionna le système d’appel. Il renouvela l’appel quelques secondes plus tard.
Lorsque l’infirmière arriva, elle le trouva dans un état d’extrême agitation.
— Que se passe-t-il, Monsieur ?
L’homme indiqua son voisin du doigt sans pouvoir articuler le moindre mot.
L’infirmière se pencha sur lui.
— Oui, eh bien, qu’est-ce qu’il y a ?
Il ouvrit la bouche, la tint ouverte durant un instant avant de parvenir à lâcher quelques mots.
— Il a bougé.
L’infirmière jeta un regard en direction de X Midi, mais ne remarqua rien de significatif.
Le lendemain, le neurologue affecté au suivi de X Midi fut informé du fait dès son arrivée. Il se rendit auprès de son patient, l’ausculta avec soin, mais ne discerna aucun signe qui laissait augurer d’une évolution de son état.
Il interrogea ensuite le septuagénaire. Il lui fallut plus d’une demi-heure pour rassembler les bribes de réponse.
Ce dernier n’était plus aussi affirmatif concernant les mouvements qu’il avait signalés, mais il assurait avoir vu l’homme ouvrir les yeux.
Le neurologue décida de procéder à une nouvelle batterie d’examens.
Il remarqua que le score de Glasgow était passé de 4 à 5. La réponse verbale et les mouvements de X Midi restaient inexistants, mais l’ouverture des yeux — ou plutôt le battement des paupières — qui ne se manifestait jusqu’à présent qu’en réaction à la douleur, se produisait lors de l’émission de certains bruits.
Cette observation incita le médecin à compléter l’examen par le score de Liège. Celui-ci consistait à évaluer les réflexes du tronc cérébral afin d’améliorer la précision du pronostic.
Le médecin nota une diminution de la fréquence cardiaque lorsqu’il exerçait des pressions sur les yeux, ainsi qu’une contraction des pupilles lorsqu’elles étaient stimulées par un faisceau lumineux.
L’électroencéphalogramme qui n’avait présenté qu’un tracé ralenti lors des précédentes consultations montra cette fois une réactivité aux stimulations auditives. Il révéla également l’apparition d’un rythme de base postérieur dans la bande alpha.
Le neurologue compléta le panel d’examens en faisant appel à une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Cet examen avait pour but de repérer la présence d’un éventuel syndrome de désafférentation pour ne pas le confondre avec un coma prolongé ou un état végétatif.
Plusieurs médecins et infirmières se présentèrent au chevet de X Midi et lui adressèrent la parole. Ces interventions visaient à le faire cligner des yeux après l’émission de certains mots ou de certaines phrases s’il en avait saisi le sens.
L’homme réagit aux sollicitations, mais ne se conforma pas aux demandes qui l’invitaient à fermer les yeux une fois pour signifier oui, deux fois pour signifier non.
Il fut interpellé dans d’autres langues, mais les réponses qu’il fournit se limitèrent chaque fois à un clignement.
En fin de journée, l’équipe médicale avait acquis la certitude que X Midi était conscient. Il entendait ce qu’on lui disait, il comprenait le français, l’anglais et même l’allemand, mais refusait de coopérer.
Les résultats des différents examens apportèrent la conclusion que X Midi était victime d’un syndrome d’enfermement.
Dans un tel cas, le sujet était éveillé et pleinement conscient. Ses facultés intellectuelles et sa mémoire étaient intactes. Il était capable de voir et d’entendre, mais ne pouvait ni s’exprimer ni bouger en raison d’une paralysie complète. Le seul mouvement qu’il était capable d’accomplir était le clignement des paupières.
Ce tableau neurologique était mieux connu sous l’appellation de Locked-in syndrome.
14
Là-bas
Un faisceau lumineux troue la nuit, enflamme mes rétines.
Un brouhaha me parvient. Je distingue des sons, des murmures. Des mots inconnus. Tétraplégie. Dysarthrie. Pertes sensorielles. Je ne veux pas qu’ils recommencent. Les questions. Les traitements. Les drogues. L’isolement. La peur.
Des mains explorent mon corps. Un objet parcourt la plante de mes pieds. Mon gros orteil se tend instinctivement. D’autres voix. D’autres mots. Babinski bilatéral. Abdomen souple. Réflexes pupillaires. Des visages entrent dans mon champ de vision, grossissent, vacillent. Des bouches s’ouvrent, se tordent dans un ralenti effrayant. Clignez !
J’oscille entre une mort rassurante et une vie qui n’est plus la mienne.
À force de les fréquenter, j’ai appris à déjouer leurs pièges. Je connais leurs questions, leurs manipulations, leurs drogues.
Une, clignez, deux. Je tente de tourner la tête. Mes yeux parviennent à suivre le mouvement des blouses blanches. Je vous ai déjà tout dit. Vous n’avez pas voulu me croire.
Vous n’aurez de moi que mon silence et les larmes qui couleront contre ma volonté. Vous ne me renverrez pas là-bas.
15
Quatre jours et quatre nuits
La nuit, les hurlements et les râles d’agonie traversent les murs, franchissent les portes, s’infiltrent dans mes tympans. De temps à autre, le son aigu de l’alarme retentit. Des ordres fusent. Le bruit d’une cavalcade résonne dans le couloir.
Chaque nuit, la mort rôde. Elle se glisse dans ma chambre. Son ombre me frôle, sa silhouette tournoie dans la pénombre. Elle me rappelle que je suis en sursis, qu’elle m’emportera bientôt.
J’avais treize ans lorsqu’elle m’a adressé un premier signe.
Dans l’espace, la guerre froide faisait rage. L’Europe tremblait. À coups de Spoutnik et d’Explorer, Russes et Américains revendiquaient leur suprématie technologique.
À Bruxelles, après deux années de travaux titanesques qui avaient défiguré la ville, l’Exposition universelle ouvrait ses portes. Bruxelles était devenue le centre du monde. Les journaux et la radio ne parlaient que de cela. La liesse générale voilait l’imminence de la guerre.
Les golden sixties approchaient. Notre situation financière s’améliorait. Mon père avait reçu de nouvelles responsabilités qui l’éloignaient de la sphère familiale. Il s’absentait durant la semaine et ne rentrait que le vendredi soir, pour repartir le lundi à la première heure.
Nous avions quitté notre modeste appartement de l’avenue de la Couronne pour un rez-de-chaussée avec jardin à Uccle, dans une élégante avenue située à une centaine de mètres du bois de la Cambre.
J’avais entamé mes études secondaires et étais parvenu à me soustraire à l’éducation catholique. J’avais convaincu ma mère de m’inscrire à l’Athénée, institution moins stricte et à l’esprit plus ouvert. Mes prédispositions naturelles à apprendre ne s’étaient pas pour autant développées.
La batterie restait mon principal centre d’intérêt. Petit à petit, au fil des mois et de mes rentrées d’argent, j’avais réussi à assembler une batterie complète que j’avais installée dans la cave. Comme je l’avais constituée par étapes avec des pièces de seconde main, les couleurs disparates lui donnaient un aspect dépareillé ; la grosse caisse était une Olympic, la caisse claire, le tom alto et le tom médium étaient des Ludwig et le tom basse venait de chez Premier. Les cymbales et le charleston provenaient également d’horizons différents.
Si l’on voulait se profiler comme batteur averti, il fallait choisir son camp. À l’instar des guitares, Gibson ou Fender, il fallait opter pour Ludwig, Gretsch ou Premier. Le choix fait, on devait le défendre jusqu’à son dernier souffle. J’en étais loin. Musicalement, ce panachage ne me dérangeait pas, mais je n’imaginais pas de proposer mes services à un groupe avec un tel assemblage.
Le pronostic de la disquaire ne s’était pas vérifié. Le rock poursuivait sa route et livrait chaque mois son lot de nouveaux hits. Même si j’étais resté fidèle à Chuck Berry, d’autres musiciens tels que Jerry Lee Lewis ou les Everly Brothers faisaient partie de mes artistes de prédilection.
En revanche, je n’accrochais toujours pas avec Elvis Presley qui cartonnait pourtant avec Hard Headed Woman. Il chantait fort et juste, mais je n’aimais ni son jeu de scène ni ses tenues d’apprenti torero.
Nos voisins du premier étage, un couple de joyeux fêtards sans enfant, faisaient venir du vin de Bourgogne et le mettaient en bouteilles dans la cave adjacente. Certains samedis, ils invitaient quelques amis et tiraient le vin au rythme de mes battements.
En fin d’après-midi, grisé par les émanations d’alcool et les mises en bouche successives, tout le monde frappait dans les mains et riait de bon cœur. Durant des années, j’ai associé mes rimshots aux senteurs du Puligny-Montrachet.
Dès que j’étais en possession d’une somme suffisante, je me rendais chez le luthier de la place Saint-Jean pour compléter mon instrument. Pour l’essentiel, il s’agissait de petites percussions, des clochettes ou des chimes.
Pour renflouer mes caisses, j’avais déniché un job de porteur de journaux dans une librairie de la rue Vanderkindere.
J’effectuais chaque jour deux tournées, une tôt le matin, vers six heures trente, l’autre le soir, aux environs de dix-huit heures. Le jeudi et le samedi après-midi, je faisais une tournée supplémentaire pour distribuer les hebdomadaires et les magazines pour enfants.
Le libraire avait mis à ma disposition un imposant vélo noir équipé d’un panier métallique et d’une large sacoche à l’avant. D’un poids considérable, il était difficile à manier, surtout en début de tournée, lorsque la sacoche regorgeait de quotidiens.
L’accident s’est produit un samedi, par un après-midi ensoleillé du mois de mai.
Le samedi matin, l’Athénée laissait aux élèves le choix entre deux heures d’études ou une excursion à la piscine. Hormis les pleutres et les punis, la majorité était partante pour la piscine.
Nous devions nous présenter une demi-heure plus tôt, ce qui m’obligeait à m’activer pour terminer ma tournée matinale.
Deux bus nous attendaient, garés en double file dans l’avenue Houzeau, moteur ronronnant. Nous nous rendions à Saint-Gilles, aux bains de la Perche. C’était une piscine à l’allure rétro, avec trois étages de cabines individuelles qui entouraient le bassin. Dès que nous franchissions la porte d’entrée, une chaleur humide et des effluves de chlore nous assaillaient.
Dans le bassin, les nageurs débutants étaient harnachés comme des poneys de foire et maintenus à la surface de l’eau par une sorte de canne à pêche treuillée. Nous nous moquions d’eux et lancions quelques plaisanteries en passant.
Indifférents à nos sarcasmes, les maîtres-nageurs poursuivaient leur travail. J’entends encore vibrer leurs directives dans l’enceinte : « une, pliez, deux, trois ».
Nous étions nombreux et plusieurs établissements scolaires se succédaient. Nous devions partager une cabine à deux, voire à trois. Dès que nous nous étions changés, nous nous rangions en file indienne pour le passage à la douche. C’était un moment chargé de tension et d’angoisse. Le défi consistait à profiter d’un moment d’inattention du gars qui nous précédait pour lui ôter son slip de bain et provoquer l’hilarité générale.
Ce samedi-là, je partageais ma cabine avec une baraque d’une classe supérieure. Il devait avoir deux ou trois ans de plus que moi. Il s’est déshabillé en silence. Quand il était à poil, j’ai remarqué qu’il bandait.
Au lieu de passer son slip de bain, il a attendu sans un mot que je sois nu. Il a sifflé entre les dents et a déclaré que j’étais monté comme un âne. Sans crier gare, il s’est emparé de mes testicules et à commencer à les caresser.
Malgré moi, j’ai commencé à bander. Lorsque mon érection était complète, il s’est mis à genoux dans la cabine exiguë et a pris mon sexe dans sa bouche.
Les images apocalyptiques de l’enfer ont surgi dans ma tête. Les préceptes judéo-chrétiens incrustés dans les sinuosités de mon inconscient ont remonté à la surface comme un virus malfaisant. On ne balaie pas dix années d’endoctrinement en balançant sa Bible sous un lit. J’ai vu le feu, les flammes, les diables et leur fourche, le visage des pécheurs déformé par la douleur, les images qui se trouvaient dans mon livre de catéchisme et me terrorisaient.
Malgré cela, j’étais partagé entre culpabilité et ravissement.
Je ne savais s’il me fallait rejeter ce viol ou me laisser aller à l’enivrement que la caresse me procurait. J’aurais voulu me révolter, le repousser, appeler à l’aide, mais mes défenses s’affaiblissaient à mesure que montait l’euphorie que générait la fellation.
Sa bouche allait et venait le long de mon sexe. C’était chaud, humide et prodigieusement bon. L’émotion qui me submergeait avait le goût pernicieux du paradis sur terre.
Très vite, j’ai joui.
Une répugnante décharge de plaisir m’a parcouru. Il a aspiré mon sperme et l’a avalé d’un trait. C’était délicieux et ignoble.
Il s’est relevé. Son sexe palpitait, dressé contre son ventre. J’étais confus, mes jambes flageolaient. Il a déclaré que c’était à mon tour.
L’espace d’un instant, j’ai songé à contester, mais j’ai pensé que je ne pouvais faire autrement, qu’il s’agissait de la procédure normale, que c’était la règle du jeu et que je ne pouvais me dérober.
Je me suis agenouillé.
Il a pris ma tête entre ses mains. Avec dégoût, j’ai senti son gland entrer dans ma bouche. J’ai pincé les lèvres pour restreindre le contact avec sa chair. D’une poussée, il a enfoncé son sexe au fond de ma gorge. Après quelques allers-retours, il s’est mis à râler, à gémir. Une giclée de sperme a envahi ma bouche. J’avais envie de vomir. C’était épais, âcre et javellisé.
Il m’a ordonné d’avaler. Un haut-le-cœur m’a soulevé. Il m’a traité de lopette et m’a asséné un coup de poing sur le sommet du crâne avant de quitter la cabine.
J’étais dans un état second. Des éclairs se bousculaient devant mes yeux. J’étais un pédéraste, un homosexuel, un moins que rien. J’avais commis le péché de chair.
Je tentais de refouler les images et les mots que l’on m’avait inoculés durant mon enfance.
Dieu voit tout, Dieu sait tout, même les choses les plus secrètes. Le Malin avait gagné, les flammes de l’enfer m’attendaient.
Je suis sorti de la cabine. Je ne savais si je devais en parler, me plaindre, me confesser, me confier.
Je n’ai rien dit. J’ai prétexté un malaise, je ne suis pas allé nager.
Je suis rentré chez moi.
Ma mère m’a trouvé pâle, bizarre.
Je me suis rendu à la librairie.
J’ai pris le vélo.
J’ai descendu la rue Ernest Gossart à toute allure. Mes jambes moulinaient, mon cœur battait, mon cerveau bouillonnait.
Dans la rue, les gens me dévisageaient comme s’ils savaient. J’avais encore le goût du sperme dans la bouche. Je me sentais humilié, sale et meurtri. J’aurais aimé revenir en arrière, tout recommencer de zéro, continuer à vivre normalement. J’avais envie de mourir. Je n’ai pas vu s’ouvrir la portière de la voiture.
Les témoins ont prétendu que je n’avais pas freiné. Je me suis réveillé aux urgences de la clinique Sainte-Elizabeth. Le médecin m’a annoncé que j’avais une commotion cérébrale et que j’avais eu beaucoup de chance.
La réponse de Dieu ne s’était pas fait attendre. Les suppôts du Juste m’avaient précipité dans une chambre obscure soustraite au moindre rai de lumière.
J’y suis resté quatre jours et quatre nuits.
16
En début d’après-midi
Au début du mois d’avril, l’équipe du service de neurologie se réunit sous la houlette du médecin-chef pour statuer sur l’état de X Midi.
Les études récentes menées sur les cas de Locked-in syndrome permettaient de classer ceux-ci en trois catégories ; les LIS complets, les LIS incomplets et les pseudos LIS.
Dans le cas d’un LIS complet, le patient était victime d’une lésion primaire massive du tronc cérébral. Durant les premiers mois, il ne parvenait qu’à ouvrir et fermer une paupière, les deux dans certains cas.
Lorsqu’il s’agissait d’un LIS incomplet, l’étendue de la lésion autorisait une récupération partielle d’un segment du cerveau et d’une partie d’un membre.
Le pseudo LIS était déclaré lorsque l’attaque se situait dans les hémisphères ou dans le cervelet et qu’elle ne lésait que secondairement le tronc cérébral.
L’étirement de la bouche et les faibles mouvements de rotation de la tête que les médecins avaient observés récemment chez X Midi signifiaient a priori qu’il sortait de l’état de LIS complet.
Il n’était plus tributaire de l’appareillage de ventilation artificielle et respirait grâce à la trachéotomie qu’il avait subie à son arrivée. Une canule était implantée à la base de son cou, entre le deuxième et le troisième anneau trachéal.
Ces quelques indices, bien que fragiles, permirent de répertorier le cas de X Midi dans la seconde catégorie. Il pouvait espérer regagner en motricité, pour autant qu’il ait accès à une rééducation intensive et multidisciplinaire. Une longue période de réadaptation débouchait dans le meilleur des cas sur une tétraplégie incomplète accompagnée de troubles de la parole et de la déglutition.
Dans la majorité des cas, le pronostic restait cependant défavorable. Un déficit neurologique d’une telle ampleur empêchait le sujet de manger et de se mouvoir et l’exposait à une multitude de complications qui étaient souvent responsables de son décès.
Le défi consistait à trouver un établissement équipé d’un service de rééducation neurologique prêt à accueillir X Midi et à gérer un cas aussi lourd. En temps normal, une recherche de ce type était une gageure, mais elle relevait du miracle au vu du tableau clinique pessimiste et du fait que la facture relative aux soins risquait de rester impayée.
Les médecins soulignèrent les éléments importants du dossier en détaillant les traitements administrés et les observations récentes et firent appel à l’assistante sociale pour qu’elle se mette en contact avec les institutions spécialisées.
Outre l’état neurologique dans lequel se trouvait X Midi, le rapport spécifiait qu’il était sous sondes alimentaire et urinaire, qu’il était atteint d’une tétra parésie, d’une paralysie ORL, d’une rétention urinaire qui exigeait une sonde à demeure, d’une incontinence anale et d’un encombrement de la canule de trachéotomie qui réclamait une aspiration régulière.
L’assistante sociale entama les démarches pour obtenir un lit, prête à batailler ferme contre l’inertie administrative et les protestations habituelles.
Elle ignorait que le LIS était une curiosité qui désorientait et intriguait le personnel médical de la plupart des hôpitaux dans le monde.
Trois jours après l’envoi de la demande aux différents centres du pays, deux institutions se déclarèrent prêtes à accueillir X Midi.
Il s’agissait de l’hôpital Brugmann, implanté à Laeken, dans l’une des communes bruxelloises, et de la clinique Derscheid, située à la Hulpe, dans l’agglomération sud de la capitale.
Cette seconde ayant témoigné d’une plus grande motivation pour le cas, il leur fut signifié que le transfert de X Midi aurait lieu le jeudi 8 avril 2010, en début d’après-midi.
17
Un homme
Selon les médecins, ma commotion n’avait pas laissé de séquelles. Pourtant, il m’arrivait de ressentir un décalage entre la réalité et la manière dont je la percevais. J’avais de temps à autre l’impression de visionner un film mal doublé dans lequel le discours des acteurs ne correspondait pas aux mouvements de leurs lèvres.
J’aimais la solitude. J’avais peu d’amis. Quelques camarades de classe, quelques voisins, des connaissances. La batterie et mes livres comblaient mes moments d’isolement.
Peu à peu, je me suis désynchronisé du monde extérieur.
J’approchais de ma dix-septième année, mes résultats scolaires étaient catastrophiques. Mes professeurs se plaignaient de mon caractère introverti et de ma distance qu’ils interprétaient comme une marque d’asocialité et d’arrogance.
J’ai pris mon mal en patience. Une loi récente avait porté l’âge de la scolarité obligatoire de quatorze à seize ans. Après la nouvelle année, j’ai annoncé à mes parents que je renonçais à poursuivre mes études, comme la loi m’y autorisait. Je m’attendais aux pleurs de ma mère et à une pluie de coups de mon père.
Je n’ai eu à subir que les pleurs de ma mère. Mon père a levé la main. Je l’ai regardé dans les yeux, prêt à encaisser sans broncher la raclée que je méritais. Il s’est ravisé. Ma stature imposante et mon mutisme en impressionnaient plus d’un. Pour la première fois, cette autorité physique m’a permis de me soustraire à la violence de mon père.
Ma mère a filé dans la cuisine. Mon père me donnait trois mois pour trouver un emploi, faute de quoi il me flanquerait à la rue sans scrupule. Dès que j’aurais trouvé cet hypothétique emploi, il opérerait une ponction sur mes rentrées d’argent pour couvrir le loyer et la nourriture. Il en avait d’ores et déjà fixé le montant à la moitié de mon futur salaire.
Plus tard, j’ai compris qu’il s’agissait d’une tentative désespérée pour me faire changer d’avis. J’ai accepté ses conditions et me suis mis à la recherche d’un boulot.
Sans diplôme et sans compétence, je ne pouvais espérer une fonction enviable. Je me suis demandé ce que je ferais si je n’obtenais rien. À quelles ressources devrais-je faire appel si mon père me jetait à la rue ? J’étais inquiet à l’idée de ne pouvoir conserver ma batterie. Par-dessus tout, j’espérais qu’il ne m’empêcherait pas de voir ma mère.
J’ai parcouru des centaines d’annonces dans Le Soir et La Libre Belgique, j’ai écrit une multitude de lettres, je me suis présenté aux quatre coins de la capitale. J’ai essuyé affronts et mépris.
Deux semaines avant l’échéance fixée, alors que le courage m’abandonnait, j’ai décroché un contrat comme aide-magasinier chez l’importateur Peugeot, à quelques centaines de mètres de mon ancien domicile.
Le magasin central de pièces de rechange occupait près de mille mètres carrés en sous-sol. Il était enseveli sous le garage et la salle d’exposition dans laquelle se pavanaient les 403 et la plus récente 404.
Pour m’y rendre, j’avais puisé dans mes économies et m’étais acheté un Puch deux vitesses d’occasion, un cyclomoteur qui m’offrait un sentiment de liberté malgré son caractère poussif.
J’avais intégré une équipe d’une vingtaine de magasiniers, tous plus âgés que moi. Une partie était chargée de la vente au comptoir clientèle. C’étaient les mieux lotis, ils attendaient qu’un garagiste ou un carrossier se présente pour abandonner leur chaise, rechercher dans le catalogue les références des pièces demandées et aller les prélever dans les rayonnages.
Deux employés étaient affectés au comptoir atelier. Les mécanos descendaient à intervalles réguliers et alignaient les pièces sur le zinc, les mains imprégnées de cambouis. Ils profitaient de cette interruption pour fumer une cigarette ou échanger quelques plaisanteries.
L’un des mécaniciens m’amusait. C’était un Noir au sourire étincelant, bâti comme un catcheur. Il riait à longueur de journée à propos de tout et de rien. Comme il se doit, tout le monde l’appelait Blanche-Neige. On ne se prenait pas au sérieux, on pouvait plaisanter sans se faire traiter de raciste ou de fasciste. Il n’en prenait pas ombrage.
De temps à autre, le chef d’atelier débarquait pour les rappeler à l’ordre à grand renfort d’insultes et de menaces.
Pour ma part, j’étais chargé de préparer les commandes que les concessionnaires adressaient chaque matin par courrier. Certaines s’étalaient sur plusieurs pages. Je parcourais les allées en tractant un chariot et entassais les pièces pour les porter au service d’expédition.
Dans ma fonction, il n’y avait ni attente ni cigarette ni plaisanterie. Si je parvenais à terminer la préparation de mes commandes, j’étais aussitôt chargé de balayer les allées ou de mettre en rayon les nouveaux arrivages de pièces.
Lorsque l’heure de la délivrance arrivait, je remontais à la surface, en manque d’air et de lumière. Le soleil meurtrissait mes rétines, l’air frais me montait à la tête. J’enfourchais mon Puch et je rentrais chez moi exténué.
La hiérarchie était marquée. Les aides-magasiniers tels que moi portaient un cache-poussière gris, les confirmés un bleu et les cadres un blanc. Le chef magasinier était un ancien militaire de carrière reconverti dans le civil, un Français râblé aux manières brusques et à l’accent du Midi. Il disait à qui voulait l’entendre que ses fils réussissaient haut la main de brillantes études universitaires quelque part en France.
Avec mes cheveux en bataille, mon cache-poussière ouvert, ma chemise qui sortait du pantalon et mon cursus rachitique, j’étais le prototype de ce qu’il haïssait ; un gamin oisif, inculte, désinvolte et indiscipliné, issu de cette nouvelle race de jeunes qui mènerait le monde à sa perte. Il ignorait que je lisais Balzac, Hugo, Zola et que j’étais capable de réciter de tête certains passages d’Andromaque.
Toute occasion était bonne pour m’humilier. Lorsqu’un concessionnaire téléphonait parce que sa commande contenait une erreur de référence ou de quantité, il me faisait appeler au secrétariat. Quatre femmes hautaines y officiaient. Elles étaient chargées de la gestion du stock et de la comptabilité. Elles ne me saluaient jamais, nous ne faisions pas partie du même monde.
Le militaire m’interpellait avec aigreur devant elles, me lançait ses griefs, menaçait de mettre fin à mon contrat si cela se reproduisait et me renvoyait au travail.
Je subissais ses assauts avec stoïcisme. Je me contentais d’attendre la fin de sa diatribe en auscultant le bout de mes chaussures. Lorsque je refermais la porte derrière moi, il lançait une plaisanterie à sa basse-cour qui s’esclaffait aussitôt.
Au fil des semaines, j’ai compris que je ne craignais rien pour mon emploi. J’étais son souffre-douleur, il avait besoin de moi pour exister.
Comme je versais la moitié de mon salaire à mon père, je m’étais trouvé un job complémentaire pour arrondir mes fins de mois. Je travaillais de dix-neuf heures trente à vingt-trois heures dans une brasserie située sur la chaussée de Waterloo. J’étais barman, payé au noir. Je préparais les apéritifs, je décapsulais les bouteilles, je lavais les verres.
J’avais sous les yeux un aide-mémoire qui détaillait la composition des cocktails. Je m’imaginais dans L’Écume des jours, où un piano élaborait les mixtures en fonction du morceau que l’on jouait. Par curiosité, j’ai commencé à les goûter. Bien vite, je me suis mis à avaler les fonds de verre que l’on me ramenait. J’aimais l’euphorie que l’alcool me procurait, j’ai commencé à boire.
Le couple qui tenait le restaurant avait deux fils et une fille. Les fils étaient plus jeunes, la fille avait mon âge. La gamine n’avait pas froid aux yeux et se faisait un malin plaisir à tourner autour de moi. Elle profitait d’un mouvement innocent pour dévoiler ses jambes ou m’effleurer de ses seins.
Un soir, alors que je terminais mon service, elle m’a demandé de l’accompagner chez elle. Elle prétextait qu’un homme rôdait autour de sa maison depuis quelques jours. Ses frères étaient déjà au lit et ses parents ne rentraient que vers une heure du matin.
Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, elle m’a proposé d’entrer. Comme j’hésitais, elle m’a pris par la main et m’a conduit jusqu’à sa chambre. Sans crier gare, elle s’est allongée sur le lit, a ôté sa culotte et a écarté les jambes.
Je suis resté immobile durant quelques instants, paralysé, subjugué par la fente rosée qui happait mon regard. Instinctivement, je me suis agenouillé et ai enfoui mon visage entre ses jambes. Comme animée par une force propre, ma langue a parcouru son sillon avec frénésie.
Elle s’est mise à soupirer, a glissé une main entre ses jambes. Des doigts, elle a écarté ses lèvres. Elle voulait que je stimule son point sensible. Je ne savais où il se trouvait. J’ai tâtonné. Je ne voulais pas avoir l’air idiot. De la voix, elle m’a guidé. Elle agitait la tête de gauche à droite, poussait de petits cris, gémissait.
Après qu’un premier orgasme l’a secouée, elle m’a demandé de la pénétrer. Je me suis débarrassé de mes vêtements. Les yeux me sortaient de la tête. Je bandais comme un étalon. J’étais à peine en elle que je jouissais comme une fontaine.
Elle m’a attiré contre elle. Elle avait aimé, mais il fallait que je me rase et que j’achète des préservatifs, elle avait pris un risque, la méthode Ogino n’était pas fiable. Je suis rentré chez moi hébété, heureux, réconcilié avec le genre humain.
Le lendemain, j’ai été appelé au secrétariat.
Un concessionnaire se plaignait de ne pas avoir reçu une série de pièces. Le petit Français m’a enguirlandé. C’était ma seconde erreur de la semaine.
Cette fois, j’ai soutenu son regard. Quand la réprimande était terminée, j’ai déclaré que l’erreur était humaine.
Je me rends compte avec le recul que ce n’était pas une réplique foudroyante, mais en sortant du bureau, j’ai senti le souffle de la victoire me parcourir.
Quand j’ai refermé la porte, le poulailler ne s’est pas mis à jacasser.
J’étais devenu un homme.
18
Quarante-cinq minutes
Peu de gens pouvaient se targuer d’avoir vu Jim Ruskin mal luné, d’humeur maussade ou contrarié.
Avec ses longs cheveux décolorés, ses tenues de cuir bigarrées, sa collection de bagues médiévales et son sourire goguenard plaqué en permanence sur son visage poupin, Jim Ruskin était l’amuseur attitré de Pearl Harbor.
Enjoué, loquace, bon vivant, il se faisait un plaisir de prendre le contre-pied des comportements outranciers de Steve Parker et de Larry Finch. Lorsque les circonstances l’exigeaient, il parvenait à dédramatiser la situation en faisant appel à un lot de pitreries dont il avait le secret. Il se dressait sur la pointe des pieds, esquissait une série de grimaces, pétait bruyamment ou débitait des plaisanteries en adoptant d’innombrables accents étrangers.
L’orage passé, il martelait sa poitrine des deux poings et se glorifiait d’être le rayon de soleil de Pearl Harbor. Il préjugeait que sans sa présence enthousiasmante et ses bons mots, les luttes intestines et les tensions incessantes auraient eu raison de la pérennité du groupe.
En règle générale, ses facéties amusaient les membres du groupe, même si elles n’étaient pas toujours du goût de Steve, surtout quand il se pendait à son cou ou lui sautait dans les bras.
Lors de leur premier concert à Londres, Jim s’était déshabillé pendant la prestation, avait tourné le dos à la salle et avait exhibé ses fesses sur lesquelles était peint l’Union Jack. Une autre fois, dans un club de Soho, face à un public qu’il trouvait apathique, il avait décroché un extincteur et s’était mis à asperger la salle.
Jim Ruskin était le plus jeune musicien de Pearl Harbor. Le plus doué aussi. Gaucher, doté d’une oreille absolue, la guitare était pour lui une seconde nature. Il s’entraînait peu, ne répétait que s’il était contraint de le faire, mais jouait toujours juste.
Né à Epsom en juin 1947, d’un père comptable et d’une mère secrétaire, il avait passé une enfance heureuse dans un milieu aisé.
Alors qu’il avait dix ans, il avait entendu Baby, Let’s Play House, le hit d’Elvis Presley et avait été marqué par l’énergie qui s’en dégageait. Il était aussitôt rentré chez lui et s’était emparé d’une vieille guitare espagnole qui pourrissait dans le grenier. Le soir même, il jouait quelques accords qu’il avait découverts à force de tâtonnements.
Par la suite il avait suivi des cours privés auprès d’un professeur du quartier. D’après ses dires, il ne lui avait fallu que quatre semaines pour en savoir plus sur la guitare que son instructeur.
Son aisance était à ce point surprenante que ses parents lui offrirent quelques mois plus tard sa première guitare électrique, une Grazzioso d’occasion, vite remplacée par une Fender Stratocaster neuve.
Aux solos agressifs et rageurs de Steve, Jim opposait une guitare mélodique, aux montées planantes et aux riffs dynamiques, à l’instar de Jimmy Page, un gamin du quartier avec qui il avait passé des heures à décortiquer les solos des maîtres tels que Scotty Moore, James Burton ou Cliff Gallup.
Le lendemain de l’enregistrement, au contraire des autres, Jim Ruskin avait pris la décision de rester à Berlin.
Il aimait cette ville, son ambiance cosmopolite, ses larges avenues et sa vie nocturne animée. Il aimait se promener dans les allées du Jardin zoologique, s’asseoir sur un banc public, entamer la conversation avec le premier passant ou regarder les lapins gambader sur la pelouse.
Même si les jeans et les cheveux longs n’étaient pas trop bien vus par la population, les Berlinois qu’il côtoyait l’appréciaient. Il avait appris leur langue, parlait comme eux, mangeait et buvait comme eux, boycottait le S-Bahn, le réseau de train urbain dont la gestion était assurée par la RDA, et se réjouissait du fond du cœur quand des résidents de Berlin-Est déjouaient les pièges des Vopos et réussissaient à franchir le Mur.
Aux petites heures, lorsque Pearl Harbor terminait son office, il se perdait dans la nuit, allait de bar en bar et rentrait fin saoul au petit matin pour s’enfoncer dans un sommeil sans rêves.
Amateur de femmes, il avait fait la connaissance de Birgit, une Berlinoise au corps épanoui et à la sexualité débridée dont il était tombé amoureux en l’espace d’une soirée. Elle travaillait au KaDeWe, le grand magasin de la Wittenberg Platz qui s’enorgueillissait d’offrir des centaines d’articles que l’on ne trouvait nulle part ailleurs.
Jim rejoignait Birgit en fin d’après-midi, lorsqu’elle avait terminé son travail. Ils dînaient ensemble dans un restaurant du quartier puis allaient chez elle.
Là, ils fumaient quelques joints et faisaient l’amour avant qu’il n’aille retrouver les membres de Pearl Harbor pour la soirée.
Le lundi 20 mars 1967, en fin de matinée, Jim fut réveillé par quelqu’un qui tambourinait à la porte de l’appartement qu’il occupait avec les autres musiciens de Pearl Harbor. C’était un minuscule trois pièces, situé au septième étage d’un immeuble vétuste du quartier de Zehlendorf, dans le secteur américain.
Au travers de la paroi, le commerçant du rez-de-chaussée l’informa qu’un appel téléphonique urgent l’attendait.
Jim émergea de son sommeil, le crâne en feu. Encore vaseux, il ne réalisa pas que ses trois compagnons étaient partis et qu’il était seul dans la chambre.
Il répondit que quelqu’un allait descendre et se rendormit.
Lorsqu’il sortit en fin d’après-midi, le commerçant, exaspéré, l’avisa que huit appels urgents étaient arrivés pour lui et qu’il n’avait pas pour vocation de jouer au coursier.
Jim prit la liste des numéros, forma le premier et tomba sur la tante de Larry. Celle-ci lui apprit la mort de ce dernier, survenue la veille à Majorque.
Consterné par la nouvelle, il ne songea pas à former les autres numéros, persuadé qu’il s’agissait de proches de Larry désireux de lui communiquer la même information.
Hébété, incertain, il parcourut l’avenue, entra dans un bar, avala deux cafés, ressortit, erra sur le boulevard et s’engouffra dans la station de métro.
À mesure que ses idées s’éclaircissaient, il prit conscience de la portée de la nouvelle. La mort de Larry annonçait la fin de Pearl Harbor, la fin du contrat à Berlin et la fin de sa relation avec Birgit.
L’espace d’un instant, il envisagea de prendre contact avec les autres pour connaître leurs réactions et retrouver un peu d’espoir, mais il ne savait ni où ni comment les joindre. Steve errait quelque part à Hambourg et Paul était parti en Irlande.
Tel un automate, il sillonna les couloirs du métro et se dirigea vers l’un des quais, sans savoir quelle destination la ligne desservait.
En début de soirée, lorsque la police allemande interrogea le conducteur du train, celui-ci déclara que l’accident s’était produit à l’heure de pointe.
Comme tous les soirs, de nombreuses personnes stationnaient sur le quai au moment où il était entré dans la station. Il avait perçu un mouvement dans la foule et un homme s’était précipité sous la rame. Il avait aussitôt actionné les freins. Malgré la vitesse relativement réduite, il n’avait pas réussi à arrêter la voiture. Le corps de l’homme avait basculé sous le train et avait été entraîné sur plusieurs mètres. Les cris qu’il avait poussés avaient semé un vent de panique et bon nombre de personnes avaient quitté les lieux.
Un passager s’était porté à son secours, mais le bas du corps de l’homme était pris dans les roues et ses jambes étaient en partie broyées dans les engrenages métalliques. L’homme était conscient, mais la douleur l’empêchait de communiquer.
Les secours étaient arrivés quelques minutes plus tard. Devant la gravité de la situation, ils avaient fait appel à une équipe de pompiers spécialisée dans les cas d’extraction.
Une fois sur place, ceux-ci s’étaient déclarés pessimistes au vu du temps nécessaire pour leur intervention. Comme l’homme perdait beaucoup de sang, les médecins avaient tenté de l’opérer sur place, mais avaient dû renoncer.
Malgré la somme d’efforts qu’ils avaient déployés, les secouristes n’avaient pu extraire l’homme du piège d’acier.
L’agonie de Jim Ruskin avait duré quarante-cinq minutes.
19
Comme un gamin
En octobre, la crise de Cuba a éclaté. Les Russes avaient installé des rampes de missiles sur l’île de Cuba et les avaient pointées sur le territoire des États-Unis.
Heure par heure, les commentateurs de la télévision et de la radio rapportaient l’escalade de la tension avec des inflexions hystériques dans la voix.
Les activités journalières marquaient le pas. Les magasins étaient dévastés. Les gens se préparaient à la guerre et amassaient des provisions. Il n’était plus possible de trouver du sucre, du riz, de la farine ou la moindre boîte de conserve. Le sujet occultait toute autre préoccupation. Chacun y allait de ses certitudes et de ses pronostics, cataclysmiques pour la plupart. Une chose semblait acquise, nous allions mourir.
Mon père avait annulé ses pérégrinations pour attendre l’apocalypse au sein de sa famille. Ses prédictions se révélaient exactes ; la guerre était à nos portes. Il passait ses soirées effondré dans le fauteuil, à maugréer devant la télévision. Nous ne pouvions lui adresser la parole, parler ou faire le moindre bruit dans la pièce.
Lorsque les programmes étaient terminés, il allumait la radio, collait son oreille contre le récepteur et passait d’une station à l’autre jusque tard dans la nuit.
La crise a duré deux semaines. Deux semaines durant lesquelles le monde a été au bord de la guerre nucléaire.
Quand Khrouchtchev a abandonné la partie, mon père a semblé plus dépité que rassuré. Bien vite, il a auguré que ce n’était que partie remise, que les Russes ne perdraient pas la face aussi facilement et qu’ils préparaient certainement un nouveau coup tordu.
Côté rock, c’était aussi la crise. Les prévisions de la disquaire étaient en passe de se réaliser.
Mes idoles avaient mal négocié leur entrée dans les années soixante. Buddy Holly et Eddy Cochran avaient rejoint le Paradis en emmenant avec eux Ritchie Valens, ce qui était plutôt une bonne chose, La Bamba était l’une des pires choses que j’aie entendue.
Little Richard était devenu mystique, Chuck Berry purgeait une peine de prison pour avoir eu les mains baladeuses sur une mineure et Jerry Lee Lewis était en disgrâce après qu’il avait épousé une gamine de treize ans.
Même si je l’avais voulu, je n’aurais pu reporter mon affection sur Elvis Presley, lui aussi acoquiné à une toute jeune fille. Il avait arrêté de chanter à la sortie de son service militaire pour se tourner vers Hollywood et se consacrer au cinéma.
Quelques mois auparavant, un ancien plumeur de poulets nommé Chubby Checker avait lancé la mode du twist. Le phénomène n’avait pas duré bien longtemps, mais l’espace d’une saison, tout le monde avait remué son derrière sur Let’s Twist Again.
C’est dans ce climat de déprime, comme un soleil inattendu qui pointe ses rayons après la tempête, que mon frère est rentré à la maison avec un 45 tours. C’était au début du mois de novembre. Il m’a adressé un clin d’œil, m’a montré le disque et m’a dit que ce truc-là allait faire un malheur.
J’étais dubitatif. J’ai d’abord pensé qu’il se moquait de moi. Nous ne partagions pas les mêmes goûts en matière musicale. Il était plutôt orienté chanson française et écoutait des âneries comme le Mexicain basané ou les rengaines pleurnichardes de Richard Anthony.
J’ai jeté un coup d’œil à la pochette. La chanson titre s’intitulait Love Me Do. Le groupe, inconnu, s’appelait The Beatles. Sur la photo, quatre types à l’air songeur posaient tels des quadruplés, deux assis, deux debout. Ils étaient vêtus du même costume gris souris et portaient une coupe de cheveux identique ; un montage capillaire qui ressemblait au balai à franges que ma mère utilisait pour laver le carrelage de la cuisine.
J’ai mis le disque sur le plateau, j’ai posé l’aiguille et les anges sont descendus du ciel.
C’était un rock, c’est sûr, mais pas un rock comme les autres. C’était un rock mélodique, énergique, d’une simplicité qui poussait au génie. Marqué par un harmonica lancinant et une surprenante complicité vocale, le morceau était d’une fraîcheur qui me laissait muet d’admiration. On sentait que les gars s’amusaient, qu’ils aimaient ce qu’ils faisaient et prenaient du plaisir.
La face B était tout aussi convaincante. J’ai écouté le disque de nombreuses fois, en cherchant à saisir la recette de ce tour de magie.
Dans un second temps, j’ai prêté une oreille plus attentive au jeu du batteur. Il s’appelait Ringo Starr. Je trouvais son jeu sobre, sans grande originalité, mais efficace. Pas de fioritures, mais une rythmique implacable et entraînante. Plus tard, je me suis laissé dire que ce n’était pas Ringo Starr, mais Pete Best qui était à la batterie lors de l’enregistrement.
Quand j’ai eu l’occasion de rencontrer Andy White à Londres, il m’a confié que c’était lui qui avait joué dans Love Me Do. Ringo Starr venait de remplacer Pete Best, mais le manager des Beatles ne l’aimait pas. Andy était batteur de session. Pour couper court à la polémique, c’est lui qui avait joué. Il n’a jamais touché un shilling pour son travail et a dû acheter son propre exemplaire du disque.
Mais ce jour-là, je m’en fichais, j’ignorais cette anecdote. Le rock de ma jeunesse venait de prendre un fameux coup de vieux et les Beatles étaient là pour dépoussiérer ma nostalgie. La musique pop était née et je me suis offert l’une des plus belles gueules de bois de ma vie.
Mi-décembre, peu avant les congés de Noël, l’école de filles qui se trouvait près de chez moi organisait sa fête annuelle. L’objectif était de récolter de l’argent de manière détournée en proposant une série de jeux et d’attractions allant du théâtre de marionnettes à la pêche aux canards.
Le samedi soir, ils organisaient une soirée dansante. Pour les jeunes mâles du quartier, c’était une formidable opportunité pour draguer. Un groupe de musiciens animait la soirée. Ils s’étaient baptisés The Drivers et avaient pour vocation de revisiter le répertoire des Shadows.
Comme tout un chacun, j’avais acheté Apache à sa sortie. Je reconnaissais un certain talent aux Shadows, surtout au sein des guitaristes, mais je réfutais l’étiquette de premier groupe européen de rock qu’on leur avait collée. Leurs compositions étaient pour la plupart instrumentales, mécaniques, exécutées sans émotion. Je trouvais leur manière de jouer pédante et académique. Je détestais leur ridicule jeu de scène, avec la façon militaire qu’ils avaient de pivoter le tronc d’un quart de tour en levant un pied de concert. Quand ils ne jouaient pas pour leur enseigne, ils accompagnaient Cliff Richard, un chanteur bien élevé et propre sur lui, trop mou à mon gré.
Les Drivers étaient des amateurs de mon âge qui ne se prenaient pas au sérieux. L’un des guitaristes, le soliste, était doué, mais pas bien secondé. Le bassiste, un grand échalas boutonneux, ne semblait pas à son affaire et le second guitariste, qui s’était affublé d’une grosse paire de lunettes sans verre pour parfaire la ressemblance avec son idole, tournait la plupart du temps le dos au public pour cacher ses hésitations.
Le batteur quant à lui était un fils à papa équipé d’une batterie Ludwig flambant neuve, mais dont il ne savait pas se servir. Ses breaks étaient basiques, ses roulements répétitifs et il abusait de la cymbale, apanage des piètres batteurs. Après une heure de jeu, il a commencé à peiner. Il ne parvenait pas à imprimer un tempo régulier et contrariait le déroulement du récital.
Il a demandé aux autres de faire une pause pour se reposer et se masser les poignets. Un quart d’heure plus tard, il a tenté de redémarrer, mais a rapidement dû déclarer forfait.
Après quelques apartés, un organisateur est venu au micro et a demandé s’il y avait un batteur dans l’assistance. Je trouvais cela amusant. Des doigts se sont levés. Je les cherchais vainement dans la foule. Ensuite, j’ai compris que j’étais la cible des index tendus.
Je suis devenu écarlate. J’ai fait non de la tête, mais les ados en mal d’ambiance ne l’entendaient pas de cette oreille. Ils m’ont conduit manu militari vers l’estrade qui servait de scène.
Le guitariste solo s’appelait Jean-Claude. Il s’est penché à mon oreille, m’a remercié, m’a dit qu’on allait jouer mollo.
On a commencé avec Blue Star, un morceau plutôt lent. Au début, mes mains tremblaient, je parvenais à peine à tenir les bâtons. Je faisais n’importe quoi, des trucs faciles, comme le fils à papa. Je transpirais par tous les pores de la peau. Petit à petit, j’ai trouvé mes marques et un semblant d’assurance. Je suis allé jusqu’au bout du morceau et quelques applaudissements ont salué ma prestation. Jean-Claude m’a dit que je m’en étais bien sorti. Il m’a proposé d’en faire un second, un peu plus rapide.
On a fait Shaddogie, puis Nivram et d’autres encore.
Plus j’avançais, plus je m’enhardissais. Je tentais des choses et cela réussissait. Je variais mon jeu et il me semblait qu’à la fin des morceaux, la salle se réchauffait et que les applaudissements s’épaississaient.
Après une dizaine de morceaux, j’ai remarqué que Marc, le bassiste, s’était réveillé, que Michel, le second guitariste, avait un sourire resplendissant et que Jean-Claude s’amusait comme un fou. Il m’a donné une tape dans le dos et m’a dit qu’on allait s’offrir Little B.
J’ai tressailli. Little B était un morceau alibi. Cela commençait gentiment, par quelques roulements de batterie et un riff de guitare rondelet. La finalité était de préparer un long solo de batterie.
Dans le 33 tours des Shadows, le solo durait plus de cinq minutes. Je n’ai jamais su si c’était Tony Meehan ou Brian Bennett qui l’interprétait. Contrairement à beaucoup, je n’étais pas convaincu par ce solo, je trouvais le jeu trop cyclique. Mais jamais je n’avais envisagé de le dérouler moi-même, qui plus est devant mon premier public.
Dans l’euphorie, grisé par les bières que j’avais avalées entre les morceaux, j’ai marqué mon accord. J’ai ajouté que j’allais le faire à ma sauce et que j’allais sûrement faire un bide.
J’ai avalé une nouvelle bière et on a démarré.
Jean-Claude et Michel s’en donnaient à cœur joie. Marc était complètement réveillé. Quand les guitares se sont tues, j’ai attaqué mon solo sobrement, en cross sticking sur la caisse claire et le charleston.
Progressivement, j’ai commencé à me lâcher. Double stroke roll. Je perdais la notion du temps et de l’espace, j’étais ailleurs, dans un état second. Buzz roll. Je me suis mis à taper de plus en plus fort, de plus en plus vite. Flam rolls. Mon corps vibrait sous les coups que j’assénais. L’alcool me montait à la tête, j’étais transporté, hors de moi-même, en communication directe avec les dieux du rock. Je m’éclatais comme jamais je ne m’étais éclaté. J’avais douze bras. Cross stick, paradiddle five stroke roll, single stroke, rimshots, sticks on sticks, l’ensemble des techniques que j’avais apprises dans ma cave y passait.
J’ai joué pendant près d’une demi-heure. Quand je me suis arrêté, un tonnerre d’applaudissements a retenti.
J’ai relevé la tête. J’étais trempé. La salle était comble, l’audience avait triplé. Les gens sifflaient, criaient, gesticulaient. Les Drivers, eux aussi, m’applaudissaient. Même le fils à papa y allait de ses encouragements.
J’étais sur une autre planète.
Je ne sais ce qui m’a pris. Je me suis levé. J’ai fendu la foule. J’ai quitté l’école. J’ai couru jusque chez moi sans m’arrêter. Je me suis enfermé dans ma chambre et me suis jeté sur le lit.
La tête dans l’oreiller, j’ai sangloté comme un gamin.
20
Transport de légumes
L’ambulance qui assurait le transfert de X Midi sortit du Ring, le périphérique qui ceinturait Bruxelles, et emprunta l’étroit chemin qui sinuait dans la forêt, seule voie d’accès à la clinique Derscheid.
Hormis le personnel soignant et les visiteurs, peu de gens fréquentaient l’institut. La majorité des soixante mille automobilistes qui passaient chaque jour à sa hauteur ignoraient son existence. Certains randonneurs se surprenaient à découvrir une telle installation au cœur de la forêt.
Le convoyeur, un jeune débraillé qui venait de décrocher son brevet de transport médico-sanitaire, prit l’air dubitatif et se tourna vers le chauffeur.
— Tu es sûr que c’est ici ?
Le chauffeur leva les yeux au ciel.
— Oui, je suis sûr que c’est ici, je suis déjà venu plusieurs fois.
L’homme avait une cinquantaine d’années et travaillait depuis vingt ans pour la société d’ambulances. Ils faisaient équipe pour la première fois et l’impression que l’auxiliaire lui avait laissée était désastreuse. Il n’appréciait ni ses piercings ni son ton dédaigneux, mais le secteur était en crise et il était de plus en plus difficile de trouver du personnel qualifié et enthousiaste.
Ils parcoururent trois cents mètres, dépassèrent une élégante villa de style normand et accédèrent à l’entrée du domaine.
Une imposante construction de quatre étages se dressait devant eux.
— C’est plutôt sinistre comme endroit ! En plus, il n’y a pas l’air d’y avoir grand-monde.
Avec sa silhouette fantomatique, sa terrasse protégée par une longue verrière et son clocheton en surplomb, le pavillon Laennec ressemblait à un palace désaffecté.
Le chauffeur soupira.
— C’est un peu plus loin. Il n’y a plus rien ici. On parle de raser le bâtiment.
Le stagiaire ricana.
— Quel gâchis ! C’est le décor idéal pour tourner le remake de Shining.
Le chauffeur esquissa un sourire.
— Ils ont construit l’ensemble au début du vingtième siècle. À la base, c’était un sanatorium, le premier en Belgique. Après, ils en ont fait un centre de revalidation et un hôpital psychiatrique. Le pavillon Laennec était occupé jusqu’il y a quelques mois, mais ils ont transféré une partie des patients au nouveau centre qui s’est ouvert à Wavre.
— Je vois, des éclopés et des dingos, c’est pour ça qu’ils les ont planqués dans les bois.
Ils passèrent devant une sorte de chapelle et parvinrent au fond du site, devant un édifice ocre à trois étages, construit dans un style architectural proche du premier pavillon.
À l’exception de quelques voitures et d’un infirmier qui fumait une cigarette devant la porte, l’endroit semblait désert.
Le chauffeur arrêta le véhicule devant l’entrée réservée aux ambulances.
— Nous y sommes, c’est le pavillon Vésale. Du temps du sanatorium, c’était le pavillon des femmes. Il a été ouvert une dizaine d’années après le premier.
— Tu connais la blague ? En Afrique, les femmes ont toutes le sida ou la tuberculose. Moralité, vaut mieux baiser celles qui toussent.
Le chauffeur haussa le ton.
— Je ne trouve pas ça drôle. Surveille ton langage et tes manières ! Je vais au secrétariat pour les papiers, prépare la civière.
— Ok, chef !
Il sortit et claqua la portière.
Dès qu’il eut disparu, le convoyeur sortit à son tour, fit le tour du véhicule et ouvrit le hayon.
— Salut pépère, fin du voyage. Bienvenue dans ta dernière demeure.
Il considéra quelques instants le visage de l’homme puis se pencha vers lui.
— Tu n’es pas très bavard, toi. Qu’est-ce qui t’est arrivé ? Éclopé ou dingo ? Ou un peu des deux ?
Le chauffeur revint accompagné de deux brancardiers qui transportaient un lit d’hôpital. Ils firent coulisser la civière hors de l’ambulance et placèrent le corps de l’homme sur le lit.
Le chauffeur fit signe au convoyeur.
— C’est bon, on peut y aller.
Ils s’installèrent dans l’habitacle.
Le jeune se cala dans son siège et posa les pieds sur le tableau de bord.
— Je vais faire un petit somme, tu me réveilles quand on est arrivés ?
D’un mouvement brusque, le chauffeur pivota, chassa les pieds du stagiaire et pointa un index.
— Tu commences à m’énerver. Qu’est-ce que tu viens faire ici ? Tu es sûr que c’est le métier qui te convient ?
Le stagiaire lui adressa un clin d’œil.
— Je commence à me le demander. J’ai cru que j’allais passer mon temps à sauver des vies. Ma petite amie s’imagine que je suis George Clooney. En réalité, je passe mes journées à faire du transport de légumes.
21
Quarante ans de ma vie
Les couleurs étaient plus vives, le ciel plus bleu, l’air plus pur. Le monde a vieilli, mais je reconnais cet endroit. Je ne savais pas qu’il était peuplé d’éclopés et de dingos, je pensais qu’il s’agissait d’une maison de retraite ou d’une sorte d’hospice.
Elle s’appelait Sylvie ou Sylviane. Peut-être Sylvia. Notre histoire n’a pas duré bien longtemps. Quelques semaines, un ou deux mois, tout au plus. C’était peu de temps avant que je m’en aille.
J’allais la chercher avec mon Puch. Elle m’attendait sur le pas de la porte, un sourire moqueur aux lèvres. Elle montait et s’accrochait à ma taille.
Quand il faisait beau, nous venions ici. Mon cyclomoteur crachait ses poumons. Nous rencontrions des personnes âgées qui déambulaient en robe de chambre dans les allées.
Des bancs se trouvaient derrière le bâtiment, à la lisière de la forêt. Nous nous asseyions sur le dernier, Sylvia et moi. C’était calme. Personne ne venait nous déranger. Elle sortait le tube de colle et le sac en plastique.
Sylvia ressemblait à un garçon. Elle avait des cheveux blonds coupés court, de grands yeux bleus et des seins minuscules. Nous nous étions offert de redoutables cuites, mais elle voulait passer à la vitesse supérieure. Elle m’avait initié au Peracon et au Romilar, des pilules et du sirop pour la toux. Nous en avions avalé des quantités phénoménales, mais cela n’offrait pas de sensations fortes. Nous restions vaseux pendant un jour ou deux, rien de plus. À peine suffisant pour dire que nous planions.
C’était de la Humbrol 77. Je m’en souviens. Une colle pour modèles réduits. Je vois encore le tube jaune et argenté. Elle en prélevait une petite quantité qu’elle étalait à l’intérieur d’une boîte d’allumettes puis plaçait le tout au fond du sac en plastique.
Tour à tour, nous plongions la tête et inhalions les vapeurs.
Elle disait que le flash était aussi intense qu’avec du LSD, même si l’effet restait de courte durée.
Qu’est-ce qu’elle en savait ?
Le LSD, c’était autre chose. Le LSD, c’était l’entrée vers le paradis et la sortie en enfer.
Les couleurs étaient plus vives, le ciel plus bleu, l’air plus pur, la vie plus simple. Je venais ici de temps en temps.
Quand Sylvia revenait sur terre, elle plongeait ses yeux dans les miens et me demandait de la caresser. Elle était un peu folle, mais je l’aimais bien. C’était avant que les hommes ne me volent quarante ans de ma vie.
22
Aucune question
La clinique Derscheid avait été rebaptisée clinique de la Forêt de Soignes en 2009, mais la plupart des gens continuaient à utiliser son ancien nom. L’équipe nouvellement en place avait abandonné les installations du pavillon Laennec, jugées trop vétustes, pour moderniser le pavillon Vésale et y concentrer l’ensemble des activités.
La clinique était organisée en quatre unités. L’unité principale, le service de psychiatrie générale, accueillait les patients atteints de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. Les personnes âgées qui présentaient des troubles du comportement étaient regroupées dans le service de psychogériatrie. Le troisième département prenait en charge les personnes souffrant de désordres psychiques liés à une consommation chronique d’alcool ou de drogues.
La quatrième unité, appelée service de réadaptation de patients présentant des troubles cognitifs, était la plus petite des sections et comptait douze lits. C’est au sein de cette dernière que X Midi fut admis le jeudi 8 avril 2010.
Dès le lendemain, le médecin-chef tint une réunion avec l’ensemble du staff en vue d’établir le projet thérapeutique du nouvel arrivant. La première résolution qu’ils prirent fut de faire une analyse minutieuse du dossier et de procéder à un bilan global afin de diagnostiquer d’éventuels problèmes psychopathologiques.
Ensuite, ils verraient si une adaptation du traitement actuel devait être envisagée. En attendant les conclusions de cet examen, ils poursuivraient l’administration de Baclofen, un antispastique destiné à éviter que les muscles ne se rigidifient, et y adjoindraient de l’Asaflow à petites doses pour assurer la circulation sanguine. Les injections sous-cutanées de Fraxiparine, un anticoagulant, seraient maintenues.
La suite de la réunion fut consacrée à préciser le rôle de chacun. Au total, six acteurs ou groupe d’acteurs seraient affectés au cas de X Midi.
En premier lieu, ils validèrent la tâche de l’équipe médicale. Composée d’un psychiatre, d’un médecin généraliste et d’un médecin interniste, sa mission serait de gérer le schéma de réadaptation de X Midi.
L’équipe soignante, constituée des infirmiers, des aides-soignants et d’un éducateur, serait chargée de prodiguer les soins de base vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout en assurant un rôle de liaison et de transmission entre les différents intervenants du processus. L’ergothérapeute accompagnerait X Midi et lui proposerait des activités spécifiques en lien avec l’évolution de son état. La psychologue mènerait des entretiens réguliers en bonne intelligence avec l’équipe pluridisciplinaire. Considérant la pathologie de X Midi, sa mission se révélerait délicate. L’assistante sociale aurait pour mission d’entreprendre les démarches administratives nécessaires à la régularisation de la situation sociale et de poursuivre les recherches visant à déterminer l’identité du patient.
Enfin, l’équipe de kinésithérapeutes opérerait quotidiennement. Selon les besoins, ils interviendraient de une à trois heures par jour.
Afin d’éviter tout risque de maladies nosocomiales, X Midi serait placé en chambre particulière.
La réunion se termina par une relecture des décisions prises. Il n’y eut aucune question.
23
Dans ses bras
S’ils m’ont emmené dans cet endroit, c’est qu’ils ne savent ni qui je suis ni d’où je viens. Le seul indice qu’ils possèdent est l’adresse que j’ai écrite sur la paume de ma main. À part cela, je n’existe plus.
Même si je sors de cette prison, je ne pourrai me la remémorer. Le temps en a déjà effacé les données. Peut-être réapparaîtra-t-elle, comme ces images que je croyais oubliées et qui resurgissent.
J’approchais de mes dix-huit ans. J’avais arrêté mes études et je ne bénéficiais plus de sursis pour ajourner mon service militaire. Je savais que la convocation arriverait en été, autour de mon anniversaire.
Je craignais cette échéance. Je ne voulais pas apprendre à tuer ou obéir aux ordres. Je ne voulais pas arrêter de lire et de jouer de la batterie pendant quinze mois.
Je me réconfortais en me disant qu’il serait temps d’y penser quand le moment arriverait, que je trouverais une solution pour m’y soustraire. Selon les rumeurs, il existait plusieurs moyens pour se faire réformer.
Quelques semaines après la fête de l’école, Jean-Claude est venu me chercher. La neige tombait. Je lisais à la fenêtre en regardant les enfants du quartier se lancer dans une bataille de boules de neige.
Je ne l’ai pas reconnu. Des flocons s’étaient accumulés sur ses cheveux crépus. Lors de la soirée, je n’avais pas remarqué qu’il était mulâtre.
Il voulait que je fasse partie des Drivers. Il m’a assuré qu’il trouverait un arrangement avec le batteur actuel, il n’était pas à niveau et ne progressait plus. Il était surtout préoccupé par le fait que les répétitions se déroulaient dans la cave du fils à papa et qu’il faudrait trouver un autre endroit.
Entre-temps, Marc, le bassiste, avait commencé à suivre des cours dans le but d’améliorer son jeu et Michel avait quitté le groupe. Pour pallier son départ, Jean-Claude avait déniché un guitariste chanteur, Alex, un type plus âgé que nous qui avait déjà joué dans des groupes.
J’ai accepté. Jean-Claude a évincé le batteur et on s’est retrouvés dans la cave de Marc pour notre première répétition. Il habitait à trois cents mètres de chez moi. La veille, j’avais déménagé ma batterie pièce par pièce.
Le sous-sol sentait le moisi et une ampoule faiblarde fournissait le seul éclairage. La cave ne disposait que d’une prise électrique. Des monceaux de câbles dans lesquels on se prenait les pieds parsemaient le sol.
Ce jour-là, j’ai fait la connaissance d’Alex. Il est arrivé avec une heure de retard. Il n’a donné aucune explication et a commencé à accorder sa guitare sans jeter le moindre coup d’œil autour de lui.
Il prenait son temps. C’était interminable. Je l’observais du coin de l’œil. Il avait des cheveux blonds peignés en arrière et une paire de lunettes noire aux verres épais. Il semblait absent, comme ces gens qui ont connu un drame ou ont vécu une expérience hors du commun.
Quand il était enfin prêt, il nous a demandé ce que nous voulions jouer. Jean-Claude voulait en rester aux Shadows, Marc voulait faire du rock. Quant à moi, j’aurais bien aimé jouer des morceaux des Beatles. Leur second 45 tours, Please Please Me, venait de sortir et je le trouvais encore meilleur que le premier.
Alex a attendu un moment en souriant. Ces quelques secondes avaient suffi pour qu’il prenne l’ascendant du groupe.
Il a hoché la tête et a déclaré qu’il allait nous initier au blues. Les Shadows étaient morts, les Beatles pas encore vivants et il n’aimait pas ce qu’il appelait le rock à bananes. Il préférait Memphis Slim ou le blues rapide et électrique de Jimmy Reed. De même, il trouvait que les Drivers faisaient ringards et nous a rebaptisés le Nain Chiffre.
Il a pris sa guitare, s’est éclairci la voix et a entonné You’ve Got Me Dizzy.
De fait, il jouait bien et chantait juste. C’était puéril, mais nous l’avons applaudi à la fin. Après, il nous a donné des directives précises et nous a laissé le temps de nous entraîner. Le soir, nous maîtrisions quelques morceaux dont Down in Virginia et Every Day I Have the Blues.
De samedi en samedi, nous progressions. Le répertoire du Nain Chiffre s’étoffait et je commençais à aimer le blues.
Malgré nos contacts réguliers, Alex restait une énigme pour moi. Il semblait serein, à l’écoute des autres, sûr de lui et de ce qu’il avançait.
Quand nous ne parvenions pas à le suivre ou à répondre à ses demandes, il restait calme, s’arrêtait et souriait. Il réexpliquait ce qu’il voulait et nous reprenions, encouragés par ses claquements de doigts et ses mouvements de tête.
Personne ne savait ce qu’il faisait. D’après Jean-Claude, il ne travaillait pas. Il avait pas mal bourlingué et fait plusieurs boulots. Il connaissait beaucoup de monde et faisait partie d’une sorte de confrérie.
Lors d’une de nos conversations, il a appris que je lisais.
Un livre l’avait beaucoup marqué et il souhaitait me le prêter. Il m’a proposé de passer chez lui le dimanche après-midi.
C’était dans une rue parallèle à l’avenue Churchill. Il habitait au dernier étage d’un vieil immeuble sans ascenseur. Il vivait avec des amis dans un logement dont ils partageaient les frais.
Je suis arrivé en milieu d’après-midi. Il m’a accueilli avec son sourire habituel. L’appartement baignait dans la pénombre. De longs voiles rouges tamisaient la lumière du jour. Une musique bourdonnait dans le fond. Une odeur douceâtre flottait dans l’air.
Dans le séjour, deux types discutaient à voix basse, assis en tailleur. Il n’y avait presque pas de meubles. Des matelas étaient jetés à même le sol. Une fille allongée sur l’un d’eux semblait dormir.
Alex a suivi la direction de mon regard. Elle s’appelait Marianne, elle faisait un beau voyage et nous rejoindrait plus tard.
Nous sommes allés dans la cuisine. Alex m’a offert une bière et m’a remis le livre, Le Festin nu, de William Burroughs.
Il a ensuite tenu un long discours dans lequel il évoquait la politique, le non-conformisme et la révolution. Il soutenait que nous n’étions pas obligés de nous laisser assujettir par les grands de ce monde, que nous devions arrêter de nous résigner, que la guerre n’était pas une fatalité.
Il affirmait que les jeunes avaient leur mot à dire et finiraient par prendre le pouvoir pour créer un ordre nouveau dans lequel le monde vivrait en paix. Ce n’était qu’une question de temps.
Je ne saisissais pas tous les termes qu’il employait et certains concepts me semblaient confus ou idéalistes. Pour moi, il fallait être adulte pour exister. J’étais néanmoins fasciné par l’assurance et la conviction qui émanaient de ses propos.
Il parlait posément en choisissant ses mots. Il étayait ses assertions en faisant appel à des exemples issus de l’actualité. Je l’écoutais, je l’observais. Une aura l’enveloppait, j’étais hypnotisé.
Les deux autres gars nous ont rejoints. Nous avons encore bu quelques bières. Alex a continué à parler et nous l’avons écouté sans l’interrompre.
Plus tard, Marianne est venue se joindre à nous. Elle était longue, mince et très belle. Elle se déplaçait avec grâce et souplesse, ses pieds touchaient à peine le sol. En silence, elle est passée de l’un à l’autre. Elle a déposé ses mains sur nos épaules, s’est penchée et nous a embrassés sur la bouche. C’était plus qu’un baiser d’amitié.
Elle a préparé une soupe épaisse et odorante. En fin de soirée, Alex a confectionné une sorte de cigarette et me l’a tendue.
Il a souri. C’était du libanais rouge. Le joint est passé de main en main, en une sorte de rituel. J’aurais dû être surpris ou méfiant, mais j’ai perçu ce geste comme une forme de communion, un acte fraternel qui me faisait penser à l’eucharistie.
Les autres aspiraient la fumée, l’avalaient à plusieurs reprises et la tenaient longtemps dans leurs poumons. Au second passage, j’ai fait comme eux.
Petit à petit, un sentiment de béatitude m’a envahi. J’étais bien. Mes idées étaient claires. Mon cerveau, mon cœur et mon corps étaient en harmonie. Nous avons parlé, bu et fumé jusque tard dans la nuit.
Tard dans la nuit, Marianne m’a pris par la main. Nous nous sommes allongés et je me suis endormi dans ses bras.
24
Sa prime enfance
Paul McDonald ne croyait ni à la loi des séries ni aux concours de circonstances exceptionnels.
Dans la matinée du mardi 21 mars 1967, alors qu’il tentait de contacter Jim Ruskin à Berlin, il apprit de la bouche du commerçant qui officiait au rez-de-chaussée de leur logement que ses trois compagnons de chambrée avaient perdu la vie dans les quarante-huit heures qui avaient précédé, en des lieux séparés et de causes différentes.
Le boutiquier ajouta que plusieurs personnes cherchaient à le joindre depuis ces événements et qu’il devait prendre contact sans tarder avec la police de Berlin ou les autorités locales de l’endroit où il se trouvait.
Pour Paul McDonald, il ne faisait aucun doute que ces morts étaient liées et n’avaient rien de naturel. Il en déduisit qu’il devait, en toute logique, être le prochain sur la liste.
Après avoir surmonté la montée de panique, il chercha à cerner le mobile de ces trois meurtres et à évaluer les menaces potentielles.
Plusieurs pistes s’ouvraient à sa réflexion. Avec leur attitude provocatrice et leur cynisme, Larry et Steve s’étaient mis beaucoup de monde à dos à Berlin. Patrons de boîtes de nuit, dealers, souteneurs, sans compter les innombrables militaires américains qu’ils insultaient pendant leurs passages sur scène. Tous auraient pu aspirer à les voir passer de vie à trépas. Lui-même n’était pas en reste.
Surnommé le Mammouth par ses intimes — sobriquet dont il était fier —, Paul mesurait près de deux mètres et pesait plus de cent trente kilos. À l’inverse de ses deux compères, il ne réglait pas ses comptes à coups d’insultes ou de sarcasmes assassins. Quand il estimait que les limites de sa patience avaient été franchies, il se triturait le bouc, se dirigeait de sa démarche chaloupée vers son contradicteur et lui fracassait le nez d’un coup de tête ou de son redoutable direct du droit.
Né à Dublin en avril 1940, Paul McDonald était le plus âgé des membres de Pearl Harbor.
À l’âge de six ans, il avait organisé une collecte dans son quartier afin d’amasser le plus de boîtes métalliques de bonbons Mackintosh. Il les avait ensuite disposées par ordre de grandeur sur le sol de son grenier et s’était mis à les marteler à l’aide de bâtons rudimentaires en tentant de reproduire le style de ses idoles, Gene Krupa et Buddy Rich.
Sa mère lui avait offert un tambour pour ses dix ans. Durant deux semaines, il l’avait emporté partout avec lui, ne le lâchant que pour aller dormir. Il avait reçu sa première batterie à l’âge de quinze ans, le jour de son anniversaire. C’était une Premier de seconde main que son père avait achetée chez un marchand peu scrupuleux et qui avait très vite rouillé.
Après avoir quitté l’école publique, Paul avait travaillé avec son père dans le secteur de la construction. En plus de son métier de maçon, il avait appris le lancer du poids, la boxe et avait rejoint divers groupes locaux en tant que batteur.
En 1958, il avait épousé Margareth, une amie d’enfance, qui avait accouché un an plus tard d’un garçon qu’ils avaient baptisé Jason. Bien vite, leur couple avait battu de l’aile et ils avaient divorcé deux ans plus tard.
Fin 1963, alors que la Beatlemania déferlait sur l’Europe et que les groupes britanniques commençaient à faire parler d’eux, Paul avait quitté l’Irlande et s’était rendu à Londres avec l’ambition de se lancer dans une carrière de batteur professionnel.
Il avait connu quelques revers avant de trouver un emploi de videur au Ronnie Scott’s, un club de jazz de Soho, et une place de batteur à temps partiel dans un groupe de rock nommé Black Spirit.
De fil en aiguille, il avait appris que le groupe Pearl Harbor cherchait un batteur et avait rejoint le groupe en mai 1964.
Paul McDonald se couchait tard et se levait tôt. En moyenne, il ne dormait pas plus de quatre heures par nuit. Malgré ces courtes périodes de sommeil et les quantités phénoménales d’alcool qu’il ingurgitait, il semblait toujours dans une forme olympique. À ceux qui lui demandaient quel était son secret, il répondait la sobriété, ne jamais être sobre.
Un soir, avant d’entamer leur set, Larry Finch était arrivé avec un tube de somnifères pour chevaux et avait parié vingt livres avec lui qu’il ne tiendrait pas jusqu’à la fin du concert s’il prenait un demi-comprimé. Paul avait doublé la mise et avalé un comprimé entier accompagné d’un verre de cognac. Une demi-heure plus tard, il s’était effondré sur sa batterie. Une ambulance avait dû intervenir. Il avait passé les deux journées suivantes dans un fauteuil roulant, à essuyer les quolibets des trois autres.
Sa puissance à la batterie était impressionnante. Il utilisait les bâtons les plus longs et les plus lourds et les surnommait mes arbres. Il frappait si fort qu’il lui arrivait de déchirer les peaux de son instrument. En plus de sa force herculéenne, il utilisait deux grosses caisses de vingt-six pouces dans le but d’augmenter l’effet qu’il produisait. Non content de cela, il avait retiré la peau de résonance des grosses caisses pour assécher le son et pouvoir frapper plus fort.
Lorsqu’il eut retrouvé un semblant de calme, il tenta de se raisonner.
Personne ne savait qu’il était à Londres. Il avait déclaré aux autres qu’il allait voir son fils et visiter sa famille à Dublin. En réalité, il venait participer à un casting. Stuart, l’un de ses amis intimes, lui avait appris qu’un groupe prometteur nommé Fairport Convention était à la recherche d’un batteur.
Il était arrivé dans la capitale le samedi, s’était installé dans un hôtel et était parti en virée. Le casting était planifié le mercredi suivant et il comptait profiter de son retour à Londres pour s’offrir un peu de bon temps.
Il jugea peu prudent de contacter la police allemande. Deux semaines auparavant, il avait dévasté un bar à Berlin. Le patron des lieux estimait qu’il avait trop bu et qu’il importunait les clients. La mise à sac du bistro s’était accompagnée d’un passage à tabac en règle et le gérant du bar s’était retrouvé au service des urgences.
De plus, il évalua que la mise sur pied de trois assassinats dans un laps de temps aussi réduit et dans des lieux différents exigeait de la main-d’œuvre qualifiée et une organisation rodée. Il ne pouvait exclure l’éventualité que la police ou une quelconque structure allemande puisse être derrière ces actions.
Il aurait pu composer le 999 et se confier à la police londonienne, mais lors de son dernier séjour à Londres, il avait eu maille à partir avec un jeune automobiliste qui avait manqué de le renverser sur un passage pour piétons. Il avait extirpé le gamin de sa voiture et lui avait infligé une correction devant de nombreux témoins qui s’étaient gardés d’intervenir. Il avait laissé le chauffard à demi inconscient sur le trottoir et s’en était pris à son véhicule qu’il avait saccagé à coups de poing, de coude et de pied. Il s’était ensuite perdu dans la foule alors qu’une voiture de police arrivait, sirène hurlante.
Le plus sage était de disparaître en effaçant les traces derrière lui, de laisser passer quelques jours et de voir comment les choses allaient se décanter. La presse britannique se saisirait certainement de l’affaire et lancerait ses limiers sur le terrain.
Il téléphona à Stuart et lui annonça qu’il quittait Londres. Le soir même, il prit le train de nuit pour Glasgow. Le lendemain, dès l’ouverture des banques, il se rendit dans une agence de la Barclays sur Buchanan Street et retira l’intégralité de l’argent qu’il avait sur son compte. Il reprit ensuite le train pour Londres.
Pour brouiller davantage les pistes, il prit un autre hôtel. Il se rendit à Nothing Hill et s’installa au Samarkand Hotel où il se fit enregistrer sous le nom de jeune fille de sa mère.
Durant les cinq journées qui suivirent, il resta cloitré dans sa chambre au cinquième étage et n’en sortit que pour acheter des journaux, prendre ses repas dans un restaurant du quartier ou se réapprovisionner en alcool.
Le mardi 28 mars, vers six heures du matin, un livreur de viande qui remontait Lansdowne Crescent à bord de sa camionnette vit un homme chuter du cinquième étage du Samarkand Hotel et s’effondrer sur le sol.
Lorsque les services de soins arrivèrent sur les lieux, ils constatèrent le décès de l’homme.
La police découvrit rapidement l’identité de la victime et dressa un parallèle entre cet accident et la mort des trois autres membres de Pearl Harbor.
L’enquête démontra que Paul McDonald s’était enfermé dans sa chambre et avait tiré le verrou, fait qui excluait que quelqu’un ait pu s’introduire dans la pièce.
L’analyse sanguine révéla qu’en plus de deux grammes et demi d’alcool, la victime avait avalé une dizaine de comprimés de Vesparax, un puissant barbiturique. La police releva également de nombreuses vomissures sur la moquette.
Ils en déduisirent que Paul McDonald avait sombré dans un coma éthylique. Il avait vomi pendant son sommeil, ce qui l’avait réveillé. Il s’était dirigé vers la fenêtre pour prendre une bouffée d’air frais et avait perdu l’équilibre.
Malgré les protestations de la famille, ils conclurent à une mort accidentelle par défenestration.
Les funérailles de Paul McDonald eurent lieu une semaine plus tard en l’église de St Lawrence O’Toole de Dublin, le jour même où il aurait dû fêter ses vingt-sept ans.
Lors des obsèques, Jason, le fils de Paul, âgé de huit ans, scanda la marche funèbre en frappant sur le tambour que son père avait reçu durant sa prime enfance.
25
Une bouche d’égout
J’ai trouvé ma convocation pour l’armée sur la table de la salle à manger. Elle semblait se moquer de moi, pliée en quatre dans une enveloppe brune sans timbre. À force de l’attendre, j’avais fini par l’oublier.
Je sortais d’une journée d’inventaire, une épreuve particulièrement épuisante. Une fois par an, il fallait mettre en balance le stock comptable et le stock physique. L’opération s’étalait sur deux semaines et prenait place lors de la fermeture d’été, avant la rentrée de septembre.
Les magasiniers recevaient une série de fiches cartonnées. Ils devaient se rendre dans les rayons et s’assurer que la quantité indiquée sur le papier correspondait au nombre de pièces. Il fallait regarder s’il y avait eu des erreurs d’encodage, des pertes ou des vols. Pour cette raison, l’exercice se pratiquait en tandem, l’un étant censé surveiller le bon déroulement du travail de l’autre.
Le chef magasinier m’avait associé à Jacques, un dur à cuire d’une trentaine d’années, à la moustache épaisse et aux cheveux noirs brillantinés. Il était irascible et semblait prêt à se battre en permanence. Un soir, je l’avais vu régler un compte personnel à coups de poing dans le fond du magasin.
Une chose était sûre, nous ne plaisions pas au chef du magasin. Il n’aimait ni son agressivité ni mon apathie. À charge de revanche, il nous avait assignés à la petite boulonnerie, la tâche la plus ingrate.
Notre travail consistait à compter les boulons, les écrous et autres minuscules rondelles jetés en vrac dans de grands tiroirs métalliques. Dans la majeure partie des cas, la fiche faisait mention de plusieurs centaines de pièces et il nous fallait valider l’exactitude des données.
Au début, nous avons travaillé dans le plus grand silence, nos seuls échanges se bornant à comparer deux chiffres. Jacques annonçait le nombre de pièces enregistré sur la fiche et je me mettais à les compter manuellement. Dans certains cas, cela me prenait quinze à vingt minutes. L’opération terminée, je lui communiquais le résultat obtenu.
Pendant que je m’escrimais avec mes rondelles, Jacques fumait une cigarette ou lançait des remarques acerbes aux magasiniers qui passaient à sa portée. Plusieurs centaines de références nous attendaient. Au train où allaient les choses, nous étions sûrs de ne pas respecter l’échéance.
De temps à autre, une péripétie venait rompre la monotonie de la tâche. Un jour, un groupe de mécaniciens se sont emparés par surprise de Blanche-Neige et l’ont enfermé dans une grande caisse en carton qu’ils ont scellée à renfort de ruban adhésif.
Prisonnier dans sa caisse, Blanche-Neige rigolait comme une baleine. Au lieu d’essayer de se libérer, il exhalait la fumée de sa cigarette par quelques trous qu’il avait pratiqués à l’aide d’un tournevis. L’incident a rameuté l’ensemble des magasiniers et une partie des mécanos. Nous nous sommes marrés jusqu’à l’arrivée du chef d’atelier.
Des haut-parleurs diffusaient de la musique à faible volume au-dessus de nos têtes. Un matin, ils ont passé Lucille, de Little Richard. Jacques a commencé à se déhancher et a marmonné que cet idiot n’aurait jamais dû arrêter de chanter. Je lui ai relaté l’anecdote selon laquelle un incendie s’était déclaré dans l’avion qui le transportait et qu’il avait juré d’abandonner la musique du diable pour se consacrer au gospel s’il s’en sortait.
Jacques m’a regardé, médusé. Il m’a demandé comment je savais cela. Nous avons découvert notre passion commune pour le rock.
En l’espace de quelques heures, il s’est métamorphosé et l’inventaire est devenu une partie de plaisir ; nous dialoguions, discutions, fredonnions quelques mesures à l’occasion tout en poursuivant notre mission. Nous ne voyions plus le temps passer.
Comme moi, il aimait le jeu de guitare de Chuck Berry et le beat hallucinant de Jerry Lee Lewis. Je savais que ce dernier avait épousé une gamine de treize ans, mais Jacques m’a confié qu’il en était alors à son second mariage, le premier ayant été consacré alors qu’il n’avait que quatorze ans. Jerry Lee Lewis disait qu’il fallait être soit chaud, soit froid, parce que Dieu n’aimait pas les tièdes. Jacques m’a aussi raconté que Chuck Berry était le plus grand radin de tous les temps. Lorsqu’il donnait un concert à l’étranger, il tenait à l’œil le cours du dollar pour adapter le montant de la facture en cas de hausse et ne jouait que s’il avait encaissé l’argent. Il m’a aussi raconté qu’il s’était overdubbé sur l’un de ses disques pour éviter de payer un second guitariste.
Par-dessus tout, il adorait Eddy Cochran et considérait qu’il représentait le mieux ce qu’était l’essence même du rock. En quelques morceaux, il avait réussi à reproduire l’atmosphère d’une époque et à résumer le système de pensée de toute une génération. De plus, tel James Dean, il était entré dans la légende en mourant au bon moment. Jacques prétendait qu’en l’an 2000, les enfants de nos enfants écouteraient encore Summertime Blues.
Il était épaté par ce que faisaient les Beatles. Au printemps, leur premier album était sorti. Dix morceaux enregistrés en l’espace d’une demi-journée pour la somme ridicule de quatre cents livres. Dix petits chefs-d’œuvre truffés de guitares carillonnantes et de mélodies accrocheuses. Twist and Shout était ma préférée. C’était une reprise de Medley et Russel, enregistrée en fin de session par un John Lennon épuisé, en rupture de voix.
À la fin de la semaine, notre travail avait bien avancé, mais il nous restait plus de la moitié des fiches à contrôler et le boss s’impatientait. Jacques m’a alors proposé de permuter les rôles.
Nous avons changé notre méthode de travail. Je citais la référence et il se dirigeait d’un pas décidé vers le tiroir. J’annonçais à voix haute les quantités inscrites sur la fiche ; six cent treize, deux cent vingt-trois ou quatre cent cinquante-huit. Il s’emparait du tiroir, le soupesait d’une main, l’air circonspect, et annonçait que le compte était bon ou qu’il manquait trois pièces. Je notais le résultat. L’opération nous prenait quinze secondes, tout au plus. Nous étions écroulés de rire. Après m’avoir ignoré pendant près d’un an, il m’avait adopté en l’espace de trois jours.
À la fin du mois de septembre, je me suis rendu au Petit-Château pour y faire mes trois jours, conformément à la convocation.
La caserne se trouvait non loin de l’avenue de la Couronne, là où j’avais passé les premières années de ma vie. Tout le monde parlait des trois jours du Petit-Château, mais il ne s’agissait en fait que de deux jours.
Je m’étais arrêté sur le scénario de la folie. Selon les spécialistes de la débrouille que j’avais rencontrés, je devais jouer sur ma commotion cérébrale et les laisser croire que j’en avais gardé des séquelles irréversibles. En outre, ils m’avaient conseillé de tenir des propos incohérents et de grincer des dents durant l’électro-encéphalogramme. L’idéal aurait été de provoquer une bagarre ou de m’opposer aux autorités.
Ce matin-là, je me suis retrouvé au milieu de la cour, entouré d’une centaine de gars. La plupart étaient plus âgés que moi et avaient terminé leurs études. Comme moi, ils avaient emporté une valise et semblaient perdus.
Ils étaient aussi peu enthousiastes que moi à l’idée de passer quinze mois sous les drapeaux. Nombre d’entre eux s’étaient mêlés aux manifestations qui avaient accompagné le mouvement de grève de 1960. En les écoutant dialoguer entre eux, j’ai compris que l’ère de la jeunesse soumise, maintenue dans les normes strictes par l’éducation parentale et scolaire touchait à sa fin. Leurs propos me faisaient penser à Alex.
J’ai commencé par répondre à un long questionnaire. Les militaires me demandaient si j’avais une préférence pour une arme ou si je souhaitais devenir sous-officier. J’ai refusé toute idée de grade et opté pour la force aérienne dont la réputation était d’être plus ouverte que la force terrestre.
En fin de matinée, j’ai reçu une plaque d’identification métallique. Pendue à une chaînette, je devais la porter en permanence autour du cou, sous mes vêtements. Elle comportait mon numéro de matricule, mon nom, les initiales de mon prénom, ma date de naissance et l’indication Armée Belge. Un gradé est venu nous expliquer qu’en cas de découverte de notre cadavre, la moitié de la plaquette serait brisée suivant la découpe et expédiée au service ad hoc.
Nous sommes ensuite passés à la visite médicale. Nous étions tous à poil, en rang. Nous avons dû uriner dans un flacon et nous pencher en avant pour que le médecin puisse nous ausculter le trou de cul.
Lorsqu’ils ont vu dans le dossier que j’avais eu une commotion cérébrale, ils m’ont envoyé à l’électro-encéphalogramme. J’ai pris l’air absent et j’ai fait rouler mes yeux comme si j’étais à moitié fou. Dès le début de l’examen, j’ai grincé des dents comme on me l’avait conseillé. Le médecin m’a interpellé et m’a sommé d’arrêter de me moquer de lui.
L’après-midi, ils nous ont montré un film sur la guerre, l’utilisation de la morphine et les dangers de la syphilis. Ils avaient une collection de photos de bites ravagées à faire peur. Nous avons terminé la journée par des examens psychotechniques chargés de carrés, de ronds et d’engrenages. Le soir, j’ai revu Les 400 coups, de François Truffaut, le seul film qu’ils possédaient.
Quand la nuit est tombée, certains ont sorti leurs bouteilles de gnôle. Nous avons bu comme des ivrognes et entamé une gigantesque bataille d’oreillers qui s’est terminée aux petites heures du matin. Le lendemain, ils ont fait la photo du groupe en nous informant que le coût de celle-ci serait retiré de la solde que nous allions percevoir pour les deux jours. En fin de journée, j’ai fait la file pour passer dans un bureau où un médecin militaire m’a annoncé que j’étais bon pour le service. J’ai encaissé ce verdict avec un mélange d’incrédulité et de résignation. Sans savoir dans quel sens, je savais que ces quelques mots allaient changer le cours de ma vie.
J’ai pris mes affaires et je m’en suis allé.
Au coin de la rue, j’ai jeté ma plaque d’identification dans une bouche d’égout.
26
Coupables d’un quelconque délit
Le médecin-chef de la clinique Derscheid était une femme énergique d’une quarantaine d’années, à l’allure décidée et à la voix puissante.
Le mercredi 15 avril, elle se rendit au chevet de X Midi en compagnie de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Les derniers rapports qu’elle avait reçus indiquaient que l’homme était prêt à recevoir cette visite.
Elle positionna son visage dans l’axe de l’homme et chercha à capter son regard.
— Bonjour, je m’appelle Marie-Anne Perard. Je suis le médecin-chef de cette clinique.
Elle marqua une pause et guetta les yeux de l’homme.
— Je sais que vous me comprenez. Je vais vous dire ce qui vous est arrivé et vous expliquer ce que nous allons faire.
Elle s’arrêta, se tourna vers ses assistants et leur signifia d’un hochement de tête que l’homme était conscient. Elle revint vers lui, se déplaça lentement de gauche à droite.
L’homme la suivait du regard.
— Vous avez eu un accident, Monsieur. Dans notre jargon, nous appelons cela un accident vasculaire cérébral. Votre tronc cérébral a été touché.
Elle laissa l’homme enregistrer le message.
— En quelques mots, le tronc cérébral est une partie du système nerveux central. Il est situé entre le cerveau et la moelle épinière et sert de passage aux nerfs, ceux qui vont vers votre cerveau et ceux qui en partent.
Un filet de bave s’échappa de la bouche de l’homme.
— Je vais être franche avec vous. Pour l’instant, vous êtes complètement paralysé, mais il y a de l’espoir. Vous réagissez bien aux premiers traitements. Vous avez commencé à remuer les doigts d’une main, ce qui signifie que vous êtes entré en phase de récupération. Ces signes indiquent que vous vous réveillez progressivement. Votre état peut évoluer. Si cela continue, nous pouvons…
Elle s’arrêta, chercha ses mots.
— Nous pouvons prolonger votre vie. Dans certains cas, nous pouvons vous permettre de retrouver certains sens. Mais vous devez nous aider.
Elle passa une main sur le visage de l’homme.
Les yeux de X Midi s’agrandirent.
— Vous sentez ma main sur votre visage ? Si vous sentez ma main, clignez une fois des paupières.
L’homme ne réagit pas.
— Je sais que vous me comprenez. Nous pouvons communiquer avec vous et vous pouvez communiquer avec nous. Nous vous poserons des questions auxquelles il vous suffira de répondre par oui ou non. Pour dire oui, clignez une fois des paupières, pour non, clignez deux fois.
L’homme continuait à la fixer. Elle crut déchiffrer de la frayeur dans ses yeux.
— Vous devez nous faire confiance, il y a de l’espoir, mais vous devez nous aider. Vous êtes prêt à nous aider ?
Elle approcha davantage.
— Je ne sais pas ce qui vous est arrivé avant cet accident, mais vous êtes en sécurité ici. Il ne vous arrivera rien. Je viendrai vous voir régulièrement. Je ne peux pas vous obliger à communiquer avec nous, mais ça nous aiderait si vous acceptiez de le faire.
L’homme chercha à fuir son regard.
Elle s’écarta et fit signe à son équipe. Ils se mirent en file indienne et quittèrent la chambre sur la pointe des pieds, comme s’ils s’étaient rendus coupables d’un quelconque délit.
27
Contre mon cœur
Des bribes du monde d’autrefois me parviennent. Des bruits, des couleurs, quelques images indécises. En journée, ils m’infligent des dessins animés, des jeux insipides ou la retransmission de vieux matchs de football. Le niveau du volume est si bas que je ne parviens pas à saisir ce qui se passe.
Hier, un groupe de rock a surgi de l’écran. Quatre types déchaînés. Je ne sais de quel siècle ils venaient. J’ai ouvert grand les yeux. Je me suis concentré pour pouvoir les entendre. Les guitaristes grimaçaient, se tortillaient comme de beaux diables, le batteur était survolté et secouait la tête, le chanteur gesticulait et virevoltait dans un déluge de lumière.
Seuls quelques notes et un filet de voix me parvenaient, mais l’espace d’un instant, je me suis senti vivant.
Quelqu’un est entré dans la chambre et a éteint la télévision. Il fallait éviter les stimulations excessives.
Parfois, ils me frôlent, se penchent, me palpent. L’un d’eux s’acharne sur ma carcasse, mais ses mains me font du bien. Il me masse les jambes, les pieds, le dos, la nuque.
Une femme m’a demandé de tendre les lèvres, de faire comme si je voulais lui donner un baiser. Avec ses doigts, elle a ouvert ma bouche. Je devais faire glisser ma langue le long de mon palais. Elle a dit que c’était bien, que j’évoluais.
Une autre femme est venue me parler d’espoir.
De quel espoir parlait-elle ? L’espoir de quitter une prison pour en rallier une autre ? Hormis l’imagination et mes souvenirs, rien ne me permettra de me soustraire à cet enfermement.
S’ils savaient à quel point la liberté comptait pour moi. Pour elle, j’ai renoncé à ce que je chérissais le plus au monde.
L’ordre de marche est arrivé à la fin de l’automne. Deux gendarmes sont venus au petit matin me remettre le document en mains propres. Il pleuvait. Le vent soufflait. Les arbres étaient décharnés et les feuilles tourbillonnaient dans la rue.
Je devais me présenter à la caserne Dossin, à Malines, le 2 janvier 1964, avant dix heures du matin. Le document précisait que j’allais y passer trois mois avant de rejoindre une unité en tant que dactylo, à l’État-Major d’un hôpital d’évacuation mobile situé près de Cologne, en Allemagne. Un billet de train était annexé au formulaire.
Le lendemain, j’ai annoncé à mon supérieur que j’allais quitter mon emploi pour accomplir mon service militaire. Il m’a toisé de haut en bas et a décrété que cela allait me faire du bien et me mettre un peu de plomb dans la tête.
Le midi, Jacques m’a pris à part. Il voyait que j’étais soucieux, que j’avais perdu mon entrain. Pour me remonter le moral, il m’a raconté les péripéties qu’il avait vécues durant son service militaire chez les para-commandos. Il était intervenu à Léopoldville lors des émeutes qui s’étaient produites peu avant l’indépendance du Congo et avait assisté aux événements qui avaient suivi.
Il m’a promis que j’allais avoir un service moins éprouvant. Il m’a prédit un ou deux jours de cachot, quelques passages à vide, des gueules de bois mémorables et une chaude-pisse lancinante.
En décembre, j’ai passé la plupart de mes soirées chez Alex. J’étais chargé d’apporter la nourriture et la bière. En contrepartie, il me fournissait en haschisch et en marijuana.
Pendant le repas, nous écoutions Bo Diddley, B.B. King ou les Beatles dont le deuxième album était sorti quelques semaines auparavant, le jour même de l’assassinat de Kennedy à Dallas, un événement qui avait traumatisé la terre entière.
Alex n’était pas convaincu par les Beatles, pourtant, ce deuxième album contenait des titres encore plus marquants, comme I Want to Hold Your Hand ou She Loves You et sa ribambelle de Yeah.
Quand nous avions terminé de manger, nous allumions un joint sous le regard soucieux de Che Guevara et Alex se mettait à parler. Il savait que ma décision était prise, mais cherchait malgré tout à la conforter.
Il m’a raconté l’histoire de ce brave gars de dix-sept ans, fils de fermier, originaire du Middle West, apprécié de tous, qui s’était retrouvé malgré lui dans l’enfer du Vietnam.
L’un de ses camarades était tombé dans une embuscade tendue par le Viêt-Cong. Quelques jours plus tard, ils avaient retrouvé son cadavre. On lui avait coupé les couilles et on les lui avait enfoncées dans la bouche. On l’avait ensuite décapité et empalé sa tête sur un pieu de bambou.
Le lendemain, le brave gars du Midwest est entré dans un paisible village et a massacré une famille entière à coups de crosse de fusil. Il n’a épargné ni les femmes ni les enfants. Quand l’officier est arrivé pour arrêter le carnage, il s’est fait sauter la cervelle.
Selon Alex, il était possible que je réagisse comme ce jeune gars dans une situation similaire. La guerre transformait les hommes en animaux et en monstres. La CIA formait en secret des escadrons de la mort dont la mission était de terroriser les Sud-Vietnamiens en tuant les civils.
Il estimait que nous ne pouvions laisser perpétrer de tels crimes sans réagir, que nous nous rendions coupables si on laissait de telles infamies se produire sans protester. Nous devions nous révolter. Il fallait que les jeunes prennent le pouvoir, arrêtent ces tueries et encouragent les hommes à redevenir humains.
Il expliquait cela calmement, avec une étrange lueur dans les yeux, comme s’il était témoin des événements qu’il décrivait.
Le dernier jour de l’année, j’ai joué avec Alex et le Nain Chiffre pour une soirée privée du côté d’Ohain, dans une salle que des gens friqués avaient louée pour l’occasion. La soirée se voulait décadente, avec Rome pour thème.
Tout le monde était costumé, nous y compris. Des hommes paradaient et se trémoussaient dans leur toge immaculée, des femmes outrageusement maquillées riaient à gorge déployée, les seins en grande partie dévoilés.
Cette atmosphère et ces excès me paraissaient décalés et indécents. À l’autre bout de la planète, des enfants grillaient sous les bombes au Napalm, des bonzes s’aspergeaient d’essence et y mettaient le feu dans l’espoir de sensibiliser l’humanité à leur sort. Chaque minute, des innocents mouraient dans les deux camps.
Nous avons terminé notre charge vers cinq heures du matin. Les derniers invités ont quitté les lieux. La camionnette qui devait reprendre notre matériel ne venait que le surlendemain.
J’avais besoin de rester seul.
Alex et les autres ont quitté les lieux.
J’ai continué à jouer. J’ai martelé ma batterie jusqu’à l’épuisement. Vers midi, je suis rentré chez moi, mais je n’ai pas dormi de la journée. Tard le soir, j’ai préparé ma valise. En plus de quelques vêtements et de mes affaires de toilette, j’ai emporté une dizaine de livres qui m’étaient chers.
Quand tout était prêt, je me suis assis dans la cuisine et j’ai attendu que la nuit s’achève.
Nous avions conservé le mobilier qui se trouvait dans notre appartement de l’avenue de la Couronne. Sur la table, je discernais les taches de couleur et les entailles de mon enfance.
Ma mère m’a trouvé à moitié endormi vers six heures du matin. Je lui ai dit qu’il était l’heure, que je devais y aller. Je me suis levé et je l’ai prise dans mes bras. Je perçois encore l’empreinte de son corps contre le mien. Je ressens sa chaleur, je respire son odeur.
Elle a senti que je n’allais pas bien. Elle ne comprenait pas ce qui me tourmentait. Elle m’a dit de ne pas m’en faire, que cela se passerait bien, que tout se passait toujours bien.
Je l’ai serrée contre moi sans pouvoir la lâcher. J’avais des larmes dans les yeux, elle a passé une main sur mon visage.
Mon père ne nous a pas rejoints. Je le voyais qui observait la scène dans la pénombre du salon. Ma mère m’a dit qu’il me souhaitait bonne chance et qu’il se réjouissait de me revoir dans mon bel uniforme, lors de ma première permission, les cheveux courts et l’allure fière.
J’ai pris ma valise et j’ai quitté la maison. J’ai trouvé la force de ne pas me retourner, le visage de ma mère à la fenêtre m’aurait fait changer d’avis. Je n’imaginais pas que c’était la dernière fois de ma vie que je l’avais serrée contre mon cœur.
28
À destination de Berlin
Quelques jours après qu’ils eurent pris connaissance du rapport du détective qu’ils avaient engagé et qui contestait la thèse du suicide de leur fils, les parents de Steve Parker contactèrent les familles des autres membres de Pearl Harbor et leur proposèrent une rencontre.
La tante de Larry Finch déclina l’invitation. Sa sœur, la mère de Larry, s’était suicidée lorsqu’elle avait appris la mort de son fils. Elle ne parvenait pas à surmonter la douleur que lui infligeait la disparition de ses deux plus proches parents. Elle ne voulait plus évoquer cette tragédie et souhaitait oublier les circonstances qui entouraient ce drame. Elle ordonna qu’on la laisse tranquille et raccrocha sans autre forme de procès.
Les parents de Jim Ruskin acceptèrent la demande avec un soulagement mêlé de rancœur. Les conclusions de la police qui mettaient la mort des quatre musiciens sur le compte d’un exceptionnel concours de circonstances étaient inacceptables. Les explications que le père de Jim avait reçues de la part du chef de la police de Berlin-Ouest lorsqu’il était allé reconnaître la dépouille de son fils ne l’avaient pas convaincu.
Depuis les événements de mars, il avait parcouru plusieurs ouvrages traitant de la loi des séries, des probabilités, des coïncidences signifiantes et de la synchronicité.
Il en était arrivé à la conviction que ces morts étaient liées et se révélaient suspectes. Il avait émis de nombreuses hypothèses, mais n’était pas parvenu à cerner un mobile cohérent pour justifier de tels actes. Cet appel des parents de Steve Parker conforta son opinion ; d’autres personnes doutaient des conclusions tirées par la police. Il n’était désormais plus seul, face au mépris et à l’infaillibilité administrative.
Dirk et Caroline McDonald, les parents de Paul, le batteur, acceptèrent également la proposition et suggérèrent à l’ex-épouse de leur fils de les accompagner. Jason, leur petit-fils, n’acceptait pas la thèse de l’accident et était persuadé que son père avait été assassiné.
Eux-mêmes avaient été troublés par le relevé de l’emploi du temps de leur fils durant les jours qui avaient précédé sa mort. Il avait agi comme un homme traqué. Selon son père, Paul n’avait peur de rien, il n’hésitait pas à affronter l’adversité et à se battre s’il le fallait. Il n’était pas homme à se cloîtrer sans raison dans une chambre d’hôtel.
La rencontre eut lieu à Londres, au domicile des Parker, le samedi 15 juillet 1967.
Les invités ne se connaissaient pas, ils n’avaient pas eu l’occasion de se rencontrer auparavant, aucun n’ayant participé aux obsèques d’un autre membre de Pearl Harbor.
Dès les premières minutes, ils se sentirent proches les uns des autres, unis par la douleur d’avoir perdu un enfant.
Lorsque l’ensemble des invités fut présent, Gary Parker, le père de Steve, fit une courte allocution chargée d’émotion dans laquelle il dépeignit la douleur d’un père amené à survivre à son fils. À l’issue de son intervention, sa femme servit quelques rafraîchissements. Ils passèrent la première heure à évoquer la mémoire des disparus. Certains avaient emmené des photos qui passèrent de main en main.
Les Parker leur présentèrent ensuite George West, le détective qu’ils avaient engagé pour mener une enquête sur le décès de Steve.
Celui-ci leur exposa les raisons qui le poussaient à remettre en question les conclusions de la police. Il leur fit part de ses observations et des déductions qu’il en avait tirées. Il évoqua entre autres l’infime probabilité que quatre hommes demeurant dans le même logement et pratiquant une occupation identique disparaissent dans un laps de temps aussi court sans qu’il n’y ait quelque chose de nébuleux derrière leur mort.
Il entama ensuite un tour de table et invita chacun à s’exprimer. Les familles exposèrent les éléments qu’ils détenaient.
West écouta attentivement, prit des notes, posa des questions. Lorsqu’il fut en possession de l’ensemble des informations, il fit part de quelques commentaires.
La coordination entre les polices allemande, espagnole et anglaise s’était avérée inefficace. Aucune organisation n’avait pris cette affaire au sérieux, chacune avait analysé le cas séparément. Si les quatre disparitions avaient été traitées par le même corps de police, il ne faisait aucun doute qu’une enquête approfondie aurait été lancée.
Il reprit ses notes et épingla quelques éléments qu’il avait interceptés lors du tour de table. Il mit en exergue le fait que le portier de nuit de l’hôtel de Majorque avait enregistré les allées et venues de Larry, mais ne l’avait pas vu descendre entre cinq heures et six heures pour se rendre à la piscine alors qu’il était encore en service à cette heure-là.
Pourquoi ne l’avait-il pas vu ? Par quel chemin Larry était-il allé à la piscine ? Pourquoi n’avait-il pas emprunté l’itinéraire le plus court ?
En ce qui concernait Jim Ruskin et son présumé état dépressif évoqué par la police de Berlin, il trouvait surprenant qu’un homme réputé d’une humeur inaltérable, bon vivant, résolument optimiste, et amoureux qui plus est, mette fin à ses jours sur un coup de tête. Ruskin venait d’apprendre le décès de Larry Finch, le leader du groupe, et cette nouvelle était sans nul doute susceptible de l’affecter, mais pas au point de se donner la mort, d’autant qu’il ignorait à ce moment-là la mort de Steve Parker.
Ses talents de musicien et les contacts qu’il avait à Berlin l’autorisaient à envisager une continuation de ses activités musicales. L’amitié relative qui le liait à Larry ne pouvait constituer un motif suffisant pour en arriver là.
Enfin, le témoignage du conducteur du train n’attestait pas de manière explicite que Jim s’était volontairement jeté sous la rame.
Quant à Paul McDonald, le fait qu’il ait fermé sa porte à clé avait amené la police à la conclusion hâtive qu’il était seul dans sa chambre et que personne n’aurait pu y entrer. Qui pouvait certifier que personne n’y était entré avec son assentiment ?
Il connaissait le Samarkand Hotel, la chambre de Paul était située au cinquième et dernier étage. Il était enfantin pour quiconque de s’enfuir par les toits.
Pour parachever son exposé, il leur posa une question décisive.
D’où venait l’argent ?
Les quatre hommes se plaignaient de leur maigre salaire, de leur manque de moyens et de leur difficulté à joindre les deux bouts. Lors de leur mort, Larry Finch se trouvait dans un hôtel quatre étoiles à Majorque, Steve Parker s’était offert plusieurs relations sexuelles et avait assisté à un concert de Jimi Hendrix pour lequel il avait acheté une place hors de prix et Paul McDonald s’était payé un billet d’avion pour Londres et s’était installé dans un hôtel de luxe.
L’exposé de George West terminé, les parents de Steve Parker en vinrent à leur proposition. Ils suggérèrent aux personnes présentes de renouveler le mandat du détective et de financer ses recherches en se partageant les frais.
Contrairement à ce qu’ils escomptaient, ils essuyèrent un refus.
La mère de Jim Ruskin connaissait les doutes qu’avait son mari. Elle préférait néanmoins accepter la thèse du suicide plutôt que d’apprendre que son fils s’était rendu coupable de quelque acte inavouable. Elle était encore en plein processus de deuil et ne voulait pas s’infliger de nouveaux tourments. Elle savait que Jim buvait et consommait des drogues, et elle pensait que cela pouvait avoir un rapport avec sa disparition. Elle voulait garder de lui le souvenir d’un garçon tendre, farceur et enjoué.
Les parents de Paul McDonald évoquèrent des problèmes financiers et déclarèrent ne pas être en mesure de financer une enquête dont l’issue était malgré tout incertaine. Margareth, l’ex-épouse de Paul, regretta amèrement la situation, mais était elle-même au chômage et ne pouvait envisager la moindre dépense.
Les Parker n’avaient pas de quoi assumer seuls les frais du détective. Ce dernier n’envisagea pas de négocier la hauteur de ses émoluments, de nombreux clients le sollicitaient et étaient prêts à payer les prix qu’il demandait.
Lorsqu’il eut quitté les lieux, le père de Jim Ruskin émit l’idée de soumettre l’affaire à la presse. Jusqu’à présent, aucun journaliste ne s’était intéressé à cette série de disparitions.
Sa proposition fut retenue.
Ils rédigèrent une lettre relatant les faits et la signèrent conjointement.
La lettre fut envoyée aux principaux quotidiens londoniens, mais ne reçut aucune réponse favorable. Ils se replièrent sur de plus petits titres et sur la presse régionale, mais aucun retour ne leur parvint.
Alors qu’ils s’apprêtaient à abandonner la partie, un journaliste du Belfast Telegraph à qui Dirk McDonald avait fait parvenir le courrier en désespoir de cause prit contact avec eux et leur proposa une rencontre.
Les Ruskin et les Parker se rendirent au domicile des McDonald, à Dublin le 8 septembre 1967, où ils rencontrèrent en fin d’après-midi Michael Stern, le journaliste en question.
Dans un premier temps, ils restèrent quelque peu perplexes suite à la première impression que leur laissa le journaliste. Ce dernier était à l’opposé de George West et de son assurance sereine. Il était chauve et de petite taille. Il avait le regard fuyant, plissait les yeux comme s’il était ébloui par le soleil et remontait sans cesse une grosse paire de lunettes qui glissait le long de son nez.
Ils furent néanmoins réconfortés par sa capacité d’écoute et l’empathie dont il fit preuve.
À l’issue de l’entrevue, le journaliste marqua son intérêt pour l’affaire et leur promit de solliciter le feu vert de son rédacteur en chef pour entamer des investigations sur ces morts suspectes.
Quelques jours plus tard, Stern leur annonça avoir reçu l’accord attendu et demanda de lui faire parvenir tous les éléments en leur possession. Il souhaitait reconstituer le parcours des membres de Pearl Harbor depuis la création du groupe jusque mars 1967. Il se disait optimiste et s’engageait à mettre tout en œuvre pour faire la lumière sur cette ténébreuse affaire.
Le lundi 18 septembre 1967, en début de matinée, Michael Stern prit l’avion à destination de Berlin.
29
Pour mon apparence
J’ai pris le tram en direction du Midi. À cette époque, la gare avait une dimension humaine. Il n’y avait ni ces boutiques criardes ni ces hordes de jeunes menaçants que j’ai vus à mon retour.
Dans le grand hall, j’avais l’impression que tout le monde m’observait comme s’il était écrit sur mon visage que j’étais un déserteur.
J’ai marché jusqu’au quai, tête baissée. Ma main étreignait le billet que j’avais acheté. Je suis monté dans le train et j’ai parcouru les couloirs à la recherche d’une place sans vis-à-vis.
Je consultais sans cesse ma montre. Plus les minutes passaient, plus le sentiment de culpabilité s’accentuait. J’imaginais la consternation des autorités militaires, l’appel à mes parents, le lancement de l’avis de recherche. Le malaise s’est accru lorsque le contrôleur et les douaniers sont entrés dans le compartiment. Ils m’ont dévisagé, ont étudié mes papiers et sont ressortis.
Le temps de l’innocence était révolu. J’étais en situation illégale, je devais être en permanence sur mes gardes.
Je suis arrivé à destination vers midi. Alex m’avait dit que Paris était plus animée que Bruxelles, mais je n’imaginais pas qu’une telle différence puisse exister entre deux métropoles distantes de moins de trois cents kilomètres.
Les rues grouillaient de monde. Les artères étaient encombrées de véhicules qui avançaient au pas, rugissaient et crachaient une épaisse fumée. Les gens marchaient, couraient en tous sens, gesticulaient, tonnaient. La tête me tournait. Je découvrais des bruits, des couleurs et des odeurs inconnues.
Autour de moi, Paris bouillonnait et j’étais seul au monde.
Je me suis engouffré dans le métro. J’étais désorienté. Je me suis trompé de direction et me suis perdu dans le labyrinthe avant de monter dans la bonne rame pour atteindre la station Saint-Michel. J’ai débarqué en milieu d’après-midi chez Popov, le bar situé rue de la Huchette. J’avais l’estomac vide. J’étais prêt à remettre en question la décision que j’avais prise.
Par chance, le couple de vieux Russes dont Alex m’avait parlé était là. Quand je leur ai dit que je venais de sa part, ils m’ont ouvert les bras.
Ils m’ont guidé vers l’arrière-salle. Plusieurs sacs de couchage jonchaient le sol. Un jeune Américain dégingandé était allongé sur l’un d’eux. Il lisait On The Road de Jack Kerouac en fumant une cigarette. Le bouquin était en lambeaux. Il m’a salué comme si mon arrivée était la chose la plus naturelle du monde. Avec un fort accent, il m’a demandé d’où je venais et si j’aimais Bob Dylan. Je ne savais pas de qui il parlait, j’ai répondu que je n’avais encore rien lu de lui. Il a déclaré que j’avais le sens de l’humour et que nous allions bien nous entendre.
Tout le monde l’appelait Candy parce qu’il avait un visage rond comme un bonbon tendre et qu’il souriait tout le temps. Nous avons mangé et sympathisé. Après le repas, il s’est levé d’un bond et m’a annoncé que nous allions retrouver les autres.
Nous sommes allés à pied au square du Vert-Galant, à la pointe de l’île de la Cité. Les autres, c’était une bande de types dans son genre, des jeunes gars qui avaient décidé de rompre avec les normes et de faire la route. Ils venaient d’un peu partout. En plus des Français, il y avait des Anglais et des Américains. Quelques Hollandais aussi. Ils se massaient sur les bancs publics. On aurait dit qu’ils occupaient les lieux et en avaient chassé les promeneurs. Certains étaient allongés sous le saule pleureur, enveloppés dans de larges couvertures. D’autres étaient assis sur le quai et s’adossaient au muret. Les joints passaient d’une main à l’autre. La plupart portaient un surnom. L’un d’eux, Finger, un Américain, s’était fait amputer de la dernière phalange de l’index pour éviter de devoir servir au Vietnam.
Bon nombre me faisaient penser à Alex par leurs discours et leur style. Ils étaient plutôt négligés, semblaient indolents et portaient des cheveux longs. Parmi eux, l’un ou l’autre frisait la trentaine. Un vieux Nantais nommé Cheyenne avait passé les soixante ans. Il avait le visage buriné et les yeux bleu délavé. Il portait une barbe et de longs cheveux blancs séparés par une raie au milieu. Son surnom venait du bandeau coloré qu’il portait autour du front.
Il n’était pas le meneur du groupe, mais une sorte de sage que tout le monde respectait. Dès qu’il en avait l’occasion, il sortait de sa poche un livre de Rimbaud et se plongeait dans la lecture, ne relevant la tête que pour réclamer le silence et nous lire un passage.
J’ai passé mes premières semaines avec eux. Je les suivais du matin au soir et jusque tard dans la nuit. En plus du square du Vert-Galant, leurs quartiers de prédilection étaient Saint-Germain-des-Prés et les quais de la Seine.
Le soir, ils se donnaient rendez-vous place de la Contrescarpe. Ils s’asseyaient contre le parapet ou à même le trottoir. S’il faisait trop froid, ils s’attablaient dans les bistrots. Ils parlaient de politique, de littérature, de musique. Ils débattaient de la nature humaine et de Dieu. Le spectre de la guerre était omniprésent. Les Américains parlaient de celle du Vietnam, que leurs jeunes vivaient de plein fouet. Les Français parlaient des guerres passées, l’Indochine et l’Algérie. Elles semblaient avoir laissé des plaies ouvertes dans leur mémoire. Tous parlaient de la future guerre, celle qui allait anéantir la Terre.
Ils parlaient à longueur de journée avec grandiloquence et gravité. Ils s’emportaient, haussaient le ton, se révoltaient, frappaient de la main sur la table, lançaient des menaces à la volée même s’il n’y avait personne pour les contredire.
De temps à autre, ils entamaient une discussion avec quelqu’un de l’autre camp, un de ceux qu’ils appelaient les bourgeois réactionnaires. Les propos s’envenimaient rapidement. Plus d’une fois, je les ai vus prêts à en venir aux mains.
Je ne me mêlais pas de leur conversation. J’écoutais. Je tenais à me forger ma propre opinion avant de défendre la leur. Souvent, ils cherchaient mon approbation quant aux thèses qu’ils avançaient. Même si j’avais un avis sur la question, je ne parvenais pas à l’exprimer. Ils ont fini par accepter mon statut d’observateur taciturne.
Leurs raisonnements étaient souvent confus, parfois contradictoires. Ils se déclaraient contre la guerre, portaient un badge qui prônait le désarmement et se disaient antimilitaristes. Pourtant, nombre d’entre eux arboraient des vêtements issus des stocks américains ; chemises kaki, parkas, casquettes militaires et bottillons.
Ils ont tenté de m’expliquer la symbolique qui se cachait derrière ce choix. Je n’ai jamais compris cet illogisme. Ils se déclaraient pacifistes, mais se promenaient déguisés en soldats.
De même, j’avais un certain respect pour feu John Fitzgerald Kennedy et je ne l’imaginais pas en va-t-en-guerre sanguinaire manipulé par un McNamara diabolique comme ils le soutenaient.
Je ne souhaitais pas entamer de polémique et me faire rejeter du groupe, je n’ai rien dit.
Côté finances, je m’en sortais. J’avais emporté l’ensemble de mes économies. J’avais suivi la recommandation d’Alex et converti mes francs belges en dollars. Une liasse de billets verts sommeillait au fond de ma valise. Je changeais de temps à autre une coupure pour subvenir à mes besoins. Je pensais que ce pactole me permettrait de tenir jusqu’à ce que je trouve un emploi stable.
Le cours des événements en a décidé autrement, l’argent s’est rapidement volatilisé. Le groupe disait que l’argent était le moteur de l’économie et l’économie le moteur de la guerre. Ils déclaraient avec fierté ne pas en posséder et ne s’en porter que mieux.
Sous leur impulsion, j’ai dilapidé mes avoirs pour atteindre leur niveau d’affranchissement. J’ai financé le train de vie de la bande. Je payais les repas, les boissons et l’herbe. Quand tout l’argent était parti, j’ai suivi leur méthode, j’ai fait la manche. Cette activité était plutôt mal vue, il fallait se méfier des flics.
Candy jouait de la guitare, le matin dans les couloirs du métro, l’après-midi et le soir à la terrasse des cafés. Un jour, j’ai proposé de me joindre à lui. Il a hésité quelques instants avant d’accepter. J’ai emporté mes baguettes. Je l’ai d’abord observé pendant un jour ou deux. Je veillais sur les pièces de monnaie que les gens jetaient dans son étui à guitare.
Un matin, je me suis senti en confiance. J’ai attendu qu’il entame un blues et je l’ai accompagné en martelant le sol. Il était épaté du résultat. Il ne savait pas que j’étais batteur. Ma démarche lui a plu, au public aussi.
Les jours suivants, je me suis lâché. À la terrasse des bistrots, je tambourinais sur le sol, les murs, les tuyaux, les bouteilles, les tables, le plateau des serveurs, sur tout ce qui me tombait sous la main. Je virevoltais autour de Candy comme un satellite en orbite.
Sur le trottoir, les gens s’arrêtaient, tapaient du pied, frappaient dans leurs mains, chantaient avec nous. Certains après-midi, il nous arrivait de rassembler plus de cinquante personnes autour de nous. C’était une aubaine, mais l’attroupement attirait la police et plus d’une fois, nous avons dû prendre nos jambes à notre cou.
Candy connaissait ma situation et couvrait ma fuite. Il ralentissait et se laissait appréhender à ma place. Son passeport américain était un véritable sésame. Il ne restait jamais plus d’une heure dans un commissariat.
Lors d’une de nos tribulations, nous avons croisé un jeune type diaphane qui se livrait au même exercice que nous sur les marches du Sacré-Cœur. C’était un chanteur guitariste sympa, ouvert et surdoué. Plus tard, je l’ai revu à la télévision, il s’était coupé les cheveux, les avait teints et était devenu Michel Polnareff.
À partir de ce moment, j’ai joué tous les jours avec Candy. En fin de soirée, nous comptions l’argent et nous nous le partagions. Nous allions ensuite manger, nous enivrer et fumer des joints. Nous rentrions chez Popov aux petites heures du matin et repartions quelques heures plus tard. J’étais libre, je me sentais bien, même si je ne mangeais pas à ma faim et que je perdais du poids à vue d’œil.
Cette autonomie me convenait, mais l’ersatz de batterie ne me suffisait pas. Le vrai jeu me manquait. Mes mains et mes pieds me démangeaient.
La scène rock parisienne était peu propice à répondre à mes aspirations. Même si les Beatles cartonnaient en France, surtout après leur passage à l’Olympia en début d’année, et que d’autres groupes britanniques comme les Rolling Stones ou le Spencer Davis Group commençaient à faire parler d’eux, les Français restaient repliés sur leur hexagone. Ils s’obstinaient à protéger leur production nationale au lieu de se tourner vers le vrai rock.
C’était la période des yéyés, des chanteurs insipides qui chantaient des chansons insipides. Pourtant, certains croyaient dur comme fer qu’ils faisaient du rock, comme Johnny Hallyday, Eddy Mitchell ou Dick Rivers, des dilettantes à qui je ne donnais pas deux ans pour tomber aux oubliettes. Ils pensaient qu’il suffisait d’angliciser leur nom, d’adapter des standards du répertoire anglo-saxon et de se déhancher mollement pour devenir un vrai rocker. La reprise de Maybellene par Eddy Mitchell était à pleurer de mièvrerie.
Même Sylvie Vartan, une midinette de mon âge qui avait partagé l’affiche des Beatles à l’Olympia, déclarait le plus sérieusement du monde à la radio qu’elle faisait du rock.
Le premier Français à s’être autoproclamé chanteur de rock s’appelait Henry Cording. C’était quelques années auparavant, à la fin des années cinquante. La musique était insignifiante, mais les paroles étaient de Boris Vian. Ce même gars s’appelait à présent Henri Salvador et baragouinait une insondable niaiserie intitulée Mimie petite souris.
De fil en aiguille, Cheyenne a appris que j’étais batteur et que je briguais une place dans une formation. Lui-même était musicien et avait joué de la trompette dans un groupe de jazz après la guerre. Selon lui, il existait une sorte de marché des musiciens qui avait lieu le vendredi soir à la Porte Saint-Martin, près du théâtre de la Renaissance. Sur le terre-plein, les musiciens en recherche d’emploi échangeaient des tuyaux, se passaient les bons plans, suggéraient des places à prendre ou des remplacements à assumer.
J’y suis allé, mais je n’ai rencontré personne. Un bistrotier m’a informé que c’était dorénavant à Pigalle que cela se passait. J’y suis allé plusieurs fois, mais je suis rentré bredouille. J’avais presque abandonné l’idée de jouer de la batterie lorsqu’un soir de bonne fortune, Candy m’a emmené voir un groupe de jazz à la Cigale.
Il y avait là de nombreux amateurs de musique, de jazz en particulier. Candy m’a présenté Maurice, un Antillais qu’il connaissait. Il jouait du trombone dans une petite formation de jazz et m’a proposé de faire un bœuf le lendemain soir dans une cave de la rue de Clichy.
J’y suis allé. J’ai joué durant toute la nuit en alternance avec un autre batteur, un Français un peu hautain qui se faisait appeler Mike. Au petit matin, j’étais épuisé et heureux. J’avais retrouvé mes sensations. Ma technique était revenue, comme si mes mains disposaient d’une mémoire propre. L’un des guitaristes est venu me trouver et m’a proposé de jouer avec lui. Il s’appelait André et souhaitait former un groupe de rock. Il connaissait un bon bassiste et avait un chanteur en vue. De plus, il possédait une batterie neuve qu’il mettrait à ma disposition.
Deux semaines plus tard, nous avons commencé à répéter. André habitait rue de Provence. Il avait baptisé notre groupe les Tourbillons. Nous nous débrouillions bien. Jacques, le chanteur, avait quelques introductions, il nous a décroché quelques contrats.
Nous avons joué plusieurs fois au Golf-Drouot le vendredi soir. Cinq ou six groupes se succédaient dans la soirée. Nous avions quarante-cinq minutes pour conquérir le public et mériter le droit de revenir la semaine suivante. J’ai passé de mémorables moments dans cet endroit. C’était le temple du rock parisien. Le public était constitué de vrais amateurs. Ils nous donnaient des conseils et nous permettaient de progresser.
Quelques semaines plus tard, nous avons participé à un festival de rock organisé au Tabarin, un cabaret situé au pied de Montmartre. À l’affiche, il y avait des pointures comme Vince Taylor et les Chats Sauvages.
À la fin de notre passage, un homme d’une quarantaine d’années, en costume et cravate, est venu nous trouver et nous a proposé de faire quelques essais en studio. Nous y sommes allés quelques jours plus tard. C’était un peu en dehors de Paris, en Seine-Saint-Denis. Ce n’était pas vraiment un studio, mais un simple local muni d’un magnétophone et d’un micro Neuman posé au centre.
L’homme nous attendait, accompagné d’un technicien et d’une femme à l’air revêche qui m’a toisé de haut en bas. Il nous a proposé quelques partitions, des succès récents, anglais ou américains pour la plupart.
Nous nous sommes positionnés autour du micro, le technicien a fait la balance en vitesse. Nous avons joué une dizaine de morceaux du répertoire ainsi qu’une ou deux compositions d’André. Les deux hommes et la femme nous écoutaient en se frottant le menton, assis côte à côte, à l’écart, sur des chaises instables. De temps à autre, ils se glissaient quelques mots à l’oreille.
L’homme s’est levé au milieu d’un morceau et nous a fait signe d’arrêter. Il a appelé André. Ils sont sortis de la pièce et sont revenus un quart d’heure plus tard. Nous étions pris pour enregistrer un 45 tours, mais l’homme ne voulait pas de moi.
Ce n’était pas à mon jeu qu’il en avait, mais à mon style. Il ne voulait pas de beatnik dans ses groupes. Il allait proposer un autre batteur pour accompagner les Tourbillons. André était désolé pour moi, mais ne voulait pas passer à côté d’une telle opportunité. Il m’a viré sur-le-champ.
J’ai retrouvé Candy, les autres et mes récitals sur les grands boulevards.
L’automne touchait à sa fin et mon second hiver parisien pointait du nez. Les Anglais rentraient à Londres les uns après les autres. Il s’y passait un tas de choses. Les jeunes prenaient le pouvoir, Londres était devenu The Place to Be. Un nouveau courant musical appelé le rythm’n’blues faisait fureur. De nouveaux groupes émergeaient chaque jour. Ils parlaient des Animals, des Kinks ou des Who.
Ces derniers se présentaient comme de dangereux concurrents pour les Beatles, ils avaient un batteur qui jouait comme aucun batteur n’avait jamais joué.
De plus, une radio pirate appelée Radio Caroline était annonciatrice d’une révolution. La station émettait depuis un bateau mouillé en dehors des eaux territoriales et proposait de la bonne musique à longueur de journée, à mille lieues des Tom Jones ou Engelbert Humperdick autorisés par les huiles guindées de la BBC.
Pour la première fois, il ne fallait pas avoir un nom connu, faire partie d’un label important ou offrir un son approuvé par le gouvernement pour être entendu.
Je me plaisais à Paris, mais je sentais que c’était là-bas que je devais désormais aller si je voulais continuer à jouer de la batterie sans me faire exclure pour mon apparence.
30
Vers l’écran
Le mois de juin était marqué par une canicule inhabituelle. Malgré la climatisation, de nombreux patients souffraient de la chaleur et la clinique avait dû déplorer plusieurs décès.
X Midi, en revanche, ne semblait pas incommodé par la vague de chaleur et son état continuait à progresser.
Chaque après-midi, les brancardiers l’installaient dans un fauteuil roulant et un aide-soignant l’emmenait faire une balade dans les couloirs de la clinique. Si la météo le permettait, il partait en promenade dans les allées du parc.
Tous les deux jours, il se rendait en salle de kinésithérapie et suivait une séance de verticalisation. La thérapie consistait à sangler le patient sur un plan incliné et à l’amener progressivement à la verticale. Le traitement favorisait la mobilisation respiratoire et prévenait la diminution de la spasticité. Il était également censé procurer des bienfaits psychologiques.
Grâce à ces séances et au drainage quotidien des bronches que lui procurait sa kiné, X Midi avait recouvré une ventilation spontanée.
L’ergothérapeute avait observé de plus amples rotations de la tête et un affermissement des mouvements des doigts de la main gauche. L’homme étirait à présent les coins de la bouche. Une logopède était entrée en action et avait décelé l’émission de quelques sons.
Comme elle le faisait régulièrement, Marie-Anne Perard lui rendit visite le mardi 29 juin, en fin de matinée. Elle était accompagnée par un géant de race noire qui affichait un large sourire.
Le médecin-chef vint aux côtés de X Midi.
— Bonjour, mes collaborateurs me disent que vos progrès sont encourageants, je vous félicite.
L’homme vissa son regard dans le sien.
— Vous avez chaud ?
Elle n’enregistra aucune réaction.
— Vous avez mal quelque part ?
L’homme continua à la fixer sans ciller.
— Vous ne voulez toujours pas communiquer avec nous ?
Elle se tourna vers le géant et lui fit signe d’approcher. Elle s’écarta légèrement pour qu’il entre dans le champ de vision de X Midi.
— Je vous présente Dominique. Il vient de nous rejoindre et sera votre kiné à partir de demain. Dominique vient de France, il a travaillé à Garches et a connu des cas similaires au vôtre. Je suis sûre qu’il vous plaira.
Les yeux de l’homme se déplacèrent et s’arrêtèrent sur le kiné.
Celui-ci élargit son sourire et lui adressa un clin d’œil.
— C’est vrai, je suis sûr que nous allons nous entendre.
Le médecin-chef reprit l’initiative.
— Grâce à Dominique, vous allez faire connaissance avec notre piscine. Nous avons prévu deux à trois séances par semaine. Cela vous fera beaucoup de bien.
Dominique renouvela un clin d’œil.
— Vous allez voir, avec Dominique, la piscine, ce n’est que du bonheur !
Marie-Anne Perard sourit à son tour.
— Dominique est un homme enthousiaste. J’espère que sa bonne humeur sera contagieuse. On m’a dit que vous bougiez les doigts, c’est vrai ?
L’homme ne réagit pas.
— Vous avez chaud ? Vous voulez ôter votre blouse pendant quelques instants ?
Le regard de l’homme se détourna et s’ancra sur la télévision. Une série américaine tournait en sourdine.
— Bien, je vous laisse. Continuez de progresser comme ça.
Elle sortit de la chambre et laissa le kiné en tête à tête avec lui.
Dominique s’approcha, son large sourire aux lèvres.
— Quand on est entre nous, je propose de se tutoyer, tu es d’accord ?
X Midi continuait de fixer l’écran.
— Si tu es d’accord, ferme les yeux une fois.
L’homme ne réagit pas.
Le Noir se mit à rire de bon cœur.
— Tu es un rigolo ! Tu comprends ce que je dis, mais tu ne veux pas me répondre ?
La question le laissa indifférent.
— Tu ne veux pas parler ? C’est ça ? Tu préfères regarder ces séries stupides ?
Une idée lui vint.
— Tu sais, si on travaille bien, toi et moi, je peux t’aider à assouplir tes doigts. Quand ils seront agiles, on t’apprendra à utiliser la télécommande, tu pourras choisir ton programme et regarder ce que tu veux. Qu’est-ce que tu en penses ?
L’homme détacha son regard de l’écran et vint le planter dans celui du kiné.
Dominique dodelina la tête en écarquillant les yeux, l’air triomphant.
— Ah, ha ! Ça t’intéresse, hein ?
L’homme le fixa avec intensité.
— Tu aimerais que je travaille avec toi pour que tu puisses arrêter de regarder ces imbécillités et choisir le programme que tu veux ?
Les yeux de l’homme retournèrent vers l’écran.
31
Le premier train pour Calais
Ils m’ont allongé sur une alèse en plastique. Par-dessus, ils ont posé une sorte de carré bleu en matière synthétique. La chaleur me ronge les fesses. La chemise dans laquelle ils m’ont enfermé me fait transpirer.
Ils le savent. Ils se servent de ce stratagème pour me sortir de mon mutisme.
Ils m’ont envoyé Blanche-Neige, mais je ne suis pas dupe. Blanche-Neige était plus jeune, même s’ils se ressemblent un peu, ce même entrain, ce même rire joyeux. À peine arrivé, il m’a soumis à un odieux chantage.
Il m’a imposé la piscine. Je déteste cette épreuve. Les hommes en blanc déboulent sans crier gare et me conduisent dans une salle carrelée de blanc. Une sorte de toile d’araignée descend du plafond. Ils m’emprisonnent dans les filets et me plongent dans une baignoire remplie d’eau chaude. L’espace d’un instant, je repense aux apprentis nageurs de la Perche.
Lorsque la nuit s’en va, ils prennent ma température et ma tension. Ils injectent leurs drogues dans la sonde gastrique. Ils y relient un sac en plastique qui contient un liquide brunâtre. Quand le sac est vide, ils m’éloignent de la chambre, vont me perdre dans le dédale des corridors. Un jour, j’ai entendu quelques notes sortir d’une chambre. A Day in the Life. Le cauchemar est revenu me hanter.
Dans les couloirs, je croise les occupants. Les éclopés. Les dingos. Des rescapés de la mort. De pauvres bougres sans jambes, sans bras, le visage tordu, la bouche figée dans un effroyable rictus.
Quand ils me voient, ils me dévisagent. Je peux lire dans leurs yeux.
Un gamin maigre à faire peur stationne près de l’entrée, recroquevillé sur sa chaise. Il lit des bandes dessinées en soliloquant. Dans l’ascenseur, j’ai rencontré une jeune femme dans un fauteuil roulant. Elle était belle. Elle m’a souri. Sa poitrine était sanglée dans un corset. Il lui manquait une jambe.
Après la météo, ils me transportent dans une grande salle. Ils me hissent au milieu de la pièce comme le Christ au sommet du Golgotha. Ils m’exhibent à la vue de tous. À mes pieds, les éclopés gesticulent, pédalent, soupirent, gémissent, lèvent les yeux vers moi.
Ainsi sacrifié, impuissant, à la merci de leur compassion, je pense à Floriane. Je revois son sourire, son regard flou, son corps ouvert, offert. J’entends sa voix qui souffle mon nom dans la pénombre.
Je n’avais pas compris que c’était un appel à l’aide.
L’hiver est arrivé et l’année 1965 a pointé du nez.
Je buvais de plus en plus. Ma prise quotidienne d’herbe ou de hasch était devenue vitale et l’argent commençait à manquer.
Jimbo, le revendeur qui me fournissait en dope, m’a proposé de travailler pour lui. Il flemmardait dans le quartier de la Huchette et allait d’un groupe à l’autre pour faire son commerce.
Il se vantait de loger dans le même immeuble que Chester Himes, dans la rue Bourbon-le-Château. Il devait avoir cinq ou six ans de plus que moi. Une tache de vin lui balafrait le front. Il ne tenait jamais en place et jetait de fréquents coups d’œil autour de lui, comme s’il craignait de voir surgir quelqu’un.
Je devais traîner dans les bistrots proches des écoles privées pour côtoyer les enfants de bourgeois et leur refiler sa marchandise.
En France, dans ces années-là, on produisait et on trafiquait beaucoup, mais peu de gens consommaient. À Paris, il restait quelques fumeries d’opium et quelques night-clubs à Montparnasse où l’on pouvait sniffer ou s’injecter de l’héroïne. À Pigalle, les Noirs fumaient de la Marie-Jeanne dans les sous-sols de certains bars, mais c’était sans rapport avec ce que j’allais connaître plus tard à Londres.
Comme j’hésitais, Jimbo m’a fait la leçon. J’allais rendre service à ces enfants en leur offrant un moyen d’élargir leur perception, j’allais leur permettre d’ouvrir leur conscience à un ailleurs, loin des préoccupations matérialistes de la société de consommation dans laquelle ils croupissaient.
Les autres considéraient l’herbe comme une composante de leur philosophie basée sur la négation des institutions, le refus des contraintes et la recherche intellectuelle hors des sentiers battus. Ce que Jimbo disait avait du sens et rejoignait leur raisonnement. J’ai accepté.
Le lendemain, j’ai commencé à prospecter. Après quelques essais infructueux, j’ai trouvé un endroit propice, un bistrot situé dans la rue de Londres, non loin du cours Hattemer. Durant l’heure de midi et après les cours, il était fréquenté par des hordes de jeunes insouciants et prétentieux.
Les premiers jours, j’ai fait mine de les ignorer, absorbé dans la lecture du livre que j’avais emporté. J’avais choisi des titres susceptibles d’attirer leur attention, On the Road, L’Attrape-cœur ou le Festin Nu, mais aussi des textes de Jean-Paul Sartre ou de Jean Cocteau. J’avais également acheté un roman de Françoise Sagan, j’avais appris qu’elle avait suivi une partie de ses études dans cette école.
Le nez dans mon bouquin, j’écoutais leurs discours. La plupart de temps, ils échangeaient des platitudes, mais il leur arrivait d’aborder des thèmes d’actualité, de parler de philosophie ou de politique. Ils se prenaient très au sérieux et semblaient convaincus de faire partie d’une certaine élite.
Un jour, je me suis immiscé dans leur conversation. Ma démarche les a d’abord surpris. Mon aspect et ma manière de parler les inquiétaient, mais comme ils s’étaient habitués à ma présence, ils m’ont laissé développer mes arguments.
J’ai fait de même les jours suivants. Les idées que j’avançais les interpellaient. Progressivement, elles les ont séduits, puis fascinés.
Je ne faisais que reprendre dans les grandes lignes les propos des membres du groupe. Je répétais avec conviction ce que j’entendais à longueur de journée. Je leur parlais de contre-culture, d’indifférence au lendemain, de liberté, de paix, d’amour. Je leur parlais des écrivains que j’avais rencontrés. Je leur parlais aussi de moi. Je m’étais inventé un passé dans lequel j’étais entouré de parents philosophes, quelque part dans un pays mystérieux à l’autre bout du monde.
De jour en jour, mon aura grandissait. De marginal, je suis devenu original. Finalement, j’ai acquis un statut, ils me considéraient comme leur gourou. Lorsque je débarquais dans le bistrot, un attroupement se formait. Ils m’attendaient, me pressaient de questions.
Je prenais l’air inspiré, je parlais calmement, avec une grande sérénité, comme j’avais vu Alex le faire. Ils ne semblaient pas perturbés par ma difficulté persistante à trouver certains mots. Parfois, je répondais n’importe quoi. Ils le prenaient pour argent comptant. J’étais stupéfait de l’influence que j’exerçais sur eux.
De son côté, Jimbo s’impatientait.
Je lui disais que j’avançais, mais qu’il fallait y aller par étapes.
De fil en aiguille, la question est venue ; qu’est-ce qui pouvait les aider à atteindre le niveau de conscience et la clairvoyance qu’ils m’enviaient ?
Je leur ai donné rendez-vous un jeudi après-midi à la gare Saint-Lazare, toute proche. Nous avons cherché un coin tranquille. J’ai roulé un joint devant eux et l’ai fait passer de main en main en leur expliquant comment il fallait inhaler la fumée.
L’effet ne s’est pas fait attendre. Ils se sont mis à planer, les uns après les autres.
Le lendemain, ils m’ont passé leur première commande.
Floriane se trouvait parmi eux. Elle avait mon âge. C’était une belle fille, elle avait de longs cheveux blonds, des taches de rousseur qui lui mangeaient le visage et de grands yeux bleus qui criaient détresse. Elle était fille unique. Son père faisait des affaires et sa mère avait pris un amant.
Elle est devenue l’une de mes meilleures clientes. Non seulement sa consommation personnelle augmentait, mais elle faisait des adeptes et me réclamait des quantités de plus en plus importantes.
Après quelques semaines, elle a voulu passer à la vitesse supérieure. Je n’étais pas chaud, mais comme elle insistait, j’en ai parlé à Jimbo.
Il m’a dit qu’elle avait raison, que rien ne valait le shoot, qu’à côté de cela, la fumette, c’était de la rigolade. Le shoot à l’héroïne offrait un flash somptueux, royal, il fallait le prendre en intraveineuse, jamais en sous-cutané. Il pouvait me fournir cela.
Je ne comprenais rien à ce qu’il disait. Il a proposé de lui administrer lui-même son premier shoot et de lui inculquer la méthode pour se le faire soi-même.
J’en ai parlé à Floriane.
Quelques jours plus tard, elle m’a demandé de passer chez elle le soir. L’occasion se présentait, son père était en voyage d’affaires et sa mère découchait.
Ce soir-là, je suis allé chez elle avec Jimbo. Il avait emmené deux copains avec lui, Fuzzi, un guitariste que je croisais de temps à autre chez Popov, et Roman, un type anguleux au nez busqué que je n’avais jamais vu auparavant et qu’il m’a présenté comme étant un pote d’enfance.
Floriane nous attendait avec une autre fille, Pascale, une brune à la poitrine généreuse et à l’air déluré. Floriane habitait du côté du Parc Monceau, dans un grand appartement entièrement peint en blanc. La moquette était blanche, elle aussi. Des tableaux colorés pendaient aux murs. Un gigantesque piano à queue laqué noir trônait dans le salon.
Elle a mis de la musique. Nous nous sommes installés dans de grands canapés en cuir fauve. Nous avons fait connaissance et avons commencé à boire et à fumer. Jimbo a préparé une pipe qu’il a bourrée d’une substance noirâtre et visqueuse. C’était du dross, nous allions lui en dire des nouvelles.
L’ambiance s’est rapidement échauffée. J’étais fin saoul et à moitié défoncé quand Floriane m’a pris par la main et m’a emmené dans la chambre de ses parents. Elle avait à peine refermé la porte qu’elle s’est collée contre moi et m’a embrassé à pleine bouche.
Je ne sais pas ce que Jimbo avait mis dans cette pipe, mais nous étions dans un état d’excitation extrême. Je n’avais pas eu de rapports sexuels depuis mon départ de Bruxelles. Je l’ai déshabillée avec précipitation. J’ai éjaculé dans sa bouche et dans son vagin, presque coup sur coup. Quand je l’ai pénétrée, elle a joui en poussant de petits cris.
Ensuite, elle s’est levée, a ouvert la porte et a appelé Jimbo. Il est entré dans la chambre, m’a regardé, a souri.
Il tenait une serviette de bain qu’il a déroulée sur le lit. Il a monté la seringue et préparé la dose. Floriane semblait soucieuse, il lui a dit qu’il avait l’habitude, que tout allait bien se passer.
Il lui a fait un garrot au biceps, a tapoté sur son avant-bras. Il a choisi une veine saillante, a enfoncé l’aiguille et a appuyé sur le piston. Floriane a sursauté, ses yeux se sont révulsés et son corps a fait un soubresaut.
Jimbo m’a demandé de sortir et d’appeler Roman.
Dans le salon, Fuzzi flirtait avec Pascale. Ils étaient en partie allongés dans le divan et se léchaient les lèvres. Il avait passé une main sous son pull et lui caressait les seins. Tous deux avaient le feu aux joues.
Je me suis servi un whisky. Je suis allé faire un tour dans la bibliothèque. Je chancelais dans le couloir. Les perspectives se déformaient. J’avais perdu la notion du temps et des distances.
Quand je suis revenu dans le salon, Pascale était à genoux au pied du canapé, une main sous sa jupe, elle se masturbait pendant que Fuzzi lui enfonçait son sexe dans la bouche.
J’ai entendu du bruit dans la chambre. J’ai d’abord hésité, j’avais cru entendre un cri. J’ai poussé la porte. Floriane était allongée sur le lit, prise en sandwich entre Jimbo et Roman. Ils la pénétraient sans ménagement, l’un par-devant, l’autre par-derrière. Floriane semblait absente, soumise. Son corps tressautait sous les coups de boutoir qu’ils lui assénaient. Elle a tourné la tête vers moi, a semblé me reconnaître, a tendu la main. La scène était floue, irréelle, distante.
Je n’ai pas compris que c’était un appel à l’aide.
Je suis sorti et j’ai refermé la porte. J’étais dans les vapes. Je pressentais que ce qui se passait dans la chambre n’était pas conforme, qu’ils enfreignaient une règle. J’en étais conscient, mais je ne parvenais pas à trouver l’énergie nécessaire pour m’indigner et réagir. Je suis resté un bon moment devant la porte fermée.
Un long cri a fusé. Jimbo et Roman sont sortis de la chambre. Ils s’engueulaient. Ils ont commencé à se battre dans le salon. Fuzzi et Pascale s’étaient éclipsés dans une chambre. Jimbo et Roman se tapaient dessus, sans tenter de se protéger des attaques de l’autre. Les coups qu’ils se donnaient produisaient un bruit mat. Jimbo a commencé à saigner du nez. Le sang giclait, formait des taches sur les murs et la moquette blanche. Roman continuait à lui cogner dessus. Jimbo encaissait en vacillant. Son visage était couvert de sang.
J’ai pris peur, je suis sorti. J’ai couru. Les gens me dévisageaient dans la rue. Je devais avoir l’air d’un fou. Je suis parvenu à rentrer chez moi. Candy et moi partagions une chambre au quatrième étage d’un immeuble de la rue de la Harpe. Je me suis caché sous les couvertures et j’ai sombré.
À l’aube, Candy m’a secoué comme un prunier.
Jimbo était en bas.
J’avais mal à la tête. Les images de la soirée revenaient par vagues. J’avais l’impression de sortir d’un cauchemar. J’ai passé la tête par la fenêtre. Jimbo semblait affolé. Je suis descendu. Il était couvert d’ecchymoses. Quelque chose avait foiré. Ma copine s’était jetée par la fenêtre. La police recherchait les témoins. Il filait sur Marseille.
J’ai bouclé ma valise en moins de deux minutes. J’ai pris le métro en direction de la gare et je suis monté dans le premier train pour Calais.
32
Quelque chose de peu ordinaire
Dominique s’était rapidement intégré dans l’équipe de la clinique.
En peu de temps, il était devenu un personnage marquant et l’attraction du service de soins. Son inébranlable bonne humeur, son enthousiasme communicatif et ses facéties enchantaient les aides-soignants et les patients.
Dès son arrivée, tôt le matin, son leitmotiv retentissait dans les couloirs.
— Que du bonheur !
Certains patients se plaisaient à le reprendre en chœur en imitant son intonation chantante.
Quelques médecins attachés à l’étiquette estimaient qu’il outrepassait la bienséance et qu’il gagnerait à être plus discret, surtout dans un établissement tel que la clinique Derscheid.
Dominique s’en souciait peu. En aparté, il singeait leur attitude formaliste et les appelait les Grincheux.
En revanche, ses compétences faisaient l’unanimité. Il ne devait pas chercher les zones douloureuses chez ses patients, il disait qu’il les sentait, qu’elles venaient à lui, qu’il les découvrait sous ses doigts, comme si elles étaient siennes. Il ne soulageait ni les contractures ni les douleurs, il les aspirait, se les appropriait et en débarrassait les souffrants.
Plusieurs d’entre eux en avaient fait leur confident, tant pour la qualité des soins qu’il leur prodiguait que pour sa capacité à leur redonner le moral.
Il ne mettait pas en doute les plaintes qu’il recueillait, pas plus qu’il ne minimisait les souffrances que ses patients disaient endurer. Jamais il ne jouait dans le registre de l’empathie. Il écoutait, les yeux écarquillés, le sourire aux lèvres. Pour certains, la simple vue de son visage était une thérapie en soi. Il parvenait à convaincre ses patients qu’ils étaient forts et tenaces, leur assurait qu’ils détenaient l’énergie suffisante pour se battre et surmonter la douleur.
Dans de nombreux cas, cette méthode s’avérait bénéfique.
Depuis le jour de son entrée dans le service, le 30 juin, il passait plus de deux heures par jour avec X Midi.
Il suivait sa progression en respectant l’ordre défini par les médecins. Les premiers levers et l’installation au fauteuil roulant avaient été réussis. Il lui fallait à présent travailler l’équilibre et l’indépendance de X Midi en position assise.
Viendrait ensuite le maniement du fauteuil, pour autant que l’homme accepte de coopérer. Il se chargeait également du travail respiratoire qui permettait de récupérer un maximum de mobilité thoracique.
Cette proximité quotidienne l’avait amené à développer une stratégie d’approche originale.
Avant d’entrer dans la chambre de X Midi, il annonçait son arrivée en parodiant un dialogue à bâtons rompus dans le couloir. Sa voix portait dans tout l’étage et ses échanges tragi-comiques amusaient les occupants des chambres voisines.
— Bonjour, mon ami, je suis content de te voir, tu as fait de beaux rêves ?
— Bonjour, Dominique. J’ai rêvé que je nageais avec toi.
— Dans la piscine ?
— Non, dans la mer des Caraïbes.
— Dans la mer des Caraïbes ? Avec moi ? Mon Dieu ! Il n’y avait pas de requins, j’espère ?
— Si, il y avait plein de grands requins blancs.
— Oh oh !? Est-ce qu’ils avaient des stéthoscopes autour du cou ?
Il éclatait de rire et passait la tête dans l’encadrement de la porte. Il surprenait généralement X Midi qui, alerté par les éclats de voix, guettait son apparition du coin de l’œil. Il entrait dans la chambre, jetait un regard à la télévision et lâchait un commentaire.
— Je l’ai vu, cet épisode, c’est le jardinier qui a fait le coup.
Il approchait ensuite du lit et glissait la télécommande dans la main de l’homme.
— Mets-nous autre chose, tu n’as qu’à appuyer sur l’un des boutons.
L’ergothérapeute estimait que X Midi était à présent capable d’utiliser la télécommande et la manette de fonctionnement du fauteuil roulant électrique. Il refusait néanmoins de fournir les efforts nécessaires pour y parvenir et ne semblait pas intéressé par cette perspective d’autonomie.
Dominique patientait quelques instants, puis reprenait la télécommande.
— Bien, dans ce cas, je vais mettre MTV, on va travailler en musique.
Il poursuivait par le jeu du prénom.
— Alors, on est toujours à la lettre A, c’est ça ? André ? Tu t’appelles André ?
Il attendait une réaction.
— Non, tu ne t’appelles pas André ? Albin ? Comme dans la cage aux folles ? Antoine, comme le chanteur ?
Il commençait ses soins par de légers massages des chevilles, des orteils et des genoux, tout en pratiquant une mobilisation passive. Petit à petit, les massages devenaient plus directifs. Il savait par expérience que les patients atteints du Locked-in syndrome éprouvaient la sensation d’être morcelés. Les massages dynamiques leur redonnaient une perception d’unité.
Durant son intervention, il sollicitait sans cesse sa réactivité.
— Albert, comme votre roi ? Ne me dis pas que tu t’appelles Albert ! Tu t’appelles Albert ? C’est marrant, ça !
Suivait le travail d’entretien de la mobilité articulaire et la prévention de la spasticité.
— Demain, on va à la piscine, Albert. La piscine avec Dominique, ce n’est que du bonheur !
Parfois, il baissait le ton, soufflait dans son oreille.
— J’aimerais connaître ton prénom, mon ami, si ton prénom commence par un A, tu clignes des yeux, d’accord ?
Le lundi 2 août, lors de la réunion hebdomadaire du staff, Marie-Anne Perard demanda à chacun de dresser un bilan de l’état de X Midi.
La comptable prit la parole en premier et présenta le décompte des soins de X Midi. L’identité de l’homme n’était toujours pas connue et aucune mutuelle n’intervenait. Les soins étaient entièrement à charge du CPAS qui tardait à rembourser les montants avancés et multipliait les demandes de justifications. Elle supputa qu’une partie des frais serait à imputer au compte pertes et profits de la clinique et viendrait grever le budget final.
Lorsque le tour de table toucha à sa fin, Dominique prit la parole. Au lieu d’entrer dans des considérations médicales ou de s’étendre sur le tableau clinique comme l’avaient fait les autres intervenants, il eut cette phrase qui interpella l’assistance.
— Cet homme a vécu quelque chose de peu ordinaire.
33
Le centre du monde
Je garde de la traversée de la Manche le souvenir de la cuvette en faïence que je pressais contre mon cœur comme une bouée de sauvetage. Les genoux au sol, je tournais et retournais mon estomac dans l’espoir d’exorciser le mal-être qui m’oppressait.
J’étais dessoulé, mais les effets du dross continuaient à enserrer mes tempes. Je ne percevais plus le sol sous mes pieds. À chaque pas, je plongeais dans un gouffre sans fin. Les paroles de Jimbo tournaient en boucle. Quelque chose avait foiré. Ma copine s’était jetée par la fenêtre. Les mots me martelaient les tympans. Lorsqu’ils résonnaient, des flux d’adrénaline explosaient dans ma poitrine, parcouraient mes membres, se propageaient jusqu’à l’extrémité de mes doigts.
Qu’est-ce qui avait foiré ?
Pourquoi Floriane s’était-elle défenestrée ?
J’élaborais d’improbables scénarios. Dans le meilleur des cas, je n’étais qu’un témoin indirect, dans le pire, le complice d’un meurtre.
Je ne cessais de penser à ma mère. Je pensais à la peine qu’elle ressentirait si elle apprenait ce que j’étais devenu. J’aurais aimé la serrer dans mes bras, me confier à elle, lui expliquer ce qui s’était passé, lui dire que je n’avais pas compris que c’était un appel à l’aide.
En arrivant à Douvres, j’étais dans un tel état d’hébétude que je ne me suis pas rendu compte que les policiers réclamaient mes papiers. Par chance, ils ont cru que j’avais été sujet au mal de mer. Ils ont jeté un rapide coup d’œil sur ma carte d’identité, ont échangé une plaisanterie et m’ont laissé passer.
Je devais me procurer de nouveaux papiers. Je savais qu’il était possible d’en acheter à Londres.
Quand j’ai débarqué du train, à Waterloo Station, les effets de la drogue commençaient à se dissiper. Ragaillardi, je suis parti à la découverte de la ville la plus surprenante de la planète.
Clapton is God. C’est le premier souvenir que je garde de Londres. C’était écrit sur le mur de la station de métro. J’ignorais qui était Clapton. Je ne savais pas que j’allais bientôt faire connaissance avec le meilleur guitariste de tous les temps.
Il m’a fallu moins d’une heure pour comprendre ce qui avait poussé les Anglais à rentrer chez eux.
En cet été 65, Londres offrait un cocktail insolite composé des prémices d’une révolution et du formalisme le plus radical. La circulation était plus dense qu’à Paris, mais personne ne klaxonnait. Les conducteurs ne jouaient pas des coudes pour doubler les autres véhicules, mais roulaient de manière disciplinée et s’accordaient pour fluidifier le trafic. Dans les escaliers roulants du métro, les gens se massaient d’un côté pour permettre aux voyageurs pressés de circuler.
Personne ne semblait choqué par mon allure, comme cela avait été le cas jusqu’à présent. Je ne m’étais pas coupé les cheveux depuis mon départ, je portais un catogan et une barbe en broussaille. Mes vêtements étaient fripés, troués par endroits. Malgré cela, je passais inaperçu. Je ne saisissais pas ces regards chargés de reproches et ces mimiques réprobatrices qui rythmaient mon quotidien à Paris.
Sur le trottoir, je croisais des gentlemen en costume noir et chapeau melon, des moines bouddhistes dans leur tenue orange, des sikhs enturbannés, des Kenyanes dans leur boubou coloré, des Chinois dans d’étranges costumes étriqués et des ladies d’un autre siècle. Les nations du monde entier semblaient s’être donné rendez-vous.
Mais à côté de cela, les rues fourmillaient de jeunes à l’aspect trouble qui respiraient la liberté. J’étais à Londres, j’étais vivant.
Je sentais que la jeunesse allait prendre le pouvoir et que j’étais au centre du monde.
34
Au niveau de sa conscience
Michael Stern, le journaliste du Belfast Telegraph, séjourna à Berlin du 18 au 23 septembre.
Il pensait que tout le monde parlait anglais à Berlin-Ouest et dut en dernière minute se mettre à la recherche d’un traducteur, ce qui lui fit perdre une journée.
Les témoignages qu’il recueillit par la suite confortèrent sa conviction que la disparition des quatre musiciens n’était pas un fait du hasard.
La première personne qu’il rencontra fut le commerçant turc qui travaillait au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel le groupe louait un trois pièces meublé. Il fut déçu de ne pouvoir visiter le logement, celui-ci avait été vidé de son contenu et mis à la disposition de nouveaux locataires.
Selon le marchand, l’appartement ne contenait que peu d’affaires personnelles. Après les événements, le propriétaire les avait déposées sur le trottoir où elles avaient été enlevées par le service de voirie.
L’homme déclara que s’il avait été le propriétaire du logement, il en aurait fait de même. Il aurait probablement jeté ces énergumènes dehors bien avant ; ils étaient bruyants, grossiers et ne respectaient rien. Ils rentraient au milieu de la nuit, complètement ivres ou sous l’emprise de drogues et hurlaient dans la cage d’escalier. Comme ils débarquaient à des heures différentes, ils réveillaient les occupants plusieurs fois par nuit.
Un jour, l’un des locataires était sorti furieux de son appartement pour les rappeler à l’ordre. Il s’en était fallu de peu qu’il se fasse lyncher.
Ils n’achetaient rien dans son épicerie, mais la considéraient comme une cabine téléphonique publique dont ils avaient communiqué le numéro à l’ensemble de leurs contacts.
Lorsque l’homme eut vidé sa rancœur, Stern en vint à l’emploi du temps des musiciens durant leurs derniers jours à Berlin.
Le commerçant se rappelait qu’en l’espace de vingt-quatre heures, trois d’entre eux avaient quitté Berlin pour une destination inconnue et que seul celui qu’il appelait le Bagué, le plus civilisé des quatre, était resté. Il se souvenait aussi de l’irruption de Larry Finch dans son épicerie le samedi matin, affublé d’un blouson de cuir et de lunettes noires. Il voulait utiliser le téléphone pour commander un taxi.
Après avoir raccroché, il avait choqué les clients présents en déclarant, en mauvais allemand et avec des gestes explicites, qu’il partait danser le flamenco et baiser les putes espagnoles.
Geste peu courant, il avait déposé une pièce de cinq marks sur le comptoir avant de quitter le magasin.
Le commerçant n’avait pas souvenance qu’il y avait eu plus d’appels téléphoniques pour eux durant les jours qui avaient précédé les départs. Selon lui, ils n’avaient pas reçu de visite. D’une manière générale, il n’avait jamais vu de visiteur ou de visiteuse monter chez eux. À part les appels téléphoniques et hormis le facteur, personne ne les avait jamais demandés.
Il n’avait rien remarqué de particulier dans leurs comportements, si ce n’est un peu plus d’agitation que d’ordinaire. Le Bagué ne semblait pas inquiet ou perturbé après le départ de ses camarades, du moins jusqu’à ce qu’il apprenne la mort du premier d’entre eux et aille se jeter sous une rame de métro.
Stern interrogea plusieurs habitants de l’immeuble qui corroborèrent les dires du marchand, mais ne lui apportèrent pas d’informations complémentaires.
Une femme âgée qui habitait au sixième, sous leur appartement, déclara qu’elle savait bien avant la série d’accidents que leurs jours étaient comptés ; ces hommes fumaient, se droguaient et buvaient comme des soiffards. Elle avait entendu l’un d’eux vomir pendant toute une soirée.
Le journaliste parvint également à joindre le propriétaire du logement par téléphone. Il se plaignit que les quatre hooligans n’avaient pas payé leur loyer depuis le début de l’année. Il n’avait rien à ajouter sinon qu’il ne voulait plus entendre parler d’eux.
Stern se rendit ensuite au Yoyo Bar, le club où le groupe se produisait.
Le bistro était situé dans le secteur anglais, dans une rue adjacente au Kurfürstendamm, l’artère la plus animée de Berlin-Ouest. L’endroit était une étrange combinaison de pizzeria, de salle de concert et de night-club.
Le patron de la boîte se déclara tout d’abord surpris qu’un journaliste puisse investir de son temps pour se pencher sur une banale suite d’incidents. Il convint ensuite, avec un clin d’œil complice, que la théorie du complot faisait vendre du papier et accepta de répondre aux questions.
Les musiciens arrivaient vers dix-neuf heures. Ils prenaient leur repas, faisaient quelques essais et commençaient leur tour vers vingt heures. Ils terminaient en principe à minuit, mais selon l’affluence ou l’ambiance, il leur arrivait de jouer jusqu’à deux heures ou trois heures du matin, ce qui représentait six à sept heures d’affilée sur scène, avec une pause de dix minutes toutes les deux heures. Comme ils étaient payés à l’heure, ils ne s’en plaignaient pas.
L’endroit était fréquenté par quelques étudiants et des hordes de soldats, surtout américains, qui venaient écouter les bons vieux rocks de chez eux. Pearl Harbor s’était fait une spécialité de reprendre les standards du répertoire américain et de les assaisonner à leur sauce.
Le patron lui rapporta que les musiciens étaient ingérables et lui avaient causé de nombreux problèmes. Malgré cela, il les avait gardés parce qu’ils étaient capables comme nul autre de chauffer le public et de mettre de l’ambiance.
Plus d’une fois, il avait dû intervenir pour calmer le jeu. Ils s’engueulaient entre eux, lançaient des bouteilles dans la salle, insultaient l’assistance ou provoquaient des bagarres.
Ils jouaient sept jours sur sept, mais avaient exceptionnellement demandé congé le 14 mars, sans donner de raison précise. Cette requête n’avait été faite que l’avant-veille, ce qui l’avait mis dans l’embarras.
De mauvaise grâce, il leur avait accordé le congé. Il pressentait qu’un refus de sa part aurait engendré un nouveau conflit. Il avait dû trouver des suppléants au pied levé et la soirée avait été un fiasco. Le public avait hué le groupe qui les remplaçait et exigé le retour de Pearl Harbor.
Le lendemain, Larry Finch, le bassiste et leader du groupe, lui avait téléphoné pour lui annoncer qu’ils prenaient tous les quatre deux semaines de vacances. Il s’était mis en colère et avait menacé de les renvoyer s’ils ne se présentaient pas à leur travail le soir même. Larry lui avait répondu que c’était comme ça et que si ça ne lui plaisait pas, il n’avait qu’à aller se faire enculer.
Cette réaction l’avait déconcerté, non pas pour les mots, il s’était habitué à ce type de langage venant de leur part, mais pour le fait qu’ils avaient sans cesse besoin d’argent et qu’ils tenaient à leur emploi.
Il lui confia en aparté qu’une grande partie de leurs gains partait en consommation de diverses substances prohibées.
Lors de la matinée de sa dernière journée à Berlin, Michael Stern eut rendez-vous avec Birgit, la femme dont Jim Ruskin était tombé amoureux peu de temps avant sa disparition.
Celle-ci lui livra une information qui attisa son intérêt.
Le lundi 13 mars, Jim Ruskin lui avait annoncé qu’il ne jouerait pas au Yoyo Bar le lendemain. Le groupe avait accepté un autre engagement. Il avait ajouté de manière laconique qu’ils allaient enfin sortir de l’anonymat.
Elle avait voulu en savoir davantage, mais Jim n’en avait pas dit plus. Il tenait à ce que cette soirée ait lieu et prétendait que cela porterait malheur s’il révélait quoi que ce soit avant son déroulement.
Le mercredi 15 mars, il lui avait appris qu’ils avaient participé à un enregistrement la veille et qu’un disque de Pearl Harbor serait bientôt dans les bacs.
Larry Finch, Steve Parker et Paul McDonald avaient profité de l’argent qu’ils avaient encaissé pour prendre quelques jours de vacances. Jim Ruskin avait quant à lui choisi de rester à Berlin pour passer plus de temps avec elle.
Selon elle, c’était un homme optimiste, enthousiaste et en pleine possession de ses moyens. Elle ne pouvait concevoir qu’il ait pris la décision de mettre fin à ses jours sur un coup de déprime passager.
Stern chercha à en savoir plus sur l’enregistrement dont Birgit avait parlé, mais ne parvint pas à obtenir plus d’informations. L’après-midi, il se rendit chez plusieurs disquaires de la ville, mais aucun d’eux n’avait entendu parler d’un disque enregistré par un groupe appelé Pearl Harbor.
Avant de prendre son vol de retour pour Belfast, il apprit que Berlin comptait pas moins de trente et un studios d’enregistrement, allant du prestigieux Hansa Tonstudio jusqu’à certains studios amateurs pauvrement équipés que l’on pouvait louer à la journée, à l’heure ou même à la minute.
De retour à Belfast, il prit contact par téléphone avec ces différents studios, mais aucun d’eux n’avait organisé de séances d’enregistrement dans la soirée du 14 mars au nom de Pearl Harbor. Seuls deux enregistrements avaient été programmés ce soir-là, une chorale de gospel et un duo de flûtistes.
Il proposa au rédacteur en chef de son journal de faire paraître un premier article sur cette série de disparitions troublantes, mais n’obtint pas son accord.
Ce dernier estimait que dans l’état actuel de l’enquête, les faits qu’il avait récoltés ne suffisaient pas pour présumer d’une quelconque forme de machination. Il lui conseilla de poursuivre ses investigations, mais sans investir trop de temps dans cette affaire.
Il lui assura qu’il reverrait sa position si de nouveaux éléments apparaissaient.
Trois jours plus tard, Birgit lui téléphona pour lui signaler qu’elle se souvenait d’un détail qui n’avait peut-être aucune importance. La veille du jour supposé de l’enregistrement, alors qu’il se trouvait chez elle, Jim avait passé un coup de téléphone, ce qui était inhabituel de sa part.
Il avait échangé quelques mots en allemand et mentionné plusieurs titres de rock. Elle se rappelait que son interlocuteur s’appelait Karl. Il avait prononcé plusieurs fois son prénom et lui parlait avec respect.
En fin de semaine, Stern fit le point sur l’état d’avancement de son enquête. Quelques questions restaient en suspens et demandaient une réponse.
Que s’était-il passé durant la soirée du 14 mars ?
En quoi consistait cet enregistrement dont Ruskin avait parlé et où s’était-il déroulé ?
Pourquoi le disque, si disque il y avait, n’était-il pas sorti dans le commerce ?
Enfin, qui était ce Karl à qui Jim Ruskin avait parlé ?
Il parcourut ses notes et eut l’impression diffuse qu’il avait sous les yeux une information-clé. Il relut plusieurs fois ses feuillets, mais ne parvint pas à la cerner.
Ce phénomène se produisait de temps à autre. Il savait que tôt ou tard l’information remonterait au niveau de sa conscience.
35
Un bon concert de rock
Des hordes de Noirs se succèdent sur l’écran. Tous portent des lunettes solaires et des monceaux de bijoux. Ils vont et viennent devant la caméra en agitant leurs mains. En arrière-plan, des femmes à moitié à poil se trémoussent sur le capot de grosses américaines rutilantes.
Les rythmes sont assommants, les mélodies inexistantes, les paroles répétitives.
Qu’ont-ils fait de la musique ?
Chess, un Anglais que j’avais connu chez Popov, m’avait laissé une adresse avant de rentrer à Londres. Je n’avais pas eu beaucoup d’échanges avec lui à Paris. Il parlait mal français et je ne connaissais que quelques mots d’anglais.
Dès qu’il en avait l’occasion, il sortait un jeu d’échecs de son fourre-tout et partait en quête d’adversaires. S’il n’en trouvait pas, ce qui était souvent le cas, il jouait seul. Cela ne semblait pas le déranger, bien au contraire, il disait que cela lui assurait la victoire. De temps à autre, je me dévouais et m’asseyais en face de lui. Il aimait jouer avec moi, sa victoire était d’autant plus facile.
L’adresse conduisait à un pub dans Soho, le Bricklayers Arms, sur Strip Alley. Chess y passait ses après-midi à jouer aux échecs.
J’ai pris conscience des difficultés qui m’attendaient lorsque je me suis mis à la recherche du bar. J’étais un déserteur, un fuyard recherché par la police. Je me trouvais seul dans une ville surpeuplée et je ne connaissais que quelques mots d’anglais, pour l’essentiel ceux que j’avais appris en écoutant du rock.
Par chance, Chess était présent. Il semblait content de me revoir. Je lui ai dit qu’un événement imprévu avait précipité ma venue à Londres, mais il ne m’a pas posé de questions. Pendant un bon moment, nous avons cherché nos mots. Il m’a finalement confié qu’il avait trouvé un bon plan et allait tenter de m’en faire profiter.
Le bon plan s’appelait Brian. Brian était un gosse de riches dont le père était mort d’un cancer un an auparavant. Il avait hérité de la maison familiale, d’une collection d’œuvres d’art et d’une belle somme d’argent. Brian reniait ses origines bourgeoises et rêvait d’être des nôtres. Dénué de scrupules, il avait expédié sa mère à l’hospice pour prendre possession de la maison.
Depuis, il hébergeait une quinzaine de types dans notre genre, à deux ou trois par chambre. Il pensait que ce geste de générosité lui octroyait un crédit suffisant pour se revendiquer de notre bord.
Chess et moi sommes allés chez lui, à Hampstead. La maison était magnifique et me faisait penser aux décors de Mary Poppins. Chess est entré et a discuté avec Brian. Il est ressorti avec un large sourire aux lèvres. Brian m’acceptait, je pouvais m’installer, il restait une place dans une chambre au troisième étage.
L’intérieur de la maison était moins propret. Des relents de bière et de tabac flottaient dans l’air. Les murs étaient chargés d’inscriptions et de dessins obscènes. De la musique venue de différents recoins de la maison formait une douce cacophonie. Brian m’a serré la main et m’a guidé jusqu’à ma chambre.
Malgré l’obstacle de la langue, il ne m’a fallu que peu de temps pour cerner le personnage.
Brian était filiforme, boutonneux, mal dans sa peau, en perpétuelle recherche de reconnaissance. Ses mains étaient fines et manucurées. Il portait des cheveux longs, comme nous, mais les siens étaient entretenus chez un coiffeur coûteux. Il avait fait des trous dans ses jeans et troqué ses pulls en shetland pour des vestes kaki qui provenaient d’un surplus américain. Dans le dos de celles-ci, en plus d’un N et d’un D, Nuclear Disarmament, il avait barbouillé une phrase du genre « Sois beatnik avec moi ».
Personne parmi nous ne revendiquait un tel statut. Le mot avait été inventé par nos détracteurs et venait de la contraction de beat, pour battement, et de spoutnik. Même si nous dénoncions l’impérialisme américain, nous n’étions pas pour autant fervents de Brejnev. Ce raccourci leur permettait de nous marginaliser en nous collant une étiquette d’extrémistes de gauche. Ils nous accusaient en outre de propager des idées subversives.
Nous ne contestions pas : cette mise au ban d’une société que nous rejetions nous convenait.
Brian ne se contentait pas de nous héberger. La cuisine regorgeait de victuailles, le frigo était rempli de bières et des rangées de bouteilles d’alcool garnissaient les étagères. Dans un tiroir du bureau, de l’herbe, du hasch et des quantités de pilules étaient à notre disposition.
Brian était fier de porter le même nom que le leader des Rolling Stones. Il lisait Faulkner, se piquait de tout savoir sur les groupes anglais et se gavait d’amphétamines. Quand il n’avait plus d’argent, il allait en chercher à la banque. Brian était d’une stupidité consternante, mais nous jouions le jeu.
En agissant de telle manière, nous savions que nous piétinions l’un des principes fondamentaux de notre philosophie basée sur le renoncement aux biens matériels, mais nous prenions un arrangement avec notre conscience. Nous nous persuadions que cette situation n’était que temporaire, qu’elle ne constituait qu’une courte pause entre deux actes. Cette situation temporaire a duré pour moi plus d’un an.
Au début, ma faible connaissance de l’anglais m’a permis de supporter sans broncher les crises d’autorité que Brian nous infligeait régulièrement. Sans crier gare, il se mettait à hurler, exigeait que nous rangions la maison, nous intimait l’ordre de nettoyer les chambres. Plus d’une fois, ce genre d’accès a débouché sur le départ précipité d’un locataire.
Au sous-sol, il avait installé une sorte de club privé nanti d’un bar bien achalandé et de lumières tamisées. En plus d’un matériel de sonorisation dernier cri et d’un enregistreur Grundig deux pistes, des instruments de musique étaient éparpillés dans la pièce, un piano, six guitares et deux saxos. Une dizaine d’amplis à lampes Marshall étaient posés contre les murs. Au fond, une batterie Premier quasi neuve prenait la poussière.
Incapable d’émettre une note de musique sur le moindre instrument, Brian espérait attirer des musiciens qualifiés et mettre sur pied des concerts improvisés.
Hormis les bénéficiaires de ses largesses, personne ne le prenait au sérieux et jamais quiconque n’avait accepté l’invitation. La pièce était fermée à clé et personne n’avait le droit d’y mettre les pieds.
Lucy était la seule représentante de la gent féminine dans la maison. Elle logeait au second étage, dans une chambre qu’elle occupait seule. Celle-ci était située à l’arrière et donnait sur le jardin. Les notes de Water Music, d’Haendel filtraient sous sa porte.
Lucy était l’une des nôtres. Avant de la rencontrer, je n’aurais jamais imaginé qu’une femme puisse être attirée par notre style de vie. Elle venait d’une bourgade du nord de l’Angleterre. Après avoir erré en Europe pendant deux ans, elle était revenue en Angleterre et s’était arrêtée chez Brian.
Elle était belle, mais se préoccupait peu de son apparence. Elle avait des cheveux noirs, des yeux bruns en amande et des dents éblouissantes. Elle s’amusait de tout, lançait des bons mots à longueur de temps et riait de bon cœur, à la manière de Dominique. Comme lui, c’était une manipulatrice hors pair, elle tournait Brian autour de son petit doigt et lui faisait faire ce qu’elle voulait.
Lucy n’était pas une pute, mais pour quelques livres, elle acceptait de faire une fellation, rien de plus. La première fois que je suis allé la trouver, elle a pris mon sexe entre ses mains et a sifflé longuement. Elle a dit que membré comme je l’étais, elle allait devoir exiger un double tarif. Elle prétendait que n’importe quel homme pouvait séduire n’importe quelle femme, pour autant qu’il ait un peu d’humour ou une bite de trente centimètres.
Une autre fois, elle s’était composé une monstrueuse grimace en comprimant son visage entre ses mains. Elle m’a demandé d’une voix nasillarde si j’étais prêt à me faire sucer par une femme avec une tête pareille. Elle ne voulait pas qu’on la considère comme une prostituée, c’était sa façon de se disculper et de prendre du recul par rapport à l’acte.
Ses pitreries terminées, elle prenait une gorgée de thé brûlant et prenait mon sexe dans sa bouche. L’effet était prodigieux, je parvenais à l’orgasme en quelques minutes. Quand j’éjaculais, elle comprimait mon gland entre ses seins et récoltait mon sperme dans ses mains.
Le jour de mes vingt ans, elle m’a gardé dans sa bouche et a avalé ma semence. Elle ne m’a pas réclamé d’argent et m’a demandé de rester avec elle. Je ne m’étais pas rendu compte avant ce moment que notre relation avait pris un tour nouveau.
Il m’a fallu près de trois mois pour maîtriser les rudiments de la langue anglaise et commencer à me faire comprendre. Petit à petit, j’ai pu me mêler aux conversations.
Chaque jour, les journaux rapportaient que Johnson avait ordonné de nouveaux bombardements au Vietnam. Le peuple vietnamien crevait sous les tonnes de bombes au napalm.
Les locataires de la maison en parlaient à peine. Pour eux, le monde tournait autour de la musique. Les swinging sixties battaient leur plein et la déferlante des groupes britanniques constituait le principal sujet de conversation. Il n’était de jour sans que l’on annonce l’ascension d’un nouveau groupe. Tous avaient du génie, de l’inventivité et un avenir assuré. En plus des Beatles, les incontestables têtes de liste qui en étaient à leur quatrième album, des dizaines de groupes se profilaient comme candidats à leur succession.
Ils en parlaient à longueur de journée avec une passion qui frisait l’hystérie. Certains ne juraient que par les Rolling Stones qui avaient pris le contre-pied des gentils Beatles en se profilant comme les méchants Stones. D’autres idolâtraient les Pretty Things. Plus laids les uns que les autres, ils cherchaient à se démarquer des Stones en étant plus odieux et en faisant faire plus de bruit qu’eux.
Chess voyait en les Animals les meilleurs représentants du rock britannique, grâce à Alan Price et à son orgue survolté ou à Eric Burdon qui ne chantait pas juste, mais criait de manière passionnée et sauvage. Manfred Mann remportait la faveur d’un bon nombre, c’était un groupe de musiciens professionnels composé d’un vrai chanteur et d’un faux batteur qui tenait ses bâtons comme s’il faisait monter des œufs en neige.
Brian, fidèle à ses origines, trouvait que les Kinks avaient de la classe sous couvert qu’ils montaient sur scène dans des vestes de chasse rouges. En revanche, il désapprouvait les Who qui cassaient tout pendant leurs concerts et quittaient la scène en la laissant tel un champ de bataille avec des résidus de batterie, des fragments de guitares et des morceaux d’amplis qui jonchaient le sol.
C’est lors d’une de ces discussions que j’ai appris qui était Eric Clapton. Après le triomphe de For Your Love, il avait quitté les Yardbirds et avait rejoint les Bluesbreakers de John Mayall pour retourner au blues.
Une chose était sûre, que le sujet soit la politique, le sexe ou la drogue, tout passait par le rock’n’roll.
À l’automne, j’ai reçu des nouvelles de Paris. La mort de Floriane avait des côtés sombres et j’étais recherché comme témoin. La police connaissait l’un de mes surnoms, mais ne m’avait pas identifié. Roman et Jimbo étaient eux aussi recherchés. Aux dernières nouvelles, ils avaient embarqué pour l’Amérique du Sud.
Pour brouiller les pistes, et à la demande de Lucy, je m’étais rasé. Elle disait que la barbe faisait vieux jeu, aucune star du rock, à part le pseudo-intellectuel de Manfred Mann, n’en portait. Nous poursuivions notre relation particulière. J’aimais m’endormir dans son corps. Elle était douce et me faisait rire. Elle m’écrivait des mots gentils ou drôles qu’elle glissait dans mes poches et que je découvrais au fil de la journée.
Brian ne connaissait pas la nature de notre relation. Il ne l’aurait pas supporté et nous aurait jetés à la rue.
Les nouvelles en provenance de Paris me poussaient à me faire confectionner d’autres papiers. J’avais reçu l’adresse d’un restaurant dans Clerkenwell Road. Il suffisait de commander le plat du jour et de glisser un mot de passe au serveur.
Dès le lendemain, j’y suis allé. Ils pouvaient me fournir un passeport canadien plus vrai que nature, mais il fallait attendre plusieurs semaines et débourser une somme que j’étais loin de posséder.
Par la force des choses, je suis devenu laveur de vitres. J’ai acheté le matériel nécessaire chez Domestic’s et j’ai entamé ma prospection en sonnant aux portes des maisons du quartier.
Hampstead était un coin prospère. Je prenais l’air du gars de bonne volonté. J’expliquais que j’étais Français, que je faisais le tour du monde et que je ne connaissais que quelques mots d’anglais. Assez rapidement, j’ai acquis ma clientèle.
Ce boulot me convenait. Hormis quelques phrases de politesse et des banalités sur la météo, nous en restions là, on me fichait la paix. Je faisais mon travail sans me hâter, sans bâcler le résultat ou chercher à augmenter ma cadence comme le faisaient mes pairs. Je n’avais pas de tarif, les gens me donnaient ce qu’ils voulaient. Certains en profitaient et me refilaient quelques pièces de monnaie, d’autres se montraient d’une générosité surprenante.
En septembre, l’un de mes clients m’a demandé si je connaissais un groupe appelé les Rolling Stones. Son fils avait une place pour un concert qui se déroulait le soir même, mais il avait quarante de fièvre. Je n’en croyais pas mes oreilles. Je lui ai confié que j’étais fou de rock, il m’a donné une tape dans le dos et m’a offert le billet d’entrée.
Je suis rentré chez Brian en guettant les passants, le précieux billet serré contre mon cœur. Je l’aurais déposé dans le coffre-fort d’une banque si j’en avais eu les moyens. Après le concert, j’ai conservé le coupon jusqu’à ce qu’il se désagrège et devienne poussière. J’ai encore sous les yeux le petit carré de papier blanc. Je peux y lire les références qui y étaient inscrites, Stalls 8 juin J 24.
Je n’étais jamais allé à un concert et je ne connaissais du rock que ce que j’en entendais par les disques ou ce que j’en voyais à la télévision.
Nous étions le 24 septembre et ce jour-là, les Stones sortaient leur deuxième album, Out of Our Head, qui reprenait entre autres, le sulfureux single Satisfaction. Ils entamaient la campagne de promotion par une tournée britannique.
Le stage show avait lieu à l’Astoria Theatre de Finsbury Park. Les Stones se produisaient à deux reprises, la première fois aux environs de dix-huit heures, la seconde à vingt et une heures.
Mon billet était valable pour la deuxième session. Je suis arrivé sur place avec une heure d’avance. J’avais bu et fumé en prévision de l’événement.
La salle était déjà pleine à craquer. Des centaines de filles criaient sans discontinuer. Je pensais qu’elles allaient s’arrêter quand les Stones entreraient en scène.
Lorsque le rideau s’est levé, les hurlements ont redoublé. Je parvenais à peine à entendre le riff d’entrée de Keith Richards. Mon voisin m’a crié dans l’oreille qu’il s’agissait de She Said Yeah. Les filles se sont mises à pleurer, à secouer la tête, certaines défaillaient et devaient être évacuées sur une civière. Les gens martelaient le sol, gesticulaient, frappaient dans les mains.
Sur la scène, je ne voyais que Mick Jagger. Il était sauvage et obscène. Ses lèvres rouge sang, épaisses et luisantes illuminaient la salle tel un phare. Il se déhanchait, rabattait ses cheveux sur son visage, courait d’un bout à l’autre de la scène, tournait le dos au public, se pliait en deux, remuait les fesses, glissait le micro entre ses jambes.
Noyés dans le vacarme, ils ont chanté une dizaine de chansons. Satisfaction était la dernière, le sommet, l’apothéose. Le public s’est rué vers la sortie quand ils ont quitté la scène, dans l’espoir de les rattraper avant leur départ.
Je me suis assis, assommé, épuisé, émerveillé, terrorisé.
Lorsque les derniers spectateurs ont quitté la salle, j’étais vissé sur mon siège. Je voulais m’imprégner de ces instants jusqu’à l’ultime fraction de seconde. Je savais que désormais, rien ne serait plus comme avant.
Quand le service de nettoyage a fait irruption dans la salle, j’étais toujours prostré. Ils m’ont interpellé et m’ont demandé ce que je faisais là.
Je suis sorti du brouillard.
Une forte odeur d’urine contrariait mes narines. Les filles avaient hurlé avec tellement de passion qu’elles s’étaient pissé dessus. Le sol était moite, l’odeur prenait à la gorge.
Par la suite, je me suis habitué à cette puanteur. J’ai fini par la considérer comme l’indicateur d’un bon concert de rock.
36
Je t’aime
Le mardi 21 septembre, Dominique avança dans le couloir et entama son mode de fonctionnement routinier. Après avoir parodié un échange vaudevillesque, il entra dans la chambre.
Il salua X Midi, déposa la télécommande dans sa main et lui choisit le prénom du jour sans recevoir de réaction de sa part.
Lorsqu’il entama les massages, il perçut un infime frémissement dans les membres de l’homme.
Il observa son visage.
Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front et ses lèvres tremblaient légèrement. Il décela un éclat inhabituel dans son regard. L’homme centrait son attention sur l’écran de la télévision et semblait en proie à une vive agitation intérieure.
La chaîne diffusait un reportage sur U2, le groupe irlandais qui se produisait le lendemain au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. La totalité des places avait été vendue depuis plus d’un an et le concert se jouerait à guichet fermé. Les admirateurs du groupe étaient sur les charbons ardents et l’arrivée imminente des musiciens provoquait une grande effervescence dans la capitale belge.
Le court-métrage retraçait les préparatifs du 360° Tour. On y voyait le groupe sur scène, interprétant Get On Your Boots, l’un des morceaux de leur dernier album.
Dominique poursuivit ses soins comme s’il n’avait rien remarqué. Après quelques instants, il se redressa avec nonchalance.
— J’ai bu trop de café, Barnabé, je dois aller au petit endroit. Surtout, ne t’en va pas, je reviens tout de suite.
Il s’assura que la télécommande était ancrée dans la main de X Midi. Avant de quitter la pièce, il bascula le programme de la télévision sur une chaîne de téléachats. Il referma ensuite la porte derrière lui, s’éloigna dans le couloir et se tint à proximité de la porte.
Il interdit l’accès à une infirmière qui se dirigeait vers la chambre.
— Reviens plus tard, s’il te plaît. Je fais une petite expérience.
Il patienta encore quelques instants puis fit son retour dans la chambre.
La télévision diffusait à nouveau le reportage sur le groupe de rock et le volume du son était plus élevé.
Il s’approcha et s’immobilisa au milieu de la chambre, les poings sur les hanches, l’air faussement ébahi.
Après quelques instants, les yeux de l’homme quittèrent l’écran et s’ancrèrent dans les siens.
Il cligna des yeux et des larmes apparurent.
Dominique ne se méprit pas, il n’y avait pas de tristesse dans ces larmes, X Midi était pris d’un inextinguible fou rire.
Dominique se pencha vers lui, lui épongea les yeux.
— Tu sais quoi, Barnabé ? Je t’aime.
37
J’espère mourir avant d’être vieux
Avec ses yeux ronds et sa mimique d’abruti, sa tête valait le détour. Moi aussi, je l’aime bien. Il me soulage et me fait rire. Il s’adresse à moi normalement. Les gens qui passent s’imaginent que je suis sourd parce que je ne parle pas. Ils se mettent à hurler, me parlent en petit nègre ou articulent des mots simplets comme si j’étais un enfant.
Cela fait plus d’un demi-siècle que la disquaire a lancé son funeste présage et le rock est toujours bien vivant. Il semble même au mieux de sa forme : ces Irlandais libèrent une puissance impressionnante.
Rubber Soul est sorti à Noël. La presse estimait que c’était l’album le plus complexe et le plus abouti des Beatles. Pour ma part, j’étais quelque peu déçu, je trouvais que le beat était plus mou et que certains textes sentaient la prise de tête. C’étaient les signes avant-coureurs d’un changement profond, une frange non négligeable du rock allait se ramollir et se prendre au sérieux.
Birkin est arrivé dans les premiers jours de 66. C’était un frileux matin d’hiver, je partais travailler. J’ai ouvert la porte. Comme un mirage, il a émergé du brouillard qui engloutissait la rue.
Je n’ai jamais su si ce n’était qu’un surnom ou s’il s’appelait réellement Birkin, mais tout le monde l’appelait comme cela.
Birkin venait de nulle part. Il m’a dit qu’il arrivait en droite ligne de Buenos Aires où il avait vécu deux ans. J’ai remarqué par la suite que sa version changeait selon les circonstances et les gens auxquels il s’adressait.
Il était petit, maigrichon et portait des cheveux courts avec une raie bien nette sur le côté. Il débordait d’énergie et semblait à tout moment détenir la nouvelle la plus surprenante qui soit. C’était un ami d’enfance de Brian. Il connaissait tout le monde à Londres et jouait de l’harmonica comme un dieu.
Il a emménagé dans ma chambre, suivi de près par ses quinze valises.
Nous nous situions aux antipodes l’un de l’autre, tant par notre apparence que par notre tempérament. Il était toujours tiré à quatre épingles, j’étais débraillé, il parlait sans cesse, j’étais taciturne. Il se levait chaque matin de bonne humeur et voyait la vie de manière positive, je me méfiais de tout. Nous sommes pourtant devenus les meilleurs amis du monde.
À toute heure du jour ou de la nuit, il sortait son harmonica de sa poche, l’emprisonnait au creux de ses mains et le faisait rire ou pleurer. Je n’en croyais pas mes oreilles. C’était comme si ce banal morceau de bois était animé par ses propres émotions. J’étais ébloui par son talent. J’interrompais ce que je faisais et je l’écoutais, subjugué.
Birkin faisait partie des mods. La jeunesse branchée londonienne était divisée en deux clans distincts et rivaux, les mods et les rockers. Une maxime affirmait qu’il fallait être mod ou rocker pour être quelque chose. Je ne comprenais rien aux courants de pensée et aux préférences musicales qui les opposaient, les raisons de leur antagonisme m’échappaient.
D’après Birkin, les mods étaient des citoyens du monde qui se voulaient tournés vers l’avenir, ils étaient optimistes et décontractés. En public, un mod se devait de ne jamais sourire. Shepherd’s Bush, un quartier à l’ouest de Londres, était leur point de ralliement.
Les rockers n’étaient selon lui qu’une résurgence malsaine des Teds, les Teddy Boys des années cinquante. Avant de lisser leur image, les Beatles étaient de vrais Teds. Ils cherchaient la bagarre, s’empoignaient pour un oui ou pour un non et étaient interdits d’entrée dans les pubs de Liverpool. Sous des dehors de poète du prolétariat, Lennon était le plus querelleur des quatre.
Les néophytes tels que moi différenciaient les mods des rockers par leur aspect extérieur. Les premiers portaient des costumes italiens taillés sur mesure. Ils se changeaient plusieurs fois par jour et sillonnaient les rues de la capitale en scooters Vespa customisés. Leur mouvement était à l’origine du phénomène de Carnaby Street, du nom de cette rue londonienne qui était devenue l’épicentre de la mode et de la révolution culturelle au début des années soixante.
Les rockers arboraient une banane enduite de gomina. Ils étaient vêtus de jeans et de blousons de cuir noir rehaussés de clous ou de chaînes. Ils se déplaçaient en grosses motos anglaises, Triumph, Norton ou BSA et se retrouvaient à la périphérie des villes.
Les mods et les rockers formaient deux clans fanatiques. Les mods considéraient les rockers comme des voyous, les rockers disaient des mods qu’ils n’étaient que des minets efféminés.
Leurs redoutables bagarres avaient tourné en guerre sainte. Quand ils ne travaillaient pas, ils se donnaient rendez-vous en bord de mer et se livraient à de véritables batailles rangées.
Birkin ne sortait jamais sans son hameçon, sa matraque et son couteau de poche. Il les dissimulait dans la doublure de la parka militaire qui protégeait ses beaux habits.
Quand je lui ai présenté ma collection de disques, il n’a pas daigné y jeter un coup d’œil. Je n’avais pas d’album des Who, je ne connaissais ni les Small Faces ni Georgie Fame. Je devais arrêter d’écouter des disques enregistrés en studio et partir à la rencontre du rock authentique.
Je lui ai parlé de la forte impression que j’avais gardée du concert des Stones. Il a semblé plus surpris que d’habitude. Il s’est engagé à parfaire mon éducation musicale, il avait ses entrées dans la ville et allait me faire découvrir la musique sous une autre facette.
Londres fourmillait de clubs. Les plus courus par les fans de rock étaient le Marquee et le Crawdaddy. Les amateurs de rythm and blues se retrouvaient au Club Ealing. Ce dernier était situé en sous-sol, sous la gare. Un trottoir de verre passait au-dessus de la scène, les musiciens qui s’y produisaient avaient les pieds dans l’eau et l’impression qu’on leur marchait sur la tête. Des dizaines d’autres endroits égayaient les nuits londoniennes, le Adlib Club, le Scotch, le Sybilla’s, le Flamingo, le Red Lion, le Bag O’Nails, le Speakeasy, le Revolution, et d’autres encore dont j’ai oublié le nom. Ils étaient différents à la base, mais ont fini par se ressembler.
Le premier que Birkin m’a fait découvrir était le Marquee. Il était situé à Wardour Street, au cœur de Soho. Les Stones y avaient fait leurs débuts avant de devenir le groupe à résidence du Crawdaddy. Il était dirigé de main de maître par un certain Harold, un dingue de jazz et de blues qui avait surfé sur la déferlante des premiers groupes de rock britanniques.
Birkin le connaissait bien, il avait été amené à remplacer à plusieurs reprises Cyril Davies, un harmoniciste qu’une leucémie avait emporté l’année précédente. Je ne lui ai pas demandé comment il était parvenu à réaliser cette prouesse, il était censé se trouver en Argentine.
Birkin avait une admiration sans bornes pour les Who. Le groupe se produisait au Marquee tous les mardis soirs. Les concerts se jouaient à guichets fermés, mais Harold avait une dette envers Birkin.
Nous y sommes allés fin janvier. Ce soir-là, j’ai vu le groupe le plus extravagant de la planète. J’avais entendu parler de leurs facéties sur scène, mais ce que j’ai vu dépassait de loin ce que j’imaginais.
Dès leur entrée en scène, on pressentait qu’ils étaient teigneux et violents. Ils étaient d’humeur maussade, lançaient des regards agressifs au public et se houspillaient pendant la mise en place. Au lieu de clore leur passage par leur plus grand hit, comme l’avaient fait les Stones, ils ont commencé par le fracassant My Generation qui était en tête du hit parade.
Le chanteur, Roger Daltrey, gesticulait, virevoltait, hurlait, bégayait et faisait tournoyer son micro à toute vitesse comme s’il s’agissait d’un lasso. Le bras tendu, Pete Townshend produisait de grands moulinets et martelait les cordes de sa guitare avec une force incroyable.
Leur rock était bruyant, instinctif et destructeur. Dans la salle, l’ambiance était survoltée. Les filles étaient en minorité, mais elles hurlaient plus fort encore que pour les Stones.
En plus de l’hystérie, je décelais des accents de terreur dans leurs cris, comme si on les avait attirées dans un piège. J’étais sidéré et quelque peu inquiet, lors d’un concert des Stones, une fille s’était jetée du troisième balcon et s’était tuée en blessant grièvement un spectateur.
De leur côté, les gars étaient furieux de voir leur petite amie dans un tel état et voulaient en découdre. Des coups de poing s’échangeaient en fond de salle.
Au milieu de l’ouragan de décibels, je n’avais d’yeux que pour Keith Moon, le batteur. Son charisme me fascinait. La bouche ouverte, les yeux révulsés, il cognait, cognait et cognait encore. Comme si sa vie en dépendait, il cognait, cognait, sans pause, sans respiration. Son jeu semblait chaotique, mais était soutenu par une prodigieuse technique. The Ox, un morceau de quelques minutes dans l’album, s’étirait sur plus d’une demi-heure et démontrait l’étendue de son génie. Tout en roulements de toms, il faisait trembler la scène et le sol. Les deux grosses caisses qu’il martelait à un rythme effréné émettaient un grondement de tonnerre qui se propageait jusqu’au fond de la salle.
Mes oreilles bourdonnaient, mes mains tremblaient. Le son qu’il générait était si violent que j’en avais la vue brouillée.
Lors du dernier morceau, Pete Townshend a poussé le volume à fond, s’est emparé de sa guitare et a fait mine de la briser en deux sur sa cuisse. Les amplis saturaient et crachaient du Larsen. De la fumée s’est échappée de l’arrière de l’un d’eux. Daltrey a envoyé valdinguer son micro contre la grosse caisse, le plafond, les amplis. Keith Moon, debout, donnait de grands coups de pieds dans ses cymbales, ses toms et ses grosses caisses.
En finale, Townshend a empoigné sa guitare par le manche et, telle une hache, s’est mis à la fracasser contre le sol. Ensuite, il s’en est pris aux amplis. L’épilogue était à ce point brutal qu’un mouvement de panique s’est emparé d’une partie du public. Certains spectateurs cherchaient à gagner la sortie.
Je suis sorti du club anesthésié, sourd et groggy. Birkin avait un regard halluciné. Une phrase, lancinante, inhumaine, tourbillonnait dans ma tête.
Par la suite, je l’ai souvent fredonnée à voix basse, jusqu’à en faire l’un de mes credos.
J’espère mourir avant d’être vieux.
38
Lui sauta aux yeux
Le manque d’enthousiasme du rédacteur en chef du Belfast Telegraph ne suffit pas à décourager Michael Stern. Le journaliste poursuivit avec opiniâtreté son enquête au départ de Belfast.
Il reprit contact avec les membres des familles dans l’espoir de recueillir des informations sur l’enregistrement dont avait parlé Birgit, l’amie de Jim Ruskin.
La tante de Larry Finch lui tint le même discours que lors de la sollicitation des Parker, elle ne savait rien et ne voulait plus entendre parler de cette affaire.
Du côté des Parker, ni les parents ni les amis de Steve n’avaient eu de ses nouvelles durant les jours qui avaient précédé sa mort. John Ruskin, le père de Jim, lui tint un langage identique.
Il revint également bredouille de l’entretien qu’il eut avec la famille de Paul McDonald. Le dernier appel téléphonique que celui-ci avait donné datait du début du mois de mars et était adressé à son fils Jason.
Personne n’avait entendu parler d’un enregistrement.
Début octobre, il prit contact avec George West, le détective londonien que les parents de Steve Parker avaient embauché. Il se doutait que ce dernier rechignerait à coopérer avec lui et prépara ses questions.
Il voulait savoir si les prostituées qu’il avait interrogées à Hambourg se souvenaient d’avoir entendu Steve Parker parler d’un enregistrement. Comme il s’y attendait, George West répondit par la négative.
En revanche, la conversation qu’il eut avec le détective lui inspira une idée de piste à explorer.
À son tour, il revint sur la question que West avait soulevée lors de la réunion à Londres, d’où provenait l’argent dont les quatre hommes disposaient tout à coup, cet argent dont Jim Ruskin avait fait mention lors de sa rencontre avec Birgit au lendemain de l’enregistrement ?
En effet, Steve Parker s’était offert à plusieurs reprises les services de prostituées et les avait payées en marks. L’une d’elles se souvenait avoir reçu un pourboire royal. S’il s’était procuré une arme à Hambourg, comme la police l’avait laissé entendre, il avait dû s’acquitter d’une somme d’argent conséquente, toujours en espèces au vu de ce genre de trafic.
Stern téléphona au Kastanien, l’hôtel dans lequel Parker avait séjourné à Hambourg. Il reçut la confirmation que Steve avait réglé sa note au comptant, en argent allemand.
Il ne lui fut pas possible de retrouver la trace du billet que Steve Parker avait acheté au marché noir pour le concert de Jimi Hendrix, mais nul doute qu’il avait également été payé en espèces.
Si les membres de Pearl Harbor avaient participé à un enregistrement, il était néanmoins peu probable qu’ils aient été payés le soir même. Il n’était pas dans les habitudes de la profession de rémunérer ce type de prestations. En règle générale, les artistes étaient rétribués par la suite, par un pourcentage sur les ventes, sauf en cas de contribution ponctuelle réalisée par un musicien de studio.
Il décida d’approfondir cette piste et lança une nouvelle série d’appels téléphoniques qui lui apportèrent quelques informations intéressantes.
Larry Finch avait réglé son voyage à Majorque en espèces, à l’agence de voyages de Berlin. Pourtant, il n’y avait pas eu de mouvement sur son compte en banque qui comportait un solde négatif et était provisoirement bloqué. Selon l’entraîneuse avec laquelle il avait passé la nuit à Majorque, il se trouvait en possession d’une grande quantité de pesetas.
Le parcours de Paul McDonald se révéla encore plus intrigant.
Il avait payé en espèces son billet d’avion pour Londres et en avait fait de même pour régler la facture du premier hôtel dans lequel il était descendu. Le 22 mars, il s’était rendu dans une agence de la Barclays à Glasgow et avait vidé son compte en banque. Il était revenu à Londres le soir même et s’était installé au Samarkand. Peu après son arrivée, il avait changé des marks à la réception et avait payé six jours d’avance.
Cette récolte d’informations l’amena à se poser un nouveau lot de questions.
D’où venait l’argent qui avait permis à Larry de s’offrir un voyage de plusieurs centaines de marks et de le payer en espèces ? Ces marks qui avaient permis à Steve Parker de s’offrir les services de prostituées et un billet pour le concert de Jimi Hendrix ? Ces mêmes marks que Paul McDonald avait laissés sur le comptoir de la British Airways de Berlin ? Pourquoi ce dernier avait-il versé une avance en marks alors qu’il venait de retirer des livres à Glasgow ? Pourquoi s’était-il fait enregistrer au Samarkand sous le nom de sa mère ? En bref, d’où venaient ces marks ?
D’autre part, Stern chercha à identifier le correspondant de Jim Ruskin, le dénommé Karl à qui il avait parlé au téléphone chez Birgit.
C’était un prénom très courant en Allemagne et il dut rapidement abandonner cette piste pour revenir à celle du studio d’enregistrement.
Si le studio où s’était produit cet enregistrement n’était pas l’un des trente et un recensés à Berlin-Ouest, il restait deux hypothèses ; soit il se trouvait hors de Berlin-Ouest, ce qui impliquait un passage du Mur, peu vraisemblable au vu de la tension régnante et du fait que l’événement semblait être survenu à brûle-pourpoint, soit il s’agissait d’un studio privé, voire d’un studio aménagé à cet effet, ce qui paraissait peu probable.
Michael Stern en conclut que cet enregistrement n’avait probablement pas eu lieu et que c’était une histoire que Jim Ruskin avait inventée pour justifier auprès de Birgit l’apparition de l’argent et le départ des trois autres.
Le jeudi 26 octobre 1967, il reçut l’appel d’un certain Stuart Bloomfield. Ce dernier habitait dans la banlieue de Londres et se présentait comme un ami de Paul McDonald.
Bloomfield n’avait pas eu l’occasion de faire le déplacement à Dublin pour assister aux obsèques de son ami, mais il devait s’y rendre prochainement. Il avait téléphoné au père de Paul pour savoir où se trouvait la tombe de son fils afin d’y déposer une gerbe.
De cette manière, il avait appris l’existence de l’enquête de Michael Stern. Il disait avoir vu Paul à Londres avant sa mort et souhaitait aider le journaliste dans la mesure de ses moyens.
Michael Stern prit un vol pour Londres le samedi suivant.
Stuart Bloomfield lui confirma avoir vu Paul à son retour de Berlin. Il était en pleine forme et venait participer à un casting resté secret pour ses acolytes. Ils étaient sortis et avaient fait la fête.
Paul dépensait de l’argent comme s’il avait gagné à la loterie. Il l’avait interrogé sur la provenance de cet argent et Paul avait répondu qu’ils avaient enregistré un single à Berlin.
Il l’avait pressé de questions, mais Paul ne lui avait donné aucun détail. Il semblait embarrassé et avait éludé les questions ou répondu évasivement.
La veille du casting, Paul lui avait téléphoné. Sa bonne humeur s’était envolée. Il paraissait soucieux, nerveux et sur la défensive. Il avait déclaré qu’il avait changé d’avis et qu’il quittait Londres. Il n’avait pas précisé où il allait.
De retour à Belfast, Michael Stern consigna ses notes dans le dossier et relut l’ensemble. C’est alors que le détail qui lui avait jusqu’alors échappé lui sauta aux yeux.
39
Mon cœur s’emballe
L’arrivée de Birkin a bouleversé les habitudes de la maison.
À son contact, Brian a viré de bord. Il a troqué son déguisement de beatnik pour se mettre au diapason et devenir un mod. Malgré ce qu’en disait Birkin, le courant montrait des signes d’essoufflement.
Une fois devenu mod, Brian comptait sur ses locataires pour qu’ils en fassent autant. Il s’est d’abord limité à dispenser quelques conseils désintéressés, mais il est rapidement devenu plus incisif.
Lorsqu’il nous croisait, il relevait nos fautes de goût et nous transmettait les directives à suivre pour conformer notre aspect et nos comportements aux nouvelles normes. En deux mots, nous étions également priés de devenir des mods.
Il a fait repeindre la maison et a engagé une femme de ménage. Les chambres devaient être rangées et les lits faits lorsque nous quittions la maison.
Nombre de locataires ont fait les frais de ce revirement, Chess en tête. Il a tiré sa révérence et quitté Londres pour New York. Selon lui, Londres allait se scléroser et les meilleurs artistes quitteraient bientôt l’Angleterre. L’avenir se trouvait de l’autre côté de l’Atlantique.
Les contacts que j’avais avec Brian se sont peu à peu rafraîchis, d’autant que Birkin s’interposait en ma faveur lorsqu’il m’adressait un reproche.
J’ai néanmoins opéré quelques changements à mon look, cela me permettait de me fondre dans le décor quand je sortais avec Birkin. Je me suis coupé les cheveux et me suis offert quelques vêtements seyants. Birkin m’a accompagné dans les boutiques in pour guider mes achats. Considérant ma taille et ma corpulence, l’opération n’a pas été de tout repos.
Paradoxalement, les musiciens qui se produisaient dans les clubs que nous fréquentions affichaient une tête échevelée et mon ancien style négligé.
Birkin se changeait deux ou trois fois par jour. Le soir, avant de sortir, il déployait sa collection de costumes, essayait plusieurs chemises, enfilait des pulls, changeait de pantalon, se déshabillait et se rhabillait jusqu’à trouver la combinaison la mieux adaptée. Il se trémoussait devant le miroir du hall, allait d’avant en arrière, se tortillait, minaudait, me demandait mon avis. C’était à n’en plus finir.
Quand il n’était pas entièrement convaincu de son choix, il remisait ses costumes, rependait ses chemises, rangeait ses pulls au carré dans l’armoire, s’asseyait sur le lit et déclarait qu’il était hors de question qu’il sorte. Après quelques minutes, il se levait et reprenait le rituel en partant de zéro.
Lorsqu’il avait trouvé la tenue adéquate, il sélectionnait les effets que je devais porter pour être en harmonie avec lui, sans créer un contraste trop marquant ni ressembler à des jumeaux.
Ce cérémonial prenait plus d’une heure. C’était assommant et excessif, mais cela m’amusait. Birkin prenait cela très au sérieux. D’après lui, il était un homme mort si on le voyait deux fois avec les mêmes fringues.
Un jour, Birkin m’a donné l’ordre d’arrêter de laver les vitres. Les mods crachaient sur le prolétariat. Je devais brûler ma salopette et venir travailler avec lui, il avait décroché un job chez un disquaire de King’s Road. Il avait trouvé grâce aux yeux du propriétaire et s’est débrouillé pour me faire engager. L’activité était florissante et le personnel qualifié manquait.
Dans un premier temps, je rangeais le stock dans l’arrière-boutique. Après quelques jours, le patron a trouvé que mon accent bizarre avait un certain charme et m’a muté au comptoir auprès de Birkin.
Ma faible connaissance du marché ne constituait pas un obstacle majeur, les questions les plus pointues se limitaient à connaître la date de sortie du prochain single des Beatles ou du futur album des Stones. Quand arrivaient ces dates fatidiques, les files s’allongeaient sur le trottoir et les journées étaient interminables. J’ai vécu des heures inoubliables lors de la sortie du deuxième album des Who, A Quick One, avec son titre provocateur et sa pochette pop art colorée.
Birkin et moi étions inséparables. Tout nous opposait. Je me fichais des fringues, il ne s’intéressait pas à la littérature. Notre seul point commun était le culte que nous vouions au rock.
En le côtoyant, j’ai changé de style. À mon contact, il a saisi le bénéfice qu’il pouvait tirer de la lecture. J’avais commencé à lire en anglais et je m’étais rendu compte de l’ampleur de la tâche qui me guettait. Le vocabulaire était plus étendu qu’en français, je devais sans cesse recourir à un dictionnaire pour saisir le sens d’un mot ou d’une phrase. Birkin m’a dévisagé comme s’il était frappé de stupeur lorsque je lui ai appris que Mick Jagger avait glissé une phrase tirée d’Ulysse de James Joyce dans Paint It Black.
Lucy est partie un matin. Brian avait poussé le bouchon trop loin. Elle est partie, sans une explication, sans laisser un bout de papier dans l’une de mes poches. Nous nous voyions moins, mais ce départ sans préavis m’a laissé un goût amer. Je me sentais frustré, trahi, laissé pour compte.
Ce soir-là, j’ai eu un coup de cafard et j’ai retracé mon parcours à Birkin. Nous devions aller voir John Mayall, mais il est resté près de moi, sans se lever de sa chaise, sans m’interrompre, sans lancer de coup d’œil à sa montre. Il m’a écouté, avec ses yeux ronds, ses plis dans le front et son air stupéfait.
À son tour, il s’est ouvert. Son père était quelqu’un de connu en politique. Il ne supportait pas ce milieu hypocrite. Il ne m’en a pas dit plus.
Nous sortions tous les soirs. Nous écumions les clubs de la capitale. Mes nuits étaient peuplées de rock, de ce rock pur et vivant qui n’avait rien à voir avec le produit que l’on trouvait dans les disques que nous vendions. Au milieu des cris, dans une salle enfumée parcourue par l’odeur de la bière, du tabac, de la sueur et de l’urine, même l’espace entre deux rocks était du rock. Les fausses notes, le Larsen, les coups de gueule et les morceaux de bravoure faisaient partie de notre univers.
J’ai fait la connaissance de nombreux groupes, des formations réputées comme Manfred Mann, le Spencer Davis Group ou les Yardbirds, mais aussi des musiciens prometteurs qui faisaient leurs débuts au Marquee, tels Pink Floyd, The Actions, David Bowie ou Al Stewart.
Nous étions au Scotch of Saint James lors d’un passage de Jimi Hendrix. Le souvenir de ce moment reste tatoué dans ma mémoire.
Au début, Jimi se penchait sur sa guitare, l’air inspiré, les yeux fermés. Soudain, il se mettait à tourbillonner. Il s’agitait, jouait avec les dents, le coude, raclait les cordes de sa Fender contre la scène. Des bombes explosaient, des sirènes hurlaient, des Stukas piquaient sur Londres comme en plein Blitz.
Il était capable de recréer un contexte sonore et visuel en trois dimensions à l’aide de sa Stratocaster et d’une pédale fuzz.
Subjugués par son talent, nous sommes retournés le voir au Bag O’Nails. Chacun de ses concerts était unique.
Le Crawdaddy restait l’un de nos endroits de prédilection. Les Stones y avaient été le groupe à résidence, mais leur popularité battait de l’aile. Pour leur malheur, Mick Jagger était devenu l’hôte le plus brigué de la planète. Il prenait son rôle à cœur et voyageait dans des sphères supérieures.
Les Yardbirds les avaient remplacés. Jeff Beck occupait désormais la place laissée par Clapton. La basse était tenue par un certain Jimmy Page, un gars de mon âge, un musicien de studio à la virtuosité phénoménale. De temps à autre, il troquait sa basse pour une Gibson à double manche sur laquelle il jouait avec un archet.
Nous terminions nos nuits à l’Adlib Club ou au Speakeasy. Contrairement à ce que tentaient de faire croire les magazines spécialisés, les groupes de rock qui squattaient les places d’honneur au Top 50 se connaissaient bien et n’étaient pas rivaux. Les Beatles et les Rolling Stones étaient des habitués de l’Adlib. Des cohortes de fils à papa faisaient le poireau dans la boîte avec l’espoir de les voir débarquer. Ils se shootaient à la cocaïne et avalaient des litres de whisky jusqu’à sombrer dans un coma éthylique.
Bon nombre de musiciens se rendaient au Speakeasy après leurs concerts. Ceux qui y venaient ne se prenaient pas au sérieux et étaient accessibles. Si l’on montrait patte blanche, il était possible de les approcher et d’échanger avec eux.
C’est là que j’ai fait la connaissance de quelques pointures avec qui j’ai sympathisé, Andy White, Ritchie Blackmore, John Lord, Jeff Beck ou encore Bobbie Clarke.
Jimi Hendrix y est venu une ou deux fois. Autant il explosait sur scène, autant il était discret en dehors. Il s’asseyait dans le fond de la salle et dessinait sur des cartons de bière.
Je buvais beaucoup et fumais de grandes quantités d’herbe. Nous ne rentrions qu’à l’aube et le disquaire ouvrait les portes à neuf heures, nous ne dormions que quelques heures. Pour tenir le coup, nous renforcions l’effet de l’herbe en avalant des pilules de méthédrine ou de benzédrine.
La recette était simple ; un joint, un comprimé, un joint, un comprimé. Birkin m’avait refilé le tuyau. Durant la guerre, ces amphétamines avaient permis aux soldats anglais de rester éveillés pendant plusieurs jours.
Nous entendions souvent parler de l’acide, mais il ne circulait pas en Angleterre. Il était considéré comme un produit de prestige qui ne s’adressait qu’à une certaine élite. Selon la rumeur, tout ce que l’Amérique comptait comme artistes était devenu accro au LSD.
Une nuit, alors que nous étions au Speakeasy, quelques musiciens sont montés sur scène pour bœuffer. Après quelques morceaux ils ont demandé s’il y avait un harmoniciste dans la salle. Birkin a fait une grimace, s’est levé et est allé les rejoindre.
Deux heures plus tard, nous débarquions à une vingtaine chez Brian.
Birkin, complètement ivre, galvanisé par le triomphe qu’il venait de remporter au Speakeasy, l’a tiré hors du lit et lui a ordonné de nous remettre les clés de la cave.
Nous nous sommes précipités dans l’escalier, avons allumé les amplis et branché les guitares. Denny Laine et un autre type se sont rués sur les instruments. Denny avait été le guitariste des Moody Blues. Il avait quitté le groupe et errait comme une âme en peine. L’autre était bassiste. Je me suis mis à la batterie, Birkin au chant et à l’harmonica.
Je n’avais plus joué depuis longtemps. J’avais bien tenté de traîner au coin d’Archer Street l’un ou l’autre lundi, comme le faisaient les musiciens en quête de travail, mais je n’étais jamais parvenu à me vendre. Ma réserve et mon manque de maîtrise de la langue me desservaient et les Anglais présents raflaient la mise.
Par chance, les dizaines de pilules que j’avais avalées avaient levé mon inhibition naturelle et désamorcé mon trac. Il ne m’a fallu que quelques minutes pour retrouver mes sensations. Je me suis identifié à Keith Moon et me suis appliqué.
Nous avons joué jusqu’à huit heures du matin. Quand nous avons arrêté, une centaine de types venus de je ne sais où se massaient dans la cave. Brian, habillé à la hâte, les cheveux hirsutes, s’était mis derrière le bar. Il avait vidé les frigos et encaissé un bon paquet de fric.
La période la plus mouvementée de ma vie a commencé ce soir-là pour se terminer quelques semaines plus tard, avec l’entrée de Mary dans ma vie.
Ce furent des semaines de folie. Nous passions notre temps à courir comme des dératés, à dépenser en une heure l’argent que nous gagnions en une semaine, à suivre des concerts et à nous précipiter dans la cave pour rejouer ce que nous avions entendu.
Nous passions notre temps à faire du rock, à parler de rock, à boire, à fumer et à avaler des centaines de pilules.
C’était futile et destructeur. Avec le recul, je garde pourtant de cette période la sensation que j’étais devenu moi-même.
Birkin et moi formions une paire déjantée, dépareillée et indestructible. Il a été l’un des rares cadeaux que le ciel m’a offerts. Il m’a appris la beauté et la richesse de l’amitié.
Quand le moment est venu, il s’est sacrifié pour me sortir de l’enfer. Quand je pense à lui, mon regard se trouble et mon cœur s’emballe.
40
Toute ma vie
Elle est entrée.
Les murs ont vacillé et la pièce s’est recroquevillée autour d’elle. Mes muscles se sont figés. J’ai arrêté de battre la mesure.
Selon Platon, il existait à l’origine des êtres androgynes composés de quatre bras, de quatre jambes et d’une tête à deux visages. Zeus, craignant leur puissance, aurait décidé de les couper en deux, les condamnant de la sorte à passer leur vie à rechercher leur part manquante.
Elle s’appelait Mary, elle a été toute ma vie.
41
Comme une huître
Dominique arriva de bonne heure à la clinique. Il gara sa voiture dans le parking, ouvrit le coffre et en sortit une chaîne stéréo portable qu’il chargea sur son épaule.
Il pénétra dans la clinique, salua l’assemblée et se dirigea vers la chambre de X Midi.
Lorsqu’il fut à proximité de la porte, il entama son dialogue imaginaire habituel.
— Tiens, Dominique, bonjour. Dis-moi, c’est qui, tout ce monde avec toi ?
— Tu ne les reconnais pas ?
— Leur tête me dit quelque chose.
— J’imagine ! Tu les as vus hier à la télévision. Lui, c’est Bono, et là, c’est The Edge.
— Ah oui, c’est U2 ?
— Oui, ils sont venus à Bruxelles pour le concert de ce soir. Comme ils étaient dans le coin, je leur ai demandé de venir jouer pour toi.
Il plongea dans la chambre, l’air goguenard. X Midi épiait son arrivée du coin de l’œil.
Dominique éteignit la télévision.
— Alors comme ça, tu aimes le rock, Baudouin ?
Il approcha du lit.
— Tu t’appelles Baudouin ? Cligne une fois si tu t’appelles Baudouin, deux fois si je me trompe.
L’homme ne réagit pas.
— Tu aimes le swing ? On va travailler en rythme. J’ai pris quelques bons rocks avec moi.
Il approcha la table roulante et y installa la stéréo. Il choisit un CD et l’inséra dans le lecteur.
Les premiers accords de One résonnèrent dans la chambre.
Dominique prit les pans de sa blouse, leva les bras et se mit à tournoyer dans la chambre.
— Tu reconnais ? C’est U2. C’est la chanson préférée des auditeurs de Classic 21. C’est celle que tu préfères ?
Il se pencha vers X Midi, leva les sourcils.
— Alors, Baudouin, tu l’aimes, celle-là ?
Il se mit à rire.
— Tu préfères que je remette la télévision ?
L’homme le fixait sans ciller.
— Si tu veux, je t’en mets une autre, pour voir tes goûts.
Il inséra un autre disque, le laissa tourner pendant quelques instants.
— With or Without You. Elle te plaît, celle-là ?
Il répéta la manœuvre avec d’autres disques, sans succès.
Il changea de tactique.
— Quel idiot je suis ! Tu aimes les groupes plus anciens, c’est ça ?
Il prit une dizaine de disques et fit défiler les pochettes devant les yeux de l’homme.
— S’il y a quelque chose que tu veux entendre, tu clignes des yeux une fois, d’accord ?
Il passa les CD les uns après les autres en citant le nom des artistes.
— Cure ? Clash ? Tu aimes le punk, Baudouin ? Bon Jovi ? Phil Collins ? J’adore Phil Collins. Les Eagles ? Santana ? Supertramp ? Queen ? Ouah, Freddie Mercury, quel chanteur ! Simple Minds ? Non pas Simple Minds, tu as raison.
Il leva les bras au ciel et les laissa retomber le long de son corps.
— Je t’ai montré tout ce que j’avais, Baudouin. Tu veux que j’en amène d’autres demain ?
L’homme détourna les yeux.
Dominique dut se rendre à l’évidence, les espoirs nés la veille n’avaient été que de courte durée, X Midi s’était refermé comme une huître.
42
J’avais assuré
Nous jouions chaque soir, et chaque soir, plus de monde nous rejoignait. La cave de Brian était l’endroit branché, le rendez-vous privé des après-concerts où il était de bon ton d’être convié.
Birkin et moi étions devenus des oiseaux de nuit à la réputation bien trempée. La faune qui hantait les clubs londoniens guettait notre arrivée, nous saluait, nous offrait des verres, sollicitait notre avis, fondait l’espoir que nous les invitions chez Brian.
Certains soirs, des dizaines de personnes attendaient sur le trottoir.
Cet attroupement bruyant ne plaisait pas aux voisins. Plus d’une fois, la police est intervenue, mais n’a rien trouvé à redire. Aucune loi n’interdisait d’avoir des invités, même tous les soirs de la semaine. Leurs visites se concluaient généralement par une injonction à respecter le sommeil des riverains.
Lorsque nous arrivions avec nos invités, nous descendions et prenions possession des lieux. Brian opérait sa sélection parmi les badauds qui patientaient à l’extérieur. Le critère prédominant était la hauteur du billet que lui tendaient les postulants. Il redescendait aussitôt et s’installait derrière le bar jusqu’à l’aube.
En automne, Birkin et moi sommes allés au Klooks Kleek, un petit club situé dans les étages du Railway Hotel, à West Hamstead, pas très loin de chez Brian. Cream, le nouveau groupe d’Eric Clapton, y donnait un stage show.
J’avais souvent entendu parler du batteur, Ginger Baker, mais je ne l’avais jamais vu à l’œuvre. Quand nous sommes arrivés, sa Ludwig argentée attendait sur la scène, un énorme Ginger inscrit sur l’une des grosses caisses, un Baker tout aussi imposant sur l’autre.
J’étais intrigué par le nombre d’accessoires et de percussions qu’il avait ajoutés à son instrument ; des congas, des shimes, des clochettes, mais aussi certaines pièces que je n’avais jamais vues installées sur une batterie, comme une bouteille de whisky vide.
Le trio est arrivé avec une heure de retard. Ils ont fendu la foule en traînant les pieds et sont montés sur scène.
La salle était survoltée. Jack Bruce et Eric Clapton arboraient des moustaches d’un autre siècle. Ginger Baker était roux, hirsute, barbu et semblait en phase terminale d’une longue maladie. Ils étaient tous trois vêtus d’amples chemises bariolées, c’était le look dans le coup, un nouveau courant venu de Californie qui allait tout balayer sur son passage. Les Américains allaient prendre leur revanche, tout se passerait bientôt à San Francisco.
Nous nous attendions à ce qu’ils jouent du blues et ils ont joué du blues ; mais ce blues-là était une combinaison savante de blues, de rock, de country et de jazz. Leur virtuosité faisait le reste.
Clapton méritait son surnom, il jouait comme un dieu. Ramassé sur sa guitare, il paraissait absent, absorbé dans ses constructions complexes. La salle était suspendue à ses notes. Sa vitesse d’exécution était phénoménale, ses solos vertigineux. De temps à autre, sa guitare partait dans une envolée lyrique qui se terminait sur une note soutenue qui flanquait le frisson.
Le jeu de Ginger Baker était à couper le souffle. Avec son visage émacié, son teint blafard et ses dents pourries, il symbolisait le batteur suprême. Il jouait comme s’il ne lui restait que quelques heures à vivre, comme s’il pouvait encore sauver sa peau à condition qu’il cogne suffisamment fort pour éloigner le mauvais sort. Les yeux exorbités, la bouche béante, il s’immergeait dans d’interminables roulements qui emportaient tout avec eux.
À la fin du concert, je tremblais de tous mes membres. Le phénomène d’identification avait fait son œuvre, j’allais me laisser pousser la barbe et les cheveux. Plus tard, je les passerais à l’eau oxygénée pour qu’ils se rapprochent de la couleur de Ginger.
Nous sommes allés au Speakeasy. Nous savions que Clapton risquait d’y faire un saut. Il a débarqué une heure plus tard. Il était accompagné par sa clique de parasites. Ni Bruce ni Baker n’étaient là. Ils se sont installés au fond du club, indifférents à ce qui se passait dans la salle et sur la scène.
Lorsque nous avons quitté le club, une quinzaine de gars nous ont suivis, des habitués pour la plupart. À notre grande surprise, Clapton nous a emboîté le pas, une partie de sa bande sur ses talons.
Tout ce beau monde est arrivé à la cave en même temps. Brian a frisé la syncope quand il a reconnu Clapton. J’étais également tétanisé par sa présence. Quelques types ont pris les guitares, je me suis mis à la batterie et nous avons commencé à jouer.
À force d’observer le jeu des batteurs, j’avais enrichi le mien. La plupart des batteurs de rock jouaient les quatre temps sur le charleston. Pour ma part, je m’arrêtais en position levée sur le deuxième et le quatrième temps, ceux qui formaient le backbeat, et je laissais la caisse claire dominer. Je traînais un peu sur celle-ci, mais j’étais parfaitement en place sur le charleston.
Le style de chaque batteur était déterminé par ce décalage infime entre les deux. Cette manière de faire durer la mesure un peu plus longtemps caractérisait mon jeu et les musicos avec lesquels je jouais aimaient cela.
Clapton était accoudé au bar. Il buvait, fumait et bavardait, des filles accrochées à ses basques. De temps à autre, il jetait un coup d’œil dans notre direction, c’était machinal, comme s’il avait devant les yeux une télévision qui diffuse un match de foot sans le son.
Entre deux morceaux, j’avalais des pilules par poignées. Quelques verres plus tard, les échanges se sont animés et Clapton est venu dans notre direction. Nous nous sommes arrêtés de jouer. Il a pris une guitare, l’a accordée, a réglé le son, a donné quelques instructions au bassiste. Ce dernier m’a adressé un clin d’œil, s’est penché sur le micro, a compté jusqu’à quatre.
Nous avons joué pendant une heure ou deux. Des standards de rock et de blues. Je ne me souviens ni des titres ni de la façon dont je les ai interprétés. J’avais perdu la notion du temps et de l’espace.
Après le dernier morceau, la salle s’est déchaînée. Clapton s’est tourné vers moi, a levé son pouce et m’a dit que j’avais assuré.
Il n’a rien dit de plus, mais il n’aurait rien pu dire de mieux.
J’avais assuré.
Plus tard, Birkin m’a dit que j’avais été impérial.
Je n’étais pas encore le meilleur batteur de la planète, mais j’avais joué avec Clapton et j’avais assuré.
43
Ta trahison
Mary a fait son apparition le lendemain de ce fameux soir. Si je n’avais été encouragé par les paroles de Clapton, je serais sans doute resté cloîtré dans mon mutisme habituel.
Mary est née un soir de réveillon, pendant la dernière heure du dernier jour de l’année 1946.
Ses parents descendaient de la petite-bourgeoisie. C’étaient de fervents anglicans, bien-pensants et attachés aux grands principes. Malgré leur dévotion, ils ont divorcé quand elle avait dix ans. Elle a quitté Londres pour suivre sa mère et s’installer à la périphérie d’une petite ville dans le Berkshire. Sa mère y avait trouvé un emploi dans une librairie du centre.
En s’inscrivant au cours d’art dramatique de son école, Mary a pris conscience de son don pour la musique et le chant. À l’âge de quatorze ans, elle chantait le samedi soir dans les cafés de son patelin. Son répertoire était constitué d’airs populaires traditionnels. Sa mère la chaperonnait et récoltait les pourboires.
Comme ses récitals étaient fort appréciés, elle a commencé à chanter le vendredi et le dimanche, puis tous les jours de la semaine. Poussée par sa mère, elle a suivi des cours de chant et développé sa technique. Sa voix s’étendait sur près de trois octaves.
Elle a fait irruption dans la cave en compagnie d’une bande de types que je n’avais jamais vus. J’étais occupé à jouer avec quelques habitués. J’ai croisé son regard et j’ai décroché du tempo. Le guitariste m’a dévisagé, l’air interrogateur. Nous avons repris, mais je n’étais plus avec eux.
Mary trouvait qu’elle avait un menton proéminent et des yeux trop écartés. Elle répétait cela chaque fois qu’elle se regardait dans un miroir.
Je répondais que Jackie Kennedy pensait la même chose d’elle-même. Elle me regardait et haussait une épaule, la droite, toujours la même. Je rajoutais que Jackie Kennedy était l’une des plus belles femmes du monde. Elle riait et rétorquait que j’étais un fieffé menteur, mais qu’elle allait faire semblant de me croire.
Ils se sont regroupés à l’extrémité du bar et ont commandé des bières. Elle a pris la sienne et s’est mise à la boire à même le goulot.
De temps à autre, elle me lançait un regard en coin. Elle avait relevé mon trouble et compris qu’elle en était l’origine.
À dix-huit ans, elle s’est mariée avec le fils du libraire chez qui sa mère travaillait. C’était un coup de tête, un acte irréfléchi, presque un caprice. Elle voulait s’émanciper et se libérer du joug de sa mère. Leur mariage a tenu moins d’un an. Elle l’a quitté et est revenue à Londres.
Elle a commencé à fréquenter les clubs de la capitale à la recherche d’un guitariste prêt à l’accompagner.
C’est comme cela qu’elle a croisé le chemin d’un groupe de musiciens de rock, les Frames, de bons amateurs qui jouaient en dilettante. Fascinés par sa voix et son talent, ils lui ont composé quelques chansons qui exploitaient sa tessiture et l’ont convaincue de se joindre à eux. Confortée par le succès qu’elle rencontrait où ils se produisaient, elle a commencé à écrire ses propres textes et a appris à les faire sonner sur des accords de rock, de blues ou de jazz.
Les gaillards qui étaient avec elle la traitaient d’égal à égal. Ils la considéraient comme l’une des leurs. Aucun ne semblait avoir pour elle une attention particulière.
Je l’épiais en jouant. Elle parlait, gesticulait et buvait bière sur bière. La jalousie me tourmentait lorsqu’un quidam lui adressait la parole. Elle était là depuis moins d’une heure, mais je la considérais déjà comme mienne.
À son tour, elle s’est mise à m’observer, avec un mélange d’agacement et de curiosité.
Je me suis souvenu des mots de Clapton. J’ai soutenu son regard. J’ai assuré.
Après une heure de cache-cache, elle a interpellé l’un de ses accompagnateurs, un barbu famélique qui se grattait sans cesse le crâne.
Ils se sont approchés. Le barbu a demandé au guitariste s’il pouvait emprunter son instrument et s’est ensuite dirigé vers le bassiste pour lui énoncer la grille d’accords. Elle allait chanter un truc de sa composition, un quatre-quatre plutôt lent, une sorte de jazz latin, proche d’une rumba. Avec cela, il fallait que je me débrouille.
Mary a pris le micro, a fermé les yeux et s’est mise à chanter. C’était une ballade jazzy au rythme syncopé. Sa voix était rauque, mélodieuse et puissante.
Quand elle a entonné le refrain, des fourmis ont envahi ma nuque. En l’espace de quelques secondes, j’étais couvert de chair de poule. Dans la salle, les conversations se sont tues et l’assistance a retenu son souffle.
Elle me tournait le dos et dansait paresseusement sur place. De temps à autre, elle s’arrêtait et se figeait dans une pose suggestive.
À la fin du morceau, elle a tourné le dos au public et m’a fixé dans les yeux. Elle m’a dédié les dernières phrases de sa chanson.
Give a little bit of your love to me,
I’ll give a little bit of my love to you
J’ai suivi sa prophétie, je lui ai offert tout l’amour que j’avais dans le cœur. Je me suis vidé de cet amour jusqu’à l’assèchement, tel un philanthrope qui dilapide sa fortune pour une cause perdue.
Avec ma mère, je pense qu’elle a été la seule femme à m’avoir aimé.
Au petit matin, la cave s’est peu à peu vidée.
Les amis de Mary l’ont saluée et sont partis. Hormis Brian, il ne restait que nous deux. Brian a vidé la caisse, a mis l’argent dans un petit coffre dissimulé derrière le bar et m’a demandé d’éteindre en partant.
Nous nous étions à peine parlé.
Elle a passé une main sur mon visage, elle m’a dit qu’elle avait envie de moi et m’a demandé si j’avais envie d’elle.
Nous sommes montés dans ma chambre. Elle s’est déshabillée et m’a déshabillé en silence. Je suis entré dans le lit et elle est venue s’allonger sur moi. Elle a posé ses mains sur ma poitrine, a fermé les yeux et a penché la tête en arrière. Elle s’est empalée sur mon sexe et a commencé à onduler du bassin.
Elle m’a attendu.
Au moment où j’allais jouir, je lui ai demandé la permission de me laisser aller en elle.
C’était ridicule de lui poser cette question, mais elle a apprécié ma requête. J’étais le premier homme à lui demander une chose pareille. Elle l’a pris comme une marque de respect.
J’aimerais que tu sois à mes côtés, j’aimerais que tu saches que je te pardonne ta trahison.
44
Son champ de vision
Lors de l’une de ses visites journalières, l’ergothérapeute releva un léger tressaillement des doigts de la main droite de X Midi ainsi que de plus amples mouvements faciaux.
Elle consigna ces observations dans son rapport et ajouta que ces signes prometteurs confirmaient que l’état de X Midi continuait à progresser. Il quittait progressivement l’état de LIS et entrait peu à peu en phase de récupération.
Le protocole concluait qu’une réversibilité partielle était désormais envisageable.
Compte tenu de la relation que Dominique entretenait avec son patient, il fut l’un des premiers informés.
Ce dernier se rendit aussitôt chez X Midi pour lui annoncer la bonne nouvelle.
— Salut, Casper, j’ai vu ton ergothérapeute ce matin. Elle a enregistré des signes encourageants. On va te sortir de là.
Il élargit son sourire et lui présenta un petit pot d’eau gélifiée accompagné d’une cuiller en plastique.
— Je t’amène ton premier repas.
Il resta un instant immobile, le récipient à hauteur des yeux de l’homme, en quête d’une réaction.
— Tu ne crois tout de même pas que tu vas continuer à te laisser nourrir comme un bébé. Tu n’en as pas marre de cette sonde ? Tu devras tôt ou tard recommencer à manger normalement, alors autant réapprendre avec moi.
Les yeux de X Midi se remplirent de larmes.
Dominique se pencha et examina le visage de l’homme.
— Qu’est-ce qui se passe, Casper ? Tu pleures ? Tu es triste ou tu es fou de joie ?
Il s’assit sur le lit, lui prit la main et l’examina.
X Midi était en proie à une crise de détresse.
— Je suis ton ami, j’aimerais t’aider.
Il épongea les yeux de l’homme, passa une main dans ses cheveux.
— Je suis ton ami. Moi aussi, je suis aussi triste, tu n’as pas l’air de vouloir de mon amitié. J’imagine que tu as dû vivre quelque chose de terrible. Je comprends que tu ne veuilles pas te confier. Des hommes t’ont fait du mal, je le sens. Moi, je suis ton ami. Tu peux me parler. Tu peux me faire confiance.
L’homme le fixa sans ciller.
Dominique se pencha davantage et prit le ton de la confidence.
— Je te propose un marché. J’accepte que tu ne souhaites pas me parler et je ne te forcerai plus à le faire. Je continuerai à te parler sans te poser de question.
Il s’arrêta quelques instants.
— Si un jour tu veux me parler, j’aimerais que tu saches que je suis ton ami. Je t’écouterai, je répondrai à tes questions, et tout ce que tu diras restera entre nous.
L’homme le fixa avec une attention soutenue.
— On est d’accord ? Si un jour tu veux me parler, si tu as quelque chose à me dire ou à me demander et si tu veux que personne ne le sache, tu peux compter sur moi, je n’ai qu’une parole. Tu es d’accord, mon ami ?
X Midi ferma les yeux, les tint clos un moment, puis les rouvrit.
Dominique se leva et sortit de son champ de vision.
45
Jusqu’au bout de la nuit
Nous ne nous sommes plus quittés. Mary louait une chambre exiguë sous les toits d’une maison bourgeoise de Kensington, dans Argyll Road, non loin de Holland Park. La propriétaire était une ancienne connaissance de sa mère, une veuve de longue date, à cheval sur les principes.
À moitié sourde, elle tolérait ses vocalises, ses retours nocturnes et ses tâtonnements dans le hall d’entrée au petit matin, mais elle ne pourrait accepter qu’elle débarque dans sa maison avec un homme. Mary est allée chercher quelques affaires qu’elle a rangées dans ma chambre, des partitions, une trousse de toilette et un sac de vêtements.
Brian ne l’aimait pas. Dès le lendemain de notre rencontre, il est venu me trouver pour me dire qu’il la connaissait de réputation, que c’était une pute, qu’elle couchait avec tout le monde et que je devais me méfier d’elle. Je l’ai remercié pour cet avertissement, je me méfierai, je resterai sur mes gardes.
Une quinzaine de jours plus tard, il a fait une nouvelle crise. C’était un dimanche matin. Birkin et moi prenions le petit déjeuner dans le bow-window. Mary venait de sortir.
C’était une belle matinée d’hiver. Le soleil était éblouissant. Birkin et moi clignions des yeux. Il me faisait face et me regardait en souriant. Le café me brûlait le palais. J’étais heureux. Mary et moi étions amoureux.
Brian est descendu et a commencé à hurler.
Sa maison n’était pas un hôtel, encore moins un bordel, il en avait marre d’entendre ma pute gémir comme une truie pendant que je la baisais et il ne voulait pas qu’elle passe une nuit de plus ici. Si je voulais continuer à perdre mon temps avec cette connasse, je n’avais qu’à aller la baiser ailleurs.
Je suis resté muet. J’étais désarmé, impuissant, incapable de répondre à une attaque aussi virulente.
J’aurais aimé trouver les mots appropriés pour défendre la réputation de Mary, lui dire qu’il dépassait les bornes, mais pas un son n’est sorti de ma bouche.
Birkin a vu que j’accusais le coup. Il s’est levé et a pris ma défense. Il a interpellé Brian, il exagérait, il était grossier et ingrat, il se faisait des couilles en or grâce au public que nous amenions chaque soir, nous avions fait de sa cave l’un des endroits les plus branchés de Londres, j’avais joué avec Clapton, la moindre des choses était de me foutre la paix et de me laisser baiser avec qui je voulais.
Cela n’a pas calmé Brian, bien au contraire. Il est parti dans une envolée qui vantait son altruisme et sa générosité. Il hébergeait une dizaine de personnes à ses frais et personne ne lui avait proposé de participer aux dépenses, pas même ceux qui avaient un boulot rémunéré, comme les deux parasites que nous étions.
Le ton montait.
J’étais assis. Je les écoutais, décontenancé.
Birkin ne voulait pas en rester là. Ils s’engueulaient ferme. Ils parlaient vite, criaient, je ne comprenais pas tout.
Ulcéré, Brian a insinué que ce n’était pas parce que le père de Birkin couchait avec des ministres qu’il pouvait se croire tout permis.
Birkin s’est arrêté net, au milieu d’une phrase.
Je l’ai vu blêmir.
Ses lèvres se sont mises à trembler.
Je me suis levé et suis allé droit sur Brian. Il a écarquillé les yeux.
Le coup de poing que je lui ai balancé l’a expédié au fond de la pièce. Il est parti à reculons en se tenant le nez et a atterri dans la bibliothèque dont une partie des bouquins lui est tombée dessus.
Birkin était toujours tétanisé au milieu du salon, les larmes aux yeux.
Je l’ai pris par l’épaule. Il était blessé. Je l’ai serré contre mon cœur, je l’ai bercé comme on berce un enfant malheureux. J’ai tenté de le réconforter comme je le pouvais. Ce soir, nous irons voir les Easy Beats à l’Upper Cut, Brian n’est qu’un pauvre gosse mal dans sa peau, il a raconté n’importe quoi, je n’ai rien compris. Nous allons nous éclater, nous allons nous saouler et avaler des tonnes de pilules. Ce soir, tu feras chanter ton harmonica et nous jouerons jusqu’au bout de la nuit.
46
Une option peu réaliste
Dès qu’il eut identifié le lien qui lui avait jusqu’alors échappé, Michael Stern se saisit du téléphone et forma le numéro du Yoyo Bar, le club dans lequel Pearl Harbor s’était produit du dimanche 2 janvier 1966, date du début de leur contrat, jusqu’au lundi 13 mars 1967, jour de leur dernier passage.
Un employé lui répondit que le patron était parti à Francfort pour le week-end et qu’il ne serait de retour à Berlin que le lundi suivant, en fin d’après-midi.
Stern promit de le rappeler et poursuivit ses investigations en prenant contact avec l’épicier qui officiait au rez-de-chaussée de l’immeuble des quatre hommes. Personne ne répondit à son appel, la boutique était en toute vraisemblance fermée à cette heure tardive.
Il prit son mal en patience et renouvela ses appels le lundi après-midi.
Le patron du Yoyo Bar confirma que les musiciens avaient été fidèles au poste chaque soir. Aucun d’eux n’avait manqué à l’appel durant les dernières semaines, et ce, jusqu’à la veille du jour où ils avaient demandé ce congé de dernière minute et n’étaient plus revenus.
L’épicier, pour sa part, répondit de mauvaise grâce à son appel. Il y avait du monde dans son magasin et il ne se souvenait pas de l’emploi du temps des musiciens pendant les journées qui avaient précédé leur mort. Il répéta ce qu’il avait dit lors de la visite de Stern à Berlin.
Lorsque Stern émit le souhait de parler à la locataire du sixième étage, il rétorqua que la femme n’avait pas le téléphone et qu’elle ne sortait que très rarement. Elle était atteinte de rhumatisme et ne parvenait à descendre les six étages qu’au prix de lourdes souffrances.
Stern lui proposa de convenir d’une heure à laquelle il rappellerait et lui demanda d’aider la femme à descendre au rez-de-chaussée. Face à la réticence qu’il ressentit, il motiva sa demande en expliquant que son enquête avançait, qu’il s’agissait vraisemblablement d’une affaire de meurtres et que le témoignage de cette femme était déterminant.
En fin d’après-midi, il retéléphona à l’heure prévue et put parler à la femme en question. Il baragouina quelques mots d’allemand et finit par se faire comprendre.
Elle entérina les déclarations qu’elle avait faites lors de sa visite à Berlin. Peu avant la disparition des quatre hommes, l’un d’eux était resté à l’appartement durant la soirée. Elle l’avait entendu se déplacer. Elle avait perçu des quintes de toux et des haut-le-cœur.
En revanche, elle ne pouvait préciser la date à laquelle l’incident s’était produit.
Stern tenta de lui rafraîchir la mémoire en lui posant des questions sur son emploi du temps ce soir-là. Il lui suggéra des pistes comme la composition de son repas, les visites qu’elle avait reçues ou la nature de l’activité qui avait occupé sa soirée.
À force de tâtonnements, elle se rappela avoir dressé un parallèle entre les vomissements qu’elle entendait à l’étage et la chronique médicale qu’elle parcourait à ce moment-là dans Der Spiegel. L’article en question rapportait que les Allemands mangeaient trop gras au petit déjeuner.
Elle précisa qu’elle recevait le magazine le mardi et consacrait sa soirée à sa lecture.
Un court appel à la rédaction du magazine allemand permit à Stern d’apprendre que l’article en question s’intitulait Reiner Tisch, qu’il avait été rédigé par un journaliste de la rubrique santé et qu’il était paru dans le numéro 12 de l’année. L’hebdomadaire avait été mis en vente le lundi 13 mars et distribué aux abonnés dès le lendemain.
Cela signifiait que l’incident rapporté par la femme s’était produit pendant la soirée du mardi 14 mars 1967.
Stern en conclut qu’un des quatre hommes n’avait pas participé à l’enregistrement, cloué à son domicile par une indigestion ou un malaise passager.
Même si ce détail était d’une importance secondaire, il indiquait que seuls trois d’entre eux auraient dû être éliminés s’ils avaient été témoins de quelque fait obscur.
Stern reprit ses notes, les relut une nouvelle fois et se mit en devoir d’identifier l’absent. Face au casse-tête que cela représentait, il prit contact avec Birgit, la compagne de Jim Ruskin et lui demanda de l’aider à remonter l’emploi du temps du groupe.
Ruskin avait passé la soirée du mercredi 15 mars chez elle. Il en avait fait de même le jeudi 16, le vendredi 17 et le samedi 18, comme le groupe s’était mis en congé et ne travaillait pas ces soirs-là. Jim avait logé chez elle ces quatre nuits, mais elle l’avait prié de rentrer chez lui le dimanche soir. Elle accusait un peu de fatigue et reprenait le travail le lendemain matin.
Michael Stern nota les informations et en tira ses déductions.
L’enregistrement avait eu lieu le mardi 14 mars 1967. Seuls trois des quatre musiciens y avaient assisté. Le quatrième était resté dans l’appartement, victime d’un malaise. Le mercredi 15 mars, hormis Jim qui était resté chez Birgit, les trois autres hommes avaient dormi dans leur lit. Le jeudi 16 se présentait vraisemblablement de la même manière.
Le vendredi 17, Steve Parker avait pris le train pour Hambourg en fin de matinée. Restaient dans l’appartement Larry Finch et Paul McDonald. Le samedi 18, Larry Finch et Paul McDonald étaient partis respectivement à Majorque et Londres.
Cette nuit-là, le samedi 18, personne n’avait logé dans l’appartement. Seul Jim Ruskin y était revenu le dimanche soir. Sa présence avait été confirmée par l’épicier qui l’avait réveillé le lundi en fin de matinée.
Stern examina ses notes.
Elles ressemblaient à un problème de logique qui le ramenait à ses premières années d’étude.
Il griffonna un tableau, y mit le nom des quatre hommes en colonnes, les dates en ligne, puis remplit la grille à l’aide des informations qu’il avait récoltées, détaillant les lieux où chacun était censé se trouver.
De nombreux points d’interrogation émaillaient le document.
Qui était resté à l’appartement le soir de l’enregistrement ? Pourquoi ce quatrième homme, l’absent, était-il mort ? S’il n’avait pas participé à l’enregistrement, pourquoi était-il, lui aussi, en possession d’une importante somme d’argent ?
Il ne pouvait exclure l’éventualité que le logement ait été occupé par une personne étrangère au groupe le soir de l’enregistrement, mais cela lui semblait une option peu réaliste.
47
À destination de Berlin
Brian avait le nez cassé. Il est parti se faire soigner. Quand il est rentré, il n’est plus revenu sur le sujet. Cette nuit-là, Mary a dormi avec moi. Nous avons fait l’amour et elle a crié plus fort que d’habitude.
Hormis dans ces moments-là, nous nous parlions peu, nous étions réservés de nature.
Elle chantait pour exorciser ce qu’elle taisait. Les paroles de ses chansons traduisaient sa détresse, ses colères et ses espoirs déçus. Ses couplets dénonçaient l’abandon, la violence, la servilité et l’enfance qu’elle n’avait pas eue.
J’en faisais de même lorsque je jouais de la batterie, avec mes mots à moi. Je frappais pour oublier la peur que m’inspirait la folie dans laquelle je m’enfonçais.
Nous buvions jusqu’à l’écœurement. Nous commencions dès le matin par quelques bières innocentes et du vin. En fin de soirée venaient les alcools plus forts. Nous fumions de l’herbe et carburions aux amphétamines.
Lors de son retour à Londres, Mary avait consommé de l’héroïne et m’en avait vanté les effets. Elle rêvait d’en reprendre, de m’initier, mais nous n’avions pas la somme suffisante pour nous en procurer.
Je ne lui avais pas dit que j’avais mis de l’argent de côté, je ne voulais pas de cette substance. Depuis Paris, je l’associais au viol, au malheur et à la mort.
L’image de Floriane, prisonnière des deux hommes, la main tendue, continuait de me hanter.
Il nous arrivait de passer de longues heures, allongés sur le lit, l’un à côté de l’autre, à retourner mille pensées sans échanger un mot. Nous écoutions nos souffles, les Stones ou les bruits qui circulaient dans la maison. Quand le silence devenait trop lourd, nous faisions l’amour.
Nous avons passé la soirée du réveillon dans ma chambre. C’était notre havre. Mary fêtait ses vingt ans. La maison était calme.
Dans la rue, les gens riaient, criaient, sifflaient. Les voitures roulaient plus vite que de coutume. Nous entendions la cacophonie des avertisseurs, le crépitement des feux d’artifice au loin.
Nous avons fait l’amour à en perdre haleine.
Au petit matin, je lui ai dit que je l’aimais. Les mots sonnaient étrangement dans ma bouche. Je les entendais sans cesse dans les chansons, mais je les prononçais pour la première fois.
Elle n’a pas dit un mot, elle m’a pris dans ses bras et m’a serré longuement. Elle paraissait songeuse.
Après un moment, elle a pris son souffle et m’a avoué avoir été enceinte.
Quelques semaines après leur mariage, son mari avait invité l’un de ses amis pour le dîner. Ils avaient mangé, ri et bu plus que de raison. En fin de soirée, ils avaient baisé à trois. Elle n’avait pas trouvé l’expérience désagréable, mais elle pensait qu’il ne s’agissait que d’un concours de circonstances. La semaine suivante, il a recommencé. Et la semaine suivante. Son appétit était insatiable. Sans cesse, il ramenait d’autres hommes, certains qu’elle ne connaissait pas. Il lui arrivait de devoir satisfaire trois hommes dans la soirée.
Un jour, elle a eu du retard, ses règles ne sont pas apparues. Elle est allée voir son médecin, il lui a annoncé qu’elle était enceinte. Elle a quitté son mari pour se faire avorter à Londres.
Personne ne savait rien de cette histoire. J’étais le seul à qui elle avait osé l’avouer.
Sa confession n’a rien changé à mes sentiments, mais quelque chose s’était cassé en elle.
Quelques jours plus tard, elle m’a annoncé qu’elle partait pour Berlin. Un agent allemand dépêché à Londres par une association de night clubs berlinois était venu recruter de nouveaux artistes.
Il l’avait vue chanter avec les Frames. Le soir même, il leur avait proposé un contrat de trois mois dans une boîte branchée. Ils seraient logés, nourris, blanchis, avec un salaire à la clé.
Hormis le bassiste, ils avaient d’emblée accepté. L’Allemand avait décrété qu’il s’engageait à trouver un remplaçant au bassiste à Berlin. Il a pris Mary à part. L’essentiel était que la chanteuse soit partante.
J’ai annoncé à Mary que je ne voulais pas la quitter et que j’allais l’accompagner.
Elle s’est emportée, trois mois, ce n’était pas long, je n’étais pas raisonnable, j’avais un travail, j’avais mes amis, ma passion, il n’y aurait rien à faire pour moi là-bas, ces trois mois passeraient vite.
J’ai insisté. Je dénicherais un job à Berlin, même si je devais servir dans un bar, laver les vitres, porter des journaux ou balayer les trottoirs. Peut-être trouverais-je une place de batteur, de nombreux groupes jouaient dans les grandes villes allemandes.
Elle m’a dévisagé, a haussé une épaule, la droite, puis a hoché la tête.
J’étais têtu, je n’avais qu’à faire ce que je voulais.
Il me fallait de nouveaux papiers pour quitter l’Angleterre et aller dans une ville comme Berlin. J’avais suffisamment d’argent pour les acheter. Je suis retourné dans le restaurant de Clerkenwell Road. J’ai commandé le plat du jour et donné le mot de passe au serveur.
Je suis allé dans l’arrière-salle, j’ai déposé la somme d’argent sur la table et j’ai dit qu’il me fallait des papiers dans la semaine.
Trois jours plus tard, ils étaient prêts. Je m’appelais désormais Jacques Berger, citoyen canadien, célibataire, né à Québec le 6 mars 1946.
Les membres restants des Frames n’étaient pas très heureux de me voir débarquer. J’avais eu l’occasion de jouer avec eux dans la cave, mais ma venue semblait les contrarier. Malgré tout, ils étaient conscients que leur contrat avait été signé grâce à Mary et que sans elle, ils ne l’auraient pas obtenu.
Ils n’ont rien dit, sinon qu’ils me souhaitaient bonne chance pour trouver un job.
Le 15 janvier 1967, nous avons quitté Londres à destination de Berlin.
48
Il n’y a qu’à toi qu’il parlera
Le lundi 15 novembre, Dominique fit son apparition à la clinique aux environs de sept heures.
Comme il avait coutume de le faire, il pénétra dans le hall, lança un mot de bienvenue à la cantonade et se dirigea vers les vestiaires en ébauchant un pas de danse.
Une des infirmières de nuit était présente dans le local de repos. Elle était assise, la tête entre les mains, l’air soucieux.
— Eh bien, Michèle ? Qu’est-ce que tu fais encore ici à cette heure ?
L’infirmière semblait épuisée.
— Je t’attendais.
Il éclata de rire.
— Tu m’attendais ? Tu voulais me draguer ? Ce n’est pas bien, Michèle. Tu es mariée et tu as deux enfants.
— Je ne plaisante pas, Dominique, X Midi a eu un malaise cette nuit.
Son sourire disparut sur-le-champ.
— Un malaise ? Il n’est pas… ?
— Non, maintenant, il est stabilisé.
— Qu’est-ce qui s’est passé ?
L’infirmière jeta un coup d’œil à l’extérieur.
Il avait plu à torrents durant tout le week-end. De nombreux cours d’eau étaient sortis de leur lit. Les crues avaient provoqué d’importantes inondations, plusieurs villes et villages avaient été envahis par les eaux. Des centaines d’habitations avaient dû être évacuées, des chutes d’arbres et des coulées de boue avaient perturbé le trafic ferroviaire et avaient bloqué le réseau routier.
Le samedi midi, le plan catastrophe avait été déclenché, les pompiers avaient travaillé jour et nuit. Le dimanche matin, l’armée et la Croix-Rouge avaient été appelées en renfort.
Elle soupira.
— Quel week-end d’apocalypse ! La clinique de Tubize a été touchée de plein fouet. Leur sous-sol a été inondé, ça a provoqué une coupure de courant. Les pensionnaires ont dû être transférés vers d’autres institutions. Les patients ont appris ça par la télévision. Tu imagines la panique ! Ça les a traumatisés. On a eu des crises d’angoisse à tour de bras. Heureusement, ça a l’air de se calmer.
— Vous auriez dû m’appeler, je serais venu vous donner un coup de main.
Elle fit un geste de dépit.
— Laisse tomber, on en a vu d’autres. Viens, on sort une minute, j’ai besoin de fumer une clope, on parlera dehors.
Elle enfila son manteau. Dominique remit sa veste et lui emboîta le pas. Ils sortirent et se dirigèrent vers le parking.
Dominique vit que les mains de l’infirmière tremblaient lorsqu’elle alluma sa cigarette.
— Tu devrais arrêter de fumer.
— Tu me l’as dit mille fois.
— Qu’est-ce qui s’est passé avec X Midi ?
Elle tira une bouffée, avala la fumée, la retint un moment dans ses poumons avant de l’exhaler.
— Ça s’est passé hier soir, vers neuf heures. La télévision s’est mise à hurler dans sa chambre. Quand je suis arrivée, il n’y avait personne, mais il avait la télécommande dans la main.
Dominique fit une grimace.
— Il est capable de l’utiliser, mais il ne l’a fait qu’une seule fois.
— C’est ce que j’en ai déduit. Il a poussé le son à fond.
— Il l’a fait volontairement ?
— J’en suis sûre. Il était immobile, mais ses mains remuaient, il bavait, poussait des râles et me fixait avec intensité.
Elle alluma une deuxième cigarette avec le mégot de la précédente.
— J’ai pris sa tension et son pouls. Il était en pleine crise de tachycardie. Il transpirait. J’ai appelé le médecin de garde. Il a diagnostiqué une crise d’angoisse et lui a administré du Valium.
— Il s’est calmé ?
— Non, c’est ça qui est surprenant. Ça n’a pas eu l’air de lui faire le moindre effet. Ou ce type est une force de la nature ou il a été dépendant au Valium. Le toubib a attendu une demi-heure, mais il était toujours aussi agité. Après trois quarts d’heure, il lui a réinjecté une dose.
— Et ?
— Il a commencé à s’assoupir.
— Il a sans doute vu le journal parlé et a paniqué.
— Ce n’est pas ça, Dominique, il s’est passé quelque chose. Ça fait presque un an que je vois ce pauvre type, paralysé, enfermé dans cet état végétatif. D’un coup, c’était comme s’il venait de se réveiller. Ses yeux exprimaient un tas de choses. De la peur, de l’impatience, de l’étonnement, je ne sais pas. Il m’a fixée dans les yeux. C’était interminable. Ça va te paraître idiot ce que je vais dire, mais ça m’a retournée. J’ai l’impression qu’il voulait me dire un truc. Il y a sept ans que je fais ce boulot. Chaque jour, je côtoie le drame, la douleur et la mort. Je pensais être blindée, mais cette souffrance muette m’a touchée de plein fouet. C’était comme s’il avait un secret qui le rongeait et qu’il voulait l’expulser.
Dominique resta un instant silencieux.
— Je crois que cet homme a connu un drame dans sa vie. J’ai souvent essayé de communiquer avec lui, mais il a l’air mort de peur. Qu’est-ce que tu attends de moi ?
— Je sais que tu l’aimes bien, enfin, je crois.
Il haussa les épaules.
— Dominique aime bien tout le monde. C’est dans ma nature. Mais c’est vrai, je me suis attaché à cet homme. J’aimerais l’aider. J’ai l’impression qu’il aimerait se confesser, libérer sa conscience, ou se décharger d’un secret.
— C’est pour ça que je t’attendais.
— Tu penses qu’il est prêt ?
— C’est ce que j’ai ressenti hier soir. Je ne sais pas quelle sera sa réaction aujourd’hui, mais je crois qu’il en a marre de se taire. Il veut parler et il n’y a qu’à toi qu’il parlera.
49
Il pleuvait
Mary avait chanté dès le soir de notre arrivée à Berlin. Le bassiste que l’agent allemand leur avait promis était au rendez-vous. C’était un Anglais d’une trentaine d’années, originaire de Leeds. Il s’était établi à Berlin à la fin des années cinquante, après avoir rencontré une Allemande durant son service militaire. Il s’appelait Freddie et s’est tout de suite accordé avec les membres des Frames.
Le club dans lequel ils jouaient s’appelait le Graffiti. Il était situé à Charlottenburg, dans le secteur anglais, à proximité de la place Richard Wagner.
C’était une boîte à la décoration tape-à-l’œil qui s’étendait sur deux niveaux. Un restaurant occupait le rez-de-chaussée. On y servait des plats simples à des prix abordables ; des pizzas, des pâtes, des hamburgers ou le traditionnel bratwurst mit zwiebeln. De grands lustres kitsch pendaient au plafond et les murs étaient tapissés d’affiches de cinéma des années trente.
Au fond du restaurant, une double porte capitonnée s’ouvrait sur un escalier qui menait à la discothèque. La boîte était plus spacieuse que le restaurant. Un bar d’une quinzaine de mètres longeait l’un des murs.
J’y ai passé l’essentiel de mes soirées, accoudé au zinc ou juché sur une chaise haute, à avaler bière sur bière en discutant avec Gunther. Je pourrais en décrire chaque recoin. La scène était dressée face au bar, à un mètre du sol. Hormis ces deux endroits stratégiques, la pièce était plongée dans la pénombre. Le mobilier était composé de tables basses, de poufs de cuir rouge et de tabourets à trois pieds qui exigeaient un bon équilibre.
Les premiers clients arrivaient en fin d’après-midi, mais le gros de la troupe débarquait aux environs de vingt heures. C’était pour l’essentiel des militaires ; des Anglais, des Américains, des Français, la plupart en uniforme. Des cohortes d’Allemandes les attendaient de pied ferme, pomponnées, maquillées et parfumées. Elles piaillaient, riaient fort et me traitaient de haut.
C’était un endroit dédié au plaisir et à la frivolité, un endroit comme il y en avait à Soho, mais contrairement à Londres, une détresse se cachait derrière cette façade de gaieté. Berlin-Ouest était une mégalopole qui revêtait des facettes contradictoires. En journée, elle semblait silencieuse, en paix avec elle-même, malgré l’omniprésence du Mur qui hantait les Berlinois et les voyageurs de passage. La circulation y était fluide. La ville était vaste et aérée, traversée par de larges avenues et parsemée de nombreux parcs dont l’immense Tiergarten implanté au cœur de la cité.
Berlin-Ouest était une enclave capitaliste enchâssée dans une zone communiste. L’Occident avait voulu en faire la vitrine de sa démocratie, de sa liberté de pensée et de son pseudo humanisme.
Les vieux Berlinois semblaient maussades et mélancoliques, partagés entre la honte de leur passé nazi, l’humiliation d’être occupés par une force étrangère et la douleur d’être séparés d’une partie de leurs proches. Lorsqu’ils m’apercevaient, avec mon allure négligée et mes cheveux décolorés, ils détournaient les yeux, à l’inverse des Londoniens qui marquaient leur indifférence ou des Parisiens qui me toisaient avec mépris.
Les jeunes s’étaient accommodés de la situation. Ils avaient adopté les codes en vigueur, mais restaient distants de l’excentricité que j’avais connue à Londres.
À la tombée de la nuit, la ville s’échauffait en de nombreux endroits. Le quartier le plus animé jouxtait le Kurfürstendamm, l’artère guindée, avec ses bars à boire, ses night-clubs et ses spectacles de strip-tease. De nombreux groupes anglais s’y produisaient. Ils avaient fui le boom culturel londonien et la déferlante de musique psychédélique dans l’espoir de connaître une certaine prospérité, faute de rencontrer la gloire dans leur patrie.
La chambre mise à la disposition de Mary se trouvait au dernier étage d’un immeuble ocre de la Liesen Strasse, à Wedding, dans le secteur français, à une dizaine de kilomètres du Graffiti. Les autres membres du groupe étaient logés dans un petit appartement meublé situé dans une rue parallèle.
Mary répétait et composait de nouvelles chansons pendant une partie de l’après-midi. Elle me quittait vers quatorze heures et je la rejoignais en début de soirée. Je prenais le bus ou l’U-Bahn pour me rendre à Charlottenburg. Il m’est arrivé d’y aller à pied, mais le périple m’épuisait.
Nous rentrions vers une heure du matin. Bien souvent, nous prenions un taxi dont nous partagions le prix de la course.
De notre fenêtre, nous voyions le Mur qui traversait le cimetière Saint-Hedwig, de l’autre côté de la rue. Pendant sa construction, les autorités est-allemandes avaient déplacé une partie des tombes qui se trouvaient sous le no man’s land.
La nuit, la bande de terre était vivement éclairée. Lorsque je ne parvenais pas à dormir, j’observais les garde-frontières qui allaient et venaient tels des spectres menaçants.
À intervalles réguliers, nous entendions le fracas du S-Bahn qui passait à l’arrière du cimetière. En dehors de cela, la rue était calme, peu de véhicules circulaient.
Je gaspillais mes après-midi à aller de bistrot en bistrot. Je m’asseyais au bar et tentais de lier connaissance avec le gérant. La plupart baragouinaient quelques mots d’anglais ou de français. Je commandais une bière et leur proposais de se joindre à moi. Habituellement, ils acceptaient.
J’ouvrais le dialogue sur un sujet passe-partout, l’agenda des concerts et la météo n’avaient pas de secrets pour moi. Quand le contact était noué, j’expliquais ce que je faisais à Berlin. Je m’étais confectionné des cartes de visite au distributeur minute du KaDeWe, un grand magasin du centre. J’y avais tapé mon nom, Jacques Berger, et mentionné que j’étais batteur professionnel. Pour toute adresse, j’avais inscrit le numéro de téléphone du Graffiti.
Man weiss ja nie ! On ne sait jamais. Gunther m’avait appris cette formule, je la lâchais en fin de parcours, en posant avec nonchalance le rectangle de carton sur le comptoir, accompagné de quelques billets qui arrondissaient le règlement de mes consommations.
Mon état de délabrement empirait de jour en jour. Mon âme avait suivi la déchéance de mon corps, mon corps avait suivi la ruine de mon âme. Mon pessimisme obscurcissait mes jours, mes érections se faisaient rares et laborieuses. Mes matins triomphants avaient fait place à des midis désenchantés.
Mary s’inquiétait. Je devais attendre que les dizaines de pilules que j’avais ingurgitées produisent leur effet pour parvenir à lui faire l’amour. J’étais devenu accro au Tuinal, une gélule à la robe rouge et bleu qui m’aidait à surmonter mes défaillances.
En journée, je prenais un mélange de Dexedrine et de Preludin. Ce dernier était considéré comme un stupéfiant et avait été retiré du marché, mais il existait un réseau de contrebande en Allemagne et je parvenais à m’en procurer à bon prix.
J’absorbais mes pilules avec de la bière. En soirée, je fumais de l’herbe et mâchais des boutons de peyotl. Ce cocktail me permettait d’être un homme pour un moment, et de ne plus en être un le reste du temps.
Je ne lisais plus. Ce n’était ni le temps qui me manquait ni le fait que Berlin était pauvre en livres, mais je n’étais plus capable de me concentrer sur un texte. Je survolais les lignes sans parvenir à en comprendre le sens.
Je m’étais lié d’amitié avec Gunther, l’un des barmen du Graffiti. Il trimballait une énorme panse et ne souriait jamais. Il parlait couramment anglais et adorait le rock. Nous devisions sur les succès d’autrefois et les tendances qui se dessinaient.
Je restais campé sur mes positions, j’estimais que le rock devait être pur et dur ou ne plus porter le nom de rock. Je restais fidèle aux Rolling Stones, je trouvais que les Beatles avaient trahi la cause, leur dernier simple, Strawberry Fields Forever était mollasson.
Gunther prétextait que c’était une évolution logique, qu’il n’était pas envisageable de continuer à composer des rocks basiques sur trois accords jusqu’à la fin des temps. Il aimait ces nouvelles sonorités exotiques et appréciait des groupes américains comme les Byrds.
Un soir, alors que Gunther me disait tout le bien qu’il pensait d’Arnold Layne, le single de Pink Floyd, le téléphone a sonné. Il a échangé quelques mots avec son interlocuteur et m’a dévisagé.
Je me souviendrai de ce jour jusqu’à mon dernier souffle. Le contrat de Mary touchait à sa fin. C’était le 14 mars 1967.
Il pleuvait.
50
Back up
Stern partit du principe que l’enregistrement avait eu lieu et qu’il constituait la clé de voûte de l’affaire.
Que s’était-il passé ce soir-là ?
Qu’était-il advenu de cet enregistrement ?
L’espace d’un instant, il souleva la possibilité que le résultat de la séance n’avait pas donné satisfaction aux organisateurs, ce qui fournissait une explication au fait que le disque n’était jamais sorti.
Après réflexion, il écarta cette hypothèse, l’argent en excluait la probabilité. Si leur performance avait été médiocre, les musiciens n’auraient pas été rémunérés, d’autant qu’ils avaient perçu l’argent dès la fin de leur prestation, contrairement aux pratiques en vigueur dans la profession. Au Royaume-Uni, les artistes étaient payés au pourcentage ou selon un barème forfaitaire, ils recevaient leur dû un an après la sortie du disque. Ce délai grimpait à un an et demi pour les ventes réalisées à l’étranger.
Stern en conclut qu’un événement inattendu avait contrarié la sortie du disque ou que celui-ci était destiné à un autre marché ou à un autre usage.
Il se pencha sur l’absence présumée de l’un des musiciens, celui qui était resté à l’appartement et n’avait pu se rendre à l’enregistrement. Il consulta le tableau qu’il avait réalisé et procéda par élimination.
Il lui parut raisonnable d’exclure d’emblée Jim Ruskin. Ce dernier avait vraisemblablement été l’homme de contact du groupe auprès des organisateurs, sa bonne connaissance de l’allemand penchait en faveur de cette thèse. Les contacts téléphoniques qu’il avait eus avec le dénommé Karl depuis l’appartement de Birgit et les déclarations qu’il lui avait faites la veille et le lendemain du 14 mars confortaient cette option.
En examinant le profil des autres, il conclut que l’absence de Larry Finch à un tel événement ne pouvait être envisagée. Il était le fondateur et le leader de Pearl Harbor. Sans chef de file, un groupe ne fonctionnait pas, surtout s’il était question de réaliser un enregistrement.
Steve Parker était son complice de la première heure. Il tenait la lead guitare et assurait le chant. À eux deux, ils formaient l’âme de Pearl Harbor. Il y avait peu de chances que l’enregistrement ait pu se passer de leur présence.
Restait le quatrième membre, Paul McDonald, le batteur.
McDonald avait parlé de l’enregistrement à Stuart lors de son retour à Londres, mais avait éludé les questions que son ami lui avait posées et n’avait donné aucun détail sur ce qui s’était passé.
C’était un homme de forte constitution. Il buvait énormément et était réputé pour tenir l’alcool et être de santé robuste.
Avait-il été victime d’un malaise de dernière minute ?
Michael Stern prit contact avec Nick Kohn, un chroniqueur musical londonien qu’il avait eu l’occasion de rencontrer lors d’un colloque. Il lui expliqua le sens de sa démarche, lui exposa le contexte et les faits.
Kohn lui répondit qu’aucun musicien n’était réellement irremplaçable lors d’un enregistrement.
De nombreux musiciens de studio intervenaient dans ce genre de situation, soit pour remplir le rôle d’un absent, soit parce que les arrangements l’exigeaient, soit encore dans le but de donner une valeur ajoutée à certaines parties du morceau.
Dans bien des cas, lors d’une absence, on faisait appel à une autre technique, le re-recording. Le procédé consistait à enregistrer après coup des parties sur une piste supplémentaire.
Il prit pour exemple le récent morceau de Cream intitulé Sunshine of Your Love. Clapton avait joué la partition de la guitare solo et celle de la guitare rythmique à l’aide de cette méthode. D’après ses dires, Paul McCartney avait enregistré un titre entièrement seul en jouant de chaque instrument puis en pratiquant des overdubs successifs.
Enfin, Kohn lui confia que dans le monde fermé du rock, on considérait que le line-up classique d’un groupe était composé de trois musiciens et d’un batteur, ce dernier étant souvent considéré comme un mal nécessaire. Cette fonction était par ailleurs appelée à disparaître au profit des boîtes à rythmes, un nouveau composant électronique révolutionnaire. Même si ces boîtes à rythmes n’étaient pas encore au point à l’heure actuelle, il augurait que ces machines allaient se révéler plus précises et surtout plus économiques que l’être humain. Les premiers modèles venaient du Japon et commençaient à être utilisés dans de nombreux studios.
En conclusion, s’il devait émettre un pronostic en réponse à la question de Stern, il estimait que le batteur était le membre le plus facile à suppléer dans un groupe de rock.
Il conclut son appel en déclarant que dans une ville comme Berlin, où de nombreux groupes de bon niveau se produisaient, il ne devait pas être très compliqué de dénicher un batteur valable pour assurer un back up.
51
Trouver un téléphone
Le téléphone contre une oreille, une main plaquée sur l’autre, Gunther écoutait son interlocuteur sans me lâcher des yeux.
Je voyais à la manière dont il me regardait que l’appel me concernait d’une manière ou d’une autre. À un moment, il a hoché la tête et a prononcé quelques mots en forçant la voix pour couvrir le bruit de la musique ambiante. Il a posé la main sur le cornet et m’a interpellé.
Il avait le patron du Viktoria au téléphone, un bar situé près de l’Europa Center dans lequel je passais de temps à autre pour boire un verre et écouter le groupe de rock qui officiait chez lui. Le gars venait de recevoir un appel de quelqu’un qui cherchait d’urgence un batteur pour assurer un back up. Je lui avais laissé ma carte, il tentait sa chance.
Gunther a demandé ce qu’il devait lui répondre.
J’étais d’accord sur le principe.
Gunther a repris le téléphone et traduit ma réponse. Le patron du Viktoria lui a transmis un numéro de téléphone, il fallait rappeler immédiatement, faute de quoi la mission me passerait sous le nez.
Gunther a formé le numéro dans la foulée. Il est tombé sur un type surexcité qui s’appelait Karl. Je l’entendais hurler au téléphone malgré le vacarme qui régnait au Graffiti.
Je devais sauter dans le premier taxi et rappliquer à toute allure. Je ne devais pas me préoccuper du matériel, une batterie était sur place et trois guitaristes attendaient. Je recevrais six cents marks pour la soirée et mes taxis me seraient remboursés.
Je n’ai fait ni une ni deux, j’ai accepté. Gunther a conclu l’accord et le dénommé Karl lui a donné l’adresse.
Six cents marks. C’était bien payé pour un back up de quelques heures, mais c’était une somme dérisoire pour la ruine d’une vie.
Je suis sorti du Graffiti. Une pluie glaciale tombait droit sur les pavés. J’ai couru jusqu’à la place Wagner et me suis précipité dans un taxi.
L’endroit se trouvait dans la Wegelystrasse, au fond de l’avenue du 17 juin, à la limite ouest du Tiergarten. Le taxi s’est arrêté devant un immeuble sans âme comme Berlin en comptait des centaines.
Un homme trépignait d’impatience devant l’entrée. Il était penché en avant et avait relevé son manteau au-dessus de sa tête pour se protéger de la pluie. Il s’est rué dès qu’il m’a vu sortir du taxi. Il s’appelait Karl. Il m’a saisi par le bras et m’a entraîné vers l’immeuble.
Le portail d’entrée ouvrait sur une vaste cour intérieure. Pendant que nous la traversions au pas de course, il m’a lancé quelques mots en allemand. J’ai répondu en anglais que je ne comprenais pas. Il a aussitôt embrayé. Il vomissait ses mots dans le plus grand désordre, mais j’ai saisi l’essentiel du message.
J’allais participer à une séance d’enregistrement. Le groupe était normalement constitué de quatre membres, tous anglais, mais le batteur était tombé malade à la dernière minute. Hormisles trois musiciens et lui-même, personne ne savait et ne devait savoir que je n’étais pas le batteur attitré. Moins j’en dirais, mieux cela vaudrait. Le bassiste me brieferait à l’arrivée. Si je voulais mon argent, je devais jouer le jeu, faire mine de les connaître et m’excuser pour le retard. Je n’avais qu’à prétexter un problème familial.
Pour six cents marks, j’étais prêt à jurer que ma grand-mère venait de succomber à une overdose.
Nous sommes descendus dans un sous-sol dont la porte d’entrée se trouvait au fond de la cour. Nous avons parcouru un labyrinthe de couloirs étroits pour débouler dans une petite salle basse.
L’atmosphère était irrespirable. Le chauffage refoulait, la pièce sentait le moisi. Des effluves de haschich flottaient dans l’air.
Les guitaristes accordaient leur instrument et testaient le matériel. Deux techniciens s’agitaient, l’un était dans le studio et ajustait les micros, l’autre s’affairait dans la cabine. Elle était équipée d’une table de mixage et de deux gros enregistreurs. C’étaient des Studer, du haut de gamme. Je connaissais la marque, mais je n’avais jamais vu ces modèles.
En plus des musiciens et des techniciens, trois hommes étaient présents. Ils étaient debout, immobiles dans le fond de la cabine et observaient les préparatifs. Leur costume strict et leur coupe de cheveux conformiste détonnaient dans le décor. Karl est allé les rejoindre et a débité un monologue sans fin.
Le bassiste est venu à ma rencontre et m’a engueulé pour le retard. Il avait le visage creusé et la peau sur les os. J’ai mâchonné quelques mots d’excuse. Il m’a indiqué la batterie d’un geste autoritaire et m’a ordonné de me mettre en place.
J’ai fait ce qu’il disait sans rechigner, cela faisait partie du scénario. Je me suis installé, l’air penaud. La batterie était une Ludwig en bon état.
Pendant que je prenais mes marques, le bassiste a tourné le dos à la cabine et m’a demandé si je savais compter jusqu’à huit. Il semblait à bout de nerfs. Sans attendre de réponse, il a précisé que la soirée tournerait autour d’une de leurs compositions. Le morceau s’intitulait Girls Just Wanna Get Fucked All Night et débutait par un riff de guitare sur quatre mesures. Il entrerait ensuite. Après quatre nouvelles mesures, ce serait à l’autre guitariste et à la batterie d’entrer en piste. Il était prêt à accepter une mauvaise prise, pas deux, je n’avais qu’à m’adapter. Il m’a conseillé d’en garder sous la pédale pour le pont.
Pour conclure, il a annoncé qu’il attendait de moi autre chose que du rock de tapette.
Il s’est éloigné et l’un des guitaristes est venu me trouver. Contrairement au bassiste, il semblait détendu et en pleine forme. Il souriait comme s’il venait de faire une bonne blague dans le dos de quelqu’un. Il portait de longs cheveux décolorés et une bague à chaque doigt.
En faisant mine d’accorder sa gratte, il m’a lâché quelques informations à mi-voix. Le plan leur était tombé dessus l’avant-veille. Karl était venu les voir au club où ils se produisaient et leur avait proposé cet enregistrement. Il se nommait Jim Ruskin, le bassiste était Larry Finch et le second guitariste Steve Parker. J’étais censé être Paul McDonald. Le groupe s’appelait Pearl Harbor. Le vrai Paul McDonald s’était offert un popper aux nitrites d’amyle pour faire le plein d’octane et l’avait mal encaissé.
Jim n’avait que cinq cordes à sa guitare. Il a suivi la direction de mon regard. C’était l’un de ses traits de génie, il avait enlevé le mi grave et avait accordé son instrument en sol. J’allais voir comment on faisait cracher les tripes d’une Gibson.
Il m’a discrètement tendu la main en m’adressant un clin d’œil. Il tenait dans sa paume une petite boulette noirâtre et quelques morceaux de papier de la taille d’un timbre. Il m’a demandé si je préférais de l’afghan primo ou un peu de lysergesäurediathylamid.
Il transportait du bon matos, l’afghan primo était le meilleur hasch sur le marché, mais il n’était pas aisé de s’en procurer. J’avais eu l’occasion d’en prendre une ou deux fois à Londres. Des veines blanches couraient dans la résine. Birkin m’avait assuré que c’était de la crotte de chèvre et que cela servait de liant. Quant à l’acide, c’était l’occasion de faire ma première expérience. J’ai pris les morceaux de papier et les ai enfouis dans ma bouche.
Quand tout le monde était en place, Larry a fait un signe aux techniciens. Il s’est ensuite tourné vers Steve. Ce dernier était assis sur une chaise et grimaçait, la tête entre les mains. Il s’est levé, l’air maussade.
Larry a pointé un index vers le haut et a attendu que le silence total s’installe.
Il a claqué quatre fois dans les doigts et un grondement de tonnerre a jailli.
Le riff de Steve était sauvage, féroce et jubilatoire. Il produisait du Larsen et saturait à tout va. Après la quatrième mesure, la basse de Larry est entrée dans la danse. C’était un ronflement informe et monstrueux. J’ai composé un fill d’intro et je suis entré avec Jim.
L’enfer s’est déchaîné. Pearl Harbor avait inventé quelque chose.
Le sol tremblait, l’immeuble tremblait.
Berlin tremblait.
Une puissance phénoménale se dégageait de leur musique. Soutenus par une basse démoniaque, leurs riffs se combinaient, s’assemblaient, fusionnaient comme les vents en fureur s’accouplent pour former une tornade. Larry hurlait à s’en déchirer la voix. Les paroles proclamaient que les filles ne rêvent que de se faire baiser toute la nuit. Entre deux couplets, il précisait de quelle manière, puis poussait de longs cris rauques.
C’était bestial, effrayant, inhumain.
Noyé au milieu du vortex, je cognais comme un forcené.
Plus je frappais, plus je sentais un mélange de hargne et de désespoir m’envahir.
L’acide produisait ses effets. J’étais en pleine montée et elle était vertigineuse. J’ai commencé à transpirer à grandes eaux. Mes poils se dressaient sur ma peau. Des traînées lumineuses suivaient les mouvements de mes mains. Les ampoules électriques explosaient et m’aveuglaient.
L’ambiance était surréaliste. Les guitaristes se contorsionnaient, Karl secouait la tête de gauche à droite. Les techniciens prenaient leur pied derrière les manettes.
Figés dans le fond de la cabine, les trois sbires restaient de marbre comme des bobbies qui surveillent une manif.
Nous avons fait quatre prises d’affilée, sans pause, sans prendre le temps de respirer. À un moment, les techniciens nous ont fait signe que c’était bon.
Le monde s’est arrêté.
Je m’étais envolé, gorgé de décibels et de LSD.
Je me suis réveillé sur le trottoir. Les membres de Pearl Harbor me donnaient de grandes tapes dans le dos. Karl a réglé mon dû et tout le monde s’est volatilisé.
La pluie continuait de tomber.
Un fou rire m’a pris. Je suis resté un bon moment, à me marrer, seul sur le trottoir, le nez au ciel, avec des trombes d’eau glaciale qui ruisselaient sur mon visage et s’insinuaient dans mon cou.
Ensuite, j’ai entamé la descente.
Vertigineuse, elle aussi.
J’avais envie de mourir. Je voyais l’étoile Mercedes sur le toit de l’Europa Center, aux confins du Tiergarten, à deux ou trois kilomètres de là. Elle ne se contentait pas de tournoyer comme elle le faisait d’habitude, elle changeait de volume et de couleur, elle soulevait le gratte-ciel et l’emportait avec elle dans la nuit.
Aucun taxi ne passait dans la rue, je me sentais mal, je ne savais que faire.
La gare du S-Bahn était à deux pas. J’aurais pu m’y réfugier comme le faisaient les alcoolos et les drogués. Les forces de l’ordre de Berlin-Ouest n’avaient pas le droit d’y entrer, le S-Bahn était géré par la DDR et les flics se fichaient des junkies occidentaux.
J’aurais pu me réfugier dans la gare du S-Bahn et tout se serait arrêté là. Mais je suis retourné dans le studio dans l’espoir de trouver un téléphone.
52
Quinze misérables secondes
J’ai traversé la cour. La pluie redoublait, l’eau inondait mon visage et je ne voyais plus clair. Je marchais au jugé. J’étais comme une coquille de noix prise dans la tempête.
Je suis parvenu à la porte du sous-sol. Je suis entré. J’étais trempé de la tête aux pieds. J’ai tâtonné dans l’obscurité, mais je n’ai pas trouvé l’interrupteur. Les bras tendus, les yeux écarquillés, j’ai exploré le dédale de galeries en me heurtant aux murs.
Mon cheminement m’a amené devant la porte du studio. Elle était fermée. J’étais au bord de la syncope, la tête me tournait, je vacillais sur mes jambes. Je devais sortir de ce traquenard. J’ai donné un grand coup d’épaule et la porte a cédé.
Je me suis rendu compte que je venais de commettre une erreur.
Une douzaine de personnes s’activaient. Malgré cela, un silence religieux régnait.
Tout le monde s’est arrêté et les têtes se sont tournées dans ma direction. Les techniciens que j’avais vus durant la séance n’étaient plus là, d’autres les avaient remplacés. Certains hommes étaient vêtus d’une ample tenue blanche, avec un bonnet, des gants et un masque sur la bouche. Ils me faisaient penser aux laborantins qui manipulaient des souris blanches à la télévision.
La température s’était rafraîchie. Les senteurs de haschich avaient disparu pour laisser place à une odeur de désinfectant. L’espace d’un instant, les relents m’ont ramené à ma commotion cérébrale et à mon séjour à la clinique Sainte-Elizabeth.
De puissantes lampes sur pied éclairaient la salle a giorno. La batterie avait été démontée, des appareils sophistiqués avaient pris sa place ainsi que de grands coffrets métalliques surmontés de compteurs dont les aiguilles sautillaient. Dans la cabine, quatre techniciens étaient penchés sur la table de mixage, l’air soucieux, des écouteurs sur les oreilles.
Les trois individus en costume étaient toujours présents. Comme lors de l’enregistrement, ils supervisaient ce qui se passait dans le studio. Ils semblaient déconcertés et furieux de mon intrusion.
Un quatrième homme se tenait à leurs côtés. Il était plus âgé qu’eux. D’après son attitude, il devait être leur supérieur. Il mesurait près de deux mètres. Il avait le teint pâle, les sourcils bas sur le front et les yeux enfoncés dans leurs orbites. Ses cheveux étaient aussi blancs que sa chemise. Les quatre hommes étaient équipés d’écouteurs comme en portent les pisteurs sur les aéroports.
Je n’étais pas sûr que je voyais bien. Le lieu et l’instant me paraissaient incertains. J’avais la sensation d’évoluer dans un monde parallèle ou de jouer dans un film de science-fiction. Si ce n’est la présence des hommes costumés qui m’avaient reconnu, j’aurais pu croire que je rêvais ou que je m’étais trompé d’endroit. Je savais que le LSD pouvait générer des hallucinations, mais j’étais à nouveau sur terre et ces types étaient réels.
Le géant m’a dévisagé. Il m’a indiqué du menton en interrogeant les autres du regard.
L’un d’eux s’est approché de lui et a marmonné que j’étais le batteur. Il parlait anglais avec l’accent américain. Il n’en menait pas large. L’information lâchée, il a fait quelques pas en arrière.
Le géant s’est avancé et s’est planté devant moi. Il était large de carrure, son corps occultait mon champ de vision. Il m’a demandé ce que je voulais.
J’ai balbutié quelques mots qui racontaient la pluie, le taxi, la distance, l’étoile Mercedes qui s’était envolée, ce qui me passait par la tête. Avant qu’il n’ait le temps de réagir, j’avais tourné les talons et m’étais enfoncé dans le couloir obscur.
J’avais rencontré suffisamment de musiciens pour savoir que la plupart des enregistrements étaient retravaillés après la prise. Il existait de nombreuses méthodes pour habiller les morceaux dans le but d’améliorer le résultat. Je savais que le mixage était devenu une fonction créative à part entière. Je savais aussi que certains musiciens s’amusaient à produire des effets spéciaux.
Je savais tout cela, mais cette étape était généralement réalisée en bonne intelligence avec les artistes.
De mon entrée dans le studio jusqu’à ma sortie précipitée, moins de quinze secondes s’étaient écoulées.
Quinze misérables secondes.
53
La Saint-Boniface
Quand j’ai ouvert les yeux, le jour était levé et Mary était partie.
Un léger brouillard flottait dans la chambre. Des images confuses se bousculaient dans ma tête. Mon cœur cognait à grands coups, je l’entendais battre dans mes oreilles.
Mary m’avait laissé un mot sur la table.
Elle avait essayé de me tirer de mon sommeil, sans y parvenir. J’étais rentré après elle, ce qui l’avait quelque peu inquiétée. Elle me demandait de l’appeler au Graffiti dès que je serais en route.
J’ai regardé autour de moi. Pendant un moment, j’ai cru que j’avais rêvé, cet enregistrement n’avait jamais eu lieu. J’avais abusé de dope et fait un mauvais trip. J’avais trop fumé, trop bu et pris trop de pilules. Mon cerveau m’avait joué des tours, j’avais été victime d’hallucinations.
Je me suis aspergé le visage avec de l’eau froide. Le miroir m’a renvoyé mon reflet. J’avais le teint hâve et les yeux bistrés.
Je me suis préparé un café et j’ai avalé quelques Tuinal. J’ai troué l’enveloppe à l’aide d’une aiguille pour en accélérer les effets. Je voulais éloigner ce cauchemar dont le goût me pourchassait.
Lorsque je me suis habillé, j’ai trouvé de l’argent dans ma poche. Les billets étaient neufs. J’ai compté, il y avait six cent vingt marks.
J’ai dû me rendre à l’évidence, cet enregistrement avait bel et bien eu lieu. Il me restait à savoir si ce que j’avais vu après faisait partie de la réalité ou si ce n’était que le fruit de mon imagination.
Des points lumineux dansaient devant mes yeux. Progressivement, les images se sont précisées. Je me suis souvenu du guitariste et des morceaux de papier. Jim pensait que j’étais accro au LSD et m’avait donné une dose de cheval.
Je suis sorti. L’escalier tanguait. L’air frais m’a fait du bien. Les arbres commençaient à reprendre des couleurs. Il ne pleuvait plus. Un soleil froid blanchissait la rue.
Je me suis dirigé vers la première cabine téléphonique et j’ai appelé Mary. Elle était soulagée de m’entendre. J’avais eu un sommeil agité. À plusieurs reprises, je m’étais assis dans le lit et m’étais mis à suffoquer. J’étais fiévreux, je transpirais. J’ai prononcé quelques phrases inintelligibles dans un mélange d’anglais et de français. Elle a cru que je délirais.
Je voulais en avoir le cœur net, je suis allé au Viktoria. Le patron m’a reconnu et m’a demandé comment la soirée s’était passée. J’ai mâchonné un semblant de réponse, puis j’ai déposé un billet de cinquante marks sur le comptoir pour le remercier. Je voulais savoir comment cette demande de back up lui était parvenue.
Il a glissé le billet dans sa poche et m’a offert une bière. Il avait reçu un coup de téléphone vers vingt-trois heures. Il ne connaissait pas l’homme qui l’avait appelé. Celui-ci savait qu’un groupe de rock officiait chez lui et voulait engager le batteur pour la soirée. Il se disait prêt à donner cinq cents marks au musicien et à le dédommager de deux cent cinquante marks supplémentaires pour le désagrément que cela lui causerait.
D’après lui, le type n’en était pas à son premier revers. Il y avait beaucoup de monde au Viktoria et son groupe était en pleine action, il a décliné l’offre. Il voulait bien en discuter avec le groupe, mais seulement à la fin de leur set, vers deux ou trois heures du matin. L’homme était nerveux et insistait. Il ne parvenait pas à s’en débarrasser. C’est alors qu’il a pensé à moi. Il ne pouvait pas m’en dire plus.
Je me suis mis aussitôt à la recherche de Pearl Harbor. Il m’a fallu moins d’une demi-heure pour découvrir qu’ils jouaient au Yoyo Bar, dans le quartier du Ku’damm.
Comme je n’étais pas loin de là, j’y suis allé.
Le bar venait d’ouvrir et le patron était de sale humeur. Je lui ai demandé à quelle heure le groupe commençait à jouer. Il m’a répondu que Pearl Harbor ne jouerait plus dans son club, il les avait virés le matin même. J’ai tenté de savoir pourquoi, mais il m’a envoyé balader.
En désespoir de cause, je suis allé au Graffiti. Pendant que Mary terminait sa répétition, j’ai retracé ma soirée à Gunther. Je lui ai confié que j’étais retourné dans le studio après l’enregistrement et que j’y avais vu des choses étranges, mais je ne suis pas entré dans les détails, j’avais peur de passer pour un fou.
Quand nous sommes rentrés, j’ai raconté ma nuit à Mary. Pendant que je lui faisais le récit, elle me caressait le visage. Elle me regardait avec la bienveillance que l’on accorde aux enfants qui racontent un fantasme. Je n’ai pas insisté.
Les jours ont passé et je me suis fait à l’idée que je m’étais imaginé des choses, en tout cas pour la seconde partie de la soirée.
Le contrat de Mary touchait à sa fin et nous préparions notre retour à Londres. Le patron du Graffiti était satisfait de leur prestation, il leur avait proposé une rallonge, mais ils avaient refusé.
Durant mes derniers jours à Berlin, j’ai guetté l’arrivée de Girls Just Wanna Get Fucked All Night. Rien n’est apparu. J’ai interrogé les principaux disquaires de la ville, mais le disque n’était ni référencé ni annoncé.
Début avril, nous sommes rentrés à Londres. En l’espace de trois mois, tout avait changé. L’heure était aux tenues hippies, avec leur lot de franges et leurs couleurs criardes. Les cheveux étaient plus longs. Il était de mise de se laisser pousser la barbe et de porter des babioles autour du cou. La musique aussi avait changé. L’acide était apparu, tout s’était amolli, du beat jusqu’à la démarche des gars de ma génération. Ils traînaient les pieds, prenaient l’air avachi et passaient leurs journées assis devant l’ambassade des États-Unis pour réclamer la paix au Vietnam.
Ma chambre chez Brian était désormais occupée. Les maigres affaires que j’avais laissées m’attendaient, rangées dans un coin du living. Birkin s’était également fait virer. Il habitait avec quelques amis à Chelsea, dans l’appartement d’un guitariste parti en tournée en Australie.
Mary est retournée dans son logement à Kensington et m’a présenté à la propriétaire. Elle l’a prise à part et lui a annoncé que nous allions nous marier.
La femme avait des yeux doux et respirait la bonté. Elle a froncé les sourcils et lui a demandé de répéter. Mary a déclaré qu’elle savait qu’il était interdit à un couple d’emménager dans la maison. Elle allait de ce pas se mettre à la recherche d’un nouveau logement, mais priait la propriétaire d’accepter ma présence momentanée. Elle la suppliait de lui accorder deux semaines pour se retourner.
La femme m’a regardé de pied en cap.
Je me sentais mal dans ma peau, avec mes frusques élimées et ma tignasse rebelle. Elle a souri et son sourire m’a rappelé celui de ma mère. Elle s’est tournée vers Mary, m’a indiqué du pouce et lui a demandé si elle avait vraiment l’intention d’épouser un type comme moi.
Mary m’a pris la main et a hoché la tête.
La femme a soupiré. Les portes de sa maison m’étaient ouvertes, elle allait nous allouer une chambre plus spacieuse qui venait de se libérer.
Elle s’appelait Virginia Fawler. Son mari était mort pendant le Blitz. Je garde pour elle une tendresse toute particulière.
J’ai demandé à Mary ce que Miss Fawler allait penser quand elle apprendrait qu’elle lui avait menti. Elle m’a regardé, a haussé une épaule et a répondu qu’elle lui avait dit la vérité. Je n’ai pas tout de suite saisi ce que cela signifiait.
Cette nuit-là, Mary m’a mordu jusqu’au sang. Le lendemain matin, mon lobe était collé aux draps à cause du sang séché. Mon oreille en a été déformée à jamais. J’ai réveillé Mary, je l’ai prise dans mes bras et je lui ai dit que je voulais qu’elle devienne ma femme.
Ma vie a rebondi. J’allais épouser la femme que j’aimais. Je voulais que ma mère le sache. Pour la première fois, j’ai envisagé un retour au pays, mais les obstacles s’amoncelaient sur mon chemin. J’étais recherché comme déserteur en Belgique et en tant que témoin dans une affaire de mort suspecte en France.
Mary rencontrait de plus en plus de succès. Dès notre retour, il y a eu des tiraillements. Le bassiste et le batteur des Frames ont quitté le groupe. Les guitaristes ont suivi Mary. L’un d’eux s’appelait Bob, c’était un barbu maigrichon qui se grattait sans cesse la tête. L’autre était Tom, c’était un musicien efficace et discret.
J’ai posé ma candidature comme batteur. Ils ont accepté. Nous nous sommes mis à la recherche d’un bassiste. Londres fourmillait de musiciens de talent. Bien vite, nous avons trouvé chaussure à notre pied et avons constitué notre groupe à la fin avril. Quatre musiciens et une chanteuse. Mary and The Gouvernants.
J’avais gardé le contact avec Birkin. Nous nous voyions moins qu’avant mon départ pour Berlin. De temps à autre, il nous rejoignait et nous accompagnait à l’harmonica.
Ces quelques semaines ont été les plus sereines de ma vie. J’avais retrouvé mon emploi chez le disquaire, l’argent rentrait en suffisance. Je travaillais le jour, nous jouions la nuit.
Mary avait gardé ses contrats et en signait sans cesse de nouveaux. Elle était époustouflante et gagnait en assurance. Je jouais presque tous les jours et ma dextérité s’améliorait sans cesse.
La vie nous semblait simple. Nous nous aimions. Nous parlions de notre futur mariage et imaginions mille endroits pour notre lune de miel. Nous nous offrions du bon temps. Nous faisions l’amour. Nous buvions. Nous riions.
Pendant cette période, Mary et moi avons découvert la cocaïne et ses prodigieuses vertus.
Sans trop y croire, je regardais de temps en temps si le disque de Pearl Harbor faisait son apparition dans les bacs. Comme rien ne venait, j’ai commencé à oublier cette affaire.
Au début du mois de juin, alors que je n’y pensais presque plus, il y a eu le massacre de la Saint-Boniface.
54
Main
La neige était tombée en abondance durant la nuit du 23 au 24 décembre.
Le trafic routier était perturbé et Dominique ne parvint à la clinique qu’aux environs de onze heures, après avoir accompli un périple de plus de trois heures pour parcourir les quelques kilomètres qui le séparaient de son domicile.
Le lendemain du week-end pluvieux de la mi-novembre, il était revenu à la charge vers X Midi, comme le lui avait conseillé l’infirmière. Fort de l’assurance de cette dernière, il avait choisi la manière directe. Il lui avait rappelé la procédure à suivre, un battement pour dire oui, deux pour signifier non et lui avait demandé tout de go s’il voulait lui confier quelque chose.
L’homme avait détourné le regard.
Dominique avait battu en retraite. Le lendemain, il lui avait demandé si leur pacte tenait toujours. Il voulait être certain de bénéficier de sa confiance. L’homme l’avait longuement observé et avait cligné des yeux. Aucune initiative n’était venue depuis.
L’homme avait réalisé de nouveaux progrès durant les dernières semaines, les mouvements de ses doigts étaient plus souples et la rotation de sa tête plus ample. Il parvenait à pivoter la tête d’une dizaine de degrés, tant du côté droit que du côté gauche.
Dominique lança quelques formules usuelles et prit la direction de la chambre de X Midi.
Il avait coutume de lui annoncer ses absences, la veille des week-ends ou lorsqu’il prenait un jour de congé en semaine. Le matin, vers neuf heures, l’une des infirmières de nuit l’avait appelé sur son portable pour lui signaler que X Midi présentait des signes de détresse. L’homme connaissait les horaires du personnel et semblait affolé de ne pas voir débarquer Dominique. Elle avait tenté tant bien que mal de le rasséréner, mais rien n’y avait fait.
Dès qu’il fut à proximité de la chambre, il entreprit un dialogue imaginaire.
— Dominique ! Tu es en retard !
— Je sais, il a neigé.
— Il a neigé ?
— S’il a neigé ? Il n’a plus autant neigé dans ce pays depuis soixante-dix ans.
Il fit irruption dans la chambre.
X Midi guettait son arrivée. Un mélange de crainte et de soulagement se lisait dans son regard.
Dominique avança dans la chambre et prit la main de X Midi dans la sienne.
— Excuse-moi, Eddy, je suis en retard. Il a neigé toute la nuit. Il y a trente centimètres de neige dans les rues. Ce soir, c’est la veillée de Noël. Je comptais partir demain matin pour rendre visite à ma famille à Paris, mais les routes ne seront pas dégagées et le Thalys ne roulera pas.
L’homme soutint son regard. Il semblait se calmer peu à peu.
Dominique adoucit le ton.
— Où étais-tu l’année passée à Noël ? Dans ta famille, sans doute ? Tout le monde a une famille quelque part. Tu aimerais revoir ta famille ?
X Midi étouffa un gémissement et remua les doigts.
Dominique l’observa quelques instants. L’homme balançait la tête de gauche à droite, remuait les lèvres.
Dominique se pencha vers lui.
— Tu veux me dire quelque chose, Eddy ?
L’homme fixa son regard dans celui du kiné et cligna rapidement des yeux.
Dominique sentit son cœur bondir dans sa poitrine.
Il approcha son visage.
— Quelques mots de toi seraient pour moi un merveilleux cadeau de Noël.
L’homme poussa un nouveau gémissement.
Dominique passa une main dans ses cheveux.
— Reste calme, mon ami, je suis là pour t’écouter. Je t’ai fait une promesse, je la tiendrai. Ce que tu diras restera entre nous. On est d’accord ?
L’homme cligna des yeux.
Dominique ressentit une vive excitation.
— Tu sais que j’attends ce moment depuis longtemps. J’ai préparé quelque chose pour toi.
Il se dirigea vers l’armoire et prit un rouleau cartonné. Il sortit l’affiche qu’il contenait et la présenta à X Midi.
— Regarde, c’est un abécédaire. Sur la première ligne, il y a les voyelles, sur les suivantes, les consonnes. Elles sont rangées en fonction de leur fréquence. Tu savais que le e était la lettre la plus utilisée en français ? En consonne, c’est le s.
L’homme observait l’affiche avec curiosité.
— Tu vois où je veux en venir ?
L’homme ne réagit pas.
— Je t’explique. Tu vas construire des mots. D’abord je dirai voyelle, si la première lettre de ton mot est une voyelle, tu cligneras des yeux une fois, sinon, tu ne fais rien. Tu vois, je te facilite la vie. Après, je prononcerai chaque lettre, l’une après l’autre. Je le ferai très lentement, tu auras tout le temps. Je t’attendrai. Quand j’aurai prononcé la lettre qui t’intéresse, tu cligneras des yeux une fois. D’accord ?
Pas de réaction.
— D’accord, Eddy, on essaie ?
L’homme continuait d’examiner l’abécédaire.
Dominique ne voulait pas le mettre sous pression. Il enroula le document et le remit dans le tube en carton.
— Voilà, mon ami. Le jour où tu auras envie de me dire quelque chose, je sortirai le carton. Tu n’auras qu’à couper la télévision pour me le faire savoir. Maintenant, je dois y aller, Eddy, j’ai des soins à donner et mes autres amis m’attendent, à tout à l’heure.
Il tourna les talons et prit la direction de la sortie. Lorsqu’il franchit le pas de la porte, la télévision s’éteignit.
Il revint sur ses pas.
— C’est toi qui as éteint ? Tu veux me dire quelque chose ?
L’homme ferma les yeux.
— Bien, alors, je ressors mon carton ?
L’homme le dévisagea.
Dominique reprit l’abécédaire et ralentit ses mouvements. Il ne voulait pas prendre le risque de le faire changer d’avis.
Il laissa X Midi examiner le document durant quelques minutes avant de lui poser la première question.
— Voyelle ?
L’homme n’eut aucune réaction.
— Alors, c’est une consonne ?
Il entama lentement la série de consonnes.
— S ? T ? N ? R ? L ? D ? C ? P ? M ?
L’homme ferma les yeux.
Dominique sentit un flot d’adrénaline envahir ses membres.
— M ? C’est la première lettre de ton mot ?
L’homme cligna des yeux.
Dominique exulta.
— Super ! Extraordinaire ! Tu es génial, Édouard ! M ? M ! Moi aussi je t’M !
L’homme continuait de scruter l’affiche, comme si l’exercice exigeait la plus grande attention.
— Bien, on va continuer. Si je pense que j’ai trouvé le mot, je te ferai des propositions, comme ça, tu ne devras pas aller jusqu’à la dernière lettre.
Il posa son doigt sur la première ligne.
— Voyelle ?
Oui.
— E ? A ?
L’homme cligna des yeux.
— A ? C’est la deuxième lettre ? A ? Comme amour ? MA ? C’est le début de ton mot ?
L’homme acquiesça. Des larmes emplirent ses yeux.
— On continue le même mot ?
Oui.
— Voyelle ?
Oui.
— E ? A ? I ?
Oui.
— I ? MAI ?
L’homme approuva.
— Voyelle ?
Pas de réaction.
— S ? T ? N ?
Oui.
— MAIN ?
Oui.
— Maintenant ?
L’homme ne réagit pas.
— Main ?
L’homme cligna des yeux.
— Main, c’est ton premier mot ?
Oui.
— On continue ?
Pas de réaction.
— C’est ce que tu veux me dire ? Main ?
L’homme cligna des yeux et détourna le regard, laissant Dominique quelque peu perplexe.
— Main ?
55
Loin en arrière
Peut-être vais-je sortir de cette prison. Il me faut le temps. Mes pensées sont claires, je saisis ce qui se passe autour de moi. Je sais ce qu’est une main. Je suis capable de me la représenter. Je perçois à nouveau la présence des miennes.
Je pourrais prononcer le mot si j’en avais les moyens, mais l’épeler me pose problème. Je n’ai ni lu ni écrit depuis si longtemps.
Tout cela me ramène tellement loin en arrière.
56
L’un des derniers sur la liste
Stern était persuadé que le remplacement de Paul McDonald était survenu au tout dernier moment. C’était un homme vigoureux, doté d’une santé à toute épreuve. Compte tenu des enjeux en présence, il n’avait dû déclarer forfait qu’en dernière minute. Sa défection était surprenante.
Pour pallier le désistement du batteur, les organisateurs de l’enregistrement avaient dû se mettre à la recherche d’un suppléant. Nick Kohn, le chroniqueur londonien, avait soutenu que de nombreux groupes de rock officiaient à Berlin. Le défi était de trouver un groupe qui faisait relâche ou un batteur qui était prêt à assumer la relève.
Stern n’avait qu’à rassembler les noms de tous les batteurs qui avaient joué à Berlin-Ouest au cours du mois de mars ; ce qui constituait une véritable gageure. Il renonça à envisager cette option et s’interrogea sur l’attitude qu’il aurait eue à la place des organisateurs.
En toute logique, il se serait lancé dans une tournée téléphonique des boîtes dans lesquelles des groupes se produisaient.
Cette piste lui parut exploitable.
Il constitua la liste des clubs, bars, boîtes de nuit et autres établissements berlinois susceptibles d’avoir embauché des musiciens pour animer leurs soirées.
Contrairement à ce qu’il escomptait, la tâche n’était pas des plus simples, Berlin-Ouest comptait cent trente-neuf endroits qui accueillaient des musiciens de manière ponctuelle ou continue. Il ne pouvait restreindre ses recherches aux seuls groupes de rock, un batteur de jazz ou de variété aurait tout autant fait l’affaire.
Il se rendit chez son rédacteur en chef, lui fit un rapport détaillé sur l’avancement de son enquête et lui proposa de recruter un intérimaire maîtrisant l’allemand pour lancer cette recherche.
La requête lui fut refusée et le rédacteur en chef lui ordonna de laisser tomber cette affaire qui n’intéressait personne.
Stern acta la décision et ne contesta pas.
Dans la soirée, il prit contact avec son ami George Marshall, le vice-chancelier de la Queens, l’Université de Belfast, et lui demanda de dénicher un étudiant de langue allemande prêt à donner quelques coups de téléphone entre ses heures de cours pour se faire un peu d’argent de poche.
Un certain Manfred Hammer, un étudiant originaire de Karlsruhe prit contact avec lui quelques jours plus tard et se déclara prêt à accomplir la tâche. Stern avait préparé le travail et dressé la liste des bars et night-clubs par ordre alphabétique. Il installa l’étudiant chez lui et s’engagea à le payer avec ses propres deniers.
La mission de Hammer consistait à contacter le gérant de chaque établissement pour lui demander s’il avait reçu une demande de back up pour un batteur dans la soirée du 14 mars.
Stern était conscient que plus de sept mois s’étaient écoulés depuis et que la démarche risquait de ne produire aucun résultat.
Hammer entama sa tâche le jeudi 16 novembre, vers onze heures.
En fin de journée, il avait lancé plus d’une cinquantaine d’appels dont la plupart étaient restés sans réponse. Certains interlocuteurs ne lui avaient pas laissé le temps de terminer sa phrase et lui avaient raccroché au nez. Les rares personnes qui l’avaient écouté jusqu’au bout avaient répondu par la négative.
Le lendemain, en fin d’après-midi, alors qu’il commençait à se décourager, Hammer eut en ligne un des serveurs du Danny’s Club. L’homme se souvenait avoir reçu un appel en ce sens. À cette époque, The Sharks, un groupe de rock, se produisait dans la boîte. La personne au téléphone avait besoin d’un batteur pour la soirée et proposait trois cents marks pour ce remplacement.
Cet appel avait généré une controverse dans le club. Au vu de l’importance de la somme, le serveur était allé en parler au batteur qui s’était déclaré preneur. Les autres membres du groupe étaient prêts à le laisser partir s’il acceptait de partager l’argent. Le chanteur se faisait fort de proposer au public un set intimiste, sans batterie, et d’assurer lui-même la rythmique en utilisant des tambourins et des maracas. Mais le patron s’en était mêlé et avait refusé net. La discussion s’était envenimée et les échanges avaient duré quelques minutes.
L’homme au téléphone était furieux d’avoir dû patienter tout ce temps pour essuyer un refus.
Hammer le remercia et téléphona dans la foulée à Stern pour lui annoncer la bonne nouvelle.
Stern se réjouit. Il tenait le bon bout. Il fallait continuer à appeler. Il proposa à Hammer de se trouver un compatriote pour l’assister. Dès le lendemain, Hammer mit la main sur une autre étudiante, Hilde Bachmann, une Bavaroise originaire de Munich.
Entre le 18 et le 24 novembre, ils se relayèrent au téléphone. Ils passèrent des appels sans relâche de dix heures du matin à minuit, en s’encourageant mutuellement et en ne s’arrêtant que pour boire un verre ou manger un sandwich.
Dans certains cas, il leur fallait renouveler l’appel plus de dix fois pour obtenir la bonne personne. Ils réussirent finalement à entrer en contact avec sept personnes qui se souvenaient de l’appel, mais n’y avaient pas donné suite.
Le 24 novembre, vers quinze heures, Hilde Bachmann eut en ligne un certain Fred Weiss, le patron du Viktoria Bar.
C’était l’un des derniers établissements sur la liste.
57
L’un des acteurs involontaires
Les faits se sont déroulés dans la nuit du 4 au 5 juin 1967, à Ramstein, près de Kaiserlautern, à quelque sept cents kilomètres au sud-ouest de Berlin.
En temps normal, l’événement aurait fait la manchette des journaux, mais à l’aube du 5 juin, les Mirage israéliens ont attaqué l’Égypte et détruit leur aviation de chasse au sol. Une demi-heure plus tard, les blindés entraient dans le Sinaï. La Guerre des Six-Jours s’engageait.
Pour l’homme de la rue, c’était le début de la Troisième Guerre mondiale.
Les journaux du matin ont changé leurs titres au dernier moment et le massacre de la Saint-Boniface a été relégué dans les pages annexes, au rang de simple fait divers.
La ville de Ramstein était connue pour héberger la plus importante base aérienne américaine. Comme tous les dimanches soir, les soldats fêtaient leur retour de permission. L’une des boîtes les plus courues du centre-ville s’appelait le Hula Hoop. C’était un gigantesque dancing qui abritait plusieurs bars et un restaurant.
Ce soir-là, de nombreux soldats américains étaient rassemblés, mais aussi des Français, des Anglais et des Belges qui se trouvaient en garnison non loin de là. Nombre d’Allemands étaient également de sortie, pour la plupart des citoyens de la ville.
Vers une heure du matin, une rixe a éclaté.
D’après les témoignages, plusieurs assauts ont été lancés au même moment, à divers endroits de la salle. Les Allemands étaient la principale cible des attaques. Les militaires se sont rués sur eux d’un coup, comme s’ils s’étaient donné le mot.
Les pauvres gars se sont fait massacrer à coups de poing, de pied et de tessons de bouteille. Les militaires semblaient atteints de folie meurtrière. Sept civils allemands ont été tués en l’espace de quelques minutes. Après avoir lynché ces innocents, les soldats américains et anglais se sont retournés contre les Français et les Belges. Ils ont commencé à se battre entre eux. Le sang coulait de tous côtés et rien ne semblait pouvoir arrêter ce déluge de violence. Faute de proies, certains militaires américains s’en sont pris à leurs camarades de chambrée.
La police militaire est arrivée en toute hâte. Les MP ont à leur tour été pris pour cible. Face au nombre d’assaillants, ils ont dû se replier. Les agresseurs les ont poursuivis dans la rue. Les policiers ont ouvert le feu et abattu trois meneurs.
Le calme est revenu aussi soudainement que la flambée de violence était apparue.
Les ambulances sont arrivées. Le bilan était très lourd. On a relevé quinze morts et une trentaine de blessés, certains dans un état critique. Les autorités ouest-allemandes ont parlé de démence collective.
Comme tous les dimanches soir, ce dimanche-là, je faisais relâche. La guerre et le massacre se préparaient pendant que Mary et moi assistions au set de Jimi Hendrix au Saville Theatre. Paul McCartney était présent dans la salle. Jimi a ouvert le concert avec Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band, un bel hommage aux Fab Four dont le disque n’était sorti que depuis quelques jours.
Le lendemain matin, tout le monde ne parlait que de la guerre. J’ai fait ce que je ne faisais jamais, j’ai acheté le journal. J’ai parcouru le compte-rendu du début du conflit israélo-arabe en prenant mon café. Je parlais convenablement anglais, mais la lecture me posait encore quelques problèmes. Mary me traduisait les mots que je ne comprenais pas.
Après avoir lu l’article, j’ai tourné les pages machinalement et je suis arrivé à la rubrique qui retraçait les événements de Ramstein.
Mon cœur a fait un bond.
Il était là. Sur l’une des photos prises peu de temps après le drame. Il était là, mêlé aux badauds devant le Hula Hoop. Il semblait scruter le va-et-vient des ambulances. Il dépassait l’attroupement d’une tête. J’ai reconnu ses cheveux blancs, son allure martiale, son visage fermé et ses yeux enfoncés dans leurs orbites.
J’aurais dû m’arrêter là, terminer mon café et continuer mon semblant de vie, mais j’ai senti qu’il y avait à l’origine de cette hécatombe une vérité effrayante dont j’étais l’un des acteurs involontaires.
58
C’est mon devoir
J’étais troublé par ce que cette découverte présageait. J’ai montré l’article et la photo à Mary. Elle a haussé une épaule, a rétorqué que c’était une coïncidence, que la photo était floue et que mon imagination me jouait des tours.
Elle ne me croyait pas, je n’ai pas insisté. J’ai attendu qu’elle s’en aille.
Dès que la porte s’est refermée, j’ai jeté quelques affaires dans un sac et empoché l’argent que nous avions mis de côté. Une pulsion irrépressible me poussait vers Ramstein.
Je lui ai laissé un mot. Je ne m’étais pas trompé, ce n’était pas une coïncidence.
J’ai pris le métro pour Heathrow. Je suis allé au comptoir de la Lufthansa et j’ai acheté un billet d’avion pour Francfort.
J’étais dans un état second, je me demandais si j’avais pris une bonne décision, j’éprouvais un sentiment de culpabilité envers Mary. Perdu dans mes pensées, j’ai franchi le poste de contrôle sans sourciller.
J’ai débarqué à Francfort en milieu d’après-midi. De là, j’ai pris le train pour Ramstein où je suis arrivé quand la nuit commençait à tomber.
L’émotion était palpable. La gare connaissait une grande affluence, mais le silence régnait. Je croisais des visages défaits, des regards affolés, des silhouettes meurtries. Les événements remontaient à moins de vingt-quatre heures et bon nombre de parents arrivaient seulement.
Les journalistes et les familles occupaient les hôtels de la ville. Des dizaines de personnes étaient assises à même le sol dans le hall de la gare, l’air groggy, le regard dans le vide. Les parents des victimes côtoyaient ceux des assassins. Certains affichaient une expression d’incompréhension ou de déni, d’autres de profonde tristesse.
Je me suis mêlé à la foule. Pour parvenir à mes fins, je me suis fait passer pour le frère d’un militaire belge blessé. Je trouvais hypocrite de me cacher derrière ce paravent en de telles circonstances, mais cet alibi allait m’être utile pour comprendre ce qui s’était passé. Ma connaissance du français et de l’anglais, ainsi que les quelques mots d’allemand que je connaissais m’ont permis d’approcher les témoins.
Chaque fois, j’y allais des mêmes questions.
En définitive, l’un des rescapés, traumatisé par les images tatouées dans sa mémoire, m’a livré le fragment que je redoutais et auquel je m’attendais.
Peu avant l’explosion de violence, il a vu le disc-jockey parler avec un jeune homme en civil à l’entrée de la cabine. Celui-ci lui a tendu une boîte métallique circulaire semblable à celles qui renferment les bobines de film. Mon témoin n’a pas pu m’en dire plus, il a quitté les lieux quelques secondes plus tard, au moment où tout s’est déclenché.
Mon sang s’est figé dans mes veines. Mû par une force invisible, j’ai quitté la gare et pris la route qui menait en enfer. Sans savoir comment, je suis arrivé devant le Hula Hoop.
Des hommes et des femmes étaient rassemblés et se recueillaient à l’entrée de la boîte. Des messages griffonnés à la hâte sur des bouts de papier étaient agrafés sur la porte. Un tapis de fleurs s’étalait devant le bâtiment. Un magnétophone crachotait de la musique classique. Des centaines de bougies étaient posées sur le trottoir. Leur flamme vacillait dans le vent glacé.
Noyé au milieu de cette détresse, je tremblais de rage et de froid. J’étais tel le survivant d’une explosion atomique, j’errais dans les décombres d’une ville dont chaque recoin respirait la mort.
Je suis retourné dans la gare. Partout où j’allais, les gens se parlaient sans retenue, cherchaient les mots pour se faire comprendre et épancher leur chagrin.
À force de questions, j’ai trouvé le disc-jockey. Il avait mon âge. Il était attablé dans l’un des bars de la ville, l’air hagard. Il embarquait pour sa deuxième nuit blanche. L’alcool l’aidait à effacer le cauchemar. Des amis l’entouraient, cherchaient à lui redonner des souffles de vie.
Je me suis assis à sa table. Je lui ai raconté mon histoire de frère blessé. Il connaissait un peu l’anglais. Il m’écoutait sans m’écouter. Les images de la nuit continuaient à le hanter. Il ne trouverait plus jamais le sommeil.
Je ne lui ai pas posé de questions. Nous avons bu et parlé comme le font les gens réunis par le malheur.
Aux confins de la nuit, il m’a livré sa version des faits. Au moment où la rixe a éclaté, il a été pris pour cible par certains militaires américains. Ils lançaient des projectiles contre la vitre de sa cabine, des verres, des bouteilles, des chaises. Il s’est enfermé et s’est réfugié sous la table pour échapper au lynchage.
Il se souvenait des gens qui hurlaient. Il se rappelait les exclamations des assassins qui exhortaient leurs camarades à se battre. Il entendait les cris de douleur des victimes qui agonisaient.
Son récit était long et poignant.
Je lui ai demandé s’il avait une idée de ce qui avait pu générer cette violence. Il n’en savait rien. De fil en aiguille, je l’ai dirigé vers l’indice que j’avais recueilli. Je lui ai demandé s’il se souvenait du disque qui passait au moment de l’assaut. Il ne s’en souvenait pas. Après un moment, il a relevé la tête, m’a observé avec défiance et m’a demandé pourquoi je lui posais cette question. J’ai répondu que c’était une question qui m’était venue sans arrière-pensée.
Ma question l’a amené à se souvenir d’un banal incident. Un client était venu le trouver pendant la soirée. Il lui avait remis un disque dans une pochette métallique et lui avait proposé de le passer. Ce genre de demande se produisait fréquemment. En général, c’étaient les habitués qui lui soumettaient cette requête, mais il voyait cet homme pour la première fois.
Comme il le faisait dans de tels cas, il a écouté quelques mesures au casque pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une plaisanterie. Cette courte audition l’avait rassuré, le morceau était un rock de bonne facture. Il était probable que les événements aient éclaté lors du passage de ce disque.
Nous sommes restés silencieux, à méditer sur la portée de cette révélation.
Sans m’en rendre compte, je venais d’entamer la sinistre randonnée qui allait me précipiter dans les ténèbres d’où je me débats encore aujourd’hui.
J’étais loin d’imaginer que je venais d’assister à une simple répétition générale, que le pire restait à venir.
Au moment où je quittais le bistro, un homme est entré. Il était hagard et paraissait au bout du rouleau. Les gens le connaissaient, c’était l’un des policiers de la ville. Durant la journée, il avait assisté à l’interrogatoire des assaillants, pour l’essentiel des soldats américains. La police militaire menait les entretiens, il était là comme représentant des autorités allemandes.
Il n’en revenait pas de leurs réactions, la plupart d’entre eux ne semblaient pas conscients de la gravité des actes qu’ils avaient commis.
À la question sur le mobile qui les avait poussés à perpétrer ces meurtres, plusieurs avaient répondu par ces mots énigmatiques : it’s my duty, c’est mon devoir.
59
L’interminable accord final
Je n’ai pas dormi de la nuit. J’ai déambulé dans les rues de Ramstein comme un chien perdu. Je passais d’un bar à l’autre et buvais verre sur verre en tentant de capter les conversations proches. Lorsque l’établissement fermait, je sortais et suivais les silhouettes qui vacillaient dans la pénombre, à la recherche du dernier bistrot encore ouvert ou du premier qui ouvrirait.
En début de matinée, je suis retourné à la gare et j’ai acheté un billet pour Berlin. Je voulais savoir ce que les membres de Pearl Harbor avaient manigancé avec cet enregistrement.
Le voyage m’a pris la journée. J’ai dû changer de train à Mannheim et faire une deuxième escale à Hanovre. Mon allure intriguait les autorités. À de nombreuses reprises, j’ai dû exhiber mes papiers et répondre à une foule de questions.
À force de présenter mes pièces d’identité, j’ai fini par être convaincu de leur authenticité. Même les policiers les plus sourcilleux semblaient rassurés à leur lecture.
Je suis arrivé à Berlin en début de soirée. J’avais faim. Je subissais le contrecoup de ma nuit blanche. J’avais dépensé la moitié de mon argent et je me suis contenté d’une miche de pain et d’une saucisse chez un marchand ambulant.
Je suis allé au Yoyo Bar. Cette fois, le patron semblait de bonne humeur. Il faisait salle comble, son établissement était plein à craquer et il fallait jouer des coudes pour atteindre le bar.
Un groupe de rock s’échinait sur la scène. Les musiciens, allumés comme des feux de Bengale, se trémoussaient et produisaient du bon décibel.
Je me suis frayé un chemin jusqu’au zinc, j’ai commandé une bière et j’ai interpellé le patron. Il m’a adressé un signe de la tête pour me signifier qu’il avait enregistré ma requête et a continué à virevolter d’un côté à l’autre du bar. J’ai dû attendre un bon moment avant qu’il daigne m’accorder son attention.
Il m’a demandé ce que je voulais, j’ai hurlé pour couvrir le vacarme. Je souhaitais prendre contact avec les gars de Pearl Harbor.
J’avais préparé une explication fumeuse qui parlait de matériel que je leur avais prêté et que je devais récupérer, mais je n’ai pas dû l’utiliser, il se souvenait de mon passage. Il m’a observé un moment, l’air goguenard, les lèvres plissées dans un sourire mauvais. Il s’est ensuite penché vers moi et m’a raconté l’histoire de Pearl Harbor.
Quelques jours après leur éviction, Larry Finch, le bassiste, avait été retrouvé mort, noyé au fond de la piscine d’un hôtel de luxe à Palma de Majorque. Il avait succombé à une overdose d’alcool et de dope.
Le lendemain, Steve Parker, l’un des guitaristes, s’était tiré une balle dans la tête dans une chambre d’hôtel à Hambourg.
Quelques heures plus tard, Jim Ruskin, l’autre guitariste, celui qui m’avait refilé le LSD, s’était fait broyer par une rame de l’U-Bahn dans la station de la Thielplatz.
Enfin, le batteur, Paul McDonald, s’était jeté du cinquième étage d’un hôtel, à Londres, la semaine suivante.
La police était venue l’interroger au moment des faits, mais il n’avait aucune information à leur communiquer. Malgré leur proximité dans le temps, les policiers n’avaient pas établi de lien entre ces décès. Ils terminaient leur enquête de routine pour boucler le dossier de Jim Ruskin.
Ma visite le surprenait. Quelques jours auparavant, il avait reçu un coup de téléphone d’un certain West, un détective anglais que la famille de Steve Parker avait engagé pour ouvrir une enquête sur le suicide de leur fils.
Il a esquissé une moue dubitative. Selon lui, les parents de Parker tentaient de se donner bonne conscience en avançant l’archiconnue théorie de la conspiration. Pour lui, cette série de morts n’avait rien de suspect, c’était un banal concours de circonstances lié aux abus en tous genres auxquels les quatre types se livraient. Ils étaient drogués, alcoolos et fêlés sur toute la ligne.
Avant de reprendre ses tâches, il voulait savoir pour quelle raison je les cherchais. Je lui ai sorti mon histoire de matériel que je leur avais prêté, mais j’étais à ce point troublé par ce qu’il venait de me raconter que je n’ai pas dû être persuasif. Il n’a pas cru un mot de mon histoire, mais cela ne semblait pas le troubler le moins du monde.
Je suis sorti en hâte du Yoyo Bar. J’étais déboussolé. La tête me tournait. Une montée d’angoisse me tordait les tripes.
Je ne croyais pas à une coïncidence ou à la funeste loi des séries. Mon intuition me disait qu’il y avait un rapport entre ces morts en cascade et la nuit pluvieuse du 14 mars.
Plus je réfléchissais, plus une certitude me taraudait. À l’heure qu’il était, j’aurais dû être mort. Ma visite impromptue dans le studio était l’élément déclencheur de ce carnage. J’étais responsable de la mort de ces quatre hommes.
Je suis allé rendre visite à Gunther au Graffiti. Il était surpris de me voir.
Il avait encore grossi. Malgré l’ambiance survoltée qui régnait, il ne souriait pas plus qu’auparavant. Le public était déchaîné, mais le groupe qui remplaçait les Frames ne leur arrivait pas à la cheville.
Lors de nos conversations, Gunther m’avait expliqué que la liesse apparente qui animait Berlin-Ouest était liée au contexte particulier dans lequel vivait la population. De l’autre côté du Mur, les chars soviétiques se préparaient à envahir la ville, et l’ensemble de l’Europe dans la foulée. C’était une question de semaines, de jours ou d’heures. Les gens le savaient et voulaient profiter des derniers moments d’insouciance et de liberté.
Gunther avait prédit que l’invasion soviétique aurait lieu le jour de l’inauguration de la tour de la télévision. C’était l’une des rares attractions de Berlin-Est que l’on pouvait observer depuis la partie occidentale de la ville.
Les autorités est-allemandes construisaient une gigantesque tour qui culminerait au-delà de 350 mètres. Le plus grand mirador de Berlin-Est, l’emblème de la suprématie soviétique qui permettrait aux autorités communistes d’avoir une vue panoramique sur la ville réunifiée.
Gunther m’a offert un verre et je lui ai raconté la tragique destinée des membres de Pearl Harbor. Je lui ai fait part de ma conviction que les événements dont j’avais été témoin lors de l’enregistrement de mars en étaient la cause.
Il a médité quelques instants. D’après lui, des choses existaient dans certains morceaux, on ne les entendait pas, mais elles étaient bien présentes.
Je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire. Il m’a demandé si j’avais écouté le dernier album des Beatles. J’ai répondu par l’affirmative. Je n’étais plus vraiment fan du groupe, mais je reconnaissais que Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band était un album majeur. Il se vendait comme des petits pains depuis sa récente sortie et tournait en boucle chez le disquaire.
Gunther m’a proposé d’écouter attentivement le dernier morceau de la face B, le déjà célèbre A Day in The Life dont la symphonie cacophonique qui terminait la plage avait généré de nombreux commentaires, pour la plupart dithyrambiques.
Je devais l’écouter jusqu’au bout, jusqu’aux ultimes secondes, et poursuivre l’écoute au-delà de l’interminable accord final.
60
Une grande détresse
Le message énigmatique de X Midi avait tourné dans la tête de Dominique durant les jours qui avaient suivi. À plusieurs reprises, il avait tenté d’entrer une nouvelle fois en communication avec lui pour recueillir des éléments complémentaires, sans succès.
Avait-il voulu lui faire savoir qu’une de ses mains le faisait souffrir ?
Souhaitait-il se servir d’un objet ?
Voulait-il se nourrir seul ?
Désirait-il qu’on lui tienne la main ?
Dominique avait consulté son dossier médical avec attention. Rien ne mentionnait une lésion à l’une de ses mains. En revanche, l’examen lui permit de relever que l’homme avait répondu à des sollicitations en anglais lors des premiers examens réalisés à Saint-Pierre.
Le mot venait-il d’un vocabulaire étranger ?
En anglais, main signifiait principal. Il spécula quelque temps sur cette hypothèse et conclut qu’elle ne l’aidait en rien. Il relut plusieurs fois le dossier, mais ne décela aucune indication susceptible de l’éclairer davantage.
Il savait que certaines informations essentielles ne se trouvaient pas dans les rapports médicaux. Il prit contact avec l’hôpital Saint-Pierre durant la première semaine de janvier et demanda à parler à l’un des membres de l’équipe de soins qui s’était chargée de X Midi lors de son admission.
Il se heurta à l’inévitable barrière administrative et dut batailler ferme pour obtenir la vague promesse qu’une aide-soignante qui s’était penchée sur le cas en question le rappellerait dans les meilleurs délais.
Sans nouvelle, il profita d’un jour de congé pour se rendre à Bruxelles.
Le jeudi 13 janvier, il débarqua au service d’admission de l’hôpital Saint-Pierre et demanda à parler à l’un de ses pairs.
Il patienta dans le hall durant une demi-heure, mais finit par recevoir la visite d’une jeune kinésithérapeute. Elle l’écouta et s’engagea à l’aider.
Elle le pilota au service des urgences où ils mirent la main sur une infirmière qui se souvenait de X Midi.
Elle se rappelait que l’homme portait quelques données sur l’une de ses mains, mais se déclarait incapable de se rappeler de quoi il s’agissait. En revanche, l’information avait été transmise à la police qui l’avait consignée dans son rapport.
Dominique se rendit dans la foulée au commissariat de police chargé de l’affaire, situé rue Marché au Charbon, non loin de là.
Contrairement à ses craintes, il fut reçu par l’officier dirigeant, Gérard Jacobs, un homme chaleureux d’une cinquantaine d’années, à la moustache fournie et à l’accent rocailleux.
Les explications de Dominique le convainquirent et il lui ouvrit l’accès au rapport.
Il apprit que l’information annotée sur la main gauche de X Midi comportait des lettres et des chiffres, A20P7. Le policier précisa qu’un groupe d’informaticiens et un cryptanalyste s’étaient penchés sur cette formule, mais que l’examen n’avait pas apporté de clarification. Il lui communiqua les quelques éléments contenus dans le dossier et lui fit part du constat d’échec qui avait résulté des diverses démarches entreprises pour identifier l’homme.
Dominique s’engagea à son tour à lui transmettre les éventuelles informations qu’il recueillerait.
Le lendemain, Dominique se précipita dans le couloir et fit irruption dans la chambre.
X Midi le fixait avec curiosité.
Dominique s’assit sur le lit.
— A20P7.
L’homme referma les yeux. Des larmes troublèrent son regard.
— C’est ce que tu attendais de moi, n’est-ce pas ? Tu es prêt à m’en dire plus maintenant ?
X Midi sembla hésiter quelques instants, puis cligna des yeux.
Dominique se dirigea vers l’armoire et sortit l’abécédaire.
— Tu te souviens ? Tu sais encore comment ça fonctionne ?
L’homme acquiesça.
Il plaça l’abécédaire bien en vue et laissa X Midi examiner le document durant quelques instants.
— On y va ?
L’homme continuait de fixer l’affiche.
— Voyelle ?
Pas de réaction.
— On y va pour les consonnes ? S ? T ? N ? R ? L ? D ? C ?
L’homme cligna.
— C ? Ok ? C est ta première lettre. Voyelle ?
L’homme semblait troublé.
— Voyelle ?
Il approuva.
— E ?
Affirmation.
— CE, c’est noté.
L’homme ferma les yeux et les tint clos. L’exercice semblait l’épuiser. Il resta un long moment immobile avant de rouvrir les yeux.
Dominique embraya aussitôt.
— On continue ? Voyelle ? Non ? Ok, S ? T ? N ? R ? L ? D ? C ? P ? M ? Ok. M est la troisième lettre. CEM ?
L’homme ferma une nouvelle fois les yeux.
Dominique sentit qu’il se repliait à nouveau. Il se pencha et lui prit la main.
— Tu dois m’aider, mon ami. Je ne connais aucun mot qui commence par CEM. Tu veux bien m’aider ?
L’homme semblait s’être assoupi.
Dominique patienta quelques minutes, figé au pied du lit, l’abécédaire dans les mains.
X Midi rouvrit enfin les yeux.
— On continue le mot ?
L’homme resta sans réaction.
— Tu veux commencer un nouveau mot ?
Il acquiesça.
— Voyelle ? Non ? Consonne.
Il dut aller jusqu’à la lettre X.
— Tu es sûr ? X ? CEM X ?
L’homme cligna.
Dominique ne se découragea pas.
— Voyelle ?
X Midi commençait à transpirer.
— Consonne ?
Dominique entama la série de consonnes. L’homme l’arrêta à la lettre L.
— CEM XL ?
L’homme acquiesça, referma les yeux et les tint clos.
Dominique lui épongea les yeux, lui parla doucement.
— CEM XL. C’est tout ?
L’homme rouvrit lentement les yeux. Dominique y lut une grande détresse.
61
Mon pouvoir de disposer de moi-même
Plus jamais je ne pourrai communiquer avec ce monde. Ces exercices me demandent un effort surhumain. J’ai lu tant et tant de livres, mais je ne suis plus capable de construire le moindre mot. Consonnes et voyelles se livrent un combat sans merci.
Ils ont atteint leur objectif. Je suis réduit au silence. Je ne représente plus de danger pour eux. Mon histoire tombera à jamais dans les oubliettes.
Peu importe à présent s’ils retrouvent ma trace. Je dois remplir le devoir que je me suis imposé, ma raison d’être pendant ces années d’errance.
J’aurais pu partir en paix s’ils ne m’avaient privé de ma dernière liberté, mon pouvoir de disposer de moi-même.
62
Dans son calepin
Lorsqu’il apprit que Hilde Bachmann, l’étudiante qu’il avait recrutée, avait eu un échange prometteur, Michael Stern se rua sur le téléphone et réserva un billet d’avion pour Berlin.
Le week-end approchait et son escapade passerait inaperçue. L’obstination dont Stern avait fait preuve à propos de cette enquête avait irrité son rédacteur en chef. Ce dernier lui avait demandé récemment s’il avait fait une croix sur cette affaire et Stern avait répondu par l’affirmative.
Depuis, une partie des rentrées d’argent du journaliste disparaissait dans cette aventure sans qu’un indice probant atteste que ces morts obéissaient à un mobile commun.
Sa femme montrait également des signes de contrariété à son égard. Après avoir engagé des étudiants pour lancer des centaines d’appels téléphoniques depuis leur domicile, son mari partait à Berlin pour mener une enquête personnelle, le tout financé par leurs économies.
De plus, elle le trouvait nerveux ces derniers temps, il était irascible et semblait obsédé par cette affaire.
Michael Stern débarqua à l’aéroport de Tempelhof le samedi 25 novembre 1967, en milieu d’après-midi. Il prit un taxi, fit un rapide crochet à l’hôtel qu’il avait réservé et se rendit au Viktoria Bar.
Fred Weiss se souvenait de l’appel téléphonique de la soirée de mars. L’homme qui l’avait appelé semblait fébrile et sous pression. Il était à la recherche d’un musicien pour assurer un back up le soir même. Il savait qu’un groupe de rock officiait au Viktoria et souhaitait louer les services du batteur.
Il était près de minuit, l’ambiance était à la fête et la clientèle nombreuse. Pour Weiss, il était hors de question de mettre un terme à la session du groupe pour libérer le batteur. L’homme au téléphone avait insisté et proposé une somme d’argent pour le faire changer d’avis, mais il avait tenu bon.
Il avait alors pensé à l’un de ses clients ponctuels. L’homme était canadien. Il racontait qu’il était de passage à Berlin et que sa petite amie chantait dans un groupe. Il était batteur. Il se disait prêt à accepter une affectation temporaire et lui avait laissé sa carte de visite.
L’homme au téléphone s’impatientait et il ne parvenait pas à remettre la main sur cette carte de visite. Il lui avait demandé de laisser un numéro d’appel et lui avait promis de contacter l’homme en question pour lui demander de reprendre contact avec lui.
Weiss confia à Stern qu’il lui avait fait cette proposition dans le but d’avoir la paix plutôt que pour rendre service à ce client qui ne passait qu’épisodiquement, qu’il trouvait bizarre et peu sympathique.
Le batteur en question était venu le remercier le lendemain et avait déclaré que la soirée s’était bien passée. C’est par cette visite qu’il avait appris que le back up avait bien eu lieu.
Stern lui demanda s’il avait gardé la carte de visite de cet homme. Weiss lui répondit qu’il n’en était pas sûr. Des dizaines de cartes étaient punaisées sur le fronton de son bar. Comme Stern insistait, Weiss fit un tour rapide de celles-ci en maugréant.
Il mit finalement la main sur la carte et la tendit à Stern.
Elle contenait peu d’informations.
Jacques Berger
Drummer — Batteur
Un numéro de téléphone était crayonné au verso.
Weiss précisa que c’était le numéro qu’il avait formé. Son appel avait abouti à un club dont il ne se souvenait pas du nom. Il avait eu l’un des barmen en ligne. Par chance, le batteur était présent à ce moment-là. Il avait laissé le numéro de l’homme, avait jeté le papier où il l’avait inscrit et avait raccroché.
Michael Stern déposa un billet de vingt marks sur le comptoir et le pria d’appeler le club où se trouvait Jacques Berger ce soir-là.
À contrecœur, Weiss se plia à sa demande.
Stern prit aussitôt la direction du Graffiti où il arriva vers dix-neuf heures.
Il se présenta d’abord au restaurant où il interpella les différents serveurs en tentant tant bien que mal de se faire comprendre, mais aucun ne voyait de qui ou de quoi il parlait. L’un d’eux le dirigea vers le night-club situé à l’étage.
La boîte était déjà bien remplie. Un groupe de rock bruyant se démenait sur la scène. Le reste de la salle baignait dans la pénombre.
Il s’adressa à l’un des barmen, commanda un verre et lui demanda si Jacques Berger était présent.
L’employé ne voyait pas de qui il s’agissait. Il comprenait un peu l’anglais et Stern lui fournit quelques précisions. Le serveur déclara qu’il parlait probablement du boy-friend de Mary, la chanteuse des Frames, un groupe anglais qui avait joué chez eux en début d’année, mais qui avait quitté Berlin depuis plusieurs mois.
Stern voulait en savoir plus. Le serveur l’aiguilla vers un autre barman, un homme corpulent à l’air bourru. L’homme l’écouta quelques instants avec une moue d’agacement, coupa court et lui demanda ce qui l’amenait. Stern dut hausser le ton pour se faire entendre, il lui expliqua qu’il était journaliste et lui retraça les grandes étapes de son enquête.
L’homme ne parut pas intéressé par son récit. Il écouta Stern en poursuivant l’essorage de ses verres, l’interrompant régulièrement pour assurer son service.
Quand Stern eut terminé, il lui rétorqua qu’il ne voyait pas en quoi Jacques Berger ou lui-même pouvait être mêlé à cette histoire. Il l’informa que Berger avait trouvé une place de batteur dans un groupe et qu’il était parti au bout du monde pour entreprendre une tournée. Il ne connaissait pas le nom du groupe.
Stern sentit que l’homme était de mauvaise foi et qu’il n’en tirerait rien de plus. Il lui laissa néanmoins sa carte et le pria de demander à Berger de l’appeler s’il venait à prendre contact avec lui.
Dès qu’il sortit de la boîte, il nota les mots Mary et Frames dans son calepin.
63
La dernière image que je garde d’elle
Je suis rentré à Londres le mercredi soir. Mary n’était pas à l’appartement. Je n’avais pas dormi depuis trois jours. Nous jouions au Ronnie Scott’s Club le soir même et j’avais besoin de me reposer, ne fût-ce qu’une heure ou deux. Je comptais sur les quelques comprimés de Pervitine que j’avais mis de côté pour me remettre d’aplomb.
Je pensais que Mary allait rentrer, qu’elle me réveillerait et que nous sortirions ensemble, mais Mary n’est pas rentrée.
Je me suis réveillé le lendemain vers midi. J’avais dormi plus de douze heures et j’étais confus. La lumière me faisait mal aux yeux. J’avais la sensation de rentrer d’un long voyage dans un pays lointain et de retrouver le monde réel.
Mary n’était pas reparue et l’inquiétude me submergeait. J’ai soudain pris conscience de la portée de mes actes. J’étais parti sans préavis, j’avais emporté notre argent et ne lui avais laissé aucun choix. J’avais mis le groupe en péril. Ils avaient dû trouver quelqu’un au pied levé pour me remplacer et assumer les engagements que nous avions pris.
J’ai téléphoné à Bob, l’un des guitaristes. J’avais à peine prononcé deux mots qu’il m’a coupé la parole, m’a adressé quelques mots hargneux et m’a raccroché au nez.
J’aurais dû partir immédiatement à la recherche de Mary, les événements se seraient peut-être déroulés autrement. Je pressentais que mon absence avait entraîné des conséquences, mais je refusais d’affronter la réalité. Je pensais avec naïveté que le temps éclaircirait la situation, que les heures qui allaient suivre apaiseraient les tensions et résoudraient les problèmes.
Je me suis rendu chez le disquaire où une violente réprimande m’attendait. Le gérant m’a adressé un avertissement assorti d’une menace, ma prochaine absence injustifiée serait sanctionnée par un renvoi immédiat. Je me suis excusé et me suis mis au travail. Birkin était là, il m’a adressé un clin d’œil pour me rassurer.
Sur le front de la guerre, les nouvelles étaient peu réjouissantes. L’Égypte avait attaqué un navire américain non armé et l’on craignait que les États-Unis entrent en guerre aux côtés d’Israël.
Pendant que la Troisième Guerre mondiale se préparait, les jeunes Londoniens défilaient, insouciants, dans la boutique. Ils entraient à la suite les uns des autres et ressortaient avec Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band, des Beatles ou A Whiter Shade of Pale, le single sirupeux de Procol Harum.
À la fermeture, j’ai mis A Day in The Life sur l’une des platines. Je l’ai écouté jusqu’au bout, comme me l’avait conseillé Gunther.
Quand les réverbérations de l’accord final se sont éteintes, un silence d’une vingtaine de secondes a fait place à une sorte de chuintement suivi d’un craquement et d’un charabia en boucle. Les phrases étaient incompréhensibles. Le résultat me faisait penser à un disque rayé, lorsque le sillon revient sur lui-même. La séquence se clôturait par une sorte de rire forcé.
Je l’ai écouté plusieurs fois, en tentant de décrypter ce qui se disait.
J’ai appelé Birkin et les autres employés à l’aide. Un des magasiniers avait participé à des enregistrements et savait de quoi il s’agissait. Nous nous sommes regroupés autour de lui et pour la première fois, j’ai entendu parler de backmasking.
Le procédé consistait à insérer des sons ou des paroles enregistrés à l’envers. D’après lui, John Lennon avait découvert cette technique par hasard, en manipulant des bandes alors qu’il avait abusé de marijuana.
Par la suite, les Beatles l’avaient utilisé à plusieurs reprises, en introduisant des phrases, des bruits ou en passant un solo de guitare à l’envers comme ils l’avaient fait dans un de leurs titres. C’était une facétie, un jeu, une lubie de George Martin, leur producteur.
Dans A Day in The Life, la technique utilisée était plus complexe. La partie symphonique était jouée par une quarantaine de musiciens du Royal Philarmonic et du London Symphonic Orchestra. McCartney leur avait demandé de jouer la note la plus basse de leur instrument et d’aller vers la plus haute de la manière et à la vitesse qu’ils souhaitaient.
Le mystérieux sillon final contenait selon lui un message caché, composé à partir d’une bande inversée et d’un sifflement inaudible par l’oreille humaine, mais censé faire aboyer les chiens.
En temps normal, cette discussion m’aurait amusé, mais cette hypothèse ouvrait des perspectives inquiétantes.
Était-il possible de glisser dans un disque des messages ou des sons que notre oreille n’entendait pas, mais que notre cerveau pouvait décoder ? Ces messages pouvaient-ils traverser notre conscient, atteindre notre subconscient et influencer nos comportements ?
Je suis rentré à l’appartement avec la tête chargée d’énigmes et d’informations contradictoires. Un bref coup d’œil m’a suffi pour comprendre que Mary n’était pas venue de la journée.
J’ai eu un moment de panique. J’ai avalé quelques comprimés de Pervitine et je me suis rendu en toute hâte à Soho, au Ronnie Scott’s Club. Le patron des lieux m’a appris que le concert de la veille avait dû être annulé par ma faute. Les gars n’avaient trouvé aucun batteur et Mary avait disparu.
J’ai parcouru les endroits que nous fréquentions, poussé les portes, interrogé ceux qui nous connaissaient. Je devais avoir l’air d’un fou, je lisais de la frayeur et de l’embarras dans les yeux des personnes que j’interrogeais.
De fil en aiguille, j’ai appris qu’on l’avait vue avec Gab, un Jamaïquain que nous croisions de temps à autre. À plusieurs reprises, il avait voulu nous vendre de l’héroïne et j’avais refusé.
Je savais où le trouver. Je me suis rendu chez lui. Il habitait à Brixton. Un ivrogne m’a guidé jusqu’à sa piaule. Il logeait sous le toit d’un petit immeuble de deux étages dans Brixton Road, à l’intersection d’Angell Road.
J’avais les nerfs à vif. Un coup d’épaule m’a suffi pour ouvrir la porte d’entrée. J’ai monté l’escalier à toute vitesse et j’ai tambouriné à sa porte. Je savais qu’il était armé, comme la plupart des dealers, et je ne voulais pas prendre de risque.
Il est venu ouvrir. Il était torse nu. Il avait passé en hâte une paire de jeans. Sa peau ruisselait. Il avait le regard lointain des types en plein trip. Il tenait son flingue dans sa main.
Il m’a demandé ce que je voulais. Je voulais savoir où était Mary. J’ai lu la réponse dans ses yeux. Il a senti le danger. Il a tenté de refermer, mais j’ai pesé de tout mon poids sur la porte. Je l’ai ouverte à la volée et me suis précipité dans la chambre, Gab sur mes talons. Il hurlait, me sommait de m’arrêter, me menaçait de tirer.
Mary était allongée sur un matelas, au fond de la pièce. Une couverture élimée ne cachait rien de sa nudité. Elle semblait endormie, mais ses yeux étaient ouverts et elle me fixait sans me voir.
L’image de Floriane meurtrie entre ses deux violeurs m’a sauté au visage.
J’ai fait volte-face et je me suis dirigé vers Gab.
Il a pointé l’arme sur moi.
Le coup est parti. J’ai senti la balle me perforer l’épaule. J’ai continué à marcher sur lui. Il n’a pas eu le temps de tirer une seconde fois. Je lui ai arraché l’arme des mains. Je l’ai empoigné par les cheveux. J’ai projeté son visage contre la table. Je voyais rouge. Je l’ai remis debout. Toujours en l’agrippant par les cheveux, j’ai frappé une nouvelle fois son visage contre le mur. Et une fois encore. J’entendais ses os craquer, je voyais ses chairs se déchirer, mes mains étaient rouges de son sang.
Quand j’ai arrêté de le frapper, il n’était qu’une masse inerte entre mes mains. Je n’ai pas compris que je l’avais tué. Mon épaule ne me faisait pas souffrir, le sang coulait et ma chemise était trempée.
Mary était debout et regardait la scène.
Elle s’est avancée, nue, au milieu de la pièce. Elle marchait comme un automate, le regard absent. Elle m’a dévisagé, a posé les yeux sur le corps de Gab qui gisait à mes pieds. Elle était au bout du chemin, à la frontière de la folie.
Elle s’est soudain rendu compte de ce qui se passait. Ses yeux se sont agrandis, elle a posé les mains sur sa bouche.
C’est la dernière image que je garde d’elle.
64
Ma dignité
Le bruit de la détonation avait alerté le voisinage, le hurlement des sirènes s’intensifiait. Brixton était un quartier mal famé et les flics intervenaient rapidement.
Je maudissais Mary. Je la maudissais de m’avoir trahi. Je la maudissais de m’avoir amené à commettre l’irréparable. Je la maudissais et je me maudissais. J’ignorais que la meth que j’avais dans le sang était en grande partie responsable de mon accès incontrôlé d’agressivité.
Malgré mon ressentiment, j’aurais dû l’envelopper dans une couverture, la charger sur mon épaule et l’emmener loin de là. J’aurais dû lui épargner la souffrance, le harcèlement, les vexations.
Ma colère et ma peur l’ont emporté sur ma raison. J’ai paniqué et j’ai pris mes jambes à mon cou.
J’ai erré dans les rues jusqu’à l’aube. Je longeais les façades, je me terrais dans leur ombre. J’étais déboussolé. Je pleurais, j’étais ivre de rage. La douleur s’était éveillée et mon épaule me faisait souffrir. La Pervitine continuait à agir. J’étais survolté, j’avais la haine à fleur de peau. Je voulais m’attaquer aux ivrognes que je croisais. Je devais me maîtriser pour ne pas les saisir au collet et les rouer de coups, comme je l’avais fait avec Gab.
Le soleil s’est levé tôt. Le solstice d’été approchait. J’ai pris le métro et je suis allé chez Brian. Je savais qu’il disposait d’une pharmacie complète chez lui. J’ai sonné. Il est venu à la porte, mais n’a pas voulu me laisser entrer. J’ai forcé le passage, je l’ai empoigné par le col de son peignoir et l’ai contraint à descendre à la cave.
Il couinait comme un rat, implorait ma pitié. J’ai exigé qu’il ouvre le coffre-fort dissimulé à l’arrière du bar, derrière le miroir. J’ai pris l’argent qu’il contenait. Brian s’est mis à pleurnicher, il tremblait, bavait et s’était pissé dessus. J’ai pris une bouteille et l’ai frappé sur le sommet du crâne. Il s’est effondré comme une masse.
Je suis monté à l’étage. Je me suis soigné d’une main, comme je le pouvais. La balle était entrée à hauteur de la tête de l’humérus, mais n’était pas ressortie. J’ai vidé un flacon de poudre antiseptique dans la plaie et posé un bandage. Chaque mouvement me faisait gémir de douleur.
Je me suis ensuite mis à la recherche de dope et de vêtements. J’ai avalé des dizaines de pilules et empaqueté quelques affaires qui se trouvaient dans une chambre inoccupée. Avant de m’en aller, je suis redescendu à la cave. Brian était toujours inanimé, mais son cœur battait et il respirait. Il avait les yeux révulsés et du sang sur le visage.
Un nouvel accès de colère m’a submergé. À coups de pied, de genou et de coude, j’ai détruit les guitares, la batterie et les amplis. De ma main valide, je me suis emparé des bouteilles alignées sur les étagères et les ai projetées à travers la pièce, saccageant tout ce que je pouvais.
Quand je suis remonté, quelques types se tenaient en haut des marches, le visage chiffonné de sommeil, les yeux agrandis de stupeur. Ils se sont gardés de descendre ou de m’adresser le moindre mot.
En milieu de matinée, j’ai fait irruption dans le restaurant de Clerkenwell Road. Il venait d’ouvrir. Je n’ai pas commandé le plat du jour. J’ai lancé le mot de passe au serveur qui venait à ma rencontre en lui précisant qu’il s’agissait d’une urgence.
Il m’a conduit dans l’arrière-salle où trois hommes attablés lisaient le journal. J’ai mis mes pièces d’identité et une liasse de billets sur la table. J’ai déclaré qu’il me fallait de nouveaux papiers avant la tombée de la nuit. J’ai posé un second tas de billets à côté du premier et leur ai demandé de me trouver un médecin pour extraire la balle que j’avais dans l’épaule.
Ils ont vu que j’étais déterminé et n’ont pas essayé de négocier. L’un des hommes s’est levé, a empoché l’argent et m’a demandé de repasser vers minuit.
J’ai quitté le restaurant et je me suis rendu dans plusieurs pharmacies pour me procurer des antiseptiques, des antidouleurs et des boîtes de bandages. Je me suis réfugié dans le métro durant le reste de la journée. J’en sortais de temps à autre pour pénétrer dans un bar et changer mes pansements aux toilettes.
La plaie cessait peu à peu de saigner, mais la douleur restait vive et je craignais que la blessure ne s’infecte.
En début de soirée, j’ai téléphoné à Birkin. La police avait débarqué chez le disquaire et avait interrogé tout le monde. Les flics connaissaient mon identité, celle qui figurait sur mes faux papiers. Birkin ne savait pas ce qui s’était passé et n’avait pas de nouvelles de Mary.
Je l’ai remercié, lui ai dit adieu et j’ai raccroché.
Le soir même, j’avais mes nouveaux papiers. Je m’appelais à présent René Schnegg, citoyen français, né à Colmar le 31 juillet 1945.
Ils avaient également trouvé quelqu’un pour me soigner, un vétérinaire d’une soixantaine d’années dont le nez rubicond en disait long sur sa dépendance à l’alcool. Il a chaussé une paire de lunettes surmontée d’une lampe frontale, m’a administré une anesthésie locale et m’a charcuté l’épaule. Les trois Italiens observaient la scène en grimaçant.
Il est parvenu à extraire la balle et a recousu la plaie. Le projectile avait endommagé l’articulation et il émettait des réserves quant à une guérison complète sans une solide rééducation. Selon lui, je garderais une gêne dans certains mouvements.
J’étais loin d’imaginer que son pronostic se vérifierait et que plus jamais je ne pourrais jouer de la batterie.
Les Italiens avaient dû être satisfaits de la somme d’argent que je leur avais donnée, ils m’ont hébergé dans une chambre spartiate située à l’étage du restaurant.
Je me suis tourné et retourné sur le lit grinçant sans pouvoir trouver le sommeil.
Le lendemain matin, j’ai pris le premier train pour Glasgow. L’aéroport de Londres était sûrement sous surveillance et je me serais fait alpaguer si j’y avais mis les pieds.
Je comptais prendre un vol à destination de San Francisco en aménageant quelques étapes pour brouiller les pistes. Ma nouvelle identité diminuait le risque de me voir arrêté, mais j’étais à présent recherché pour meurtre et je devais faire preuve de la plus grande prudence.
Arrivé à Glasgow, je me suis rendu en taxi à l’aéroport de Prestwick. Dans le hall, une plaque commémorative relatait que l’aéroport était le seul lieu britannique dans lequel Elvis Presley avait posé les pieds, en 1960.
J’ai acheté un billet pour Genève. Le vol ne partait qu’en fin d’après-midi. Je me suis allongé dans un coin du hall où j’ai tenté en vain de m’endormir.
Je tremblais de fièvre, une douleur aigüe et lancinante me traversait l’épaule.
À mon arrivée à Genève, je me suis rendu au guichet de la Pan Am pour acheter un billet pour New York. Mon regard a été attiré par une affiche qui représentait un saxophoniste en gros plan. Elle annonçait un festival de jazz qui débutait la semaine suivante à Montreux.
J’ai changé mes plans et j’ai pris le train pour Montreux. Deux heures plus tard, je suis arrivé à destination. Je suis descendu du train.
J’étais seul sur le quai.
Ce n’est qu’à ce moment que j’ai pris conscience que j’avais tout perdu en l’espace de quelques heures, la femme que j’aimais, mon meilleur ami, mon identité et ma dignité.
65
L’homme referma les yeux
Dominique mit près d’un mois pour parvenir à déchiffrer l’énigme que X Midi lui avait posée.
CEM XL.
Sans un coup de pouce du hasard, il n’y serait sans doute jamais arrivé.
Il s’était tout d’abord cassé les dents sur les trois premières lettres, pensant qu’il s’agissait d’une abréviation. Il avait parcouru des dizaines d’annuaires dans le but de trouver à quel sigle ces lettres correspondaient.
Selon le type de publication, il s’agissait d’un cours élémentaire moyen, d’un chef d’état-major, d’une entreprise spécialisée en technologies microondes appliquées ou d’un algorithme de classification automatique.
Quant au XL, il était persuadé que ces lettres signifiaient Extra Large, au sens propre ou au sens figuré.
C’est lors d’une séance de soins avec l’une de ses patientes qu’il se rendit compte que ces dernières lettres pouvaient avoir une autre signification.
Lorsqu’il interrogea la femme sur son âge, son parcours et ses origines, celle-ci lui répondit qu’elle était née à Ixelles et qu’elle y avait passé la plus grande partie de sa vie.
Dans un premier temps, il ne prêta pas attention à cette information et n’établit pas de lien. Ce n’est qu’à la fin de la séance que l’information frappa son esprit et qu’il demanda à la femme de répéter le nom de sa commune d’origine.
Après s’être exécutée, elle lui apprit qu’Ixelles était l’une des dix-neuf communes bruxelloises et que ce nom était régulièrement écrit à l’aide des simples lettres XL, y compris dans certains documents officiels.
L’espace d’un instant, il crut détenir la solution. X Midi souhaitait qu’il consulte une carte d’état-major de la commune d’Ixelles et A20P7, les données qui étaient inscrites sur sa main, représentaient les coordonnées UTM, les lettres et les chiffres qui, disposés en abscisses et ordonnées, permettaient de situer un emplacement précis sur une carte.
Il se mit à la recherche d’une carte détaillée de la commune d’Ixelles, mais dut rapidement déchanter. Non seulement il ne fut pas en mesure de se procurer une carte d’état-major ou une carte topographique d’Ixelles, mais de plus, la combinaison A20P7 ne correspondait à aucune donnée UTM ou GPS.
Il en fut de même lorsqu’il consulta le plan De Rouck, le guide que tous les Bruxellois promenaient dans le vide-poche de leur voiture avant l’apparition du GPS.
Le second éclaircissement lui fut livré de manière tout aussi impromptue, en marge d’un décès qui était survenu à la clinique.
Il se trouvait au secrétariat au moment où l’entreprise de pompes funèbres se présenta pour enlever le corps. Les documents relatifs au transfert des restes mortels ainsi que le certificat d’acceptation par la commune de destination étaient accompagnés d’un papier qui précisait le lieu de la sépulture :
CIMETIÈRE DE VERREWINKEL,
125 avenue de la Chênaie, 1180 Bruxelles
Allée 9, Pelouse 16, Emplacement 53
Depuis le temps que la combinaison A20P7 tournait dans sa tête, il se penchait sur tous les types de coordonnées qui associaient des lettres et des chiffres pour en étudier la construction.
La vue du document le fit bondir.
X Midi lui avait indiqué l’emplacement d’une tombe.
Le A et le P correspondaient. Cette hypothèse donnait également un sens à CEM. L’homme parlait anglais. Au vu de son état de confusion et de la difficulté qu’il éprouvait à utiliser l’abécédaire, il avait dû confondre cimetière avec son équivalent anglais cemetery, ce qui expliquait également les raisons pour lesquelles il n’avait pas complété le mot.
À la fin de son service, Dominique lança un appel téléphonique au cimetière d’Ixelles. La préposée lui confirma qu’il existait, non pas une allée, mais une avenue 20 et une pelouse 7. Cette zone était située dans la partie est du cimetière, non loin du chemin de fer, et renfermait une centaine de tombes.
Le lendemain, Dominique se présenta chez X Midi sans lui servir ses facéties habituelles.
Il s’assit sur le lit sans un mot et attendit que l’homme accroche son regard.
— Bonjour, mon ami.
L’homme l’examina avec curiosité.
— Tu aimerais que j’aille faire un tour sur la pelouse 7 située dans l’avenue 20, au cimetière d’Ixelles ?
Il lut dans les yeux de l’homme le même appel de détresse qu’il y avait décelé quand il lui avait donné le message.
— Tu veux que j’y aille, c’est ça ?
L’homme acquiesça.
— Je vais y aller, mon ami, mais il y a une centaine de tombes là-bas et il me manque le numéro de l’emplacement.
L’homme sembla pris de panique.
— Je t’ai dit que ça resterait entre nous. Tu me fais confiance ?
L’homme cligna des yeux, détourna le regard et se perdit dans l’écran de télévision.
Dominique patienta.
Après quelques minutes, il sembla s’apaiser.
Dominique l’interpella.
— Tu veux bien me parler ?
D’un clignement, l’homme marqua son assentiment.
Dominique se leva, ouvrit l’armoire, prit l’abécédaire et le posa sur le lit, face à l’homme.
Il proposa la série de chiffres, mais X Midi ne répondit pas.
— Tu ne connais pas le numéro, c’est ça ?
L’homme approuva.
— Dans ce cas, donne-moi le nom.
L’homme ouvrit grand les yeux et se mit à transpirer.
Dominique fit mine de ne pas y prêter attention et entama la série de voyelles. Il poursuivit avec la série de consonnes, mais X Midi ne l’arrêta pas.
— Tu veux réfléchir ? Attendre quelques jours ? Être sûr de mon amitié ?
L’homme semblait hésiter.
— Tu veux que je recommence ?
Il exprima son accord.
Dominique reprit les séries.
À chaque lettre, l’homme semblait se creuser les méninges, comme s’il craignait de se tromper ou s’il éprouvait des difficultés à se remémorer le nom qu’il épelait.
L’exercice prit plus d’une demi-heure et permit d’identifier cinq lettres.
O-D-I–L-E.
X Midi transpirait abondamment. L’effort de concentration qu’il avait fourni l’avait épuisé.
Dominique lui épongea le front.
Il tenait le prénom, mais il lui manquait le nom de famille. Il n’insista pas, ce serait un coup de malchance s’il y avait plusieurs Odile enterrées dans cette pelouse.
— J’irai là-bas cet après-midi.
L’homme continuait à fixer l’abécédaire.
— Tu veux ajouter quelque chose ?
X Midi était épuisé, mais il acquiesça.
La première lettre fut un F.
La seconde un L.
Dominique interrompit l’exercice.
— Tu veux que je lui apporte des fleurs ?
L’homme referma les yeux.
66
Un pauvre fou
Si j’avais eu un ami tel que lui, ma vie aurait sans doute été différente. J’avais besoin de structure, d’encadrement. Mes idées n’étaient pas toujours claires et je ne savais pas les exprimer. J’avais besoin d’un guide, de quelqu’un pour m’écouter, me comprendre, me conseiller.
Bien sûr, il y a eu Birkin.
Il m’a aidé à sortir de là.
Avec le temps, je ne sais si je dois le remercier ou le blâmer.
Birkin n’était qu’un pauvre fou.
67
L’homme en question
Michael Stern dut patienter jusqu’au mercredi 20 décembre pour pouvoir se rendre à Londres.
Ce jour-là, Lord George Brown, le ministre des Affaires étrangères, de retour de la réunion des Six à Bruxelles, informait la Chambre des Communes de la marche à suivre par le gouvernement.
Les affaires de politique extérieure n’étaient pas la spécialité de Stern, mais comme aucun journaliste du Belfast Telegraph ne s’était porté volontaire pour faire ce déplacement, il s’était proposé pour couvrir l’événement.
À son retour de Berlin, fin novembre, il avait eu une vive altercation avec sa femme qui lui reprochait de négliger sa vie de famille et de dilapider leurs économies pour financer une enquête que son rédacteur en chef n’avait pas approuvée. Pour éviter une nouvelle dispute, il lui avait promis de laisser tomber l’affaire.
Il avait laissé passer quelques jours et avait repris ses investigations dans la plus grande discrétion.
Début décembre, il avait eu un nouveau contact avec Nick Kohn, le chroniqueur musical londonien, et lui avait demandé de glaner des renseignements sur un groupe anglais qui avait joué à Berlin en début d’année. L’ensemble s’appelait les Frames et la chanteuse qui les accompagnait répondait au prénom de Mary. Il voulait également savoir s’il connaissait un batteur d’origine canadienne dénommé Jacques Berger.
Avant de conclure l’appel, il l’avait prié de traiter sa requête avec la plus grande confidentialité, ce que Kohn avait accepté.
Une semaine plus tard, Kohn l’avait rappelé.
Il n’avait eu aucun mal à obtenir les informations demandées. Les Frames étaient un groupe de pop-rock constitué de cinq Anglais ; quatre musiciens et une chanteuse. Hormis cette dernière qui s’appelait Mary Ann McGregor, le line-up avait souvent changé. Le groupe avait été dissous à son retour de Berlin et une nouvelle formation était née peu de temps après, Mary and The Gouvernants. Le cœur du groupe était constitué de la chanteuse et d’un guitariste des ex Frames.
Un batteur, le dénommé Jacques Berger, un bassiste et un guitariste anglais avaient été engagés dans la foulée.
Le groupe était prometteur, mais un fait divers avait mis fin à leur ascension. En juin, le batteur avait grièvement blessé un petit dealer de Brixton. Depuis, l’homme était en fuite. La chanteuse, présente au moment de l’agression, avait été traumatisée. Elle avait été soignée pour une sorte de dépression nerveuse, mais en était sortie et s’était remise à chanter.
Depuis, elle s’était assagie, avait changé son répertoire et son nom d’artiste. Elle se faisait maintenant appeler Mary Hunter. Il était possible de la voir au Dorchester, un hôtel de luxe situé sur Park Lane.
Elle y officiait sept jours sur sept et était chargée de charmer les touristes fortunés et les hommes d’affaires pendant la happy hour. Deux fois par semaine, elle chantait en fin de soirée au Village, un bar de Soho où elle retrouvait Bob Hawkins, l’ancien guitariste des Frames et des Gouvernants.
Stern remercia Kohn pour ces informations.
Il était satisfait d’avoir réussi à remonter la piste de Berger, cet exploit flattait sa fibre journalistique, mais à présent qu’il approchait du but, l’homme était en fuite, et personne ne savait où il se trouvait.
Le 20 décembre, après avoir mené quelques interviews en rapport avec sa mission, Stern se rendit au Dorchester.
Mary Hunter était une frêle jeune femme au teint pâle. Elle était vêtue d’une longue robe noire qui semblait ne pas lui appartenir. Elle ne portait aucun bijou et n’était pas maquillée.
Stern fut instantanément séduit par sa voix. Dès qu’elle entamait les premières notes d’une chanson, elle exerçait une véritable fascination sur le public.
À l’inverse de ce qu’il avait l’habitude de voir dans ce genre d’endroit, les clients s’arrêtaient de boire et de parler pour l’écouter.
Le pianiste qui l’accompagnait en faisait des tonnes, il grimaçait, agitait les bras en tous sens et considérait que les applaudissements lui étaient destinés.
Lorsque le tour de chant prit fin, Stern apostropha Mary et lui demanda s’il pouvait lui parler. Elle eut un mouvement de recul en voyant ce petit homme insignifiant qui l’interpellait en grimaçant. Il lui expliqua qu’il était journaliste et qu’il réalisait une enquête sur une série d’événements qui s’étaient produits en mars dernier à Berlin, au moment où elle y était avec son ancien groupe.
Elle accepta à contrecœur de lui parler et proposa d’aller autre part. Stern sortit du bar et l’attendit à l’entrée de l’hôtel. Elle revint quelques minutes plus tard, habillée d’un jeans et d’un gros pull en laine. Cette tenue la rendait plus insignifiante encore. Stern constata qu’elle était atteinte d’un léger strabisme.
Ils se rendirent dans un pub proche de l’hôtel où elle répondit de manière laconique à ses questions.
Elle avait eu une liaison avec Jacques Berger. Leur histoire avait duré moins d’un an. Lorsqu’il était à Berlin avec elle, il avait assuré un back up. Il avait dû remplacer au pied levé le batteur d’un groupe de rock pour réaliser un enregistrement. Le disque n’était jamais sorti. Ils s’étaient séparés en juin. Elle n’avait plus de nouvelles de lui.
C’était tout ce qu’elle avait à dire sur Berlin et Jacques Berger.
Stern comprit qu’elle n’en dirait pas plus et que son enquête risquait de marquer une fois de plus le pas. Il reprit la parole et retraça l’histoire des quatre membres de Pearl Harbor, de leur mort dans des conditions étranges, à quelques jours d’intervalles. Il lui dévoila l’ensemble des éléments qu’il avait découverts sans omettre le moindre détail. En final, il lui confia qu’il était arrivé à la conclusion que cet enregistrement avait un rapport direct avec ces disparitions suspectes.
La jeune femme changea d’attitude du tout au tout. Elle semblait effarée par ce qu’elle venait d’entendre.
Elle avait pensé que Jacques Berger avait eu des lubies, qu’il avait rêvé. Elle se rendait compte qu’il ne s’était peut-être pas trompé. Elle se déclara toujours éprise de lui. Elle souhaitait avoir de ses nouvelles et était prête à aider le journaliste dans ses recherches.
Stern commanda une nouvelle tournée et Mary Hunter reprit le récit depuis le début.
Lors de l’enregistrement, un des musiciens avait proposé du LSD à Jacques. Il n’en avait jamais consommé auparavant. Il l’avait pris et l’avait mal supporté. Le lendemain, il était confus et lui avait raconté une histoire extravagante. D’après ses dires, il était retourné dans le studio après l’enregistrement et avait surpris des hommes occupés à trafiquer les bandes. Elle pensait qu’il divaguait et n’avait pas prêté attention à cette histoire.
Début juin, alors qu’ils étaient rentrés à Londres, Berger avait lu un fait divers dans un quotidien. L’article revenait sur une rixe qui s’était déroulée dans une boîte en Allemagne et avait fait plusieurs victimes.
Sur l’une des photos, Berger avait cru reconnaître un des hommes présents lors de l’enregistrement. La vue de cette photo l’avait troublé. Il croyait à une conspiration et était persuadé que cet homme avait orchestré le massacre. Le jour même, il avait quitté Londres en lui laissant un mot expliquant qu’il devait connaître la vérité.
Il était revenu trois jours plus tard alors qu’elle était chez un ami. Berger était devenu fou. Il avait forcé la porte, les hommes s’étaient battus et Berger avait grièvement blessé son ami avant de prendre la fuite. L’enquête de police avait conclu que Berger avait agi en état de légitime défense, mais il n’était plus là pour témoigner.
Depuis ce soir-là, elle n’avait plus eu de nouvelles de lui.
Stern lui demanda si elle avait une idée, même vague, de l’endroit où Berger aurait pu se rendre.
Elle lui confia qu’il ne s’appelait pas Jacques Berger, que c’était un faux nom, mais qu’elle ne connaissait pas sa véritable identité. C’était un homme secret, introverti, peu communicatif, dont les idées n’étaient pas toujours claires. Il lui avait très peu parlé de son enfance et de son passé. Elle savait qu’il avait grandi à Bruxelles, c’était à peu près tout. Il avait été attentionné et prévenant avec elle et il lui manquait beaucoup.
Stern voulut savoir si quelqu’un était susceptible d’en savoir plus.
Berger avait un ami que l’on appelait Birkin, elle ne savait pas si c’était un surnom ou son vrai nom. Elle ne l’avait plus vu. Ils avaient tous deux travaillé chez un disquaire, c’était peut-être une piste à explorer.
C’était maigre. Stern ne voyait pas de quelle manière exploiter les informations qu’il avait reçues. Il résolut de passer la nuit à Londres et d’aller chez le disquaire le lendemain.
Il trouverait bien une raison valable à présenter à sa femme pour justifier l’ajournement de son retour à Belfast.
Avant de quitter Mary, il lui remit sa carte de visite et lui demanda si elle se souvenait du journal dans lequel Berger avait vu la photo de l’homme en question.
68
Mon histoire
Je m’attendais à trouver Montreux en liesse, en pleine effervescence à quelques jours de son festival de jazz, mais tout était calme.
La nuit était tombée. Le lac semblait endormi, les vitrines étaient éteintes et les rues désertes. J’ai erré dans la ville. Mes pas résonnaient sur le trottoir. Hormis les affiches, rien ne laissait transparaître une quelconque agitation ou le moindre préparatif.
Je me suis installé dans un petit hôtel au centre de la vieille ville, dans le quartier des Planches.
Le réceptionniste qui m’a accueilli s’appelait Andrew, mais tout le monde l’appelait Andy. C’était une longue perche à l’allure décontractée et aux cheveux roux carotte. Il avait quatre ou cinq ans de plus que moi. Il venait de New York et avait quitté sa ville natale pour faire le tour du monde. Il faisait une halte de temps à autre et travaillait pendant quelques semaines pour financer la suite de son périple.
Je lui ai demandé s’il était possible de trouver du travail à Montreux. Vaincu par la douleur qui battait dans mon épaule, j’avais renoncé à l’idée de dénicher un back up durant le festival.
Il s’est gratté la tête. La compagnie de taxis recrutait un chauffeur, mais je n’avais pas mon permis et je n’avais jamais conduit de voiture. Le Palace cherchait un concierge de nuit : le leur les avait laissés en plan à quelques jours de l’ouverture du festival.
Selon lui, avec mon bon anglais, mon français courant et mes quelques mots d’allemand, j’avais une chance, mais aucune avec le look que j’arborais.
Le lendemain, je me suis rasé et je suis allé chez le coiffeur. Je suis allé dans une banque pour changer mes livres en francs suisses. J’ai ensuite parcouru les boutiques de la ville et me suis acheté des pantalons, des vestes, des chemises et une série de cravates. Je n’ai pas essayé les vêtements que je choisissais, ma blessure me faisait trop souffrir.
Pour finir, j’ai troqué mes godillots pour des chaussures anglaises classiques. Après cette série d’achats, le pactole de Brian avait fondu et se réduisait à quelques billets.
Dans la rue, les gens m’ignoraient. Je ne me reconnaissais plus dans un miroir.
Après n’avoir été personne, j’étais devenu monsieur Tout-le-Monde.
J’ai prélevé deux gélules du stock de Tuinal que j’avais dérobé chez Brian et me suis présenté au Palace. J’ai rencontré le chef de réception, puis le directeur.
Je n’avais pas de lettres de référence et je n’ai pas le souvenir d’avoir été brillant durant ces entretiens, pourtant j’ai été engagé séance tenante. L’imminence du festival a joué en ma faveur.
Le job n’exigeait pas de compétences pointues, il se limitait à rester éveillé de 22 heures à 8 heures du matin, à décrypter le numéro de la chambre annoncé par le client, quelle que soit la langue qu’il pratiquait ou l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait, et à lui remettre la clé appropriée.
Les fonctionnaires suisses ont pris mes faux papiers pour argent comptant. En attendant la régularisation de ma situation, j’ai pu commencer mon travail dès la veille du festival.
De ces trois jours de jazz, je ne garde que l’image de quelques artistes qui ont traversé le hall, certains en titubant dangereusement. Les stars de cette première édition étaient Keith Jarrett, Jack DeJohnette et Cecil McBee, des noms qui ne me disaient rien.
Peut-être sont-ils venus me réclamer leur clé et sans doute ont-ils été vexés par mon indifférence à leur égard. Entre le jazz et le rock, les cloisons étaient étanches.
Durant le festival et les jours qui ont suivi, j’ai été secondé par un membre du personnel qui avait fait mon job avant de s’orienter vers le room service. Il s’appelait François, c’était un Suisse froid et distant. Il m’a enseigné les rudiments du métier avec un ton chargé de mépris et de condescendance.
En plus de la remise des clés, je devais faire plusieurs fois le tour de l’hôtel pendant la nuit pour vérifier que les portes coupe-feu étaient fermées. Je devais en profiter pour éteindre les lumières aux endroits où elles n’étaient pas nécessaires et mettre les veilleuses.
En outre, je devais être capable de répondre au téléphone, de prendre un message sans le déformer et sans demander à l’interlocuteur de répéter. J’étais tenu de remplir les formalités d’accueil en cas d’arrivée tardive et de monter les bagages des clients dans leur chambre.
En cas de demande, je devais réserver un taxi, commander des journaux, indiquer un itinéraire, conseiller un restaurant ou un bar, suggérer un endroit où l’on pouvait trouver des prostituées, voire en convoquer une.
Je devais tout savoir faire, mais par-dessus tout, il ne fallait jamais discuter les ordres d’un client, si extravagants soient-ils. Je devais respecter mes supérieurs, faire preuve d’une discrétion à toute épreuve et trouver des solutions à tout problème.
Mon salaire n’était pas gratifiant, mais l’hôtel mettait à ma disposition une chambre dans une annexe. J’avais droit à un repas à mon arrivée et à un copieux petit déjeuner à la fin de mon office.
Avant mon départ de l’hôtel, le cuisinier me faisait don de quelques mets pour améliorer mon ordinaire.
Cet emploi me convenait. Les derniers serveurs quittaient l’hôtel vers minuit et me laissaient seul à bord. Hormis un client occasionnel, je ne devais parler à personne, ce qui s’accordait à mon tempérament.
L’hôtel hébergeait deux convives prestigieux. Depuis plusieurs années, Vladimir Nabokov, le célèbre romancier russe, et son épouse avaient fait du Palace leur résidence principale. Ils occupaient une suite au dernier étage.
Comme tout le monde, j’avais lu Lolita et Feu Pâle. J’avais été ébloui par le style poétique et l’imagination débordante de Nabokov et j’avais de l’admiration pour lui. Il consacrait l’entièreté de ses matinées à l’écriture. Quand venait l’après-midi, il partait se promener dans les alpages ou jouait au tennis.
À intervalles réguliers, des journalistes venus de tous les coins du monde venaient l’interviewer. Il les recevait dans le Salon Vert. En fin d’après-midi, il s’installait dans une chaise longue au bord de la piscine.
Quand je commençais mon office, il était déjà couché. Je ne l’ai aperçu que quelques fois, mais c’est sans nul doute sa présence obsédante dans les murs de l’hôtel qui m’a poussé à écrire mon histoire.
69
Quelques jours après les faits
Michael Stern mit rapidement la main sur le journal dont parlait Mary Hunter.
L’article relatant la tragédie de Ramstein se trouvait dans le Daily Telegraph du lundi 5 juin, à la rubrique des nouvelles internationales. D’autres quotidiens avaient également publié la photo sur laquelle Jacques Berger avait cru reconnaître l’un des hommes présents dans le studio après l’enregistrement.
Sur l’image, trois civières recouvertes d’un drap étaient entourées par une équipe de secouristes. Des ambulances, portes ouvertes, stationnaient à l’arrière-plan. Sur la droite, deux policiers tenaient un groupe de curieux à distance. Une bonne trentaine de badauds observaient la scène. Le format réduit et la faible définition de l’image empêchaient de distinguer leurs visages.
Comment Berger était-il parvenu à identifier cet homme sur une telle photo ?
Stern ne se découragea pas pour autant. Rien ne prouvait qu’un des spectateurs faisait partie des hommes présents le 14 mars dans le studio de Berlin, mais le concours de coïncidences était troublant.
Avant de recueillir le témoignage de Mary Hunter, il était arrivé à la conclusion que l’enregistrement était l’élément déclencheur de la disparition des membres de Pearl Harbor. Les informations que la chanteuse lui avait livrées l’avaient définitivement convaincu.
Un incident s’était produit lors de cette séance, probablement l’intrusion de Berger, et ces morts en étaient la conséquence.
Berger avait parlé d’individus qui trafiquaient les bandes.
Dans quel but ? Quel rapport pouvait-il y avoir avec le massacre de la Saint-Boniface ?
Le lien établi par Berger était ténu, mais valait la peine d’être exploré.
Stern voulait connaître tous les détails qui concernaient les événements de Ramstein ainsi que les conclusions de l’enquête.
Il prit contact avec Hans Büler, le correspondant du Belfast Telegraph à Bonn. Ce dernier n’avait pas suivi l’affaire, mais en connaissait les éléments clés.
L’enquête avait conclu à un phénomène de démence collective suivi d’un déchaînement incontrôlé de violence.
Un fait similaire s’était produit à Lima en 1964, lors d’un match de football. Un but refusé avait été à l’origine de bagarres qui avaient fait trois cent vingt morts et plus de mille blessés.
Plus récemment, en septembre, à nouveau dans un stade de football, mais en Turquie cette fois, une situation analogue s’était soldée par la mort de quarante personnes, dont vingt-sept par coups de couteau.
En revanche, c’était la première fois qu’on recensait ce genre de débordement dans une boîte de nuit. Le bilan définitif faisait état de dix-huit morts.
Cette dernière information fit réagir Michael Stern. Les articles parus au moment des faits parlaient de quinze morts.
Hans Büler lui expliqua que deux personnes avaient succombé des suites de leurs blessures et qu’un des employés de la discothèque, le disc-jockey, s’était suicidé.
On l’avait retrouvé pendu chez lui, quelques jours après les faits.
70
Je me suis fait mon idée
Je travaillais six jours sur sept. Mon jour de relâche tombait le mercredi, comme celui de Andy, ce qui nous permettait de nous rencontrer et de partager certaines activités.
Nous nous retrouvions devant l’église de la rue du Temple en milieu d’après-midi. De là, nous empruntions le sentier du Télégraphe et montions à pied jusqu’à Glion, un petit village niché dans les hauteurs, sur la route de Caux.
Le patelin abritait un bistro tenu par un Belge où nous buvions des Stella et fumions des joints. Andy savait où s’en procurer. Les prix étaient plus élevés qu’à Londres, mais la qualité était au rendez-vous.
De par mon mode de vie, j’avais peu à peu réduit ma consommation d’herbe. Je continuais à prendre des amphés, mais plus dans le but de rester éveillé toute la nuit que pour les sensations que cela m’apportait.
En fin d’après-midi, quand les effets de l’alcool et de l’herbe se faisaient sentir, je lui parlais de rock. Je m’étais offert un tourne-disque portatif et m’étais acheté quelques albums. Jimi Hendrix, Cream, Grateful Dead et Jefferson Airplane étaient en haut de la pile.
Andy me parlait de photographie et de peinture, ses deux passions. De nous deux, c’était lui qui parlait le plus. À certains moments, il s’enflammait, ponctuait son discours d’intonations chantantes et de gestes théâtraux. Andy était gay. Son homosexualité n’a jamais posé de problèmes ni créé d’ambiguïté dans nos rapports.
Un jour, je lui ai raconté l’histoire que j’avais vécue dans ma jeunesse et nous en sommes restés là.
Andy commençait la plupart de ses phrases par ces mots : quand je serai riche et célèbre.
Il avait fait ses études artistiques à l’université de Washington et à l’école d’Art de Yale. Il avait remporté une bourse et était parti étudier à Rome avant d’entamer son tour du monde. Montreux n’était que sa seconde étape.
Il disait qu’il allait lancer un nouveau courant pictural, le superréalisme. Il en serait le chef de file, mais d’autres artistes lui emboîteraient le pas. Il monterait de gigantesques expositions dans les plus prestigieuses galeries d’art de la planète et le monde entier l’applaudirait.
Quand il dissertait sur son art, il utilisait des expressions complexes, il parlait de subjectivité affective, d’illusionnisme, de leurre pictural.
Il estimait que la photographie était à mi-chemin entre l’art et la réalité. Il voulait créer une rupture avec l’art abstrait qui dominait. Je l’écoutais sans le comprendre.
Un jour, je lui ai demandé de me présenter ses toiles. Il a semblé réticent. Il les expédiait vers les États-Unis quand elles étaient terminées.
Cela faisait plusieurs semaines qu’il travaillait sur un projet ambitieux. Il a accepté ma demande, mais je ne pourrais découvrir le résultat que lorsqu’il l’aurait mené à bonne fin.
Lors d’une de nos rencontres, Andy a émis une théorie concernant nos centres d’intérêt respectifs. Il affirmait que la vue et l’ouïe étaient les sens exclusifs de l’art. La vue permettait de percevoir la réalité, de capter les objets, de les décrire et de prendre conscience de leur présence. Elle était à la base du raisonnement scientifique.
En revanche, l’oreille ne pouvait transcrire les informations qu’elle captait que sous une forme temporaire. Cette précarité était à la base de la charge émotionnelle que procuraient certains sons en général et la musique en particulier. Il prétendait que l’ouïe récoltait plus l’émotion que la notion.
Je n’ai pas tout de suite saisi la portée de sa thèse, mais il venait de me livrer les éléments qui allaient m’aider à trouver une explication à ce qui s’était passé dans le studio.
Dès le lendemain, je me suis inscrit à la bibliothèque de Montreux, proche de l’hôtel.
Je me suis également abonné à plusieurs revues scientifiques. Désormais, tout ce qui touchait au son, à l’acoustique, à la psychoacoustique, à la géophysique, à la physiologie et à la psychologie m’intéressait.
Le peu d’argent qui me restait en fin de semaine partait dans l’achat de bouquins qu’ils n’avaient pas à la bibliothèque.
Je les parcourais la nuit, pendant mon service. Je prenais des notes.
Quand je me suis senti prêt, j’ai entamé la rédaction de mon histoire en étayant ma thèse d’exemples et de données techniques issues de mes lectures.
Petit à petit, je me suis fait mon idée.
71
Un an jour pour jour
Dès qu’il eut terminé sa tournée de soins, Dominique monta dans sa voiture et prit la direction du cimetière d’Ixelles.
Il était impatient et curieux de voir ce qui l’attendait. Odile n’était pas un prénom courant, mais que ferait-il s’il y avait plusieurs Odile dans ce parterre ?
Il gara sa voiture dans l’avenue des Saisons, entra chez un fleuriste et acheta un magnifique bouquet.
Il consulta le plan qui se trouvait à l’entrée du cimetière et remonta l’allée principale. Il contourna le rond-point et poursuivit dans l’avenue 3. Au second rond-point, il prit à gauche et emprunta l’avenue 20.
La pelouse 7 se trouvait au début de la voie.
Dominique s’arrêta et embrassa la vue. La température était douce pour ces premiers jours de février et un soleil éclatant l’obligeait à plisser les yeux.
Le cimetière était situé au milieu de la ville. Pourtant, seuls quelques cris d’enfants venus d’une école invisible troublaient le silence.
Le terrain partait en légère pente vers une haie de buis derrière laquelle passait le chemin de fer. Au-delà, les tours du boulevard du Triomphe barraient l’horizon.
Le parterre abritait une centaine de tombes, alignées côte à côte sur plusieurs rangées. Pour l’essentiel, il s’agissait de sépultures datant de 1991.
Il les remonta une à une en explorant les prénoms. Au milieu de la troisième rangée, il pila devant l’une d’elles.
ODILE CHANTRAINE
ÉPOUSE R. BERNIER
1920–1991
Il ressentit un choc.
Les battements de son cœur s’accélérèrent. Une photo de la défunte en noir et blanc se trouvait sous l’épitaphe. C’était trait pour trait le portrait de X Midi.
La sépulture semblait à l’abandon. Des traces noirâtres enlaidissaient la pierre tombale. Aucune fleur et aucune bougie ne se trouvaient au pied de la tombe.
Il disposa le bouquet et prit quelques photos de la sépulture.
Une femme qui se recueillait sur une tombe voisine s’approcha en boitillant. Elle ne mesurait pas plus d’un mètre cinquante et avoisinait les quatre-vingts ans.
Son visage reflétait la tendresse.
— Bonjour, Monsieur, excusez-moi de vous importuner.
Dominique lui adressa un large sourire. Elle était coiffée d’une perruque qu’elle avait arrimée de travers.
— Vous ne me dérangez pas, Madame, que puis-je faire pour vous aider ?
— Il n’a pas plu depuis plusieurs jours. J’aimerais arroser mes fleurs, mais les arrosoirs et les robinets sont au bout de l’allée et je marche difficilement.
— Vous aimeriez que j’aille vous chercher un arrosoir ?
— Ce serait aimable à vous. C’est pour mon mari, je viens le voir deux fois par semaine, depuis trente ans.
Elle jeta un coup d’œil à la tombe d’Odile Bernier.
— C’est quelqu’un de votre famille ?
Dominique comprit que l’arrosoir n’était qu’un prétexte à satisfaire sa curiosité.
— C’est quelqu’un de la famille d’un de mes patients, je travaille dans une clinique.
Elle écarquilla les yeux et esquissa une moue admirative.
— Dans une clinique ?
— Oui.
— Vous êtes un docteur ?
Dominique se mit à rire, cette femme l’amusait.
— Non, je ne suis pas assez malin pour ça, je ne suis que kinésithérapeute.
Nouvelle mimique.
— Quand mon mari était malade, un kinéthérapeute s’occupait de lui.
— Kinésithérapeute.
— Oui, je sais, c’est trop compliqué pour moi.
— Qu’est-ce qui est arrivé à votre mari, Madame ?
Elle fit une grimace fataliste.
— Cancer. Il est parti en trois mois de temps. Il avait à peine cinquante-sept ans. Il n’a jamais bu une goutte d’alcool et n’a jamais fumé. Et il jouait au tennis deux fois par semaine.
— Je suis désolé, Madame.
Elle balaya l’air d’un geste fataliste.
— C’est la vie, que voulez-vous, je m’y suis faite. En plus, c’était un bel homme. Je ne l’ai jamais trompé, figurez-vous. Et je n’ai pas connu d’autre homme après lui. Pourtant j’étais encore belle et j’avais quelques prétendants.
— Vous êtes une sainte femme, Madame.
Elle lui adressa un clin d’œil.
— J’en ai quand même connu quelques-uns avant lui.
Dominique lui rendit son œillade.
— Ça restera entre nous.
Elle soupira.
— Il y a longtemps que je n’ai plus vu quelqu’un chez Madame Bernier.
Dominique sentit son cœur bondir dans sa poitrine.
— Vous la connaissiez ?
— Non.
— Pourtant, vous l’appelez par son nom.
— Je connais le nom des cent-huit pensionnaires qui demeurent ici, je viens deux fois par semaine, depuis trente ans.
— Vous savez ce qui lui est arrivé ?
— Je sais en tout cas qu’elle n’a plus de famille directe. Son mari est mort quelques années avant elle. Elle avait un fils qui venait de temps en temps, mais il est mort aussi.
— Elle n’avait qu’un fils ?
Elle parut surprise par la question.
— Oui, et pas de fille, c’est pour ça que personne ne vient depuis bien longtemps.
Elle prit l’air détaché.
— Sauf peut-être le membre de la famille que vous soignez dans votre clinique.
Dominique ne voulait pas entrer dans son jeu. Il se rendit au fond de l’allée, remplit un arrosoir et le lui apporta.
— Je vous souhaite une bonne journée, Madame, merci de m’avoir offert votre sourire.
— À vous aussi, Docteur.
Il la remercia et sortit du cimetière.
Dès qu’il fut dans sa voiture, il prit son téléphone portable, chercha la carte de visite de Gérard Jacobs, l’officier qu’il avait rencontré au poste de police, et forma le numéro.
Celui-ci le reconnut aussitôt.
— Bonjour, vous avez du nouveau ?
— Oui, je pense avoir identifié notre homme.
Le policier marqua une pause.
— Il s’est réveillé ?
— Non, mais il est parvenu à communiquer avec moi.
Dominique lui expliqua la situation et lui relata sa visite au cimetière.
À l’autre bout de la ligne, l’homme notait les informations.
Il attendit que Dominique ait terminé son récit et s’éclaircit la voix.
— C’est bien joué, Monsieur. Les cryptanalystes avaient envisagé les coordonnées d’un cimetière, mais il y en a plusieurs centaines dans le royaume. Je prends des renseignements sur cette Odile Bernier-Chantraine et je vous rappelle.
Avant que Dominique ne raccroche, le policier l’interpella.
— À propos, vous savez quelle date nous sommes ?
La question désarçonna Dominique.
— Le 11 février, pourquoi ?
— Votre homme s’est fait renverser devant la gare du Midi le 11 février, à 18 heures, il y a un an, jour pour jour.
72
Les mots fantômes
Michael Stern mit à profit les quelques jours de congé qu’il avait planifiés entre Noël et le Nouvel An pour se pencher sur une question décisive, à quelle sorte de manipulations s’étaient livrés les hommes que Berger avait surpris dans le studio ?
Il prit rendez-vous avec Chris Reynolds, un ingénieur du son surdoué et volubile qu’il avait connu pendant ses années universitaires. Celui-ci travaillait à présent à Radio 1 et supervisait les enregistrements en studio de l’orchestre d’Ulster. Il était régulièrement sollicité par des organisateurs de spectacles pour assurer la prise de son de certains concerts de rock ou de pop.
Reynolds reçut Stern à son domicile, un petit pavillon à la façade peinte en vert pistache dans Avoniel Drive. Il lui offrit un thé et lui aménagea tant bien que mal une place dans le salon surchargé de livres, de disques et de journaux.
Stern comprit d’emblée qu’il lui faudrait s’armer de patience pour recevoir des réponses à ses questions.
Avec force gestes et onomatopées, Reynolds commença par lui livrer le récit détaillé des concerts de Pink Floyd et de Jimi Hendrix qu’il avait supervisés au Whitia Hall en novembre dernier.
Il lui fit ensuite part de ses réalisations majeures et de son évolution sociale depuis la sortie de ses études. Il lui exposa sa vision de l’évolution de la musique à court, moyen et long terme. Ce monologue prit plus d’une heure.
Stern, dont la capacité d’écoute était une vertu, rongea son frein en sirotant son thé.
Quand Reynolds demanda à Stern la raison de sa visite, ce dernier précisa les termes de sa question pour éviter une nouvelle dérive.
Était-il possible de trafiquer une bande magnétique ?
Si oui, cette manipulation pouvait-elle avoir une influence sur l’auditoire ?
Reynolds fixa le plafond durant un moment, se leva, quitta la pièce et revint muni d’une feuille de papier sur laquelle il reproduisit le schéma d’une oreille en coupe.
Il prit un ton solennel pour entamer sa démonstration.
L’oreille permettait de percevoir les sons, mais c’était le cerveau qui traitait les informations recueillies.
Équipé d’un crayon, il poursuivit son exposé en expliquant à l’aide du schéma que les vibrations sonores étaient canalisées dans un conduit qui menait à une membrane mince, élastique et résistante d’un centimètre de diamètre, bien connue sous le nom de tympan, membrane qui vibrait au moindre heurt causé par un son.
En tapotant sur la feuille, Reynolds précisa que chaque son perçu envoyait au cerveau une impulsion nerveuse selon sa fréquence propre. Les oscillations occasionnées par ce son aboutissaient sur une mince cloison, la membrane basilaire, sur laquelle étaient fixées des milliers de cellules nerveuses qui transmettaient une image sonore au cerveau.
La réalité scientifique était plus complexe, mais il ne voulait pas entrer dans les détails.
Il souligna que l’audition avait ses limites, à l’instar de la vision. L’oreille humaine ne percevait pas tous les sons, mais seulement les fréquences comprises entre 20 hertz, la fréquence la plus grave, et 20 000 hertz, la fréquence la plus aiguë. Toute fréquence inférieure à 20 hertz était qualifiée d’infrason et celle au-delà de 20 kilohertz d’ultrason.
L’air énigmatique, il déclara qu’il était impossible à l’être humain de percevoir les fréquences qui dépassaient ces limites, mais que cela ne signifiait pas pour autant qu’elles n’avaient aucun effet sur lui.
Il prit pour exemple les éléphants, qui utilisaient les infrasons pour éloigner leurs ennemis. Ces mastodontes étaient également capables de communiquer entre eux de cette manière à des distances qui pouvaient aller de cinq à vingt kilomètres.
Il relata ensuite un fait qui fit tressaillir Stern.
Au début des années 1960, deux chercheurs anglais en acoustique avaient testé les effets des infrasons lors d’un concert à Londres. Ils avaient introduit des sons à très basse fréquence dans certains morceaux de musique et avaient demandé ensuite aux auditeurs de décrire leurs ressentis. Une grande partie des personnes interrogées avait fait état de sensations inattendues telles que nostalgie, angoisse ou agressivité.
À forte puissance, les infrasons pouvaient avoir des effets destructeurs, tant mécaniques que physiologiques. Des expériences avaient été réalisées durant la guerre par l’armée allemande. À plus faible puissance, les infrasons généraient des perturbations physiologiques importantes et engendraient des troubles nerveux ou psychologiques.
Voyant Stern fasciné par son discours, Reynolds se leva et se mit à fouiller dans sa bibliothèque. Il en ressortit une revue scientifique et commenta l’un des articles.
Dans les années 1950, deux médecins américains qui étudiaient les effets de certaines ondes sur le cerveau avaient reçu la visite d’agents de la CIA. L’agence gouvernementale s’était emparée de leurs projets et avait récupéré leur technologie pour leurs labos.
Il poursuivit sa lecture par un article signé Allan Frey, publié en 1962 dans le Journal de physiologie appliquée.
L’article rapportait qu’une utilisation de densités de puissance d’énergie électromagnétique extrêmement basse avait induit la perception de sons chez des personnes normales ou sourdes. Cet effet avait été observé à plusieurs kilomètres de l’antenne. Avec des paramètres de transmission quelque peu différents, il était possible d’induire la sensation de coups brutaux à la tête.
La lecture de l’article terminée, il se mit à fourrager dans sa bibliothèque et en sortit, triomphant, une demande de brevet émanant d’un chercheur américain natif de Norcross, en Géorgie.
Le brevet décrivait un système de communication silencieux où l’onde porteuse non audible utilisait des fréquences très élevées ou très basses. La description du procédé expliquait que le message visé était propagé par voie acoustique ou vibratoire et implanté dans le cerveau de la cible par l’intermédiaire de haut-parleurs ou d’écouteurs. Les ondes porteuses pouvaient être transmises en temps réel ou être enregistrées et conservées sur des supports mécaniques ou magnétiques.
Pour compléter sa démonstration, Reynolds s’empara d’un gros magnétophone à bandes Revox et le posa sur la table, face à Stern. Il disparut de la pièce et revint quelques minutes plus tard avec une bobine qu’il plaça sur l’appareil. Il posa une paire d’écouteurs sur la tête de Stern et lui demanda de tendre l’oreille.
L’audition se poursuivit sur près d’une minute, mais Stern n’entendit rien.
Reynolds arrêta la diffusion, fit revenir la bande en arrière et réenclencha la lecture en augmentant la vitesse de lecture.
Stern perçut alors un ensemble de sons qui ressemblaient à s’y méprendre à une sorte de dialogue. Reynolds lui expliqua qu’il s’agissait d’une conversation amoureuse entre deux éléphants.
Sa conclusion était claire, il était possible d’enregistrer ou d’insérer des infrasons dans une bande, mais il fallait disposer d’une installation de forte puissance pour qu’ils aient un effet sur l’auditeur.
Reynolds enchaîna en ouvrant un chapitre relatif aux illusions sonores, en commençant par l’effet Doppler.
Ce phénomène expliquait pourquoi le son d’une sirène devenait de plus en plus aigu lorsqu’une ambulance approchait et qu’il semblait devenir de plus en plus grave lorsque la voiture s’éloignait.
Il agrémenta sa thèse en esquissant un dessin qui explicitait ce phénomène par l’espacement existant entre chaque front d’onde.
Il embraya ensuite sur les illusions musicales ; le paradoxe du triton, la gamme infinie et la mélodie des silences.
Le paradoxe du triton démontrait qu’il était difficile de préciser à quelle octave appartenait une note lorsqu’elle était jouée simultanément sur cinq octaves. Le paradoxe survenait lorsque l’on faisait suivre cette note par une seconde note composée de la même façon, mais séparée par un intervalle de six demi-tons. Comme l’auditeur ne possédait pas d’information précise concernant les octaves, certains attestaient que la seconde note était plus grave, d’autres qu’elle était plus aiguë.
Plus Reynolds avançait dans son discours, plus il s’animait et accélérait son débit.
Il s’empara d’une nouvelle feuille pour présenter la gamme infinie. Il reproduisit schématiquement un clavier de piano et commenta l’expérience réalisée par un nommé Shepard en 1964. Ce dernier avait constitué une gamme qui donnait l’impression de monter indéfiniment. Cette gamme était quelquefois utilisée dans des œuvres de musique.
Il était au bord de l’épuisement lorsqu’il aborda la mélodie des silences.
Il disparut à nouveau de la pièce et revint avec une nouvelle bobine qu’il plaça sur le Revox.
La bande contenait une sorte de brouhaha dans lequel Stern crut discerner une mélodie.
Reynolds exulta. La mélodie entendue n’existait pas, mais était créée dans le cerveau par les silences présents entre les notes. Il partit dans une explication complexe agrémentée de nombreux termes techniques qui parlait de récepteurs toniques et phasiques, de codage de la durée des stimuli et d’adaptation du cerveau à ceux-ci.
Stern était soûlé de mots.
Il décrochait et était prêt à déclarer forfait lorsque Reynolds aborda la partie la plus impressionnante des illusions sonores.
Il s’empara d’une troisième bande et remit les écouteurs sur les oreilles de Stern.
Cette fois, le journaliste discerna des sons alternativement à droite et à gauche. Il s’agissait d’une voix féminine qui prononçait un mot inconnu de deux syllabes, le même de chaque côté, avec un léger décalage. Petit à petit, Stern commença à percevoir d’autres mots, intercalés entre ceux-ci, puis une phrase complète accompagnée d’une sorte de mélodie.
Reynolds s’amusait comme un gamin.
Les mots, les phrases et la mélodie que Stern avait entendus étaient absents de la bande. Ce phénomène était dû au fait que le cerveau humain cherchait en permanence à donner un sens à ce qu’il entendait.
Les syllabes privées de signification étaient associées à des mots connus, puis combinées pour composer d’autres mots ou des phrases complètes.
Les scientifiques avaient baptisé ce phénomène les mots fantômes.
73
Son devoir l’attendait
Les jours ont passé. L’automne est arrivé, suivi de près par l’hiver. Sur l’autre versant du Léman, les sommets se sont couverts de neige.
Le rock devenait de plus en plus planant, les morceaux étaient de plus en plus longs et je commençais à m’en lasser. Dans ce registre, les Doors et Pink Floyd tenaient le haut du pavé. Magical Mystery Tour, le dernier album des Beatles, marquait leur déclin. L’insupportable Nights in White Satin des Moody Blues n’en finissait pas de dégouliner des postes de radio.
Pour ma part, je restais fidèle au rock pur et dur et continuais à apprécier une rythmique soutenue comme celle de Sympathy for the Devil des Stones.
À l’hôtel, la routine s’était installée. À force de remarques, de critiques et de remontrances, j’avais appris mon métier. Les clients de l’hôtel me jugeaient discret et efficace, la direction se satisfaisait de cette appréciation.
Je commençais à m’exprimer. Il s’agissait pour l’essentiel de phrases toutes faites, de formules de politesse ou de questions rituelles, mais j’étais désormais capable d’adresser la parole à quelqu’un en le regardant dans les yeux.
Ma douleur à l’épaule s’était peu à peu estompée, mais je gardais une ankylose qui m’empêchait d’accomplir des gestes amples. Je refusais l’idée que je ne pourrais plus jamais jouer de la batterie. Je me rassurais en me disant que je suivrais une rééducation, plus tard, quand les choses se seraient définitivement calmées.
Je m’étais désintoxiqué. Hormis les quelques joints que je fumais avec Andy le mercredi, je m’étais libéré de la dope. L’alcool restait mon amie intime, mais il fallait que j’en avale des quantités considérables pour perdre le sens des réalités. Je buvais à petites gorgées, au long de la nuit. J’arrivais à jeun et repartais avant l’arrivée du personnel, ma dépendance passait inaperçue.
À chaque rencontre, Andy m’annonçait l’imminence de son départ. Cette information passée, il me parlait de sa peinture, je lui parlais de rock.
Le lendemain du réveillon, il a déclaré que son projet était enfin prêt. Il acceptait de me le présenter avant de l’expédier à New York.
Pour la première fois, je me suis rendu dans sa chambre, une mansarde située dans un vieil immeuble de la rue d’Etraz. Un véritable capharnaüm m’attendait. Il m’a prié de ne pas faire attention au désordre.
Une immense photographie en couleurs de deux mètres sur trois se trouvait contre le mur du fond. Elle représentait une grosse voiture américaine bleu vif, garée devant un magasin de chaussures dans une grande ville américaine, New York, à n’en pas douter. J’ai tout d’abord pensé qu’il s’agissait d’un tirage dont il s’était servi pour créer son œuvre.
Il m’a demandé d’approcher. J’ai remarqué que la fresque était constituée d’éléments carrés de cinquante centimètres de côté.
J’ai avancé de quelques pas et suis resté bouche bée. Jamais de ma vie, je n’avais vu une peinture exécutée avec autant de réalisme. Le reflet de la voiture se devinait dans la vitrine, chaque élément, chaque objet étaient reproduits avec un luxe de détails incroyable. L’effet était saisissant. Je n’osais imaginer le temps qu’un travail d’une telle minutie avait exigé.
J’ai reculé et je me suis assis. Je suis resté près d’une heure, prostré devant ce chef-d’œuvre, à en examiner chaque recoin.
Andy s’amusait. Il virevoltait autour de moi en minaudant. Il m’a demandé si je comprenais à présent pourquoi un jour, il serait riche et célèbre.
Durant la nuit, je poursuivais mes recherches. Je notais mes observations et les reliais aux faits que j’avais vécus. Lorsque le sommeil me gagnait, j’allumais la télévision.
À mesure que je me documentais, mes connaissances sur le sujet s’enrichissaient. J’étais devenu un expert de l’ouïe, du son et de l’acoustique.
Je serais bien en mal de me souvenir des innombrables articles que j’ai étudiés à cette époque, mais mon verdict était définitif les hommes du studio avaient trafiqué Girls Just Wanna Get Fucked All Night.
Je suis arrivé à la conclusion que le travail qu’ils avaient réalisé se révélait plus subtil que quelques phrases enregistrées à l’envers, même si je n’avais pas abandonné l’idée qu’ils avaient également fait appel à cette technique.
Je m’étais fixé sur les mots cachés, ce que les spécialistes en acoustique appelaient les ghost words ; des mots inexistants, mais générés par le cerveau sur base de phonèmes. Selon moi, ils les avaient enregistrés en les couplant à des fréquences très basses qui les rendaient indécelables. Ces fréquences basses que l’on ne pouvait percevoir expliquaient le fait que certains animaux pressentaient les catastrophes naturelles. Sans que l’on en soit conscient, ces fréquences provoquaient de profonds changements comportementaux.
Les ghost words, quant à eux, expliquaient que seule une partie du public de la boîte de Ramstein avait répondu à la stimulation.
J’étais convaincu de ce que j’avançais, mais deux questions restaient en suspens : qui se cachait derrière cette manipulation et dans quel but ?
La vérité m’est apparue une nuit de février 1968.
Je venais de terminer mon tour d’inspection. J’étais allé me chercher un verre de bière et avais allumé la télévision. Il était près de minuit, les émissions touchaient à leur fin. Je visionnais un reportage réalisé par une équipe de journalistes de la télévision suisse.
Ils ne cherchaient pas à prendre parti dans le conflit, mais se bornaient à dépeindre la vie quotidienne des GI’s. Leur caméra s’était promenée dans plusieurs unités. La plupart du temps, les autorités militaires les avaient empêchés de tourner et les avaient refoulés.
Ils avaient malgré tout réussi à s’infiltrer dans un camp américain situé à quelques kilomètres de Hué. L’offensive du Têt venait d’être engagée et les autorités américaines étaient submergées.
Les journalistes en avaient profité pour filmer les installations et les préparatifs d’un départ en mission. On voyait les militaires s’agiter, courir en tous sens, préparer leurs armes et le matériel sans se soucier de la caméra.
Quelques notes de musique se sont élevées.
L’un des journalistes a interrogé un GI, un jeune gars boutonneux. Hilare, il a déclaré que c’était leur hymne. Chaque fois qu’ils partaient en mission, on leur passait ce morceau. Les officiers avaient monté des haut-parleurs sur les half-tracks et les hélicos.
Mon sang s’est figé.
Au milieu du va-et-vient, j’ai entendu s’élever le riff sauvage, féroce et jubilatoire de Steve. La basse de Larry est entrée dans la danse. Une onde glaciale a envahi mon corps et s’est immiscée jusqu’à la moindre de mes extrémités. Dans un état second, j’ai entendu mon fill d’intro et l’entrée de Jim.
Pendant que le gars racontait cela, Larry Finch hurlait à s’en déchirer la voix. La basse et mes coups de grosse caisse donnaient la mesure.
Sur l’écran, le visage du GI se métamorphosait. Ses yeux s’écarquillaient, ses traits se durcissaient. Il a ajouté que ce rock leur donnait du courage et filait la pétoche aux faces de citron.
Ensuite, il a tourné les talons en bredouillant qu’il devait y aller, que son devoir l’attendait.
74
Sur la sienne
Dominique s’arrêta pour effectuer quelques achats en rentrant du cimetière. Il sortait d’une grande surface lorsque Gérard Jacobs le rappela.
Il ne put s’empêcher de plaisanter en reconnaissant la voix du policier.
— Vous êtes rapides, vous les Belges, vous démentez la réputation de lenteur de la police.
Le policier embraya sur le même ton.
— Tout dépend de la manière dont on voit les choses, il y a un an que nous cherchons à identifier cet homme, sans vous, nous serions toujours au même point.
— Vous avez du nouveau ?
— Oui, je pense que ça coïncide. Odile Chantraine est née à Bruxelles en 1920. En 1942, elle a épousé Roger Bernier, citoyen belge, né en 1917, dans la région de Namur. Ils ont eu deux enfants, deux garçons, Pierre, né en septembre 1943 et Jacques, né en août 1945.
— D’après la femme que j’ai rencontrée au cimetière, l’un des fils est mort.
— En effet, l’aîné, Pierre, est mort en 2006. Roger Bernier est mort en 1988, sa femme en 1991. Pierre Bernier s’est marié et a eu une fille. L’épouse de Pierre Bernier est également décédée, mais sa fille est toujours vivante. Elle a aujourd’hui quarante ans, elle est mariée et vit en Afrique du Sud.
— Mon patient serait Jacques ?
— C’est fort probable.
Dominique émit un long soupir.
— Jacques. J’approchais, j’étais à Isidore.
— Pardon ?
— Excusez-moi, je pensais à autre chose. X Midi serait donc ce Jacques Bernier ?
— Attendez, ce n’est pas fini. Jacques Bernier a disparu en 1964.
— Disparu ?
— Le 2 janvier 1964, pour être précis. Il devait se présenter à Malines pour faire son service militaire. Il ne s’est jamais présenté et on a perdu toute trace de lui depuis.
Dominique fit un rapide calcul.
— Il a disparu depuis quarante-sept ans ?
— Je comprends votre étonnement, mais nous enregistrons chaque année la disparition d’environ mille personnes, c’est-à-dire trois par jour.
— On ne les retrouve jamais ?
— La plupart du temps, si. La majeure partie est constituée de fugues de mineurs, ce qui devait être le cas de Jacques Bernier. Ce sont aussi des personnes confuses ou des déments qui se sont égarés. Mais on dénombre aussi des suicides, des accidents ou des drames familiaux. Plus de seize mille dossiers ont été ouverts par la cellule des personnes disparues et près de huit cents n’ont pas encore été clôturés.
Dominique n’en croyait pas ses oreilles. Il était debout devant sa voiture, ses sacs à provisions étalés à ses pieds.
— Qu’est-ce qu’il a fait pendant ces quarante-sept années ?
— Je ne pourrais pas vous répondre, mais selon le dossier, il n’a jamais repris contact avec ses parents. Il semble pourtant que le climat familial était serein.
— Que savez-vous sur lui, à part sa disparition ?
— Il y a peu de choses dans le dossier. Un gentil garçon, plutôt réservé. Il a eu un accident quand il avait quinze ans. Il a été fortement commotionné. Il en a peut-être gardé des séquelles, bien qu’il ait été reconnu apte à faire son service militaire. C’est en tout cas une des thèses qui figurent dans le dossier.
Dominique était songeur.
— Il est revenu après quarante-sept ans ? Pourquoi ? Pour dire pardon à sa mère et déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe ?
— Il se sentait peut-être partir, ce genre de réaction se rencontre souvent chez les criminels, un ultime besoin de soulager sa conscience.
— Non, ce n’est pas ça. Je ne le sens pas comme ça.
— Dans ce cas, continuez à communiquer avec lui pour en savoir plus. De mon côté, je vais voir s’il lui reste de la famille et contacter la fille de son frère. Je vous rappelle si j’ai du nouveau.
Dominique ne tint pas compte de son jour de congé et se rendit à la clinique le lendemain matin.
Il entra dans la chambre de X Midi sans préalable, le prit à bras le corps et le mit en position assise dans le lit. Il déposa ensuite son ordinateur portable sur la table de soins et le plaça face à l’homme. Il lança le programme images et ouvrit la photo qu’il avait prise la veille.
Il s’assit ensuite sur le lit et lui prit la main.
Les yeux de l’homme se troublèrent.
Dominique sentit pour la première fois la main de X Midi se refermer sur la sienne.
75
Le mal que je t’ai fait
Ton sourire est celui que j’ai toujours connu. Les années n’ont pas eu de prise sur toi. À présent, je peux m’en aller. J’espère que tu me pardonneras le mal que je t’ai fait.
76
Pour étayer sa thèse
Après sa visite à Reynolds, Michael Stern comprit que la mort des membres de Pearl Harbor était due à l’apparition malencontreuse de Jacques Berger dans le studio.
Ce dernier n’avait pas été la proie d’hallucinations, les hommes dont il avait parlé à Mary Hunter n’étaient pas imaginaires. Ils étaient présents dans le studio et trafiquaient les bandes magnétiques.
Stern était également convaincu que les événements de Ramstein et la mort du disc-jockey de la boîte étaient liés à cette affaire.
Mais son intime conviction ne suffisait pas. Dans son métier, il était hors de question de porter un sujet au grand jour sans avancer un minimum de faits avérés et il n’avait aucune preuve tangible à fournir à son rédacteur en chef pour le faire changer d’avis.
À l’heure qu’il était, Jacques Berger avait peut-être été assassiné, lui aussi. Les hommes qui se trouvaient dans le studio ignoraient qu’il n’était pas le batteur titulaire du groupe, ce qui expliquait l’élimination de Paul McDonald, mais ils s’en étaient certainement rendu compte par la suite et lui avaient donné la chasse.
Quant au mobile de ces actes, il était cousu de fil blanc. Féru d’histoire, Stern savait que de tout temps, les grandes puissances avaient expérimenté nombre de méthodes visant à galvaniser leurs troupes ou à affaiblir les défenses de l’ennemi. Les livres d’histoire regorgeaient de témoignages allant en ce sens.
Dans l’Art de la Guerre, le livre écrit quelques siècles avant Jésus-Christ par l’énigmatique Sun Tzu, l’auteur déclarait que l’art de la guerre reposait sur la duperie.
Il préconisait l’utilisation de méthodes de propagande et de désinformation pour convaincre l’ennemi que la défaite était inévitable. Il suggérait d’autres tactiques pour leur saper le moral ou à accroître leur niveau de stress.
Au onzième siècle, les ismaéliens professaient une science secrète censée procurer des pouvoirs magiques, science à laquelle les initiés accédaient par degrés. L’apprentissage du premier degré consistait à se familiariser avec l’usage du haschich dans le but d’accroître le courage physique et de connaître l’illumination.
Gengis Khan, le chef mongol, était connu pour avoir mené des hordes de cavaliers sanguinaires à travers la Russie et l’Europe. Sa réputation de domination totale avait été renforcée par le conditionnement psychologique qu’il exerçait sur ses troupes.
Même si rien ne valait la haine de l’ennemi, certains stratagèmes se révélaient utiles pour doper le moral des troupes, telle la liberté de piller, de tuer et de violer, butin de guerre affectionné par ses hommes.
Plus récemment, durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient injecté de la testostérone à leurs soldats pour augmenter leur agressivité et les médecins de la Wehrmacht avaient distribué des dizaines de millions de doses de méthamphétamines aux troupes pour les tenir éveillées et les rendre plus combatives.
Après la guerre, l’armée américaine avait fait appel à des psychiatres comportementalistes suite à une étude qui démontrait que la majorité des combattants avait désormais des scrupules à tuer, même sur un champ de bataille.
Dans le but de diminuer le sentiment de culpabilité et d’accroître l’agressivité des soldats, ils avaient mis en place une batterie de drills qui avaient pour objectif de conditionner l’individu à faire corps avec le groupe et à considérer les autres comme non humains, les transformant de la sorte en machine à tuer.
Le bruit courait que l’armée américaine avait expérimenté le LSD au début de la guerre du Vietnam.
Après l’absorption de cette drogue, les hommes de troupe présentaient les symptômes du psychotique schizophrène et pouvaient être poussés à commettre des actes violents envers autrui.
Une autre rumeur disait que cette expérience avait été un fiasco et que les autorités militaires testaient à présent des méthodes plus sophistiquées, comme les armes psychotroniques, des engins qui faisaient appel aux ondes électromagnétiques et privaient l’être humain de sa conscience de veille tout en décuplant son agressivité.
Pour Michael Stern, le drame qui s’était déroulé à Ramstein résultait de l’expérimentation d’une nouvelle technologie destinée à programmer les êtres humains, un système perfectionné qui stimulait l’agressivité d’une partie de l’assistance tout en affaiblissant les défenses de l’autre.
Il lui restait à réunir des faits pour étayer sa thèse.
77
Le numéro que je connaissais par cœur
Je serais rentré chez moi si l’on ne m’avait ôté ma liberté, ma crise d’identité touchait à sa fin, je n’étais plus révolté, je me réconciliais peu à peu avec l’humanité.
Chaque jour, je pensais à ma mère, à la douleur qu’elle devait ressentir, cette même douleur qui m’arrachait les tripes. Je pensais aussi à mon père et à mon frère. La distance et le temps avaient fini par effacer les griefs que j’avais accumulés contre eux.
Je serais rentré chez moi, j’aurais pris ma mère dans mes bras, je l’aurais serrée dans mes bras sans dire un mot. Elle ne m’aurait rien demandé.
J’aurais surmonté les obstacles. Je me serais justifié, j’en étais capable désormais. J’aurais expié mes fautes. J’aurais fait confiance à la Justice. J’aurais assumé mes responsabilités et accepté la peine que je méritais.
Le reportage de la télévision suisse m’avait ébranlé. Je savais à présent ce qui se tramait, je connaissais le but de leur manipulation. J’avais envie de le hurler, d’en parler à chaque client que je rencontrais, mais je n’avais personne à qui le dire.
J’aurais pu me confier à Andy, notre amitié était franche et sincère, mais il ne connaissait pas mon parcours. J’avais fait table rase de mon passé et lui avais raconté une légende dans laquelle je m’embrouillais dès qu’il me posait une question.
De temps à autre, je ne réagissais pas lorsqu’il me hélait. Il était l’un des seuls à m’appeler René ; à l’hôtel, on m’appelait monsieur Schnegg. Lors de la confection de mes premiers faux papiers, j’avais choisi un patronyme proche du mien pour éviter ce genre de désagrément.
Durant les jours qui ont suivi, j’ai continué la rédaction de mon récit.
Il contenait suffisamment d’éléments pour consolider ma thèse. Plus j’avançais dans mon texte, plus ma conviction s’affermissait et plus l’envie de la communiquer me tourmentait.
Une nuit, alors que j’avais bu plus que d’habitude, le besoin de partager ce secret s’est fait impérieux. Il devait être trois ou quatre heures du matin quand l’inspiration m’est venue. Je savais à qui je pouvais en parler. Je savais qui accepterait de m’écouter.
J’ai pris le téléphone et j’ai formé le numéro que je connaissais par cœur.
78
Des sessions d’enregistrement
Dans les premiers jours de février, alors qu’il s’évertuait à faire corroborer les faits, Michael Stern reçut un appel téléphonique de Birgit, l’ex-compagne de Jim Ruskin.
Elle semblait en forme. La mort de Jim l’avait touchée, mais près d’un an s’était écoulé depuis sa disparition et la vie avait repris ses droits. En octobre, elle avait rencontré un homme avec lequel elle envisageait de nouer une relation à long terme.
Elle lui demanda ensuite s’il poursuivait l’enquête sur la disparition des membres de Pearl Harbor, ce que Stern confirma.
L’objet de son appel était de l’informer d’un fait divers qui s’était produit à Berlin et qui avait un lien manifeste avec les événements de mars 1967. Les faits dataient de quelques jours, mais venaient de paraître dans les quotidiens.
Elle s’empara d’un journal et le parcourut au téléphone. La police fluviale berlinoise déclarait avoir repêché selon toute vraisemblance le cadavre d’un agent artistique allemand, Karl Jürgen, originaire de Munich, porté disparu depuis le 18 mars 1967. Le corps de l’homme âgé de cinquante-deux ans avait été découvert dans le bassin d’une écluse près du pont Mühlendamm, au centre de Berlin.
Le communiqué de la police soulignait qu’aucun élément ne permettait d’indiquer de prime abord que Karl Jürgen avait été victime d’un crime, il s’était apparemment suicidé. Les enquêteurs espéraient que l’autopsie permettrait de faire la lumière sur cette affaire. Au vu des premiers résultats de l’enquête, les raisons de sa disparition devaient être d’ordre personnel. La police excluait toute possible motivation politique.
L’homme avait quitté son appartement du quartier de Charlottenburg, dans l’ouest de Berlin, le 18 mars 1967, en début de matinée et n’avait pas été revu depuis. Sa femme, qui avait déclaré sa disparition le jour même, avait confié aux enquêteurs que son mari souffrait de dépression.
Au moment de la disparition, un avis d’appel à témoin avait été diffusé dans les environs du domicile du couple qui vivait à Berlin depuis novembre 1966 et avait une vie sociale limitée. Deux plongeurs avaient sondé un lac situé près de chez eux, sans succès.
Karl Jürgen était l’agent artistique de plusieurs groupes de rock, pour la plupart en recherche de notoriété.
Il était chargé de négocier des contrats ou de décrocher des sessions d’enregistrement.
79
En Écosse
C’était un dimanche. Par chance, Gunther était encore derrière son bar. Les Berlinois détestaient le lundi et les portes du Graffiti restaient souvent ouvertes jusqu’au petit matin.
La musique ne hurlait pas à l’arrière-plan et Gunther semblait détendu.
Il s’est dit surpris et ravi de m’entendre, ce qui n’était qu’une simple formule de politesse, l’enthousiasme ne faisait pas partie des traits marquants de son caractère.
Les derniers clients venaient de quitter les lieux et il se préparait à fermer. Ce week-end-là, Berlin-Ouest avait accueilli un congrès international contre la guerre du Vietnam. Quinze mille personnes avaient défilé dans les rues. Rudi Dutschke, un activiste marxiste, avait prononcé un discours mobilisateur qui avait semé un chaos indescriptible dans la ville.
Après cela, la soirée avait été calme et la boîte n’avait connu qu’une faible affluence.
Il a embrayé en me parlant de la situation à Berlin. La révolte grondait. La jeunesse avait été infiltrée par des agents communistes et était à présent manipulée. Bientôt, la révolution annoncée prendrait son élan et les chars russes envahiraient la ville, puis le reste de l’Europe.
J’ai attendu qu’il termine son discours, même si j’en connaissais le chapitrage complet.
Dans la foulée, il est passé au rock. Il considérait que Pink Floyd était le groupe phare du rock psychédélique. Leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn, était une brillante réussite, même s’il n’imaginait pas passer des titres comme Astronomy Domine ou Interstellar Overdrive au Graffiti.
Il a ensuite demandé de mes nouvelles. Je lui ai dit que j’avais décroché un job dans un hôtel en Suisse, mais je suis resté vague sur la localisation. Je me suis limité à dire qu’il se trouvait dans la partie romande du pays.
Je suis ensuite entré dans le vif du sujet. Je lui ai rappelé nos dernières conversations. Je lui ai dit que je savais à présent ce qui s’était réellement passé après l’enregistrement du 14 mars. J’avais acquis la preuve que la disparition des quatre membres de Pearl Harbor n’était pas une suite de morts accidentelles, mais qu’ils avaient été assassinés. De plus, je connaissais le mobile de ces meurtres.
Je lui ai raconté ce que je savais. J’avais mes notes en mains. De temps à autre, je les consultais pour lui révéler l’un ou l’autre détail.
Comme je m’y attendais, il n’a pas paru impressionné par mes révélations. Mes explications concernant les ghost words et les infrasons n’ont pas eu l’air de le passionner, pas plus que ma théorie relative au conditionnement des troupes US au Vietnam.
Lorsque je lui ai livré mon point final, il a affirmé que ma démonstration était convaincante et que cela rejoignait sa conviction, la Troisième Guerre mondiale était en marche. Il est revenu sur ses thèses et a continué à divaguer durant plusieurs minutes.
Peu m’importait, j’avais pu exorciser mon obsession. Il m’avait écouté sans m’interrompre et sans déclarer que j’étais fou.
J’étais prêt à conclure notre discussion lorsqu’il m’a brusquement coupé la parole, comme s’il venait de se souvenir d’une chose sans importance.
En novembre, il avait reçu la visite d’un Écossais qui se prétendait journaliste. L’homme lui avait déclaré qu’il réalisait une enquête sur la mort des quatre membres de Pearl Harbor. Il lui avait retracé les grandes lignes et avait terminé en disant qu’il désirait prendre contact avec moi. Gunther l’avait envoyé au diable.
À toutes fins utiles, l’homme lui avait laissé sa carte de visite.
Gunther m’a demandé de patienter un moment. Je l’ai entendu déposer le combiné sur le comptoir et fourrager dans le fatras qui traînait sous le comptoir.
Il a repris le téléphone en soufflant. L’homme s’appelait Michael Stern et travaillait pour le Belfast Telegraph.
J’ai pris note de ses coordonnées. Je ne savais que penser. Était-ce l’un des hommes du studio ? S’étaient-ils rendu compte de leur erreur ? Avaient-ils retrouvé ma trace ? Se servaient-ils de ce subterfuge pour m’approcher ?
J’ai dessoûlé dans l’instant. Il me fallait digérer l’information et réfléchir à ce que j’allais en faire.
J’ai remercié Gunther. Je me suis abstenu de lui dire que Belfast ne se trouvait pas en Écosse.
80
Cette nouvelle énigme
Gérard Jacobs reprit contact avec Dominique au milieu de la semaine suivante pour lui faire part des informations qu’il avait recueillies.
Il lui confia que sa hiérarchie ne considérait pas cette enquête comme prioritaire. En revanche, elle lui tenait à cœur. Il avait investi quelques heures de son temps privé pour aller de l’avant.
Le samedi soir, il avait eu un entretien téléphonique avec la nièce de Jacques Bernier qui vivait à Johannesburg, en Afrique du Sud. La femme savait peu de choses sur cet oncle qu’elle n’avait jamais connu. Après sa disparition en 1964, ses grands-parents avaient lancé plusieurs recherches dans le but de retrouver sa trace, mais aucune n’avait abouti.
Son grand-père et son père parlaient rarement de lui. Durant son enfance, lorsqu’elle passait chez sa grand-mère et qu’elles étaient seules, cette dernière lui racontait l’une ou l’autre anecdote, un épisode où il jouait de la batterie sur des boîtes de biscuits ou un après-midi durant lequel elle avait appris à danser le rock avec lui. Elle refusait de croire qu’il était mort. Jusqu’au bout, elle se persuadait qu’il reviendrait un jour.
Elle avait entendu dire qu’il n’était pas équilibré. Quand son père évoquait son frère et leur enfance, il parlait de lui en des termes peu élogieux. Il l’appelait le fêlé, le bègue ou le batteur fou. Elle ne savait pas ce que ces mots évoquaient et s’en était toujours désintéressée.
Le policier avait également réussi à joindre l’un des professeurs de Jacques Bernier.
L’homme, qui avait quatre-vingts ans, avait connu Jacques Bernier en 1961. Malgré cela, il se souvenait bien de lui. C’était un garçon timide, réservé, il avait un problème d’élocution et vivait dans son monde intérieur. Il lisait beaucoup, mais ne parlait pas de ses lectures.
La secrétaire du cimetière d’Ixelles lui avait confirmé qu’un homme l’avait appelée à plusieurs reprises en février 2010 pour se renseigner sur l’emplacement de la tombe de madame Bernier. La femme s’en souvenait parce que l’homme était confus, il avait téléphoné plusieurs fois d’affilée pour poser la même question.
Enfin, il avait reçu une copie du compte-rendu médical qui avait été rédigé en septembre 1963, lorsque Jacques Bernier avait passé ses trois jours au Petit-Château avant son service militaire.
Le rapport mentionnait que lors des tests psychotechniques et des différents examens médicaux, Jacques Bernier avait présenté des troubles comportementaux mineurs. L’homme était en bonne condition physique et l’électro-encéphalogramme qui avait été pratiqué n’avait rien révélé d’anormal. Les médecins l’avaient suspecté de simuler des symptômes d’aprosexie pour être réformé et n’en avaient pas tenu compte. Il avait été déclaré apte au service.
Pour conclure, Gérard Jacobs l’informa qu’il avait transmis l’identité de l’homme à la presse et que certains quotidiens allaient faire paraître l’annonce dans leurs pages.
Cette publication était susceptible de susciter de nouveaux témoignages.
Cette nouvelle mit Dominique face à un dilemme. Il avait donné sa parole à Jacques Bernier. Il lui avait promis de ne pas dévoiler les informations qu’ils échangeaient. Il estimait néanmoins qu’il devait rester intègre vis-à-vis du corps médical.
Il se rendit chez Marie-Anne Perard, le chef de la clinique, et lui fit part des démarches qu’il avait entreprises avec X Midi ainsi que des résultats qu’il avait obtenus.
Marie-Anne Perard le remercia de sa franchise et lui précisa qu’elle ne lui tenait pas rigueur de son silence. Elle comprenait qu’il ait respecté son serment et l’assura de sa confiance. Elle lui fit une nouvelle fois part de la grande satisfaction que les patients témoignaient pour son enthousiasme et la qualité de ses soins.
Dominique décida de parler à X Midi sans attendre. Depuis qu’il lui avait montré la photo prise au cimetière, ce dernier ne lui avait plus adressé la parole.
Il s’assit sur le lit.
— Mon ami, je dois te dire quelque chose.
L’homme fronça les sourcils et fixa le kiné dans les yeux.
Dominique inspira longuement.
— Je n’ai pas pu garder notre secret.
Les yeux de l’homme s’agrandirent.
— Je sais que je te l’ai promis et je peux comprendre que tu sois déçu, mais je n’ai pas pu faire autrement. Je connais maintenant quelques pages de ton histoire, mais je ne sais pas tout. Je sais que tu t’appelles Jacques Bernier et que tu as disparu il y a bien longtemps. Il y a sûrement quelque part des gens qui te cherchent. Des gens qui t’aiment. Une femme, des enfants ou des amis qui aimeraient te revoir. Pour eux, et pour toi, je ne peux plus garder ce secret.
La panique se lisait dans les yeux de X Midi. Il lança son regard vers l’armoire.
Dominique comprit aussitôt.
— Tu veux me parler ?
L’homme acquiesça.
Dominique prit l’abécédaire et commença l’énumération. Bernier canalisait son attention sur l’exercice comme s’il craignait de commettre une erreur.
Il fallut plus d’un quart d’heure pour qu’il compose le premier mot.
MICHAEL.
Le second mot vint à peine plus rapidement.
STERN.
Le regard de Bernier se porta vers la télévision. Il paraissait soulagé de s’être libéré de ces mots.
Dominique l’interpella.
— Michael Stern ? Tu sais où je peux le trouver ?
L’homme resta impassible.
— C’est l’un de tes amis ?
Il ne réagit pas.
— Il habite en Belgique ?
Jacques Bernier gardait ses yeux rivés sur l’écran.
Dominique lui posa encore plusieurs questions qui restèrent sans réponse.
Une idée lui vint.
À son tour, il fixa l’écran.
— Il est passé à la télévision, c’est ça ?
L’homme tourna légèrement la tête et cligna des yeux à deux reprises.
— Il n’est pas passé à la télévision ? Mais ça a un rapport ?
Bernier acquiesça.
— C’est une vedette ? Il est journaliste ou quelque chose comme ça ?
L’homme approuva et referma les yeux.
Dominique comprit qu’il ne lui en dirait pas plus. Il lui restait à se plonger dans cette nouvelle énigme.
81
Ajouter quoi que ce soit
Trois semaines s’étaient écoulées depuis l’appel de Birgit et l’enquête de Michael Stern n’avait pas progressé. Il commençait à se décourager et ne voyait plus vers quelle piste s’orienter, toutes aboutissaient à une impasse.
Les familles des victimes avaient pris contact avec lui pour connaître l’état d’avancement de ses recherches. Il s’était borné à leur répondre qu’il avançait à petits pas, mais qu’il ne fallait pas porter trop d’espoir dans ses investigations.
Le 29 février 1968, une dépêche annonça qu’un avion Iliouchine de la compagnie United Arab Airlines s’était écrasé à Assouan, en Égypte. Michael Stern fut mandaté par le Belfast Telegraph pour couvrir l’événement.
Il se préparait à partir lorsque la standardiste l’interpella pour lui annoncer un appel entrant. Elle ajouta que la personne n’avait décliné ni son identité ni la raison de son appel. Il hésita un moment, puis décida d’accepter l’appel. Il remonta dans son bureau et prit le combiné.
Durant quelques secondes, il crut que l’interlocuteur avait raccroché. Il était sur le point de couper la communication lorsqu’il perçut une sorte de chuintement suivi d’une voix masculine qui prononça quelques mots dont il ne saisit pas le sens.
Il demanda à l’homme de répéter et le correspondant parut chercher ses mots.
Après quelques secondes, il déclara qu’il s’appelait Jacques Berger. Il avait appris que le journaliste cherchait à le joindre et voulait en connaître les raisons.
Michael Stern sentit un flux d’adrénaline l’envahir. L’homme parlait de manière confuse. Certains mots étaient à peine compréhensibles. L’anglais n’était pas sa langue maternelle, il parlait avec un accent étranger, mais ce n’étaient pas les intonations nasillardes des Canadiens.
Stern comprit que l’homme était sous stress et qu’il n’avait que quelques secondes pour l’encourager à lui faire confiance. Il lui dit qu’il savait qui il était, qu’il savait ce qui s’était passé et qu’il souhaitait l’aider.
L’homme sembla réfléchir quelques instants, puis il lui demanda de préciser ce qu’il savait.
Stern contrôla sa nervosité et se força à parler posément.
Il savait qu’il avait effectué un back up à Berlin le 14 mars de l’année passée. Il avait remplacé le batteur d’un groupe appelé Pearl Harbor et avait participé à un enregistrement à l’issue duquel il avait surpris plusieurs hommes qui se livraient à une falsification des bandes magnétiques. Par la suite, les quatre musiciens du groupe et leur agent avaient été assassinés.
L’homme parut hésiter.
Il demanda à Stern de répéter la dernière phrase. Pendant qu’il s’exécutait, Stern en déduisit que Berger n’était pas au courant de la mort de l’agent artistique. Il lui expliqua que le corps de Karl Jürgen avait été retrouvé au début du mois de février par la police fluviale de Berlin.
L’homme marqua le coup et resta silencieux quelques instants.
Lorsqu’il reprit la parole, il interrogea le journaliste sur sa version des faits, il voulait connaître les conclusions auxquelles il était arrivé.
Stern lui parla des mots fantômes et du lien qu’il avait établi avec les événements de Ramstein.
L’homme se mit à bafouiller au téléphone.
Son discours devint bruineux. Il parla d’hélicoptère, de soldats, de la guerre du Vietnam puis déclara que sa vie était en danger, que les hommes qui étaient derrière ce complot étaient capables de tout et n’hésiteraient pas à l’éliminer.
Stern abonda dans son sens et répéta qu’il voulait l’aider.
L’homme haussa le ton. De quelle manière le journaliste pouvait-il l’aider ?
Stern s’appliqua à garder un ton apaisant.
La meilleure manière de neutraliser ces hommes était de révéler leurs agissements au grand jour. C’était la seule option raisonnable.
L’homme répondit qu’il allait réfléchir. Il raccrocha avant que Stern ait pu ajouter quoi que ce soit.
82
Ma vie normale
J’ai tourné et retourné l’information pendant les jours qui ont suivi.
Comment ce journaliste était-il parvenu à remonter jusqu’à moi ? Était-ce un piège ? Devais-je l’appeler ou m’abstenir ?
J’ai commandé le Belfast Telegraph. Le nom de Michael Stern figurait dans la liste des contributeurs, ce qui ne signifiait pas pour autant que ce soit lui que Gunther avait rencontré.
Un soir, j’ai formé le numéro du journal. Il était tard, il ne restait qu’une permanence. Michael Stern n’était pas là. Le journaliste de garde m’a demandé s’il devait laisser un message. J’aurais bien aimé lui demander si Stern s’était rendu à Berlin en novembre de l’année passée, mais je n’ai pas trouvé les mots.
J’ai continué à commander le journal. Dans l’édition du 26 février, Michael Stern signait un article relatant une réunion qui s’était tenue à Dubaï.
Le surlendemain, lors de notre rencontre hebdomadaire, Andy m’a annoncé qu’il quittait Montreux. Il avait décroché un job dans un hôtel à Vienne et partait début mars. Il voulait poursuivre son tour du monde et découvrir les peintres viennois du début du siècle pour étudier leurs techniques.
Je me suis décidé le lendemain. Je suis allé dans une cabine téléphonique et j’ai appelé Michael Stern.
L’homme n’a pas semblé surpris de m’entendre. Il est resté calme et sa voix m’a apaisé. Je lui ai posé quelques questions pour m’assurer que j’avais affaire à la bonne personne.
Il connaissait bien l’affaire, même si j’étais allé plus loin que lui dans la compréhension des procédés que les hommes du studio avaient mis au point.
En revanche, il me fit part d’une nouvelle que j’ignorais et qui confirmait la thèse que nous partagions. Karl, l’homme qui avait organisé l’enregistrement et m’avait accueilli à l’entrée du studio, avait été retrouvé mort, noyé, à Berlin. Il avait disparu depuis près d’un an, à la même période que les membres de Pearl Harbor.
Stern m’a proposé de révéler l’affaire au grand jour et promettait de m’aider. Pour lui, c’était la meilleure façon de neutraliser ces hommes et de me protéger.
À la fin de notre conversation, les choses sont devenues confuses dans ma tête. Je lui ai répondu que j’allais réfléchir.
Après avoir raccroché, j’ai appelé Andy pour lui annoncer que je partais avec lui à Vienne. J’avais peur qu’il refuse, mais il a accepté.
Je n’ai pas communiqué ma décision au directeur de l’hôtel. Je me sentais en danger. Ces hommes ne pouvaient ignorer qu’ils avaient commis une erreur sur la personne, ils devaient à présent me rechercher. Si un journaliste était parvenu à me retrouver, ils y parviendraient aussi.
Durant les jours qui ont suivi, j’ai préparé mon départ. Andy avait un appartement meublé qui l’attendait à Vienne. Il l’avait obtenu grâce à l’une de ses tantes. Andy faisait partie d’une grande communauté dont les membres avaient appris à s’entraider. Il voulait bien m’héberger en attendant que je trouve un job et un logement.
Le lundi 11 mars, j’ai rappelé Michael Stern dans la matinée. J’avais préparé ce que je voulais dire. Cette fois, c’est moi qui ai parlé.
Je lui ai dit que j’avais rédigé un document qui retraçait les faits et démontrait qu’il s’agissait d’un complot. De plus, mon texte faisait la lumière sur le procédé que les hommes avaient mis en place pour manipuler les masses. L’ensemble représentait une centaine de pages et fourmillait de détails.
Il a paru impressionné. Nous avons convenu de nous retrouver à Londres le lundi suivant, le 18 mars.
Il serait à l’aéroport et assurerait ma sécurité. Dans l’après-midi, il me donnerait l’occasion de rencontrer certains de ses confrères de la presse londonienne. En début de soirée, il organiserait une entrevue avec quelques personnalités politiques influentes pour que nous puissions révéler le scandale et déjouer le complot.
Il m’a conseillé d’être prudent et de prendre garde à mes notes.
Ce furent ses derniers mots.
L’après-midi, Andy et moi avons pris le train. Le soir, nous étions à Vienne où nous nous sommes installés. Il bénéficiait d’un appartement coquet dans le quartier du Prater. Je voyais la grande roue de sa fenêtre.
Dès le lendemain, il m’a emmené visiter les différents musées viennois. Il passait d’une œuvre à l’autre, s’extasiait, se déhanchait, s’agenouillait, se relevait, collait son nez sur la toile, me racontait une anecdote sur l’artiste ou me commentait la technique utilisée.
Lors de notre visite au Belvédère, son effervescence a atteint les sommets. L’œuvre majeure du musée était le Baiser de Gustav Klimt. La toile était mise en valeur dans une vitrine dont l’éclairage faisait ressortir les couleurs et les ors du tableau. Selon Andy, il existait une épreuve plus audacieuse que le maître avait réalisée quelques années avant celle-là et qui avait mystérieusement disparu.
Je faisais mine de l’écouter, mais je ne pensais qu’à l’échéance du 18 mars. Ma décision était prise. Une fois libéré de mon secret, je rentrerais chez moi et je me livrerais à la justice.
J’étais persuadé que le battage qui allait entourer mes révélations agirait comme autant de circonstances atténuantes et provoquerait la clémence du jury.
Une fois mes fautes expiées, je pourrais reprendre ma vie normale.
83
Inhabituel de sa part
Le jeudi 14 mars 1968, un an jour pour jour après les faits qui s’étaient déroulés à Berlin, Michael Stern débarqua en début de matinée dans le bureau de son rédacteur en chef.
D’entrée de jeu, il lui confessa avoir transgressé ses consignes et lui avoua avoir poursuivi l’enquête qu’il avait entamée six mois auparavant sur la mort des quatre musiciens de Pearl Harbor. Il lui retraça les étapes successives qu’il avait franchies et lui fit part des éléments qui prouvaient de manière irréfutable que les disparitions survenues en mars 1967 étaient liées et faisaient partie d’un complot de la CIA dont la finalité était de programmer les êtres humains à des fins militaires.
Pour conclure, il lui fit part des contacts récents qu’il avait eus avec le batteur présent au moment des faits. Il termina son discours en annonçant la venue de ce témoin clé à Londres, le lundi suivant et lui dévoila l’existence d’un document réalisé par ce dernier. Le document retraçait les faits et expliquait la méthode de programmation des masses manigancée par l’agence américaine.
Le rédacteur en chef attendit la fin de l’exposé, puis se leva et s’empara de deux exemplaires de fraîche date du Belfast Telegraph.
Il entama la lecture de l’article que Michael Stern avait rédigé sur le crash aérien de l’Iliouchine à Assouan. Stern avait conclu son billet en suggérant que dans le climat de guerre froide qui opposait les États-Unis à la Russie, cet accident n’en était sans doute pas un.
Le second article, également signé Michael Stern, datait de l’avant-veille. Le journaliste avait été délégué pour suivre la disparition du sous-marin soviétique K 129. Le bâtiment transportait trois missiles balistiques à têtes nucléaires. Il avait quitté sa base de Ribachyi dans la péninsule du Kamchatka fin février et avait disparu corps et âme le 8 mars, au large des côtes d’Hawaï.
Stern avait adopté la piste du harponnage du sous-marin par la marine américaine, thèse controversée, mais défendue par certains médias.
La lecture de ces articles terminée, le rédacteur haussa le ton.
Un journaliste se devait de rapporter des faits, rien que des faits, sans les exagérer, sans les minimiser, sans les déformer et sans les extrapoler pour échafauder des théories conspirationnistes. Il précisa que le Belfast Telegraph se voulait indépendant et n’était pas une annexe du Parti communiste.
Après ces deux récents manquements aux règles élémentaires du journalisme, Stern revenait à présent sur une ancienne affaire au contenu douteux pour chercher une nouvelle fois à dénoncer un complot de la CIA.
Stern voulut protester, mais il lui coupa la parole et l’avertit qu’il était hors de question que le journal se ridiculise en publiant un scoop aussi hypothétique qu’engagé.
Il enjoignit à Stern de prendre quelques jours de congé et de réfléchir à l’orientation qu’il souhaitait donner à sa carrière, le Belfast Telegraph refusant de se compromettre davantage dans ses thèses paranoïaques.
Sur ce, il mit fin à l’entretien. Stern quitta le bureau en claquant la porte.
En début de soirée, la femme de Michael Stern passa un appel téléphonique au bureau du journal.
Elle se disait inquiète. Son mari n’était pas encore rentré, elle avait des invités à la maison et il lui avait promis de rentrer de bonne heure. Elle n’avait pas reçu d’appel la prévenant d’un éventuel retard, ce qui était inhabituel de sa part.
84
J’ai perdu connaissance
La veille de mon départ pour Londres restera une journée très particulière dans ma vie, mais je ne le saurai que le lendemain.
Andy avait commencé son travail à l’hôtel. Je m’étais levé tard et je parcourais les rues sans but précis, mes pensées absorbées par l’échéance qui approchait.
C’était un dimanche. Un soleil vif flattait les façades majestueuses du centre de Vienne. Il aurait réchauffé les promeneurs si un vent glacial n’avait contrarié ses effets.
La ville respirait son rayonnement d’antan. Les tramways filaient dans les larges avenues. Les calèches baladaient les premiers touristes et les cochers paradaient dans leur redingote et leur haut-de-forme.
Devant l’Opéra, des couples tirés à quatre épingles faisaient la queue, une chaise pliante à la main, dans l’espoir d’obtenir une place debout à moindre prix.
J’ai longé le Graben, je me suis laissé embobiner par les prestidigitateurs et les acrobates qui faisaient leur numéro. Je me suis arrêté pour manger une saucisse et boire une bière à l’un des pavillons.
Je respirais, j’étais libre. Tout semblait simple. J’étais loin d’imaginer ce qui venait de se produire à quelque neuf mille kilomètres de là.
Le lieutenant William Calley, qui commandait la compagnie Charlie, et cent vingt de ses hommes avaient encerclé le petit village de My Lai, au Vietnam. Calley avait regroupé les habitants, fait incendier le village et donné l’ordre d’abattre la population. Près de cinq cents civils avaient été froidement exécutés. Les enfants blessés qui tentaient de s’échapper avaient été abattus. Une trentaine de femmes qui sortaient d’un abri les mains en l’air avaient été tuées avec leurs nourrissons. Ils avaient été jusqu’à massacrer les chiens et les chats.
Les hommes de Calley semblaient dans un état second. Le carnage avait été rythmé par un morceau de hard rock diffusé par des haut-parleurs montés sur les hélicos.
Je n’ai pas dormi de la nuit, comme si cette information était inscrite dans mon subconscient. Le lendemain, j’ai pris un taxi et me suis rendu à l’aéroport. Mon avion partait vers midi et atterrissait à Londres une heure et demie plus tard.
Michael Stern serait sur place. Nous avions convenu de nous rencontrer à proximité de la Mini Cooper exposée dans le hall d’arrivée. Nous aurions tous deux la dernière édition du Belfast Telegraph sous le bras, comme signe de reconnaissance. Je pourrais me la procurer à l’un des kiosques.
À mon arrivée, j’avais mal au ventre quand je me suis présenté au poste de contrôle. Les policiers ont à peine jeté un coup d’œil à mes papiers. Je me suis dirigé vers le hall. Au passage, j’ai acheté le Belfast Telegraph.
J’ai tourné autour de la Mini, mon journal sous le bras, mais Michael Stern ne s’est pas manifesté. Je me sentais ridicule, à tourner autour de cette voiture. J’ai déplié le journal pour me donner une contenance.
Mon cœur s’est arrêté. En lisant le titre qui s’étalait à la une, j’ai compris que Stern ne viendrait pas et que le piège s’était refermé sur moi.
J’ai pressé le pas vers la sortie.
J’étais à quelques mètres de la porte vitrée quand une décharge électrique m’a cloué sur place. Une poigne de fer s’était refermée autour de mes bras. L’un des hommes qui m’encadraient m’a glissé quelques mots à l’oreille, je ne devais pas faire d’histoire et les suivre docilement.
Nous avons rebroussé chemin et avons traversé le hall en sens inverse. Nous nous sommes enfoncés dans un couloir. Ils ont ouvert une porte et m’ont poussé dans un bureau. Il n’y avait pas de fenêtre, la pièce était violemment éclairée et ne comptait qu’une table métallique et deux chaises.
L’homme du studio était debout derrière l’une d’elles. Il m’a paru plus grand que dans mon souvenir. Comme lors de notre première rencontre, il m’a dévisagé avec indifférence. Il ne semblait éprouver aucune émotion.
Il s’est approché, s’est planté devant moi et n’a prononcé que deux mots, the book.
Le livre.
Je réfléchissais à toute vitesse, mais je n’ai pas trouvé les mots et je n’ai rien répondu.
Il a adressé un signe à ses acolytes. L’un d’eux a arraché le sac à dos que je portais et en a étalé le contenu sur le sol. Du pied, il a trié les objets qu’il contenait. Comme il n’y avait pas le document qu’ils cherchaient, il m’a ordonné de me déshabiller.
Je me suis exécuté et me suis retrouvé à poil devant les trois hommes. Ils ont fouillé mes effets de fond en comble, mais n’ont rien trouvé. Ils se sont emparé des objets que mon sac contenait et les ont examinés un par un. Ils ont ensuite déchiré la doublure du sac, lacéré mes vêtements, mis mes affaires de toilettes en pièces.
Comme ils étaient bredouilles, le géant s’est planté devant moi et m’a fixé dans les yeux. Il ne semblait ni furieux ni excédé. Il a poussé un soupir. J’ai perçu une pointe d’agacement sur son visage, comme si mon obstination allait le mettre en retard pour son prochain rendez-vous.
L’homme qui se tenait derrière moi a hurlé dans mon tympan.
The book !
J’ai compris que c’était ma perspective de salut. Tant qu’ils n’auraient pas mon texte, j’avais des chances de rester en vie.
J’ai dit que je ne voyais pas de quoi ils parlaient.
J’ai perçu un mouvement. Un choc. Quelque chose s’est cassé en moi et j’ai perdu connaissance.
85
L’énigme venait de s’obscurcir
Dominique présuma que Michael Stern, l’homme dont parlait Jacques Bernier était quelqu’un qui avait évolué dans son proche environnement.
Bernier avait peut-être été journaliste lui-même et l’homme était l’un de ses pairs, mais il pouvait tout aussi bien s’agir d’un ami ou d’une simple connaissance. À moins que ce Stern ait en son temps rédigé un article qui le concernait de près ou de loin.
Quoi qu’il en soit, s’il lui avait communiqué ce nom, cela signifiait que cet homme pouvait l’aider et lui expliquer ce qui était arrivé à Bernier avant son accident.
Il entama ses investigations par une recherche sur Internet. Si ce Michael Stern avait écrit l’une ou l’autre chronique digne d’intérêt, il trouverait vraisemblablement des références le concernant sur le réseau.
Il saisit le nom du journaliste dans la fenêtre Google et lança la recherche.
Les résultats le laissèrent abasourdi.
Michael Stern était loin d’être un inconnu. S’il s’agissait de l’homme dont Jacques Bernier avait fait mention, le mystère entourant sa vie s’épaississait.
Michael S. Stern était né dans une famille modeste de Londonderry, le 25 octobre 1938. Après des études de journalisme à l’université Queens de Belfast, il était entré en septembre 1963 au Belfast Telegraph, à l’époque le premier quotidien d’Irlande du Nord qui tirait à plus de cent mille exemplaires.
Le lundi 18 mars 1968, en début de matinée, il avait fait irruption dans le bureau de Roger McGuinness, son rédacteur en chef, et l’avait abattu de trois balles dans la tête. Il avait ensuite abattu Greg Ryan, un de ses collègues qui tentait d’intervenir, et blessé grièvement Stephen Jones, un annonceur présent sur les lieux. Le service de sécurité était intervenu et était parvenu à le neutraliser.
Quelques jours auparavant, il avait eu une sévère altercation avec Roger McGuinness qui lui reprochait un engagement politique trop marqué dans certains articles et lui avait adressé un sévère avertissement. Plusieurs témoins avaient vu Stern quitter les lieux en manifestant sa mauvaise humeur.
Selon sa femme, il n’était pas rentré à la maison ce soir-là et il ne lui avait pas donné de nouvelles.
Lors de son interrogatoire, quelques heures après son arrestation, Michael Stern avait déclaré avoir agi sous contrainte. Il prétendait avoir été enlevé par un groupe d’hommes et avoir été séquestré dans un endroit isolé pendant plusieurs jours. Il affirmait avoir subi un lavage de cerveau et avoir été programmé pour commettre ces meurtres. Il dénonçait un vaste complot ourdi par une agence gouvernementale étrangère dans le but de prendre le contrôle de la conscience humaine et de manipuler les masses pour favoriser leurs desseins impérialistes.
Malgré ces propos incohérents, les experts le reconnurent responsable de ses actes.
À l’issue de son procès, il fut déclaré coupable d’homicide avec préméditation et condamné à la réclusion à perpétuité.
Il fut d’abord incarcéré à la prison de Crumlin Road, à Belfast, jusqu’en 1976, puis fut transféré dans les H-Blocks de la prison de Maze où il participa au mouvement de grève de la faim qui eut lieu en 1981.
Il entreprit également d’autres actions dans le but d’attirer l’attention de l’opinion publique sur l’erreur judiciaire dont il se disait victime.
Durant toute la durée de sa détention, il avait continué à clamer son innocence et avait maintenu sa version des faits.
Il fut retrouvé mort dans sa cellule le 4 mars 1987. L’autopsie avait conclu qu’il avait été victime d’un infarctus.
Dominique consulta plusieurs sites qui relataient cet événement. Tous donnaient une version similaire des faits. Nulle part, il ne trouva trace de Jacques Bernier.
Les faits remontaient à plus de quarante ans. Au moment de cette tragédie, Bernier avait vingt-trois ans.
Pourquoi avait-il évoqué le nom de cet homme ? L’avait-il connu en prison ? Avaient-ils partagé la même cellule ?
Dominique pensait avoir trouvé un sens au message de Bernier, mais l’énigme venait de s’obscurcir.
86
Mes mains se sont mises à trembler
La veille était mon ultime jour de liberté, et mes dernières heures d’être humain.
La brume est arrivée et a pris possession de mon âme.
Mon état de conscience s’est peu à peu modifié. Mon cerveau s’engourdissait, je n’éprouvais plus la sensation d’être éveillé. Une forme d’ivresse lancinante annihilait mes facultés et neutralisait ma volonté. J’évoluais dans un monde parallèle. Mes mains ne m’appartenaient plus, il m’arrivait de les examiner, de chercher à les reconnaître. Elles m’étaient devenues étrangères.
Je me palpais le visage en quête des coups qu’ils me donnaient, mais je ne découvrais aucun stigmate. Ils me persécutaient, mais les traitements qu’ils m’infligeaient ne laissaient pas de trace.
Je captais les objets qui m’entouraient. Je les reconnaissais, mais je n’arrivais plus ni à leur donner un nom ni à identifier leur fonction.
Ils m’avaient enfermé dans une sorte de chambre austère. Ils entraient à intervalles réguliers, à deux. Ils n’avaient pas de visage. Ils me saisissaient par les bras et m’emmenaient dans une sorte de parloir, à chaque fois différent.
Ils me faisaient asseoir. Des hommes m’auscultaient et me posaient des questions.
Le livre.
Ils me parlaient poliment, avec déférence, comme s’ils redoutaient de se voir accusés d’activités illicites.
Le livre.
Le livre.
Ils imaginaient des scénarios. Je l’avais remis à quelqu’un dans l’avion. Je l’avais expédié à une adresse à Londres avant de quitter Vienne. Je l’avais déposé dans le coffre d’une banque. Je l’avais dissimulé à l’aéroport.
Je m’étais programmé. Je m’accrochais à cet ultime espoir, le silence. Je ne savais pas de quoi ils parlaient. Je ne savais pas ce qu’était ce livre dont ils parlaient. À force, j’ai fini par oublier que je l’avais écrit.
D’autres questions sont arrivées. À qui avais-je parlé ? À qui avais-je débité mes balivernes ?
J’ai pensé à Mary et à Gunther. Si Stern leur avait parlé, ils savaient pour Gunther. Je devais protéger Mary. Je priais pour qu’ils n’aient pas entendu parler d’elle. Aussi longtemps qu’ils ne sauraient pas où se trouvait le livre, j’avais des chances de rester en vie.
Le silence.
L’oubli.
Je ne pensais qu’à cela. Me taire et oublier.
Ils venaient me chercher et me posaient chaque fois les mêmes questions.
Où ?
Qui ?
Quand ils me ramenaient dans la chambre, j’inspectais mes mains, je me tâtais le visage.
Je n’avais plus d’érection, j’étais devenu impuissant. J’étais incapable de me situer dans le temps. Il n’y avait ni horloge ni miroir ni fenêtre. Des hommes en blouse blanche faisaient irruption. Ils me faisaient avaler des pilules. Je subissais des examens. Quand ils s’en allaient, je m’endormais. La brume s’épaississait chaque jour davantage.
Je ne sais combien de jours, de semaines ou de mois cela a duré.
Sans crier gare, ils sont venus me chercher. Ils m’ont conduit dans une sorte de vaste salle dans laquelle une quinzaine de personnes m’attendaient.
Tous parlaient avec emphase.
Ils ont décrit qui j’étais. Ils ont déclaré que j’étais un déserteur, un trafiquant de stupéfiants, que j’étais impliqué dans la mort d’une jeune femme à Paris, que j’avais tué l’un de mes rivaux à Londres, que j’avais agressé et dévalisé un citoyen britannique. Ils ont prononcé des mots que je ne comprenais pas.
J’ignorais que Gab était mort. Je ne voulais pas le croire. Je pensais l’avoir assommé. J’ai eu des remords.
J’aurais aimé avoir des nouvelles de Mary, mais je n’avais pas droit à la parole. Mes mains se décharnaient, la tête me tournait, mon sexe se racornissait.
Ils ont déclaré que je n’étais pas responsable de mes actes et m’ont envoyé à Dartford. La brume est devenue opaque, mes mains se sont mises à trembler.
87
Les auteurs ne furent jamais interpellés
Le dimanche 17 mars 1968, peu avant son discours contre la violence à l’Université du Kansas, le sénateur Robert Kennedy annonça sa candidature pour la conquête de la Maison-Blanche.
La nouvelle fut accueillie avec enthousiasme par les Berlinois qui gardaient un souvenir vivace de la venue de JFK en juin 1963 lorsqu’il avait prononcé la phrase restée célèbre : Ich bin ein Berliner.
Ce soir-là, le Graffiti avait enregistré l’une des meilleures recettes de l’année. Malgré une nouvelle offensive de l’hiver, les Berlinois étaient sortis et s’en étaient donné à cœur joie. Le nouveau groupe de rock constitué d’Anglais énergiques qui officiait dans la boîte avait plongé la salle dans une ambiance survoltée et les clients avaient fait la fête jusqu’aux petites heures du matin.
Ce n’est qu’après six heures, alors que le soleil était déjà levé, que les derniers piliers avaient quitté les lieux.
Comme chaque dimanche, Gunther Krombach procéda à la fermeture. Il vida les caisses, glissa les billets de banque dans une enveloppe cartonnée, versa les pièces de monnaie dans une boîte métallique et se rendit au rez-de-chaussée pour déposer l’ensemble dans le coffre-fort du restaurant.
Il y retrouva Paolo Fermi, le gérant, qui assurait la fermeture du restaurant.
Dès que l’argent fut à l’abri dans le coffre, ils se préparèrent un plat de pâtes. Il leur arrivait souvent de passer une heure à philosopher ou à échanger des propos sur la situation politique avant de rentrer chez eux.
Peu avant sept heures du matin, alors que Gunther Krombach était parti chercher sa veste à l’étage, trois hommes cagoulés firent irruption dans le restaurant. Ils portaient de longs manteaux noirs, des bottillons militaires et étaient armés de fusils à pompe.
Ils mirent Paolo Fermi en joue et l’un d’eux le somma de lui remettre l’argent. Pendant que le gérant s’exécutait sous la menace, l’un des hommes quitta le groupe et prit la direction de l’étage.
Quelques instants plus tard, Fermi entendit deux fortes détonations. L’homme qui était monté refit son apparition. Il fit un signe de tête à ses acolytes et tous trois prirent la fuite. Paolo Fermi perçut le vrombissement d’un moteur puissant et le crissement de pneus sur le bitume.
Paralysé par la peur, il patienta quelques instants avant de se ruer dans l’escalier qui menait à la boîte.
Il découvrit le corps sans vie de Gunther Krombach, allongé derrière le bar, abattu à bout portant de deux balles dans la tête.
La police arriva rapidement sur les lieux.
Trois attaques similaires s’étaient produites pendant le mois écoulé, mais c’était la première fois que les agresseurs ouvraient le feu sur leur victime.
Les policiers découvrirent une arme dissimulée sous le bar. Le gérant leur expliqua qu’elle avait pour objectif de calmer l’agressivité de certains clients et de prévenir tout risque de rixe.
Selon la disposition du corps de Gunther Krombach, rien ne laissait cependant supposer qu’il avait tenté de s’emparer de cette arme ou qu’il avait opposé une quelconque résistance.
Dans son témoignage, Paolo Fermi affirma que l’homme qui s’était adressé à lui parlait allemand sans accent étranger. Les autres hommes avaient gardé le silence.
La police n’avait retrouvé aucune douille. L’expert en balistique conclut que Gunther Krombach n’avait pas été abattu par un fusil à pompe, mais par une arme de poing utilisant des munitions de 9 millimètres.
Cette attaque fut la dernière de ce type à se produire à Berlin.
Les auteurs ne furent jamais interpellés.
88
J’étais devenu inoffensif
Je conserve de Dartford la vision du carrelage noir et blanc que je foulais lorsque je parcourais les couloirs, encadré par les hommes en blanc. Ces brefs allers et retours constituaient le seul moment où je côtoyais mes semblables.
Le nez au sol, je fixais le carrelage. Je pensais à Chess. J’imaginais le mouvement des pièces sur l’échiquier. Je percevais les attaques. J’élaborais des stratégies défensives. C’était peine perdue. L’issue ne variait pas.
Il m’arrivait de lever les yeux. Les hommes que je croisais avaient les yeux éteints. L’un d’eux me dévisageait avec animosité. Il avait le teint pâle et les traits déformés. Sa bouche ne formait qu’un pli. Je détournais le regard.
Les autres se tenaient immobiles dans les couloirs. Ils balançaient la tête d’avant en arrière ou partaient d’un rire dément.
Hormis le carrelage à damiers, j’ai dans les narines l’odeur qui suintait des murs et s’insinuait sous ma porte. Les effluves douçâtres d’excréments mêlés aux senteurs d’urine, de désinfectant et de légumes cuits. J’ai pensé que je finirais par m’y habituer, mais ce fut tout le contraire : la nausée me guettait jour et nuit, sans que je sois capable de différencier le jour de la nuit.
Ils me considéraient comme dangereux et m’avaient mis à l’isolement. J’étais enfermé dans une minuscule cellule, il n’y avait aucun meuble, mon lit était équipé de sangles, ma fenêtre était pourvue de barreaux d’acier.
Les moments d’éveil étaient rares et peuplés de cauchemars.
Par bribes dérobées, j’ai appris que j’étais interné au Stone House Hospital de Dartford, dans le Kent, à une trentaine de kilomètres de Londres. C’était l’un des plus vieux et des plus célèbres hôpitaux psychiatriques du Royaume. Jacob Levy, un boucher que l’on suspectait d’être Jack l’Éventreur y avait séjourné et y était mort de la syphilis.
À la fin du siècle passé, Dartford était considéré comme le dépotoir de l’Angleterre. La ville comptait des léproseries, des hôpitaux pour maladies infectieuses, des poudreries et des asiles d’aliénés. Ces derniers étaient en nombre dans la région. Darenth Park, un centre pour enfants retardés, et Stone House se disputaient la réputation d’être les plus sinistres.
Dartford était aussi la ville natale des Stones. La maison de Keith Richards se trouvait à quelques encablures de ma prison.
Des bruits et des cris traversaient les murs. En général, c’était de simples gémissements. De temps à autre, un hurlement de terreur retentissait. Je restais prostré dans le noir. Un homme venait à ma porte et me sommait de me taire.
Ils étaient parvenus à me faire croire que j’étais fou.
De temps en temps, les sirènes se mettaient à hurler. En règle générale, pour signaler qu’un fou venait de s’évader.
Un branle-bas se déclenchait dans les couloirs, cela courait dans tous les sens. Les pensionnaires se mettaient à beugler à l’unisson. C’était comme si un chat avait été lâché dans un chenil. Certains détruisaient ce qu’ils avaient à portée de main ou se cognaient la tête contre les murs.
Les cavales ne duraient qu’un jour ou deux. Ils finissaient par les retrouver, dissimulés dans un parc, morts ou transis de froid.
Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les hommes venaient m’interroger. Ils me promettaient un allègement de mes conditions de détention si j’acceptais de coopérer. Je ne savais pas de quoi ils parlaient.
Un jour, ils ont arrêté les visites et m’ont sorti de l’isolement.
J’étais devenu inoffensif.
89
Comme une menace
Dominique avait continué ses recherches sur les faits du 18 mars 1968 et les meurtres commis par Michael Stern. Il avait parcouru plusieurs sites en anglais, dictionnaire à la main, sans en apprendre davantage.
Cette découverte l’avait occupé pendant tout le week-end, mais malgré cette rumination obsessionnelle, il n’était pas parvenu à établir un lien entre Michael Stern et Jacques Bernier. Chaque hypothèse qu’il émettait lui semblait invraisemblable.
Le lundi matin, il imprima les pages qui retraçaient l’affaire et prit la route de la clinique avec l’espoir que la vue de ces tirages inciterait Bernier à lui en dire plus.
Il se rendit chez lui, lança quelques formules humoristiques et entama les soins comme il le faisait habituellement.
— Tu as vu les infos, Jacques ? Après la Tunisie et l’Égypte, c’est au tour de la Lybie de se soulever. Connaissant Kadhafi, tu peux être sûr qu’il va vendre chèrement sa peau.
L’homme ne réagit pas.
— Et le foot, Jacques ? Tu t’intéresses au foot ? Tu as vu que le Standard a perdu contre Gand et que Westerlo a battu Anderlecht ?
Bernier resta impassible.
Lorsqu’il entama le massage de ses jambes, Dominique perçut une grande tension dans ses muscles.
L’homme était absent, perdu dans son monde intérieur.
Vers la fin de la séance, Dominique aborda le sujet qui lui tenait à cœur.
— Je suis allé sur Internet, Jacques. Je sais qui est Michael Stern. Je sais ce qui s’est passé avec ce journaliste, mais je ne comprends pas ce que tu as à voir dans cette histoire. Tu connaissais cet homme, ou une des victimes de cet homme ?
La question ne suscita aucune réaction.
Bernier semblait déconnecté, ses yeux roulaient dans ses orbites, il donnait l’impression de ressasser un interminable cauchemar.
Dominique changea de stratégie et prit un ton enjoué.
— Tu as vu le soleil ? Le printemps est en avance cette année. Je vais t’installer dans la chaise et on va s’offrir une promenade dans la forêt, tu es d’accord ? Après ça, je t’emmène à la piscine.
Il n’attendit pas la réponse. Sorti de son contexte habituel, Bernier se sentirait peut-être plus à l’aise et accepterait de lui répondre.
Il appela une infirmière à l’aide et installa X Midi dans le fauteuil roulant.
En plus des séances de kinésithérapie, Bernier continuait le travail en piscine et les séances de verticalisation. Si les progrès enregistrés durant les premiers mois avaient été encourageants, ils marquaient à présent le pas. L’ensemble des intervenants considérait son état comme stationnaire, voire en légère régression.
Dominique parcourut les couloirs et se dirigea vers l’entrée de la clinique.
Le soleil brillait, mais la température restait fraîche. Il héla une infirmière, lui demanda de veiller quelques instants sur X Midi et se rendit au dispensaire pour se munir de couvertures.
En chemin, il croisa Marie-Anne Perard.
— Bonjour Dominique.
— Bonjour Madame.
— Où allez-vous de ce pas décidé ?
— Je vais faire une promenade avec X Midi.
Elle consulta sa montre.
— La réunion de staff commence dans dix minutes. J’ai besoin de votre présence. Les promenades se font l’après-midi et il fait trop frais pour sortir.
Il ne contesta pas, retourna sur ses pas et réinstalla Bernier dans son lit avant de prendre la direction de la salle de réunion.
Marie-Anne Perard accueillit sobrement les participants et présenta les points de l’ordre du jour. En tête de liste, il était fait mention du cas de X Midi, ce qui surprit Dominique.
— Pour commencer, j’aimerais aborder le cas du patient que nous appelons X Midi.
Elle fit une pause et posa son regard sur Dominique.
— Je suis heureuse de vous informer que Dominique est parvenu à communiquer avec lui.
Même si la plupart des participants étaient déjà au courant de cette nouvelle, l’information fut accueillie par des applaudissements.
Dominique se sentit embarrassé.
— Je vous remercie.
— Vous pouvez être fier de vous, Dominique.
— Merci à vous tous.
Elle poursuivit son discours.
— Dominique a réussi à créer un climat propice à la communication. À force de patience et de ténacité, il est parvenu à obtenir quelques informations qui nous ont permis d’identifier notre patient. X Midi s’appelle Jacques Bernier. Je vous demande d’utiliser ce patronyme dès aujourd’hui et de mettre les dossiers et les rapports en conformité avec cette information. Nous savons encore peu de choses sur lui. Monsieur Bernier est Belge et est né en 1945. Il a été porté disparu en janvier 1964. La police a ouvert une enquête qui, je l’espère, nous permettra d’en savoir plus. Une annonce est parue dans plusieurs journaux ce week-end pour inviter des personnes l’ayant connu à se manifester.
Dominique s’en voulut d’avoir oublié de consulter la presse pour parcourir cette annonce.
Marie-Anne Perard fit une pause et attendit le silence complet pour dévoiler la nouvelle.
— Je suis en mesure de vous dire que cet article a d’ores et déjà donné un résultat et que j’ai reçu ce matin un appel provenant d’Angleterre.
Dominique tressaillit.
— J’ai eu l’occasion de parler avec l’assistante du docteur Philip Taylor. Monsieur Taylor est psychiatre et professe dans la région de Londres. Il a prodigué des soins à Monsieur Bernier jusqu’à la fin de l’été 2009. Il viendra nous rendre visite demain.
Sans qu’il ne puisse en saisir les raisons, Dominique accueillit cette nouvelle comme une menace.
90
J’avais déjà rencontré cet homme quelque part
Les journées duraient une année, les années passaient en l’espace d’une journée. Dans le parc, les arbres changeaient de couleur quelquefois, c’était le seul repère qui me restait.
Ils ont agrandi ma chambre et installé des meubles autour de mon lit. Trois dingos ont été transférés dans mes murs, sans doute pour me forcer à reconnaître que j’en faisais partie.
Pour l’essentiel, ils étaient muets. L’un d’eux restait allongé à longueur de temps. Il fixait le plafond en laissant s’écouler un filet de bave. Les deux autres entraient et sortaient. Nous nous frôlions, mais ne nous parlions pas.
À mon tour, j’entrais et sortais. Je parcourais les couloirs, le nez dans l’échiquier. Je tentais de fuir l’odeur et les cris. L’issue ne variait pas.
L’un des hommes en blanc surgissait de temps à autre. Ils ne me posaient plus de questions, ils se contentaient de me tâter et de parler entre eux comme si je n’existais pas.
Les tentatives de suicide étaient légion. Peu parvenaient à leurs fins. Pour la plupart, ils tentaient de se pendre avec leurs lacets ou un morceau de drap tirebouchonné.
J’ai encore dans les rétines l’image d’un pauvre bougre qui s’est immolé par le feu. Il avait réussi à s’emparer d’un grand flacon d’alcool ou de désinfectant. Il en a avalé une bonne rasade, s’est aspergé le visage avec l’excédent et y a mis le feu.
La tragédie s’est déroulée dans la cour devant de nombreux témoins, dont quelques visiteurs. Le gaillard s’est mis à courir en hurlant, la tête et le haut du corps dévorés par les flammes.
Ils s’y sont mis à plusieurs pour parvenir à le rattraper, à l’immobiliser et étouffer le feu.
Autour de moi, les dingos se déchaînaient. Deux ou trois types en ont profité pour tenter de s’évader. Les sirènes sont entrées en action. C’était une pagaille incroyable. Le soir, tout le monde a reçu une double ration de pilules.
Je n’ai jamais su si le gaillard était mort, je ne l’ai plus revu.
De temps à autre, je percevais les mouvements lents d’une symphonie qui venaient de je ne sais où, une montée de violons qui me plongeait dans l’angoisse. Hormis ces quelques notes cafardeuses, il n’y avait ni rock ni musique ni radio ni télévision à Stone House.
Il neigeait le jour où il est arrivé. C’était un vieillard, il avait plus d’une soixantaine d’années. Il avançait à l’allure d’un escargot, pas après pas, en tremblant de partout. Il progressait dans les couloirs, centimètre par centimètre, le regard perdu devant lui. Il s’accordait des pauses régulières pour reprendre son souffle.
J’observais ses traits doux, le léger sourire qui flottait sur ses lèvres et la touffe de cheveux rebelles qui se dressait sur sa tête.
Petit à petit, un visage est sorti de la brume. J’avais déjà rencontré cet homme quelque part.
91
Plusieurs individus
Hormis le New Musical Express et le Rolling Stone Magazine, Mary Hunter ne lisait pas la presse. Elle ne s’intéressait ni à la politique ni à l’économie, encore moins au football ou aux frasques des stars qui s’étalaient dans les tabloïds à sensation dont les Londoniens étaient friands.
Lorsqu’elle arriva au Dorchester, en fin d’après-midi, elle ignorait tout de la tragédie qui s’était déroulée à Belfast quelques heures auparavant. En guise d’accueil, le pianiste qui l’accompagnait lui présenta le Daily Mail en lui demandant si l’homme qui faisait la une n’était pas le journaliste qui était venu l’interroger en décembre dernier.
Mary eut un choc en découvrant la manchette. La photo de Michael Stern apparaissait sous le titre qui relatait les événements. Elle ressentit une peur rétrospective en réalisant qu’elle avait passé une heure en tête à tête avec ce déséquilibré.
Elle parcourut l’article avec fébrilité. Rien ne faisait allusion à l’enquête pour laquelle il était venu la trouver.
Durant quelques instants, elle s’interrogea sur l’utilité d’informer la police de cette visite. Le pianiste l’en dissuada aussitôt.
Lorsque celui-ci l’avait interrogée sur la teneur de la conversation qu’elle avait eue avec Stern, elle s’était contentée de lui répondre qu’il s’agissait d’une vieille histoire pour laquelle elle n’avait qu’un lien indirect.
Il lui prédit de longues heures d’interrogatoire et une fouille en règle dans sa vie privée si elle parlait de cette entrevue à la police.
Mary vivait à présent avec Bob Hawkins, le guitariste qui la suivait depuis ses débuts. L’homme était d’une jalousie maladive vis-à-vis de Berger. Le batteur avait contraint le groupe à se séparer et avait fait souffrir Mary. Après lui avoir volé ses économies, s’être battu avec Gab et avoir quitté Londres, il l’avait laissée seule. Elle était tombée dans un état dépressif et y était restée pendant plusieurs semaines. La police venait régulièrement leur demander s’ils avaient des nouvelles de Jacques Berger.
Il ne fallait pas rouvrir les plaies, elle renonça à prendre contact avec la police.
Au fond d’elle-même, elle reconnaissait qu’elle était toujours éprise de Berger. C’était un homme taciturne, instable et perturbé, mais il était attentionné. Il ne lui avait jamais manqué de respect et l’avait toujours traitée avec égard. Il était différent des autres hommes qu’elle avait connus.
Elle regrettait ce qui s’était passé. Elle avait cru qu’il l’avait quittée en emportant leur argent. Elle s’était découragée et s’était laissé entraîner en pensant que l’héroïne l’aiderait à surmonter sa détresse. Depuis, elle se sentait en partie responsable du drame.
Durant quelques semaines, elle avait entrepris des recherches dans l’espoir de le retrouver. Elle avait pris contact avec des personnes qu’elle connaissait à Paris, Bruxelles et Berlin, mais n’avait trouvé nulle trace de lui.
Il n’était de jour où elle espérait recevoir un signe de sa part, mais recevoir un signe de sa part générerait de nouveaux problèmes. Jacques Berger était toujours recherché comme témoin dans l’altercation qui l’avait opposé à Gab. Le Jamaïcain s’en était sorti, mais avait perdu l’usage d’un œil.
Vers vingt-deux heures, à l’issue de son tour de chant, elle quitta le Dorchester et prit la direction de Soho pour retrouver Bob Hawkins et quelques amis dans un pub.
Aux environs de minuit, ne la voyant arriver, Hawkins téléphona au Dorchester. Le réceptionniste lui confirma que Mary avait quitté l’hôtel deux heures auparavant. Elle semblait accablée, manquait de voix et n’avait pas recueilli l’enthousiasme habituel.
Hawkins patienta jusqu’au lendemain. Vers midi, il se rendit à la police pour signaler la disparition de sa compagne.
Le corps de Mary Hunter fut retrouvé trois jours plus tard, dans l’après-midi du vendredi 22 mars 1968, par une équipe de dockers. Ils effectuaient leur travail dans le port de Newhaven, au sud du pays, à proximité de la ville de Brighton. Le cadavre de Mary Hunter se trouvait dans le wagon d’un train de marchandises en provenance de Londres.
Son corps portait de nombreuses traces de coups, des ecchymoses et des marques de brûlures. Le médecin légiste dépêché sur place estima que le décès remontait à quarante-huit heures.
La police en déduisit que Mary Hunter avait été enlevée et séquestrée avant d’être mise à mort.
L’autopsie révéla qu’elle avait un taux élevé d’héroïne dans le sang, mais peu de molécules dérivées. Cet indice associé à la faible présence de la substance dans les urines les fit conclure à une mort rapide par overdose.
Les constatations médico-légales démontrèrent qu’elle avait eu des rapports sexuels avec plusieurs individus.
92
En murmurant mon nom
J’ai perçu une sorte de plainte, un long gémissement désespéré. J’ai tendu l’oreille. Un filet de musique ondoyait dans le couloir.
Je me suis laissé guider.
Au fond d’une chambre, le vieillard était recroquevillé sur une chaise près de la fenêtre, les yeux tournés vers le ciel. Il tenait un harmonica dans les mains. Les notes qui s’en échappaient étaient chargées de tristesse.
Nul autre que lui n’était capable de faire pleurer un harmonica de façon aussi bouleversante.
Je me suis approché. Il m’a dévisagé. Mes traits ne lui étaient pas inconnus. Il s’est levé, a continué à me fouiller du regard. Il cherchait dans sa mémoire.
Pour ma part, j’avais trouvé.
Lentement, il a ouvert les bras.
Je savais que Birkin avait la larme facile, mais je n’imaginais pas qu’il puisse pleurer comme un gamin. Il m’a serré longuement dans ses bras en murmurant mon nom.
93
Il faut que je te parle
Le lendemain de la réunion, Dominique se rendit à la clinique plus tôt que d’habitude. Il souhaitait être présent lorsque le docteur Taylor se présenterait et tenait à annoncer lui-même la venue de ce dernier à Jacques Bernier.
Dès son entrée, une infirmière de nuit se précipita à sa rencontre.
— Dominique, tu es déjà là ? Tant mieux ! Madame Desmet se plaint de douleurs dans les jambes et demande après toi. Monsieur Bernier est très agité, il a de la fièvre et n’a pas dormi de la nuit.
Dominique lui adressa un sourire.
— Merci, Léna, je m’en occupe. Je passe chez Madame Desmet, je n’en ai pas pour longtemps, j’irai ensuite chez Monsieur Bernier.
Il fit un pas en arrière, fit mine d’examiner l’infirmière des pieds à la tête et soupira.
— Tu n’as pas bonne mine, Léna, tu devrais prendre quelques jours de congé.
Elle sourit à son tour.
— Je vais à la mer le week-end prochain. Une copine me prête son appart au Coq, je te prends avec moi ?
Il écarquilla les yeux et porta une main à son cou, comme si la question lui coupait le souffle.
— Le Coq ? Ce week-end ? Avec toi ? Pourquoi pas ? On en reparle tout à l’heure ?
Elle s’approcha, posa les mains sur ses épaules, se hissa sur la pointe des pieds et lui glissa quelques mots à l’oreille.
Dominique éclata de rire.
— Ce n’est pas grave, je prendrai un sac de couchage et je m’installerai dans le divan.
Léna travaillait à la clinique depuis quelques semaines. Elle faisait preuve d’une énergie et d’un optimisme débordants. Les manœuvres d’approche qu’elle entreprenait vis-à-vis de Dominique alimentaient les discussions de couloirs et généraient de nombreux commentaires. D’autant qu’il était criant qu’il n’était pas insensible à son charme.
Dominique se présenta chez sa patiente et pratiqua une série de massages pour soulager ses douleurs. Il prit ensuite la direction de la chambre de Bernier.
Contrairement à ce qui se passait habituellement, l’homme ne guettait pas son arrivée. Il avait la bouche entrouverte et fixait le plafond.
Dominique approcha.
L’homme ne parut pas remarquer sa présence. Il transpirait, ses yeux filaient de gauche à droite comme si l’on projetait un film d’horreur au plafond.
Dominique lui épongea le front.
— Jacques, mon ami, il faut que je te parle.
94
Dans les flammes
Nous nous mettions à l’abri des regards. Nous ne voulions pas qu’ils sachent que nous nous connaissions, ils se seraient méfiés et nous auraient séparés.
Nous nous donnions rendez-vous près de la blanchisserie, dans une allée du parc, à l’arrière de la chapelle. Quand nous étions réunis, nous nous sentions plus forts. Il nous arrivait de rester de longues minutes, assis sur un banc, murés dans un silence assourdissant, à savourer notre complicité avec la tour du château d’eau pour seul témoin.
Parfois, Birkin m’adressait la parole. Il se penchait vers moi et me parlait à voix basse en articulant chaque syllabe comme si j’étais un abruti.
Je ne comprenais pas ce qu’il disait. Je ne pouvais lui répondre. Je formais des mots dans ma tête, mais j’étais incapable de les exprimer, ils m’avaient désappris à parler.
Lors d’une de nos rencontres, Birkin m’a lancé un clin d’œil et m’a montré son poing fermé. Lentement, il a ouvert la main. Sa paume renfermait quelques pilules. Il en a pris une, l’a déposée sur sa langue, a secoué la tête, l’a recrachée. Je devais arrêter de les prendre.
Les hommes en blanc m’en apportaient matin et soir. Elles étaient prêtes, rangées en ordre dans un petit récipient. Ils les déposaient dans ma main, me tendaient un verre d’eau et attendaient que je les aie avalées. Avant que je ne devienne inoffensif, ils auscultaient le fond de ma gorge avec une petite lampe de poche pour s’assurer que je les avais ingurgitées.
Du jour au lendemain, j’ai arrêté de les prendre comme Birkin me l’avait conseillé. J’attendais qu’ils aient quitté la pièce et je les vomissais dans la cuvette des toilettes. Je prenais garde de ne pas me faire remarquer. Je me méfiais des fous qu’ils avaient infiltrés dans ma cellule pour m’espionner.
Progressivement, j’ai fait le voyage à l’envers, je suis ressorti de la brume. Les couleurs et les bruits sont revenus. Les hommes en blanc ont pris un visage. Je parvenais à les différencier. Seule l’odeur persistait.
J’ai commencé à déchiffrer les messages de Birkin, mais j’éprouvais des difficultés à communiquer avec lui. J’aurais aimé le questionner, savoir ce qui lui était arrivé. J’aurais aimé qu’il me confesse les fautes qu’il avait commises pour mériter un emprisonnement à Stone House. Je voulais savoir par quel moyen il était parvenu à revêtir l’apparence d’un vieillard.
Petit à petit, j’ai commencé à balbutier. Un matin, tôt, alors que le service de nettoyage était en action, Birkin a profité d’un moment d’inattention des femmes de ménage pour me prendre par la main et m’attirer dans le débarras.
Un évier surmonté d’un miroir se trouvait dans le fond de la pièce. Birkin m’a emmené devant celui-ci. J’ai examiné le reflet dans la glace. Birkin était pareil à lui-même. À ses côtés se tenait un vieillard que je n’avais jamais vu. Il était plus grand et plus massif que Birkin. Il m’examinait, l’air éberlué.
Pan après pan, Birkin a reconstruit son histoire. Après ses années de débauche, il a rencontré une femme. Ils se sont mariés et ont eu deux enfants, deux garçons, Thomas et William. Il a trouvé un job dans une compagnie de location de voitures. Sa femme était vendeuse dans une boutique de vêtements.
Ils formaient un couple banal, comme l’Angleterre en comptait par milliers ; ils payaient leurs impôts, partaient en vacances en été et suivaient le championnat de football.
Un matin, Birkin est parti au travail. À cette époque, ses fils étaient déjà grands, l’un d’eux avait quitté la maison et était marié. Son employeur lui a annoncé que la société avait été rachetée et qu’il n’y avait plus de place pour lui.
La police l’a retrouvé trois jours plus tard. Il s’était enfermé dans les toilettes de la gare de Liverpool et déchirait méthodiquement un magazine en petits morceaux. Il ne se souvenait de rien.
C’était sa première fugue, son premier trou. Je trouvais cette aventure plutôt amusante, mais il l’a racontée sans sourire.
D’autres fugues, d’autres trous ont suivi. On l’a découvert, en position fœtale, caché au fond d’une armoire dans un magasin de meubles, une autre fois dans un confessionnal. La police avait fini par le connaître, il était catalogué.
Il a passé un premier séjour de deux mois dans un hôpital psychiatrique. Quelques jours après son retour à la maison, il a pris quelques victuailles et s’est caché sous son propre lit. Durant près de deux jours, il a observé les allées et venues de sa femme, entendu ses plaintes, ses jurons et ses pleurs, épié ses conversations téléphoniques, écouté les pronostics des policiers et des médecins.
Il est retourné d’où il venait, jusqu’à ce que sa famille décide de l’interner définitivement. J’ai fait mine de compatir.
À mon tour, j’ai tenté de lui retracer mon parcours. Je lui ai parlé de la mort des gars de Pearl Harbor, de la mort de Floriane, de la mort de Gab, de la mort de Stern, de mon back up à Berlin, de la mort du disc-jockey de Ramstein, des mots fantômes et des infrasons qui avaient tué d’innocents civils vietnamiens.
J’ai sans doute tout mélangé, il n’a pas semblé convaincu par mon histoire.
Un jour, j’ai pris mon courage à deux mains et lui ai demandé s’il avait eu des nouvelles de Mary. Il m’a répondu évasivement. Il l’avait sans doute croisée l’une ou l’autre fois, mais il ne lui avait pas parlé et il ne savait pas ce qu’elle était devenue.
Je sentais qu’il me cachait la vérité. Il savait quelque chose, mais ne voulait pas me le dévoiler. Il parlait d’elle comme on parle d’une personne disparue, en baissant les yeux et en adoptant un ton résigné.
Je n’ai pas insisté, je voulais imaginer Mary vivante et heureuse.
Il m’a fallu plusieurs semaines, ou plusieurs mois, pour retrouver un semblant de clairvoyance. J’aimais Birkin. Nous étions solidaires quant à notre destin. Nous nous soutenions l’un l’autre dans les moments de plus grand doute, mais peu à peu, sa présence et sa sollicitude ne me suffisaient plus. Je voulais retrouver ma liberté et revoir ma mère.
Birkin a fait un calcul et m’a dit qu’elle devait avoir quatre-vingt-neuf ans. Pour autant qu’elle soit encore vivante.
L’un des fils de Birkin venait de temps à autre lui rendre visite. Il s’appelait Thomas et était chef comptable dans une entreprise du bâtiment. C’était un gaillard baraqué et sûr de lui, à l’opposé de son père. Birkin le disait débrouillard. Il m’a proposé de lui demander de se renseigner.
Je voulais savoir. Il m’a fallu un moment pour rassembler les informations qui étaient dispersées dans ma tête. J’avais oublié qui j’étais, quel était mon nom et où j’avais vécu.
Thomas est venu et j’ai parlé avec lui. Il est reparti avec les données, en promettant à son père de faire les recherches nécessaires et de n’en parler à personne.
Quelques semaines plus tard, j’ai appris que ma mère était morte au début des années quatre-vingt-dix et qu’elle était enterrée au cimetière d’Ixelles. J’ai appris que mon père était également décédé. Ce jour-là, j’ai voulu disparaître, mourir de honte et de désespoir.
Jour après jour, heure après heure, j’ai tourné et retourné cette nouvelle comme un poignard dans une plaie béante. L’évidence m’est apparue. Je ne pouvais en rester là. Je ne pouvais finir ma vie de cette façon. J’avais encore une mission à remplir avant de m’en aller.
De jour en jour, ma conviction s’est renforcée. Il fallait que je sorte de cet endroit. Je devais me réconcilier avec mon père et demander pardon à ma mère.
J’ai fait part de ma détermination à Birkin. Il est resté songeur pendant plusieurs jours.
Un matin, il m’a annoncé qu’il allait me faire sortir de là.
Il avait tout prévu.
Nous approchions de la fin de l’été, c’était la veille de la pleine lune, la nuit de toutes les démesures.
Je ne sais si le cycle lunaire avait une influence réelle sur les dingos, mais lorsque l’astre approchait de sa phase culminante, une foule de débordements se produisaient à Stone House. Ces soirs-là, les hommes en blanc se montraient généreux en tranquillisants et les agités notoires étaient placés en isolement.
La nuit était peuplée de cris de détresse et de cavalcades dans les couloirs. Il n’était pas rare que les sirènes se mettent à hurler. À l’aube, les garde-malades terminaient leur office sur les genoux.
Birkin m’avait sommé de sortir le lendemain, dès la première heure, et de flâner dans le parc à proximité de l’entrée de service qui donne sur Invicta Road.
Je ne voyais pas où il voulait en venir ni comment il comptait me faire sortir par cette issue. C’était une double grille métallique, haute de deux mètres, fermée la plupart du temps. Durant l’horaire imparti aux livraisons, un garde se postait dans une guérite située entre les portes. Lorsqu’un fournisseur se présentait, il devait franchir la première grille avec sa camionnette et attendre qu’elle se referme derrière lui. Il devait ensuite passer l’examen minutieux des documents et patienter jusqu’à ce que s’ouvre la seconde grille. Quand il ressortait, le gardien contrôlait le véhicule de fond en comble.
Birkin m’a répondu qu’il savait tout cela et m’a demandé de lui faire confiance.
Ce soir-là, avant de nous quitter, il m’a pris dans ses bras et m’a remercié de ce que j’avais fait pour lui. Je lui avais réappris l’amitié. Je lui avais enseigné la patience et la compassion. Il était ému, ses paroles dépassaient sa pensée.
Je ne voulais pas m’en aller sans lui, je lui ai demandé de m’accompagner. Il a soupiré. Il en avait assez de courir, il voulait rester là. Le monde extérieur lui faisait peur. Il avait fait son temps, il se sentait bien à Stone House et voulait y finir sa vie. Pour ma part, j’avais une mission, il fallait que je la mène à bien.
J’ai suivi ses directives. Le matin, dès le réveil, je me suis rendu dans le parc. J’ai tourné en rond pendant une bonne heure. Alors que je perdais patience, les sirènes ont retenti, mais le timbre était différent, cet appel n’annonçait pas une évasion.
J’ai entendu des cris. Une épaisse fumée s’échappait du bloc administratif. C’était une sorte de villa de briques rouges avec des bow-windows en bois blanc et une horloge surmontée d’un clocheton sur la toiture.
Je me suis approché du bâtiment. Des flammes ont brusquement surgi au premier étage, derrière les fenêtres de la bibliothèque, et la silhouette de Birkin s’est découpée sur le brasier. Je ne comprenais pas ce qu’il faisait là, pris au piège de l’incendie.
Tout le monde a commencé à s’affoler, à crier et à courir en tous sens ; les hommes en blanc, les pensionnaires et le personnel administratif. En quelques minutes, la cour fourmillait de spectateurs paniqués et impuissants.
Il n’a fallu qu’une dizaine de minutes aux pompiers pour arriver. Seules les grilles de l’entrée de service étaient assez larges pour laisser passer leurs fourgons. L’un des gardes s’est précipité, a ouvert les portes et est revenu dans la cour pour assister au spectacle.
Les grilles sont restées ouvertes. Je suis sorti en marchant, étrangement calme et serein. Je pensais que Birkin avait tout prévu, qu’il allait s’en sortir, que ce n’était qu’un stratagème.
Ce n’est que plus tard que j’ai fait le lien entre ses derniers mots et son sacrifice.
De l’autre côté, Thomas m’attendait. Je suis monté dans sa voiture. C’était une Mini. Par un fait du hasard, c’était la dernière voiture que j’avais vue à l’aéroport avant mon arrestation. Je pensais qu’après tout ce temps, ils auraient arrêté de commercialiser ce modèle.
Il a démarré en trombe. Il y avait des vêtements pour moi sur le siège arrière. Thomas était nerveux et distant. Il désapprouvait ce qu’il faisait, mais il avait une dette envers son père. Il allait me déposer dans le centre de Londres, après cela, il serait quitte, je n’avais qu’à me débrouiller.
Je n’ai pas posé de questions. Birkin m’avait raconté son histoire, Thomas avait signé la demande d’internement de son père.
Il m’a débarqué dans une rue animée de Londres. J’ai regardé autour de moi, mais je n’ai pas reconnu le quartier. Je suis descendu de la voiture. Thomas m’a tendu quelques billets de banque, a refermé la portière et a démarré sans un regard pour moi.
J’ai respiré, j’étais à Londres. Rien n’avait changé, pourtant, tout était différent. Je reconnaissais l’architecture, certains monuments et quelques façades, mais le décor et l’ambiance n’étaient plus les mêmes.
Tout était décalé. Des hommes couraient, des femmes couraient, des enfants couraient. Tous paraissaient crispés, fébriles, soucieux comme l’était Thomas. Ils me terrorisaient.
Les voitures, les bus et les murs étaient chargés de messages publicitaires vantant les mérites de produits étranges ou d’appareils aux fonctions indéfinies.
Personne ne prêtait attention à ma présence. Nul ne souriait ou ne semblait détendu comme nous l’étions quand Londres nous appartenait.
Noyé dans le magma humain, je pensais à Birkin et à sa silhouette qui s’agitait dans les flammes.
95
Chez moi
Je me suis terré dans un parc. Le soir, je suis descendu dans le métro. J’avais faim et soif, j’ai erré dans les couloirs.
Au bas d’un escalier, deux musiciens s’en donnaient à cœur joie. Ils étaient chevelus, rachitiques et édentés. Si ce n’est la taille qui les différenciait, ils auraient pu passer pour jumeaux.
Je me suis arrêté et je les ai écoutés. Ils jouaient et chantaient faux, mais c’était un duo sympathique et énergique. Leur allure formait un contraste avec celle des gens de l’extérieur, ils souriaient de leurs dents ébréchées comme s’ils étaient les plus heureux de la planète.
Le premier s’appelait Roger et avait à peu près mon âge, il chantait et jouait du banjo. L’autre s’appelait Jonathan, il faisait les chœurs et s’accompagnait aux tambourins. Leur répertoire était fait de standards du country.
Ils ont joué quelques morceaux, ont remballé leur matériel et ont changé d’emplacement.
Je les ai suivis.
Ils se sont engagés dans un autre couloir et ont recommencé à jouer. Leur numéro s’est prolongé durant une bonne partie de la soirée. À chacune de leurs prestations, je leur abandonnais l’un des billets de Thomas.
Il ne m’a pas fallu longtemps pour dilapider mon capital. Après leur avoir lâché ma dernière livre, j’ai tourné les talons. Roger est venu à ma hauteur et m’a interpellé. Il voulait savoir qui j’étais, pourquoi je les suivais, pourquoi je leur avais donné cet argent.
Je lui ai raconté ce qui me passait par la tête. J’avais été un grand batteur, je revenais de Paris où j’avais joué avec Clapton, la musique m’avait manqué. J’étais inoffensif.
Jonathan est venu se joindre à nous. Ils se sont regardés et ont dodeliné de la tête, ils semblaient comprendre ce que je disais.
Roger m’a pris à part. Londres n’était pas Paris. À Londres, les stations de métro n’étaient pas des dortoirs. Nos semblables devaient vivre en périphérie, dans les rues sombres ou au bord de la Tamise. Les gens comme nous étaient tenus de ne pas traîner dans les endroits publics et devaient être vigilants quand ils faisaient la manche, au risque d’être verbalisés ou de se voir expulsés.
Roger était paranoïaque. Selon lui, des caméras de surveillance étaient installées partout et il ne fallait pas longtemps à la police pour débarquer.
Ils ont vu que j’étais perdu et m’ont proposé de les suivre. Ils m’ont pris sous leur aile, je suis devenu l’un des leurs.
Leur quartier général était situé sous le pont Blackfriars.
Ils étaient nombreux à loger là-dessous. La plupart étaient solitaires, mais certains vivaient en clans. Roger m’a confié qu’il n’était pas de jour sans rixes ou règlements de comptes. Ma stature les impressionnait. Nous avons conclu un accord, ils me fournissaient le mode d’emploi pour survivre, je leur offrais mes services de garde du corps.
Jour après jour, ils m’ont appris à fréquenter les meilleurs soup runs, à dénicher les endroits les plus confortables et à m’offrir l’ivresse au moindre coût.
Avec eux, j’ai retrouvé un peu des sensations que j’avais éprouvées lorsque je parcourais les boulevards parisiens avec Candy. Je les escortais, je surveillais les environs et les alertais lorsqu’une patrouille de police apparaissait. Plus d’une fois, j’ai dû intervenir pour écarter des petits voyous qui tentaient de les détrousser.
En fin de soirée, lorsque l’alcool coulait dans nos veines, nous nous calfeutrions dans nos duvets et riions de bon cœur. La boisson et la dérision nous permettaient de supporter le froid. Roger aimait monter des canulars, il tentait de me faire croire qu’il y avait un tunnel sous la Manche ou qu’une femme avait été Premier ministre.
La vie était rude, les moments de désespoir fréquents. Il n’y avait ni perspective d’avenir ni retour en arrière possible. Avec le recul, je garde un souvenir ému des semaines que j’ai passées avec eux, sans doute parce que cette période fut pour moi une trêve entre deux captivités.
Hormis le froid qui me glaçait les sangs, j’étais libre, je retrouvais le goût de vivre. Ces moments passés avec Roger et Jonathan m’ont redonné une part d’humanité.
Une nuit de décembre, vers la fin de mon séjour, une bande de gros bras a débarqué sous le pont. Nous pensions qu’il s’agissait d’un racket ou d’une descente de flics en civil. Les malabars nous ont dévisagés et ont inspecté les lieux. Quelques instants plus tard, un gamin en jean, sweat et bonnet les a rejoints.
Roger et Jonathan n’en croyaient pas leurs yeux. Ils m’ont soufflé à l’oreille que c’était le prince William. J’ai cru à un nouveau canular de leur part. Leur futur roi venait s’encanailler sous les ponts de Londres. Le gamin a passé une nuit blanche, il faisait moins quatre et il était mort de froid.
Après le Nouvel An, je leur ai dit que ma mère était malade et que je voulais rentrer à Bruxelles. Ils ont paru surpris, mais ils ne m’ont pas posé de questions. Quelques jours plus tard, ils m’ont présenté Looping.
Looping était petit, chauve, tatoué des pieds à la tête. Il venait d’Aberdeen et connaissait les bons filons pour faire la traversée. Il était étonné par ma demande. Généralement, ses missions consistaient à faire passer des gars de France vers l’Angleterre, personne ne lui demandait de faire le chemin inverse.
Dans un premier temps, il m’a dit qu’il suffisait de prendre le train, mais il a vite compris que je n’étais pas en règle.
J’avais mis un peu d’argent de côté, mais cela ne suffisait pas. Roger a parlementé avec lui. Je ne sais ce qu’ils ont négocié, mais Looping a marqué son accord.
J’ai attendu quelques semaines. Un matin, Looping est venu me chercher. Nous sommes allés à Victoria. De là, nous avons pris un bus et sommes descendus dans un petit village. Nous nous sommes rendus dans un hangar où un homme nous attendait. Il m’a fait monter dans la remorque d’un camion en partance pour Douvres. Le chauffeur semblait au courant, même s’il n’a pas eu un regard pour moi.
Arrivé à Douvres, j’ai dû prendre mon mal en patience, je ne devais pas sortir de la remorque. La traversée a duré plusieurs heures. Arrivé à Calais, j’ai été pris en charge par un jeune gars à moto qui roulait des épaules. Il m’a emmené à la gare. Malgré son aspect rébarbatif, il était plus ouvert que le camionneur.
J’avais gardé quelques billets, je lui expliqué ce que je voulais. Dans la gare, il m’a aidé à trouver le numéro de téléphone du cimetière. Il a pris patience pendant mes appels répétés et n’a pas semblé agacé par ma difficulté à me faire comprendre.
La nuit venue, il m’a convoyé jusqu’à un wagon de marchandises à destination de Bruxelles. Il avait un passe-partout qui ouvrait les portes métalliques. Avant de me quitter, il m’a donné une bouteille de gnôle, pour me tenir compagnie. Je l’ai remercié et me suis dissimulé derrière une pile de caisses.
Quand le train s’est arrêté, j’ai attendu une heure ou deux, comme il me l’avait conseillé.
Je suis sorti du wagon, j’avais terminé la bouteille et j’étais ivre. J’ai remonté les voies en direction de la gare. La Tour du Midi se dressait derrière les murs noircis et les façades décrépies. J’avais assisté au début de sa construction, peu avant mon départ.
Le soir tombait. Le ciel était chargé. La pluie menaçait.
Après quarante-cinq années d’errance, j’étais de retour chez moi.
96
Le mot devait être complété
Bernier semblait ne pas avoir entendu.
Dominique lui prit la main et répéta, en parlant doucement.
— Mon ami, il faut que je te parle.
L’homme continuait de regarder droit devant lui.
— Tu vas recevoir la visite de quelqu’un qui te connaît.
Dominique était persuadé que l’homme captait ses paroles, il laissa l’information suivre son cheminement.
X Midi battit plusieurs fois des paupières et parut s’éveiller.
— Le docteur Taylor viendra ici ce matin. Tu le connais. Il nous a dit qu’il t’avait soigné jusqu’à l’été 2009.
X Midi sembla fouiller son passé. Ses yeux s’agrandirent brusquement et Dominique décela un début d’affolement.
La sueur perlait à ses tempes. Après un moment, l’homme s’apaisa quelque peu.
Il dévisagea Dominique, puis fixa l’armoire.
Dominique réagit aussitôt.
— Tu veux me parler ?
L’homme acquiesça.
Dominique ouvrit l’armoire, s’empara de l’abécédaire et le plaça devant lui.
Il entama l’énoncé des voyelles et des consonnes en se forçant à contenir son impatience.
Bernier semblait hésiter. Dominique parcourut l’abécédaire dans sa totalité sans qu’aucune lettre ne soit retenue.
Dominique reprit la série depuis le début.
— Prends ton temps, Jacques. Je vais reprendre lentement, je te demanderai de confirmer chaque lettre.
Cette fois, l’homme retint la lettre F.
Vinrent ensuite le I, le N et le K.
— F I N K ? C’est ton premier mot ?
Il cligna pour confirmer. Il semblait épuisé.
— Tu veux arrêter ?
L’homme refusa. Il souhaitait poursuivre.
M.
Il ferma les yeux et fit une longue pause.
— On continue ?
A.
Y.
Il transpirait de plus en plus. La sueur coulait dans son cou malgré les efforts de Dominique pour l’éponger.
— M A Y ? Tu veux arrêter ?
L’homme répondit par la négative.
B.
E.
— MAYBE ?
L’homme ferma les yeux.
Dominique en resta là.
Il ignorait s’il en avait terminé ou si le mot devait être complété.
97
Cette erreur
Il ne m’a jamais soigné. Il ne m’a jamais adressé la parole. Il traversait la cour, droit comme un I, sans un regard pour personne. S’il ne craignait d’être inquiété, il aurait ordonné ma mort, sans remords ni regret.
La vérité tient à présent dans ces deux mots que je ne suis pas parvenu à compléter. Ma route s’arrête ici, mon voyage touche à sa fin. J’ai échoué.
Sans ce bolide qui roulait à contresens, j’aurais pu atteindre mon objectif. Tout aurait été différent.
Je serais allé voir ma mère au cimetière et elle m’aurait pardonné.
J’aurais revu mon frère, je lui aurais dit que je l’aimais. Je l’aurais pris dans mes bras comme Birkin me l’avait appris. Je lui aurais demandé de me pardonner pour le mutisme dans lequel je m’étais trop souvent réfugié et il m’aurait pardonné. Il m’aurait raconté sa vie et je lui aurais raconté une partie de la mienne. Nous aurions échangé nos souvenirs d’enfance. Il m’aurait parlé des bêtes féroces qui se terraient sous mon lit, je lui aurais rappelé les magazines de charme qu’il parcourait sous la couette. Nous aurions évoqué le défilé des gendarmes, la camionnette du vendeur de soupe et le cheval du boulanger. Je lui aurais parlé de mes crayons de couleur et du sourire de notre mère. Nous aurions ri de notre folle après-midi de rock, des colères froides de mon père et de mes propos décousus.
Ensuite, je me serais rendu à la justice. J’aurais avoué mes crimes. Peut-être serais-je allé confesser mes péchés. Debout devant Dieu et les Hommes, j’aurais assumé mes responsabilités et expié mes fautes.
J’aurais repris la lecture. J’aurais rattrapé le retard, j’aurais relu les classiques et découvert de nouveaux chefs-d’œuvre. J’aurais écouté mes vieux morceaux de rock et ressassé mes souvenirs.
Plus tard, je serais allé voir Birkin à Stone House.
Il m’aurait expliqué ce qui s’était passé et quel tour de passe-passe il avait imaginé pour s’en sortir. Je lui aurais raconté mes semaines à Londres, ma rencontre avec Roger et Jonathan. Nous aurions formé un quatuor indestructible.
Quand tout aurait été réglé, je serais parti à la recherche de Mary.
Je n’aurais plus parlé de ce back up, de l’enregistrement, de mes recherches, de mes notes, des mots fantômes et des morts qui ont peuplé ma route.
J’avais payé chèrement cette erreur.
98
On le perd
Dominique sortit perturbé de sa rencontre avec Bernier. Il suivit néanmoins le plan de soins sans son enthousiasme habituel. Vers midi, alors qu’il approchait de la fin de sa tournée, une infirmière vint l’informer que Marie-Anne Perard souhaitait le voir.
Il comprit dès son entrée dans le bureau que les nouvelles n’étaient pas réjouissantes.
Marie-Anne Perard l’attendait en compagnie de Gérard Jacobs. Tous deux avaient le visage fermé et l’air soucieux. Il nota l’absence du docteur Taylor.
Elle l’accueillit sans entrain et le pria de s’asseoir.
— Dominique, ce que j’ai à vous annoncer n’est pas très agréable. Le docteur Taylor sort de ce bureau.
— Je savais qu’il venait aujourd’hui. À première vue, il ne vous a pas amené de bonnes nouvelles.
— En effet. Le docteur Taylor est médecin-chef dans un hôpital psychiatrique situé près de Londres. Monsieur Bernier faisait partie de ses patients.
— Je vous écoute.
— Monsieur Bernier s’est évadé de cet établissement, il y a près de deux ans, en août 2009. Il était recherché depuis. C’est grâce à l’annonce parue dans la presse qu’ils l’ont retrouvé.
Elle s’empara d’une chemise cartonnée posée sur le bureau.
— Vous êtes le seul à avoir noué un contact avec lui et je sais que vous l’appréciez.
Dominique sourit.
— Dominique aime bien tout le monde.
— Je sais, Dominique, c’est l’une de vos qualités. Vos patients le sentent et ça les aide beaucoup. Monsieur Bernier présente de lourds antécédents psychiatriques. Le docteur Taylor m’a remis son dossier médical.
Elle ouvrit le dossier et survola une page.
— C’est en anglais, je vous fais le résumé. Jacques Bernier est atteint d’héboïdophrénie, c’est une forme particulière de schizophrénie. C’est une maladie qui apparaît généralement à l’adolescence. Le diagnostic se fait par l’écoute et l’observation, il n’existe pas de test de laboratoire. Bien souvent, ce sont les proches qui décèlent les premiers dysfonctionnements, ce qui explique vraisemblablement le fait que Bernier ait passé la visite médicale au Petit-Château sans que sa maladie ne soit dépistée, mais il n’en était sans doute qu’aux prémices.
Dominique soupira.
— Je connais les effets de cette maladie, j’ai eu l’occasion de soigner plusieurs jeunes héboïdophrènes en France. L’un d’eux avait dix-sept ans. Il buvait depuis ses dix ans. Quand il était ivre ou quand il avait pris des drogues, il devenait violent et avait des crises hallucinatoires. Personne n’en voulait, ses parents le rejetaient, les foyers refusaient de l’accueillir.
— Les réactions violentes sont assez courantes, mais les manifestations varient d’un individu à l’autre. En général, on relève des troubles du comportement, les sujets ont l’impression que des personnes complotent contre eux. Ils ont des hallucinations visuelles et auditives. On observe aussi l’absence d’expressions ou d’émotions, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, de la confusion sur le plan de la réflexion et du discours, une difficulté à s’exprimer ou des mouvements répétitifs. Durant les périodes de symptômes psychotiques, leurs perceptions n’ont plus de lien avec la réalité. Dans le cas de Bernier, ça pouvait aller jusqu’à une psychopathologie criminogène.
Gérard Jacobs prit la parole à son tour.
— Le docteur Taylor nous a également fait un topo sur son parcours. Son histoire n’est pas banale. Jusqu’à l’âge de dix-huit ans, ses troubles sont peu marqués, hormis des propos incohérents et une introversion profonde. C’est après que ça se gâte. Comme vous le savez, il disparaît le jour de son entrée au service militaire. Il prend le train pour Paris où il se mêle à une bande de beatniks. Il devient dealer, vend de la drogue aux étudiants et est impliqué dans une affaire de viol suivi d’un suicide pour le moins suspect. Il échappe à la police et se réfugie à Londres. Il se fait de nouvelles connaissances et sombre dans l’alcool et les drogues. Il change d’identité et devient Jacques Berger. On le retrouve à Berlin où il consomme du LSD et prétend avoir participé à un enregistrement orchestré par une agence gouvernementale. De retour à Londres, il blesse grièvement un petit dealer ainsi que la personne chez qui il avait habité pour lui voler son argent. Il se fait faire de faux papiers, devient René Schnegg et prend la fuite vers la Suisse. Son délire s’aggrave, il échafaude une théorie de complot planétaire. Malgré ça, Dieu sait comment, il parvient à se faire embaucher comme portier de nuit dans un hôtel de Montreux. Quelques mois plus tard, il s’enfuit une nouvelle fois. La police remonte sa piste et l’arrête alors qu’il tente de revenir à Londres. Il n’y a pas eu de procès, le collège des experts psychiatres l’a déclaré non responsable de ses actes et il a été interné.
Dominique était sceptique. Il manquait un élément dans cette biographie.
— Le docteur Taylor vous a-t-il parlé d’un journaliste appelé Michael Stern ?
Ils parurent tous deux surpris par la question. Marie-Anne Perard reprit le dossier et le feuilleta.
— En effet. Lors de son arrivée à Londres, il était en possession d’un quotidien qui relatait une tuerie commise ce jour-là à Belfast. Lors de son arrestation, il a déclaré à la police qu’il avait rendez-vous avec ce Michael Stern, le journaliste qui avait commis les meurtres. C’était une manœuvre de diversion qui prouvait son aliénation mentale.
— Cela signifie qu’il n’y avait aucun rapport entre lui et ce journaliste ?
— Aucun. Seulement celui qu’il s’est créé dans la tête.
Dominique secoua la tête avec dépit.
— Pauvre Jacques ! Il en parle encore quarante ans après. Je suis surpris de ce que vous m’apprenez, mais ça ne change rien pour moi. Son passé le regarde. Pour moi, c’est un patient et mon rôle est de soulager ses douleurs.
Marie-Anne Perard intervint.
— C’est tout à votre honneur, Dominique.
Elle se leva pour signifier la fin de la rencontre. Le policier embraya aussitôt.
— En tout cas, vous avez réalisé du beau travail. Sans vous, nous ignorerions encore qui est cet homme.
Dominique se leva à son tour.
Il fit mine d’inspecter la pièce et prit l’air interrogateur.
— À propos, où est le docteur Taylor ?
— Il a souhaité voir Monsieur Bernier avant de partir. Lydia l’a accompagné. Je comptais vous le faire rencontrer, mais il était pressé. Il a sûrement quitté la clinique à l’heure qu’il est, il avait un train de retour à quatorze heures.
Le téléphone retentit alors qu’ils se dirigeaient vers la sortie. Marie-Anne Perard s’excusa et rebroussa chemin.
Dominique sortit du bureau et raccompagna Gérard Jacobs.
Le policier lui serra la main.
— Merci pour votre aide, ça ne se termine pas comme nous le pensions, mais c’est la vie.
Il sortit et traversa le parking pour regagner son véhicule.
Dominique le suivait des yeux lorsqu’il entendit Marie-Anne Perard l’interpeller.
— Dominique !
Elle se précipitait dans sa direction.
— Vite, Dominique, suivez-moi, c’est Bernier !
Ils pressèrent le pas.
— Qu’est-ce qui se passe ?
— Il est arrivé quelque chose.
Ils perçurent de l’agitation et des éclats de voix lorsqu’ils débouchèrent dans le couloir.
Ils pénétrèrent de front dans la chambre. Le chariot de réanimation était installé et un médecin était penché sur X Midi. On lui avait mis un masque à oxygène sur le visage. Le médecin pratiquait le mouvement spécifique de la réanimation cardiaque, les mains jointes sur la poitrine de l’homme. Deux infirmières l’assistaient.
D’un signe de tête, Marie-Anne Perard interpella l’une des infirmières et l’interrogea du regard.
L’infirmière prit l’air désolé.
— Je crois qu’on le perd.
99
Les yeux
Une ombre se profile derrière lui. Il se relève. Je distingue la silhouette de Birkin dans la pénombre. Il avance. Il a retrouvé son allure d’antan. Il est jeune, souriant et bien habillé. Il regarde derrière lui, tend la main. Mary approche. Sa beauté explose dans la lumière. Elle hausse une épaule et sourit à Birkin. Ils ont l’air complices. Mary passe une main dans mes cheveux. Elle fait un signe derrière elle et ma mère apparaît. Elle sourit. Tous trois ont l’air de me jouer un bon tour. Je sens leurs mains sur ma poitrine. Maman m’embrasse sur le front. Je respire son odeur. J’ai attendu si longtemps. Je ne veux plus te blesser. Elle pose une main sur mon visage et me ferme les yeux.
Épilogue
Dominique et Léna sortirent de l’aéroport JFK le mercredi 22 juin 2011 à midi.
Contrairement à ce que les oiseaux de mauvais augure leur avaient prédit, le vol ne leur avait pas paru interminable et les formalités d’entrée ne leur avaient pris qu’une vingtaine de minutes.
Ils montèrent dans un taxi et prirent la direction de Manhattan. L’autoroute et le pont de Queensboro étaient encombrés et ils ne parvinrent à leur hôtel que vers quatorze heures.
À cette époque de l’année, les touristes n’avaient pas encore envahi New York. En surfant sur quelques sites de réservation en ligne, Dominique avait trouvé un hôtel confortable à un prix abordable dans l’Upper West Side, en face du Lincoln Center.
Ils prirent possession de leur chambre, défirent leurs bagages et décidèrent de se dégourdir les jambes dans Central Park.
Depuis leur week-end de février au Coq, Dominique et Léna étaient devenus inséparables. Tous deux parlaient d’un fulgurant coup de foudre. Outre leur joie de vivre communicative, ils s’étaient trouvé de nombreux points communs et s’entendaient à ravir. Ils projetaient de s’installer ensemble dès septembre, lorsque le bail de l’appartement de Léna prendrait fin.
Comme ils devaient s’y attendre, leur union avait fait les gorges chaudes à la clinique, mais le temps, leur attitude professionnelle et leur enthousiasme avaient mis fin aux bavardages.
Ils se promenèrent durant près de deux heures dans Central Park, émerveillés par la fraîcheur et la quiétude qui y régnaient, malgré l’effervescence de la ville toute proche. Ils remontèrent jusqu’au Réservoir, sortirent du parc par l’est, flânèrent sur la Cinquième Avenue et firent un tour dans le centre commercial de Colombus Circle avant de rentrer à l’hôtel pour se rafraîchir.
Vers dix-huit heures, les effets du décalage horaire commencèrent à se faire sentir. Ils prirent un repas rapide au restaurant attenant à l’hôtel et se mirent au lit vers vingt heures où ils s’effondrèrent de sommeil.
Ils se réveillèrent de concert, frais et dispos, alors que le jour se levait. Ils firent l’amour et prirent une longue douche. Ils sortirent de l’hôtel aux environs de huit heures et avalèrent un petit déjeuner dans l’un des nombreux Starbucks Coffee qui parsemaient les rues de la ville.
Ils entamèrent ensuite le programme qu’ils avaient élaboré. Ils descendirent Broadway à pied vers l’Empire State Building dans le but d’échanger un baiser sur la terrasse du quatre-vingt-sixième étage, comme ils s’étaient promis de le faire en regardant Nuits blanches à Seattle.
Dominique faisait une halte tous les dix mètres pour prendre des photos ou s’extasier sur la moindre scène de la vie quotidienne. Léna s’en amusait et renchérissait sur ses propos.
C’étaient leurs premières vacances à deux et New York les fascinait.
Le décès de Jacques Bernier avait été enregistré le mardi 22 février 2011 à 13 h 08. Le rapport du médecin légiste concluait que la mort était survenue à la suite d’une embolie pulmonaire. Selon lui, il ne pouvait y avoir de lien entre les causes de la mort et un choc émotionnel consécutif à la visite du docteur Taylor.
Dès le lendemain, Dominique avait organisé une collecte au sein du personnel de la clinique. Il avait joué de son pouvoir de séduction pour réunir la somme nécessaire à la réalisation de son objectif. Malgré cela, il avait dû solliciter Marie-Anne Perard et Gérard Jacobs pour surmonter certains obstacles administratifs.
Son combat avait duré près d’une semaine et avait été auréolé de succès. Le lundi 28 février, Jacques Bernier avait été enterré au cimetière d’Ixelles, près de la tombe de sa mère.
Outre Dominique, Léna, Marie-Anne Perard, Gérard Jacobs et deux infirmières avaient assisté à la cérémonie. Lors de la mise en terre, Dominique avait été invité à prononcer quelques mots.
Pris au dépourvu et peu à l’aise dans ce genre de situation, il s’était contenté d’une phrase très sobre.
— Repose en paix, Jacques, mon ami.
Ils repassèrent à l’hôtel en fin de matinée et dévorèrent les sandwiches qu’ils avaient achetés. Vers quatorze heures, Léna prit la direction de Times Square afin d’y faire quelques achats et Dominique partit dans la direction opposée.
Il traversa Central Park et remonta la Cinquième Avenue en direction du Metropolitan Museum.
Il s’acquitta du prix conseillé de l’entrée, jeta un coup d’œil à sa montre et consulta le plan du musée. La salle 915 était située au premier étage, au niveau de la mezzanine.
Il parcourut un dédale de salles chargées d’œuvres prestigieuses, de sculptures et de vitrines remplies d’objets. Il traversa ensuite un immense patio entouré de colonnes de marbre et descendit un escalier monumental.
Dominique s’était penché sur le dossier de Jacques Bernier durant plusieurs semaines. Il avait analysé la chronologie des événements, étudié les faits et décortiqué les conclusions que les médecins avaient tirées.
Certains détails l’avaient intrigué. Quelques faits ne concordaient pas ou se contredisaient. Il s’était refusé à prendre contact avec le docteur Taylor ou à importuner Gérard Jacobs avec ses questions et ses doutes. Pour eux, l’affaire était classée.
Il s’était longuement penché sur les deux derniers mots de X Midi.
Que signifiaient FINK et MAYBE ? Ces noms, s’il s’agissait de noms, étaient absents dans le dossier.
Il avait pris contact avec le responsable du personnel du Palace de Montreux pour connaître les dates d’arrivée et de départ de Jacques Bernier, alias René Schnegg en leur établissement. L’homme lui avait appris que Bernier avait quitté Montreux le 11 mars 1968 et non le 18. À toutes fins utiles, il lui avait demandé si les mots Fink ou Maybe lui disaient quelque chose. C’est ainsi qu’il avait appris qui était Fink.
Selon le dossier, Bernier avait pris un vol vers Londres le 18 mars 1968 au matin, en provenance de Vienne, pour brouiller les pistes. Il y avait donc un trou de six jours dans le dossier. Où était passé Bernier durant ces six jours ?
Le second mot, Maybe, était resté une énigme.
La salle 915 regroupait des œuvres contemporaines. C’était l’une des moins spacieuses du musée. De forme rectangulaire, elle était parcourue sur sa longueur par une verrière dont les stores étaient baissés pour protéger les œuvres des rayons du soleil.
Dominique repéra la toile au premier coup d’œil.
René se trouvait sur un panneau latéral, à la droite de deux œuvres signées Andy Warhol. Le tableau mesurait trois mètres de haut sur deux de large.
Dominique s’avança, incrédule.
Le portrait semblait en tout point être une photographie. Même lorsqu’il fut à quelques centimètres de la toile, il eut du mal à imaginer qu’il s’agissait d’une peinture. Chaque détail était restitué de manière saisissante, depuis les mèches de cheveux jusqu’aux plis du col en passant par le reflet du flash que l’on pouvait discerner dans les pupilles de l’homme.
Plus étonnant que la technique, il avait devant lui Jacques Bernier, plus jeune, mais parfaitement reconnaissable.
Sur le portrait, il avait la bouche entrouverte et le regard halluciné, ce qui lui donnait quelque peu l’apparence d’un déséquilibré.
Un panonceau donnait quelques indications sur l’œuvre.
Andrew Fink. American, born 1940
René, 1969-70
Acrylic on canvas
Private collection, New York
— Bienvenue au Andy’s Corner.
Dominique fit volte-face.
Un homme longiligne lui souriait.
Il portait une barbe et de longs cheveux blancs-roux. La pâleur de son visage tranchait avec son ample chemise rouge. Un large short kaki laissait apparaître des jambes décharnées. Il était chaussé de sandales Birkenstock et tenait un sac à dos à bout de bras.
Dominique sourit à son tour.
— Vous êtes Andrew Fink ?
— Et vous êtes Dominique ?
— Oui. Votre français est impeccable.
— Vous voulez dire que je parle mieux que j’écris ?
— Vous écrivez sans accent, en tout cas.
— Les claviers américains n’en ont pas et le français est le plus grand snobisme des artistes newyorkais.
Dominique éclata de rire.
— Je suis content de faire votre connaissance.
Andrew Fink lui serra la main et fit un geste en direction de son œuvre.
— Ainsi, vous avez connu René ?
— Oui, c’était un de mes amis.
— Venez vous asseoir.
Ils prirent place sur la banquette placée en face d’un autoportrait d’Andy Warhol.
Fink examina Dominique de pied en cap.
— So, vous êtes venu de Bruxelles pour me parler de René ?
— Cela faisait longtemps que je rêvais de venir à New York. J’ai profité de cette opportunité.
— Je vois. Qu’est-ce que vous aimeriez savoir ?
— Comme je vous l’ai écrit, René était l’un de mes patients. Il était tétraplégique et ne pouvait s’exprimer que par le mouvement des paupières. Peu avant sa mort, il m’a communiqué votre nom. J’ai appris que vous l’aviez connu lorsque vous étiez à Montreux, mais je n’ai pas compris pourquoi il m’a donné votre nom.
Le peintre inspira longuement.
— C’est une vieille histoire. J’ai connu René il y a plus de quarante ans. À cette époque, je pensais que j’allais devenir riche et célèbre. J’étais le chef de file du courant hyperréaliste américain. Je pensais que notre art serait reconnu et éternel. Nous avons eu notre heure de gloire. Durant un an ou deux, on ne parlait que de nous, mais on nous a aussi vite oubliés. Nous avons eu la carrière des chanteurs de variétés. Un ou deux tubes et puis fini. Sauf que pour écrire une chansonnette il ne faut que quelques heures, mais pour peindre une toile telle que celle-là il faut des mois.
Dominique prit l’air désolé.
— C’est très impressionnant. Je n’ai jamais rien vu de tel.
— Les critiques nous ont tués. Nous n’avions pas de manifeste, la majorité d’entre nous ne se connaissaient pas, nous nous limitions à dresser un constat froid et une représentation mécanique de l’environnement, sans analyse subjective.
Il frappa dans ses mains comme s’il voulait chasser cette pensée de son esprit.
— C’est le passé ! Parlons de René.
— Vous habitiez ensemble ?
— Non, pas à Montreux en tout cas. Il a partagé mon appartement à Vienne pendant très peu de temps. Je me souviens de peu de choses à son sujet. C’était un garçon secret. Il parlait peu, ne se confiait pas facilement. J’ai tenté plusieurs fois de connaître son parcours, mais son récit changeait à chaque fois. Parfois, il semblait ignorer jusqu’à son nom.
Il fit une courte pause.
— De vous à moi, je pense qu’il n’était pas tout à fait normal, mais je l’aimais bien, il était gentil. Nous ne nous voyions qu’une fois ou deux par semaine. Nous buvions des bières et fumions de l’herbe. Je lui parlais de mon art. Parfois, il me parlait de rock ou de littérature, quand il avait beaucoup bu. Un jour, il est parti et je ne l’ai jamais revu.
— Alors, pourquoi votre nom ?
Fink parut embarrassé.
— Avant de s’en aller, il m’a laissé quelque chose.
— Quelque chose ? Quoi ?
— C’est loin tout ça, mais une promesse est une promesse et je tiens toujours les miennes.
— Que voulez-vous dire ?
Fink le fixa sans sourciller.
— Je dois vous poser une question et vous n’avez droit qu’à une seule réponse.
Dominique écarquilla les yeux.
— Bien, dans ce cas, je vous écoute.
— Quel a été le premier rock ?
Dominique s’esclaffa.
— Quoi !? Vous me demandez à moi quel a été le premier rock ? Et je n’ai droit qu’à une réponse ? Je n’en sais rien, moi, quel a été le premier rock !
Fink continuait à le fixer.
Dominique lut dans ses yeux qu’il était sérieux.
Il était désemparé et s’apprêtait à déclarer forfait quand la réponse lui apparut telle une révélation.
— Je crois que je sais.
— Je vous écoute.
— Ce n’est peut-être pas le titre complet, mais je pense que ça commence par Maybe.
Fink sourit.
— Je vous crois. Comme vous, je n’y connais rien en rock, mais je ne pouvais remettre cet objet qu’à cette condition, un mot de passe en quelque sorte. Maybellenne, de Chuck Berry. J’y ai encore pensé récemment, il est passé à la télévision pour annoncer sa nouvelle tournée.
Il se pencha et empoigna le sac à dos. Il le déposa sur ses genoux, l’ouvrit et en sortit plusieurs cahiers d’écolier reliés par une large bande élastique.
— Voilà de quoi il s’agit.
Il les tendit à Dominique.
— Il n’a pas précisé s’il m’autorisait à les lire, mais je suis curieux, je l’ai fait, enfin, j’ai tenté de le faire. Ce qui est écrit là-dedans est très confus.
Dominique ôta l’élastique et ouvrit l’un des cahiers.
Les pages étaient remplies d’une écriture serrée ponctuée de nombreuses ratures. Il feuilleta le cahier. L’écriture changeait à chaque page, elle était une fois rectiligne, une fois penchée à droite ou à gauche et la taille des lettres variait. Sur certains feuillets, seuls quelques mots étaient écrits en lettres géantes. En plus des ratures, les pages étaient chargées de dessins, de chiffres, de schémas ou de mots rajoutés en rouge dans la marge.
Fink soupira.
— Vous voyez, ce n’est pas très clair. En gros, il raconte qu’il a enregistré un disque avec un groupe, à Berlin. Il s’est passé des choses dans le studio. Il essaie d’expliquer quoi. Je n’ai pas compris grand-chose, mais je ne me suis pas vraiment investi dans cette lecture.
Dominique soupesa la pile.
— En tout cas, il avait des choses à dire.
— Si vous voulez mon conseil, ne tenez pas trop compte de ce qu’il raconte. Il n’avait pas toute sa tête, ce ne sont que de grandes élucubrations. Mais faites comme il vous plaira. Ces cahiers sont à vous. Promettez-moi seulement une chose.
— Je vous écoute.
— Si un jour, vous trouvez un sens à tout cela, reprenez contact avec moi.
— C’est promis.
Ils se levèrent et se serrèrent la main.
— Merci de votre aide, Monsieur Fink.
— Vous êtes le bienvenu, je l’avais promis à René.
Fink jeta un coup d’œil au tableau.
— Un jour, j’ai pris une photo de lui sans qu’il ne s’en rende compte. Il ne voulait pas qu’on le photographie. Il était vraiment bizarre, cet homme-là.
Ils se firent un signe de la main et partirent chacun de leur côté.
Dominique se perdit dans les salles et dut demander à l’un des gardiens de lui indiquer la sortie.
Dehors, le soleil était éblouissant.
Au bas des marches, un groupe de gospel chantait en exhortant les passants à les accompagner en frappant dans les mains. Dominique obéit à leur injonction et acheta un de leurs CD à la fin de leur prestation. Il chaussa ensuite ses lunettes de soleil, glissa les cahiers sous son bras et entreprit de descendre la Cinquième Avenue.
Il ne prêta aucune attention aux hommes qui lui emboîtèrent le pas.
Remerciements
Je tiens à confesser qu’il m’arrive de visiter Wikipédia ou de surfer sur Internet pour documenter mes textes. Néanmoins, je reste convaincu qu’une mission de reconnaissance sur les lieux de l’action et l’interpellation de témoins-clés sont d’un apport autrement appréciable.
À ce titre, je tiens à remercier Guy Mazairac, médecin-urgentiste au CHU de Namur, qui a secouru le personnage de cette histoire sur le parvis de la gare et l’a baptisé X Midi. Un grand merci à Benjamin Legros, neurologue à l’hôpital Érasme, qui a prodigué les premiers soins à X Midi. Merci également à Pierre Schepens, médecin psychiatre et chef de service à la clinique de la Forêt de Soignes, qui a accueilli X Midi en son établissement et m’a permis de lui rendre visite. Enfin, ma gratitude à Marianne Parache, neurologue, spécialiste du Locked in syndrom, qui a permis à X Midi de me raconter son histoire.
J’adresse un clin d’œil à Michel, qui nous a quittés trop tôt et qui, d’où il est, se sera peut-être reconnu dans les traits de Dominique.
Pour la période rock’n’roll qui a bercé la jeunesse de X Midi, j’adresse mes félicitations à Marc Ysaye et à toute l’équipe de Classic 21, la radio rock. L’écoute assidue de leur fabuleuse station m’a permis d’agrémenter Back up d’une multitude d’anecdotes issues de l’histoire du rock.
Un grand merci à Lydie et Maxime pour leur relecture rigoureuse et leurs bons conseils.
Enfin, j’aimerais adresser un message personnel à mon éditeur ; Pierre, le message que tu m’as envoyé après la lecture de Back up figure désormais en bonne place dans mon bureau. Je ne dois plus le lire, je le connais par cœur. Merci pour cette cure de jouvence quotidienne.
