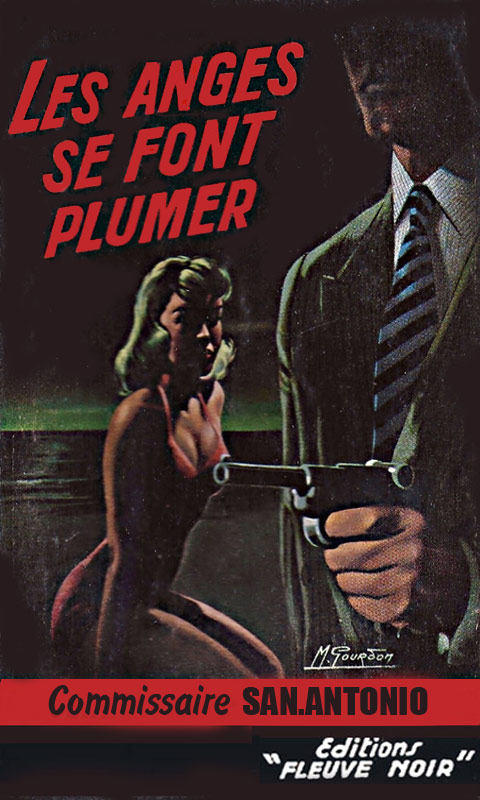
« Une lettre et un chiffre rédigés hâtivement sur un petit bout de papier :
K 2. Ça pouvait vouloir dire beaucoup de choses… Ça pouvait ne rien signifier du tout… Mais moi je ne crois pas qu'on puisse écrire deux signes, comme ça, sans que quelque chose ne se trame quelque part.
K 2 ?
Une marque de détachant ? Il manque le R. Un morceau de jeu de bataille navale ? Pas sérieux… Le nom du deuxième sommet du monde, le Kapa Due ? Pourquoi pas…
K 2 ?
Ça ne vous dit rien, à vous ?
Moi si… aujourd'hui…
Aujourd'hui… que j'ai rassemblé tous les éléments du puzzle. »
San-Antonio
Les anges se font plumer
A mon ami Pierre TOLLET, romancier au cœur pur, avec le mien pourtant…
Les personnages de ce récit…, etc., etc., qu’une coïncidence !
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER
La première chose que je vois en pénétrant dans mon burlingue, c’est un magnifique pot de géraniums posé sur le radiateur du chauffage central.
Ensuite mon regard se porte sur Pinaud, qui, en veston, le chapeau sur le crâne, est occupé à repasser son pantalon. Les pans de sa limace passent sous sa veste et ses calcifs à fleurs sont muselés du bas par des fixe-chaussettes à changement de vitesse.
Abasourdi, je regarde la scène. Mon valeureux équipier se retourne et me jette un bon sourire.
— Je suis venu dans ton bureau à cause de la prise électrique, explique-t-il. C’est le café d’en bas qui m’a prêté le fer…
Ses fesses en goutte d’huile pendent dans le calbar comme un regard d’enfant de Marie. Il s’active avec une certaine noblesse. Le fer fait fumer le pantalon et lui arrache une épouvantable odeur de crasse chaude.
— T’as jamais entendu parler du pressing, Pinuche ?
— J’ai été pris de court, m’explique-t-il. Figure-toi que ma femme m’a téléphoné… Elle avait oublié qu’on allait chez les Larose ce soir… Des gens du monde… Lui, tripier en gros, si tu vois ce que je veux dire ? Comme je n’aurais pas eu le temps d’aller à la maison pour me changer, vu qu’il y a un conseil chez le Vieux en fin de journée…
Il pose le fer à même une pile de dossiers qui en profitent pour roussir.
Je stoppe l’incendie en traitant mon éminent collègue de noms introuvables sur le calendrier des Postes.
Après quoi, je désigne le pot de géraniums.
— C’est à toi, ce massif ?
— Oui, pour la maîtresse de maison.
— Tu lui portes des fleurs en pot, tu ignores donc que ça ne se fait pas ?
— Possible, mais ça dure plus longtemps !
Et avec ça, il a épinglé sa carte après une tige, le gougnafier ! Je la sors de son enveloppe. Pinuche a écrit : « Avec toutes nos amitiés. » Un gars du monde, quoi !
Subrepticement, je la remplace par un rectangle de papier sur lequel j’ai griffonné : « M… pour celui qui le lira. »
C’est de la blague pauvre, d’accord, mais il faut bien rire de temps à autre. Comme ça, la tripière en gros sera joyce en ligotant ce message ! La cote de Pinuche va monter dans les abats !
Le bigophone se met à grelotter. Je décroche. Le standardiste me dit en roulant les « r » (because il est de Perpignan) que le Vieux me réclame d’extrême urgence.
Je fonce donc dans les étages. Le boss m’attend avec impatience car, lorsque je frappe à sa lourde, c’est lui qui ouvre d’un geste nerveux. Chose ahurissante, il porte un costard prince-de-Galles. C’est la première fois que je le vois autrement qu’en bleu marine. Est-ce qu’il serait tombé amoureux, le soleil aidant ?
Je considère sa tronche sans poils, son crâne luisant comme un suppositoire prêt à prendre ses fonctions, son regard bleu acier, ses lèvres minces et je me demande quelle nana pourrait bien avoir envie de jouer aux quatre jambons avec un désastre pareil !
— Ah, vous voilà, San-Antonio, asseyez-vous, j’ai à vous parler.
Je pose donc la partie charnue de ma personne sur le cuir d’une chaise rococo. J’attends. Avec le Vieux, vous le savez, l’attitude idéale pour lui plaire, c’est bouche-cousue-j’écoute.
Il tire sur ses manchettes, s’assure de la bonne fermeture de ses boutons et finit par s’accoter au radiateur éteint du chauffage.
— Mon cher ami, commence-t-il.
Pour qui le connaît, ce préambule annonce des choses tout ce qu’il y a de mimi.
— Mon cher ami, vous n’êtes pas sans avoir entendu parler de l’accident d’aviation de Limetz ?
J’acquiesce. Tu parles ! C’était dans tous les baveux de France et des environs.
Un avion anglais en perdition dans le brouillard s’est abattu voici trois jours près de l’écluse de Limetz, à quelques kilomètres de la Roche-Guyon. Bilan, trente-huit macchabes, pas le moindre survivant, car le zoziau a explosé…
— En essayant d’identifier les victimes, la commission d’enquête a trouvé ceci sur l’un des corps calcinés…
Il va à son burlingue et extirpe d’un tiroir une montre-bracelet en acier. Elle a été noircie par l’incendie. Le verre a pété, le cadran a grillé et il ne reste qu’une espèce de boîte ronde à laquelle adhère un morceau de bracelet de cuir.
Je tourne ce vestige dans mes mains. Le gars qui portait ça au poignet a dû comprendre sa douleur. M’étonnerait qu’il soit un jour capable d’annoncer un carré de valets à la belote !
Seulement, je ne vois pas très bien ou le Chef veut en venir avec cette tocante amochée. Apparemment, ce fut une breloque tout ce qu’il y a de normal… Franchement, le mystère me dépasse.
— Je ne vois pas, Chef…
— Ouvrez…
Je n’ai pas à forcer le boîtier, car le choc lui a collé un fameux jeu. J’ouvre et j’aperçois, fixée contre la paroi interne du boîtier, une petite plaque métallique d’un diamètre légèrement inférieur.
Des caractères minuscules sont gravés dedans avec la pointe d’un poinçon ou d’un couteau acéré.
Je bigle d’un peu près et j’arrive à déchiffrer ce curieux message :
« AAl to K2 28-7-61. »
J’écris les caractères sur une feuille de papier à cigarette afin de pouvoir le considérer tout à mon aise. Le Vieux me guette de son œil en forme de tire-bouchon à pédale.
— Ça vous dit quelque chose, San-Antonio ?
Je gamberge un bout de temps, histoire de ne pas lui déballer des gognandises, comme dirait mon oncle Gustave qui est lyonnais.
Le Vieux ne tolère pas les erreurs d’aiguillage. C’est un vicelard de la précision ; un superman du papier quadrillé ; un délirant du métronome ; un tourmenté du zéro absolu !
— AA1, patron, n’est-ce pas l’appellation… heu, télégraphique si je puis dire, de cette bande internationale spécialisée dans le trafic d’armes ?
— Exact…
Je regarde la suite.
— To est une préposition anglaise signifiant « à »… K2, par exemple, ne me dit rien… Enfin, 28-7-61 est, je pense, la date du 28 juillet ? Il n’y a aucun effort de dissimulation là-dedans…
Le vieux s’approche de son calendrier. Au milieu, il y a un énorme éphéméride. Il marque la date d’aujourd’hui, naturliche. C’est-à-dire le 26 juillet… L’homme à la casquette en peau de fesse soulève délicatement deux pages sans les arracher et regarde le chiffre 28 comme s’il pouvait y lire des présages…
— 28 juillet, murmure-t-il. Oui, ce doit être cela…
— Reste à traduire K2, fais-je, manière de me manifester…
Il se retourne, les paluches au fion.
— C’est fait, soupire-t-il.
Je le défrime pour vérifier qu’il ne me balance pas une vanne, mais non. Son visage reste impavide.
— Vraiment, Patron ?
— Oui. Avant d’arriver à cette traduction, laissez-moi vous dire que le passager carbonisé sur qui cette montre a été découverte vient d’être identifié, il s’agit d’un certain Ali Kazar, agitateur arabe réputé. De toute évidence, ce monsieur s’apprêtait à rencontrer les gens de AAl pour négocier avec eux l’achat d’armes destinées aux rebelles d’Afrique du Nord… ou d’ailleurs !
Tout cela me paraît cousu avec du gros cordonnet.
J’ai envie d’insister pour connaître la suite car le Vieux, en orateur consommé, prend des temps, calcule des effets et cherche des poses avantageuses pour mettre en relief sa compétence.
— L’avion anglais assurait le service Londres-Rome via Florence…
— Ah ?
— Oui. Kazar avait pris un billet pour cette dernière ville…
— Il devait donc rencontrer AA1 en Toscane ?
— C’est ce que j’ai conclu, dit le Vieux. J’ai envoyé quelqu’un au C.I.T., vous savez ce que c’est ?
— L’Office italien de tourisme ?
— Oui.
Chose curieuse, il paraît déçu, notre mironton. Ce type-là croit toujours qu’il vous apprend quelque chose dès qu’il ouvre le clapoir. Son rêve, ce serait d’enseigner l’alphabet à ses subordonnés.
— Vous pensiez, Chef, que cet Office pouvait vous être de quelque utilité en la conjoncture ?
Tiens, v’là que je me mets à employer le style redondant du Vieux.
— Oui, acquiesce-t-il. Et j’avais raison de penser cela…
— Vraiment ?
— Oui. Nous avons appris que K2 n’est autre que l’enseigne d’un hôtel situé à Cervia, sur la côte Adriatique, entre Ravenne et Rimini…
— Drôle d’enseigne pour un hôtel…
— K2 est le nom du deuxième sommet de l’Himalaya, autrement nommé Dapsang. C’est d’ailleurs une cordée italienne qui l’a vaincu. Donc Kazar devait être mandaté par son organisation pour négocier un achat d’armes avec AAL. Maintenant qu’il est mort, ses amis vont adresser quelqu’un d’autre au rendez-vous…
— C’est probable…
— J’aimerais que vous assistiez à ces négociations…
Il cesse enfin de tourniquer autour de mon siège et consent à déposer sur le sien la partie de son académie réservée à cet usage.
Je hoche la tête.
— Je dois partir immédiatement, débarquer à l’hôtel K2 et observer les autres pensionnaires. En admettant que j’arrive à dénicher les envoyés des deux groupes, que devrai-je faire ?…
Il avance ses mains racées sur le cuir de son sous-main, comme s’il voulait les mettre dans une vitrine. Ses manchettes sont impeccables. Leur blancheur Persil me meurtrit la rétine.
— Lorsque vous les aurez identifiés, dit-il en appuyant sur ce futur chargé de pulvériser mon conditionnel, vous suivrez la piste.
— Laquelle des deux ?
— Les deux, puisqu’elles se rejoignent. Vous découvrirez le dépôt d’armes et, s’il n’est pas récupérable pour nous, vous le ferez sauter…
Il parle d’un ton tranquille, exactement comme s’il était en train de s’acheter une paire de lattes chez le bottier du coin. Vous le voyez, ce qu’il attend de moi est d’une simplicité enfantine.
M’est avis qu’il a trop lu les albums de Tintin, le Vieux, ça lui fausse un peu le sens des réalités. Il a le cervelet qui fait « Tilt » comme un billard électrique. Pourtant, sachant qu’il est inutile et malvenu de la ramener, je me soude les labiales à l’autogène.
— Vous m’avez bien entendu ?
— Admirablement, Patron.
Comme si j’avais les feuilles constipées, à mon âge !
— Parfait. Maintenant il y a certains points de détail que nous devons régler… Madame votre mère est-elle à Paris en ce moment ?
J’en suis complètement jojo ! Le voilà qui s’inquiète de la santé de Moman, le croquemitaine.
— Mais… oui…
— Elle se porte bien ?
— Très bien, merci.
— Un voyage en Italie lui plairait-il ?
Du coup, j’ai l’impression d’avoir pris place sur une fourmilière. Ça se met à grouiller dans mon calbar comme la station Chaussée d’Antin à midi dix !
— Vous voudriez que j’emmène ma mère avec moi ? articulé-je d’une voix pareille aux premiers exercices vocaux d’un sourd-muet de naissance.
— Oui, et vous allez comprendre pourquoi, San-Antonio.
Comme je ne demande que ça : piger, je m’aiguise les trompes d’Eustache et je pose sur le Vieux un regard qui ressemble à deux points d’interrogation majuscules !
— D’après mes renseignements, Cervia est une station balnéaire fréquentée presque exclusivement par les Italiens, contrairement aux autres coins d’Italie, littéralement envahis par les touristes. Si vous alliez là-bas, vous attireriez immanquablement l’attention, car il y aurait de fortes chances pour que vous fussiez l’unique Français… Comprenez-vous ?
Cette fois, j’ai la coupole qui s’illumine.
— Compris. Avec une vieille dame, j’aurai l’air du grand garçon en vacances avec sa brave maman ?
— Voilà !
Avouez, les gars, que la situation ne manque pas de sel, comme dit mon ami Cérébos, maintenant les agents secrets sont présentés par leurs parents, comme les apprentis bouchers !
— Pensez-vous que madame votre mère accepte ?
— C’est mal connaître madame ma dabuche ! Félicie, vous le savez, ne demande qu’à lever la pioche avec moi. Et comment qu’elle va accepter !
— En ce cas, allez chez vous et préparez hâtivement vos bagages, vous prendrez l’avion de nuit. Deux chambres seront retenues à l’hôtel Rafael à Florence… Demain matin, vous trouverez une auto devant l’hôtel… Ce sera une DS immatriculée en Seine-et-Oise. Les papiers de cette voiture se trouveront sous le siège arrière… Vous prendrez immédiatement la route de Cervia…
Il ouvre un tiroir de son burlingue et prend une carte routière de l’Italie.
— Je vous ai marqué le chemin à suivre au crayon bleu. Là-bas, descendez à l’hôtel K2, deux chambres seront également retenues à votre nom…
Il a vachement préparé son coup, le Vieux. Lorsqu’il sera à la retraite, il pourra monter un office de tourisme, ça boomera. Pour les croisières organisées, il en connaît un brin.
Je me lève.
— Eh bien, il ne me reste plus qu’à…
— Un instant…
Il n’a pas refermé son tiroir. Il en sort, comme un prestidigitateur sort de son chapeau les objets les plus idiots, un stylo d’assez forte dimension…
— Prenez ça !
— Qué zaco ?
— Vous le voyez : un stylographe… Enfin, en apparence. Seulement, dans le corps de remplissage se trouve un explosif d’une extrême puissance. Avec ce simple objet, vous pouvez faire sauter l’immeuble…
— Fichtre ! Et vous voulez que je me promène avec ça ?
— Il est inoffensif tant que vous ne le « préparez » pas…
N’empêche que je considère ce Waterman avec une certaine inquiétude. Vive la pointe Bic, les gnards !
— Et comment le prépare-t-on ?
— C’est simple, regardez…
Il saisit la plume et l’ôte. Puis il dévisse l’autre extrémité du stylo.
— Il vous suffit d’introduire la plume à l’intérieur du réservoir. Vous revissez et déposez le stylographe sur les lieux où doit se produire l’explosion… Celle-ci intervient cinq minutes plus tard très exactement… N’oubliez pas…
J’en bave de stupeur.
— C’est formidable !
— Non, ingénieux. La plume comporte une particule de radium qui agit sur l’explosif au bout du laps de temps que je viens de vous indiquer…
Je m’empare du stylo dont il a remis la plume en place.
— Hé, dites, Chef, les effets de la plume ne peuvent-ils pas se faire sentir à la longue, sans qu’on ait à l’introduire dans le réservoir ?
— Du tout ! Le capuchon du stylo est pourvu d’une pellicule de plomb. Soyez sans inquiétude…
— Bon.
Je glisse le stylo dans ma poche en faisant des vœux très sincères pour qu’il ne débloque pas. Si jamais l’aimable fabricant qui a mis cette invention au point s’est gouré d’un quart de poil, on retrouvera le bon San-Antonio dans les hautes branches d’un platane.
— Vous avez bien compris, San-Antonio ?
— Tout, Chef, l’avion de Florence ce soir… L’hôtel Rafael… La DS 21 immatriculée 78 demain… Les papiers sous la banquette… L’hôtel K2 à Cervia… J’ouvre 1’œil… Je démasque les trafiquants… Je remonte jusqu’au dépôt d’armes… Et enfin je fais sauter celui-ci… Tout est O.K.
Il me tend la main.
— Eh bien… Bonnes vacances !
Vous parlez d’un culot !
En déguerpissant du burlingue directorial, je croise Bérurier qui amène un prévenu à coups de pompes dans les noix.
— Salut, San-A, me dit-il en lâchant son souffre-douleur. Je te vois pour une belote ce soir ?
— Non, mon gros… Et tu peux te chercher un autre partenaire parce que tu ne me verras pas de sitôt…
— Tu prends tes vacances ?
— Tout juste !
— Et où que tu vas ?
— Au pays du macaroni en branche… La côte Adriatique, mon cher, pas moins… Paraît qu’avec de bonnes jumelles on aperçoit Tito d’une rive à l’autre par temps clair…
Il hausse les épaules.
— Moi, Tito, je m’en fous… Ce qui m’intéresse, c’est les jolies pépées avec leurs petits maillots de bain à moustaches.
Il se marre. Un sourire servile flotte sur la frime défraîchie du prévenu. Bérurier, qui s’en avise, lui flanque une mandale de trois kilos, histoire de lui rappeler les convenances.
— Amuse-toi bien, me dit-il en me serrant la louche.
— Je tâcherai…
CHAPITRE II
Félicie est en train de cueillir des fleurs lorsque je m’annonce à la porte de notre jardinet.
Elle a un sourire radieux.
— Déjà toi, mon grand ?
— Oui, m’man, je viens te chercher…
— Me chercher ?
— Nous partons en Italie.
Elle croit que je lui balance des vannes, mais elle s’aperçoit que je parle sérieusement et une sorte d’inquiétude transparaît sur sa bonne figure.
— Comment ça, en Italie ?
— Oh, c’est bien simple : un de mes collègues de la Grande Taule devait filer ce soir en vacances avec sa femme… Son hôtel est retenu, tout était archiprêt… Et puis il lui tombe un turbin sur le crâne. Comme je devais prendre mes vacances le mois prochain, on s’est arrangé avec le Vieux et je pars à sa place, tu saisis ?
L’explication lui suffit. Du reste, ce qu’elle voit dans tout ça, c’est que son petit San-Antonio d’amour va l’emmener en voyage ! Y a pas plus brave mère que cette mère-là !
Frénésie ! Valoches hâtivement faites… Cavalcade chez le voisin d’à côté pour lui confier les plantes vertes et lui demander d’arroser un peu le potager… Ruée à la poste pour leur dire de nous conserver le courrier jusqu’à nouvel ordre… Gare des Invalides où un planton de la Grande Taule m’attend avec les billets et les devises…
C’est la première fois que Félicie prend l’avion.
— Tu crois que je vais supporter ça, Antoine ?
— T’as peur, m’man ?
— Penses-tu, avec toi, que veux-tu qu’il m’arrive ?
Je lui achète un tube de bonbons à la menthe. Ensuite, c’est la grande envolée…
— Je vais voir l’Italie, murmure Félicie toutes les cinq secondes.
Pour la voir, elle va la voir ! Et comment !
Je ne vous bonnis rien sur le voyage sans incident, l’arrivée à l’hôtel Rafael, les exclamations de ma brave femme de mère qui n’était jamais descendue dans un palace et sur notre route jusqu’à Cervia. La bagnole promise par le Boss se trouvait effectivement devant l’hôtel et sous le siège arrière, outre les papiers de l’auto se trouvait aussi un P 38 flambant neuf avec deux chargeurs de rabe… De la jolie mécanique de précision, parole ! On se sent nettement moins seulâbre avec un tel compagnon de voyage.
Il est un peu plus d’une heure de l’après-midi lorsque je débarque à Cervia. Cette situation-là ne ressemble pas aux autres. Je cherche pourquoi et je finis par trouver : la végétation de l’Adriatique n’a rien de commun avec celle de la Méditerranée. Ici, pas de palmiers, mais des platanes… Les hôtels ressemblent à des propriétés privées. Ils s’élèvent comme des pavillons dans une luxueuse banlieue. Seule concession : le Casino. Il se dresse au bout de l’avenue, morne et blanchâtre, très Utrillo. Derrière, il y a la mer, la plage, de la viande…
Je trouve sans difficulté le K2. C’est une magnifique construction moderne, blanche, avec des stores jaunes, des parasols multicolores, et un perron bordé de pots de fleurs.
— C’est ravissant ! déclare Félicie.
Je m’annonce dans un joli hall à carreaux verts et blancs dont les larges baies comportent des tentures de velours vertes. Les meubles font Primavera en diable. Les fauteuils ressemblent à des soucoupes volantes…
Je m’annonce à la caisse où une dame à cheveux blancs, l’air digne, demande avec une insistance polie un numéro de téléphone qu’elle n’arrive pas à obtenir.
Je lui dis qui je suis, d’où je viens et la suite. Mais elle me répond par une phrase désarmante :
— No parla francese !
« Ça démarre bien, me dis-je, en français et en aparté. » Comme j’ai l’air embêté, la digne personne, après avoir dit : « Momente ! » à la gonzesse de la poste, met sa main sur sa passoire à mensonges.
— Martha ! appelle-t-elle.
Se lève alors d’un fauteuil éloigné une étrange créature. C’est une grande fille pâle et blonde sans le moindre brin de fard. Elle est fringuée d’une robe verte, très quelconque et porte des espadrilles vertes. Il se dégage de sa personne je ne sais quoi de malsain, malgré sa physionomie souriante.
La vioque de la caisse me confie à elle.
— Vous êtes français ? me dit-elle. C’est pour vous les deux chambres retenues hier matin par téléphone ?
— Oui.
Elle me jette un regard tout bleu afin de prendre mes mesures. Ecoutez, bande de tartes à la crème fouettée, j’ai vu déjà bien des nanas voraces, mais jamais encore des comme celle-ci. Elle est à poil sous sa robe, la chérie… Et ses yeux vous disent gentiment : « Où est-ce qu’on se met ? » Elle doit aimer les malabars de mon gabarit.
Comme elle s’exprime sans l’ombre d’un accent, je questionne à mon tour :
— Française aussi ?
— Non, allemande !
Vlan ! Du coup, je dégode un peu.
— Vous parlez pourtant un français sans bavure…
— J’ai fait mes études à Paris…
— Vous êtes en vacances ici ?
— Non, j’y habite… Ma sœur a épousé le fils du patron.
Je lui file un coup de saveur encourageant qui lui va droit à la cible.
— Si vous avez besoin de cours du soir, pour parfaire votre syntaxe, faites-moi signe !
Elle a un sourire un peu énigmatique. Moi je freine sur le baratin car Félicie qui poireaute dans la bagnole me lance des regards de détresse.
— On peut descendre nos valises et nous conduire à nos chambres ?
— Naturellement.
Elle appelle :
— Gigi !
Un garçon en veste blanche, brun comme tout l’anthracite de la Ruhr, s’avance, souriant. La blonde allemande lui explique le pourquoi du comment du chose et il se précipite vers ma calèche.
Quatre minutes plus tard, nous pénétrons dans nos chambres. Cet hôtel est absolument charmant. Il y a des divans modernes, avec des tablettes de couleur… Une salle de bains époustouflante avec bidet carrossé par Ferrari, changement de vitesse automatique, freins à tambour et injection directe, comme la Mercedes 300 SL ! Des couleurs vives, une propreté qui ravit Félicie… Du soleil à faire bronzer un cachet d’aspirine ! Je me sens du bonheur dans le tiroir de la cravate.
Nous faisons un brin de toilette, ma dabuche et moi, et nous descendons dans la salle à grailler où une trentaine de pensionnaires sont en train de tortorer du spaghetti. Du haut de l’escadrin surplombant la salle, je les bigle presto. Parmi eux se trouve l’envoyé des AAl brothers… C’est fatal, le grand rencart étant pour domani !
J’ai l’œil en flash. Pif-paf-pouf, j’ai une vue générale des gars…
Je m’assieds avec Félicie à un petite table au fond de la pièce. Bath position stratégique, les gars ! D’ici, je peux voir tout le populo.
Près de nous, il y a une famille de Suisses-allemands qui bâfre en silence : papa-maman-la nurse et deux chiares en culotte de peau ! A écarter, de prime abord. A moins que chez AAl on utilise comme chez nous sa famille comme paravent. Ensuite, une autre famille, ritale cette fois : lui, un gros-lard avec un costar blanc à déconstiper les mouches ! Elle, une mégère apprivoisée avec des nichemards croulants et une moustache gauloise. Plus trois bambinos. Une fille aînée que la puberté travaille à mort ; un garçon qui s’appelle Bruno, prénom que sa daronne clame à tous les échos. Et puis le classique petit dernier qui pour l’instant se remplit de spaghetti.
Gigi, le serveur au sourire envoûtant, se penche sur nous, stoppant ma contemplation. Il nous raconte le menu d’une voix gourmande.
Nous choisissons des concombres farcis, des nouilles vertes et une côte de bélier. Le tout arrosé d’un chianti garanti de first quality !
Lorsqu’il a décanillé, alors que Félicie examine les lieux, comme un gosse regarde la vitrine d’un bazar, je poursuis mon inventaire.
J’avise une autre table avec deux petits vieux, genre fonctionnaires en retraite. Ils ont des manières honnêtes, des gestes lents, et des fringues soigneusement entretenues… Ça m’étonnerait que ces bonnes gens soient acoquinés avec une bande de trafiquants d’armes.
Je les quitte pour passer à une autre tablée où l’on mène grand tapage… Des gens pleins aux as. Je parierais le dôme des Invalides contre une paire de fixe-chaussettes d’occasion que l’Alfa-Roméo qu’on aperçoit dans le jardin leur appartient. Encore une fois c’est une famille complète, lui en costar clair, madame en robe imprimée éclatante, les mouflets avec des boutons sur la frite, et une espèce de vioque gouvernante à l’air vachard qui s’efforce de sourire lorsque son patron lance un mot d’esprit. Elle s’occupe particulièrement du petit dernier. Ce gosse-là n’a pas douze piges, mais il doit peser dans les quatre-vingts kilos. Il tortore à même l’assiette. On dirait le fils préféré du bonhomme Michelin. On a envie de chercher la valve… Le chef de famille est un beau brun assez racé… S’il était seulâbre, mes soupçons se porteraient sur lui. Mais, toujours la même chose : j’imagine mal un chef de bande venant traiter une affaire avec ses lardons, sa bergère et la bonne.
C’est à peu près tout. Il y a encore, à l’autre bout de la salle, un couple d’amoureux qui se serrent la louche sans arrêt avec un air de se promettre mutuellement une partie corsée de zizi-panpan pour un avenir très imminent.
Puis, tout près de la fenêtre du fond, il y a une jeune femme radieuse avec sa petite fille… Voilà… Je vous ai décrit le populo, excusez le mec s’il y a des longueurs, fallait que je vous numérote les artistes avant de vous jouer la pièce. Un générique se place toujours avant le film. Y a des tordus de metteurs en scène qui le mettent après (pour rester seul devant, seulement personne ne le lit).
— A quoi penses-tu ? s’inquiète Félicie.
Je reviens à moi et, par la même occase, à elle.
— Pardon, m’man… Je flottais dans la béatitude…
— Ça va refroidir…
Elle a raison. J’attaque ma porcif d’une fourchette allègre tandis que le gars Gigi me verse un glass de chianti. J’aime le chianti. C’est un picrate intelligent. Léger comme une chanson napolitaine et gentiment grisant, comme elle.
Après le repas, nous prenons le chemin de la mer. En Italie, les plages sont découpées en tranches[2].
Chaque hôtel a droit à un morceau. Il a ses transatlantiques, ses parasols, ses cabines, ses flacons d’ambre solaire, ses pédalos… Les pensionnaires ont automatiquement droit à un fauteuil de toile qui se situe par ordre d’arrivée plus ou moins près de la mer.
Un type en maillot rayé, coiffé d’une casquette sommée d’une ancre marine, nous guide au troisième rang d’orchestre. M’man et moi nous nous asseyons et nous faisons ce que font tous les gens dans notre cas, c’est-à-dire : rien !
Le soleil qui met toute la gomme… La mer qu’on voit danser… Et puis le ciel bleu, infini… C’est bon, ça réchauffe l’intérieur. On n’a pas envie de remuer la moindre phalange.
— L’Adriatique est verte, fais-je remarquer à Félicie.
Elle a un hochement de menton, puis elle se met à en écraser, tout doucettement, vaincue par la fatigue du voyage, par la matraque du soleil et par la paix Constrictor de la digestion.
A ces heures, il y a encore peu de trèpe, dans le circus… Les gars de par là vont faire la sieste… En Italie, ce beau pays, les gens sont obligés de remonter la sonnerie de leur Jaz pour stopper leur sieste. Et quand leur sieste est finie, il est l’heure d’aller se pieuter pour de bon.
Peu à peu, le populo se radine… C’est le même carnaval en maillot de bain. Des gosses qui courent dans l’eau en faisant gicler de l’écume… Des messieurs avec un bureau poilu… Des dames avec des bikinis à moustaches dont parlait Bérurier… Des tarderies, mahousses, croulantes, flasques… Des jeunes gens qui jouent les Apollon du Belvédère avec une petite médaille pieuse sur leur peau bronzée…
C’est dans ces cas-là que je désespère le plus des hommes. Il sont là, presque nus, sur le sable chaud qui sert à parfumer les légionnaires…
Etalés comme de la viande morte, avec leurs ventres, aérophagiques, aérodynamiques, majestueux, gonflés… Avec leurs varices, leurs seins qui, comme les feuilles mortes, peuvent se ramasser à la pelle… Avec leurs désirs assoupis, avec leurs combines en veilleuse… Contents de vivre et de se faire cuire le lard au soleil… Fiers de s’entre-exhiber leur sale bidoche contemporaine ; ne se doutant pas, les pauvres lapins, qu’ils sont aussi fugaces que les constructions de sable exécutées par les gamins… Le soleil, la mer, l’immobilité leur font croire à leur éternité…
Je ferme les carreaux pour les oublier un peu… Il y a des moments où ils me gênent… Des moments où je me gêne moi-même comme si j’étais placé en travers de mon passage…
Un long moment de flottement amer s’écoule. Et puis le miracle se produit. Je me mets à gamberger à mon turbin. Je ne suis pas ici pour philosopher…
Pour la première fois depuis la veille, je prends le temps de penser sérieusement à ma mission. Jusque-là, j’ai vécu dans une sorte de tourbillon. Maintenant, le calme se fait… J’essaie d’y voir clair. Les pensionnaires du K2 sont tous là…
Je les examine soigneusement à travers mes lunettes de soleil. Mais cette nouvelle revue ne m’apporte rien d’intéressant. Ils paraissent tous plus innocents les uns que les autres. J’en viens à me dire deux choses déprimantes : primo, peut-être le Boss s’est-il carré le médius dans l’orbite en traduisant le message gravé dans la montre par un rancart à cet hôtel… Il se pourrait fort bien que cette enseigne curieuse ait égaré les recherches. Deuxio, même si un rancart était prévu à Cervia, depuis l’accident d’aviation dans lequel Kazar a trouvé la mort, les deux clans qui devaient se contacter ont fort bien pu changer leurs batteries. Il faut aviser d’urgence… J’ai bougrement envie d’interviewer Martha, la petite Allemande pâlichonne, sur les pensionnaires… Leurs fafs m’en apprendraient peut-être plus long que leur figure, non ?
Doucement, je touche le bras de Félicie, ce qui l’éveille en sursaut.
— Excuse-moi, m’man. J’ai envie d’aller me dégourdir un peu les jambes… Pendant que tu fais la sieste, je vais musarder un peu dans le patelin, attends-moi là…
Elle pige beaucoup de choses, Félicie. Et toujours la discrétion personnifiée.
— Va, mon grand…
Je me lève et quitte la plage en répondant aux saluts courtois que m’adressent les autres habitants du K2.
Les deux petits vieux gisent comme des charognes d’animaux sous un parasol… La dame a une revue sur le visage et elle ronfle comme un feu de cheminée. Lui s’est mis les mains sur le bide, un bada en paille sur le front… Il me regarde passer d’un œil aimable. Ensuite c’est le couple d’amoureux serrés l’un contre l’autre, comme s’ils avaient froid. Ce sont eux qui sont arrivés les derniers, probable qu’ils sont allés vérifier si le sommier de leur pageot tenait le coup. Lui me sourit depuis son bonheur… Elle ne me voit même pas passer…
Tout ce petit monde est venu là pour occuper deux mètres carrés de sable étincelant.
Je secoue mes chaussures d’été pour en expulser le sable, je contourne le casino gris et m’engage dans l’avenue plantée d’arbres qui conduit à notre hôtel.
Le K2 est désert… La vieille dame aux crins blancs fait ses comptes derrière la caisse. Martha est dans la seconde partie du hall, lovée dans un fauteuil. Elle regarde la télévision qui transmet un documentaire essentiel sur « La fabrication des cannes à pêche en fibre de verre ». Ça ne la passionne pas, mais je sens qu’elle se complaît dans la pénombre. La lumière laiteuse de l’écran de télé éclaire faiblement son visage. Je pige maintenant ce qui lui donne un aspect malsain ; elle n’est pas bronzée. Elle a même la peau extrêmement blanche et ce, en plein été, dans une station balnéaire…
Je m’approche d’elle et prends place dans le fauteuil voisin.
Elle me coule un regard qui ferait fondre un bonhomme de neige.
— C’est intéressant ? fais-je en montrant le poste.
Sa moue est éloquente. J’approche mon fauteuil du sien.
— Je ne vous dérange pas ?
— Absolument pas.
— Vous n’allez pas sur la plage ?
— Non.
— Jamais ?
— Jamais.
— Pourquoi, vous n’aimez pas vous baigner ?
Il se dégage d’elle une odeur de femme qui me chavire un peu. Elle a des seins qui bougent sous la robe… Ses cheveux sont collés à ses tempes par la sueur. Pourtant, il ne fait pas particulièrement chaud dans ce hall obscur…
— Non, répond-elle au bout d’un instant. J’ai horreur de l’eau, de la foule et du soleil. J’ai horreur de l’Italie. J’ai horreur d’un tas d’autres choses encore…
Drôle de fille décidément.
Je lui file mon regard 34bis à la Rudolf Valentino, celui que j’utilise dans les cas d’urgence.
— Puis-je vous poser une question ?
— Oui.
— Me comprenez-vous dans ce tas d’autres choses qui vous font horreur ?
Ma question la fait sourire. Ses grands yeux bleus, un peu fiévreux, s’ouvrent en grand.
— Sûrement non !
— Merci…
Décidément, j’ai eu beau nez de radiner ma fraise à ce moment de creux. L’hôtel est presque vide. Les garçons, le ventre ceint d’un tablier, balaient la salle à manger en chantant un truc à la mode, sur Rome. Nous sommes bien. Le speaker de la télé vide son bla-bla à toute vibure comme s’il craignait de rater l’autobus.
— Il y a longtemps que vous habitez ici ?
— Trop…
— C’est-à-dire ?
— Deux ans !
— Vous vous ennuyez ?
— A mourir. Du reste, je crois bien que je suis un peu morte.
Elle hausse les épaules.
— Quand je pense qu’il y a des gens qui viennent passer plusieurs semaines ici et qui font semblant de s’y amuser…
— L’hôtel ne travaille qu’avec des pensionnaires, il n’y a pas de clients isolés ?
— Oh si, suivant les disponibilités…
— Et en ce moment, c’est complet ?
— Presque…
— Je suis le dernier arrivant, en somme ?
— Pour le moment, oui !
J’essaie de ne pas lui donner l’éveil par des questions trop nombreuses et trop poussées, mais je ne puis me retenir longtemps.
— Vous attendez encore du monde ?
— Non, je ne pense pas…
— J’avais un ami qui devait venir, et puis il a eu un empêchement…
Elle fronce le sourcil.
— Monsieur Kazar ?
J’en ai la glotte qui se bloque. Chapeau pour le Vieux ! C’est un zig qui sait où il met ses pinces !
Moi qui prends des chemins détournés pour essayer de me farcir un détail intéressant, et voilà cette poupée blonde qui me colle le pif en plein dans la tarte.
— Oui, c’est cela, Kazar…
— Pour un empêchement, c’en est un, dit-elle. J’ai lu dans les journaux… C’était votre ami ?
— Oh, une relation d’affaires… Comment diantre avez-vous pensé à Kazar lorsque je vous ai parlé d’un ami qui devait venir ?
Elle hausse les épaules.
— Parce que la lettre par laquelle il avait retenu une chambre était écrite en français…
— Depuis Londres, n’est-ce pas ?
— Oui.
— Pauvre vieux Kazar, fais-je du ton pénétré d’un homme « qui se remet difficilement d’un chagrin »… Alors sa chambre est disponible ?
— C’est vous qui l’occupez.
Ça me fait un drôle d’effet.
— Curieux, le hasard, hein ?
— Oui.
Depuis un moment, elle me dévisage avec un intérêt accru. Sa main pendante est prise d’un frémissement. Je sens ses doigts effleurer les miens. M’est avis que la Martha doit être vaguement hystéro sur les bords.
Je lui cramponne la paluche, manière de me rendre compte si elle va m’envoyer chez Plumeau. Pas du tout ! Elle se cambre dans son fauteuil et sa respiration se fait plus haletante. Si j’arrête pas les frais illico, il va y avoir représentation de gala avec champagne facultatif.
— J’aimerais vous parler un peu de la France, fais-je… On ne pourrait pas se voir, ce soir…
Elle met un temps à répondre, d’une voix vicieuse :
— Où ?
J’hésite. Ma chambre est contiguë à celle de Félicie. Comme Martha, si j’en crois mon expérience, est sûrement du genre bruyant, vaut mieux trouver un terrain plus discret pour cette rencontre internationale.
— Que diriez-vous de votre chambre ?
Ça la cloue un brin. Elle s’attendait à la balade au clair de lune.
— Comme vous y allez !
Je souris.
— Rien ne vaut quatre murs pour abriter une conversation à bâtons rompus…
— A quoi ?
— Bâtons rompus… Vieille expression française, je vous en apprendrai d’autres… Alors, d’accord ?
Les femmes, qu’elles soient allemandes, musulmanes ou tuberculeuses, possèdent toutes l’art d’éluder les réponses trop directes.
— Ma chambre est au deuxième… Tout au fond du couloir… Numéro 28.
— J’y serai à minuit…
— C’est un peu trop tôt.
— Alors à une heure… D’accord ?
Elle détourne la tête et ses longs cheveux blonds forment soudain comme un rideau d’or entre nous ! Mince, me voilà en pleine littérature ! Si je ne me surveille pas, je vais finir par écrire en bon français !
Le documentaire sur les cannes à pêches s’achève, et le speaker rengracie avec « La vie des mollusques de Lucrèce Borgia à nos jours ». La télé italoche me paraît presque aussi passionnante que la télé française.
— Voyez-vous, fais-je, pour changer de disque, ce qui me plaît ici, c’est que je suis parmi les estivants italiens… Au moins, j’ai le folklore. Rien n’est plus casse-bonbon que de se trouver dans un hôtel étranger avec tous les congés payés de France. Vous ne savez pas ce que ça peut être pénible. Chez nous, on se lave les pieds deux fois par an, mais en hôtel on casse la cabane si le robinet d’eau chaude de la douche est bloqué !
Elle éclate de rire.
— C’est vrai, fait-elle, les Français sont sales !
Il n’en faut pas plus pour me foutre en renaud. Vous savez, le côté Cyrano de mon personnage se met en court-circuit. « Je me les sers moi-même avec assez de verve ; mais je ne permets pas qu’un autre me les serve. » Miss Choucroute qui ose renchérir…
— Notez, riposté-je d’un ton cassant, que si on ne se fait pas de shampooing, on a du moins quelque chose dans le crâne…
Mais autant faire de l’esprit avec une douzaine de fines belons. Aucune réaction. Cette nana, elle assimile peut-être Nietzsche, mais je vous le dis, Jean Rigaux ferait un gros bide avec elle. Pour la gamberge ésotérique, on les trouve partants, les gars d’Outre-Rhin ; mais pour le trait d’esprit, ils ne reçoivent qu’une fois par semaine et sur rendez-vous !
Je me lève.
— A ce soir, ravissante déesse de l’ombre.
Elle a un regard chargé de langueur.
— Vous partez ?
— Oui, ma bonne vieille maman doit commencer à s’inquiéter. Il faut se donner du mal pour élever ses parents !
Je vais retrouver la lumière, la plage, les gigots en maillots !
CHAPITRE III
Lorsque nous gagnons nos turnes, Félicie et moi, après avoir regardé un match de boxe à la télé italoche, match au cours duquel Durand, le champion d’Italie a battu Gondolfï, l’espoir français, il n’est pas loin de minuit. Cette journée de voyage et de grand air nous a vannés. J’embrasse m’man et je m’enferme dans ma carrée.
Je commence à me déloquer et à prendre une bonne douche, ensuite je passe mon pyjama de cérémonie : bleu ciel à parements blancs. La tenue de choc pour visites nocturnes. Là-dedans j’ai l’air d’un prince charmant en exil (en toute modestie).
Il ne me reste plus qu’à attendre une plombe. Pour tromper le temps, je ligote un vieux numéro du Corriere della sera. Je découvre de grosses analogies entre le français et l’italien. Pourtant, lorsqu’on jacte rital devant mézigue je n’y entrave que pouic !
Quand le moment des effusions est arrivé, je prends le chemin du septième ciel, c’est-à-dire celui de la chambre 28.
L’hôtel est silencieux et je glisse dans les couloirs tel un fantôme.
J’ai pris la précaution de repérer la cambuse de jour. Aussi m’y dirigé-je sans hésiter. Parvenu devant la porte, je frappe discrètement. La môme Martha devait m’attendre, car elle délourde instantanément.
Vision paradisiaque, les Mecs !
Elle a un déshabillé vaporeux, presque transparent, décolleté jusqu’aux genoux et ses longs cheveux pâles ruissellent sur ses épaules.
Elle ne dit rien et recule jusqu’à son page où elle s’assied. Je ferme la porte, donne un tour de clé et m’approche, très inspiré.
Elle est légère, translucide. J’ai l’impression qu’un coup de vent l’anéantirait.
J’y vais du rapprochement franco-allemand. On devrait me verser dans le corps diplomatique un de ces quatre ! On m’attacherait particulièrement aux accords culturels avec les ambassadrices et je vous parie une balle de tennis contre douze balles dans la peau que le prestige de notre pays y gagnerait.
Sans que la moindre parole ait été dite, je lui montre mon catalogue de fin d’année.
Elle passe aussi sec son bon de commande. En fille avisée elle choisit tour à tour « Le vibro-masseur », « La poupée mongole » et les « Délices de Zanzibar », mes toutes dernières créations, modèles d’automne encore introuvables dans le commerce. Elle mène un de ces raffuts qui rappelle la chute de Berlin, en plus tumultueux. Il doit y avoir un fameux branle-bas dans l’hôtel. Les messieurs encore verts doivent virer au rouge. Quelle aubaine pour leurs nanas !
Heureusement que je suis venu incognito… Je n’oserais jamais reparaître devant les pensionnaires du K2 demain s’ils savaient que j’ai provoqué ce charivari.
Enfin Martha s’apaise comme la mer calmée. Elle file sur moi un regard bordé de reconnaissance.
— Ça, lui dis-je, doctoral, c’est l’exercice préliminaire… Quelque chose comme le cours préparatoire, si tu vois ce que je veux dire ?…
Elle a un sourire qui use ses dernières forces et elle se blottit contre moi, pâmée.
On doit composer un charmant tableautin. Si le Vieux voyait son envoyé spécial, il prendrait une congestion cérébrale. J’ai une drôle de façon d’enquêter sur l’envoyé AAl !
M’est avis que le moment est venu de tirer les vers du nez à Martha. Après une séance de penthotal comme celle-ci, elle ne doit pas avoir les réflexes branchés sur la force.
Lorsqu’un homme vient de se dépenser de cette manière, il n’a à choisir qu’entre deux attitudes : ou bien rentrer chez lui, ou bien allumer une cigarette et parler de la pluie et du beau temps. En Italie, ce serait plutôt du beau temps.
J’avise un paquet de pipes sur la table de chevet. Ce sont des blondes (naturellement).
— Tu permets ? fais-je en en prenant une.
Je l’allume et exhale une bouffée voluptueuse.
Martha roucoule, prête à remettre le couvert.
— Je ne regrette pas d’être venu ici, dis-je… Tu es la fille la plus ravissante que j’aie jamais rencontrée.
Elle en a le valseur qui fait bravo.
— C’est vrai ? murmure-t-elle, d’une voix noyée comme une portée de chatons.
Je ne sais pas si vous connaissez bien les gonzesses — vous pourriez être des habitués de chez Mme Arthur après tout — mais je peux vous garantir, moi qui les pratique et même, vous venez de le voir, qui les honore, je peux vous garantir, disais-je, qu’elles sont toutes sensibles au baratin. Oui, toutes : les grandes, les rousses, les catholiques, les apostoliques, les romaines, les parisiennes, les pharisiennes, les bossues, les tordues, les intelligentes, et les autres (les femmes normales), les petites grosses, les grandes maigres, celles qui ont leur bac et celles qui ont un mètre vingt de tour de poitrine ; celles qui se nourrissent de biscottes, celles qui se nourrissent de boy-scouts, celles qui dorment sans souliers, celles qui vont au cinéma, celles qui en font, celles qui voudraient en faire et celles qui croient franchement qu’elles en feront un jour !
Du moment qu’on leur tresse des couronnes de guimauve, elles sont preneuses. Une fille comme Martha, vous vous en doutez (et si vous ne vous en doutez pas, c’est que vous êtes encore plus tarte que je ne le supposais) n’échappe pas à la tradition. Ma salade lui plaît. Elle l’arrose d’un filet de citron et l’avale toute crue.
Je continue de la baratiner comme quoi elle a les plus beaux lampions du monde, les crins les plus romantiques, la menteuse la plus alerte, la peau la plus veloutée.
Ensuite je chique au gars jalmince qui veut garder pour lui tout seul ces trésors.
— Dis-moi, Martha, j’espère qu’il n’y a pas d’autres pensionnaires qui te font du gringue, au moins ?
— Du quoi ?
— La cour ?
— Oh non…
Elle rosit un peu… Je la détronche vachement.
— Mon petit doigt me dit que si… Tu parles, une belle vamp comme te voilà, dans un patelin où les bonshommes ont un brasero dans le baquet !
— Mais non, je le jure…
— A d’autres… Tiens, le beau brun qui a un môme boulimique ?
— Le signor Cardoni ?
— Je ne sais pas son nom, mais il a des yeux qui feraient fondre le Mont Blanc !
Elle secoue la tête.
— Oh non… Et puis c’est un habitué. Il vient toutes les années avec sa famille…
Je saute par l’ouverture.
— Oui, en somme, ici vous retrouvez toujours les mêmes bouilles ?
— Les mêmes quoi ?
— Les mêmes frimes… Les mêmes têtes, si tu préfères…
— C’est vrai.
J’affûte ma question clé et je la plante carrément dans la conversation.
— A part ma mère à moi, les autres sont des habitués.
— Pas tous…
C’est ici que les Athéniens s’atteignirent, comme dit pertinemment mon honorable collègue Bérurier, lequel a chez lui la collection entière du Vermot.
— Quels sont les nouveaux ?
Elle ne répond pas tout de suite et me dévisage avec un œil étrange… Dans ce lampion, il y a une sorte de surprise attentive.
— Les autres clients t’intéressent, on dirait ?
Je ne me dégonfle pas.
— Oui, ils m’intéressent, Martha… Autant te le dire tout de suite, je suis d’une jalousie féroce…
Elle a un frémissement d’aise. Rien n’enquiquine davantage une donzelle que lorsque vous lui faites une scène de jalousie, mais paradoxalement, rien ne la flatte mieux que ça.
Entre nous et la station Madeleine, la jalousie est un sentiment que j’ignore. Je ne suis pas exclusif. Je pars du principe que la vie étant courte, il faut en profiter au maxi… Etant donné que chaque homme a besoin de plusieurs femmes, ne serait-ce que pour se dépayser un brin, il est bien évident qu’il doit, parfois, emprunter celle des autres… A charge de revanche, nature !
Du coup elle en oublie de répondre à ma fameuse question.
— Hein, ma belle, qui sont les nouveaux ?
— Eh bien…
Elle réfléchit.
— Il y a Mme Dickson…
— Qui est-ce ?
— La jeune femme avec sa petite fille… C’est une Américaine, elle attend son mari qui est allé à Rome pour ses affaires et qui vient la rejoindre demain…
— Tu le connais ?
— Non, pas encore…
Elle me file un baiser en dialiscope et murmure :
— Je ne savais pas que les Français étaient aussi jaloux.
Je hausse les épaules.
— Ne te moque pas de moi, Martha…
Vite je rengracis :
— Elle est là depuis longtemps, cette dame ?
— Deux jours… Tu t’intéresses à elle ?
Bon, la v’là en renaud, du coup… Je moule le sujet…
— Et à part cette Amerlock, quels sont les nouveaux ?
— Des Suisses…
— D’où sont-ils ?
— Zurich…
— C’est tout ?
— Il y a aussi les vieux, tu les as vus ? Ils s’appellent Canetti… Ils sont de Torino. Tu n’es pas jaloux du mari, si ?
J’éclate de rire…
— Tu en as de bonnes…
Encore un baiser filtrant, une caresse à ventouse et je laisse Martha rêver à cette félicité que nous nous sommes dispensée généreusement.
Je rejoins ma base sans encombre. Je suis un peu fatigué, mais ma matière grise donne à plein régime.
Maintenant l’affaire se noue. Grâce aux renseignements que je possède, je puis d’ores et déjà circonscrire le champ de mes investigations. En effet, on ne peut logiquement ranger sur la liste des « suspects » les vieux habitués de la maison. Parmi les nouveaux j’ai trois lots, ce qui ne veut pas du tout dire que ce soit trois affaires. Primo, la dame Dickson qui attend un homme ! Objection valable : sa petite fille… Décidément on n’en sort pas des suspects familiaux… Deuxio, les Suisses allemands… Là itou, leurs chiares me contristent… Enfin les deux petits vieux… Mais ils sont vraiment trop croulants pour pratiquer un turbin aussi délicat et dangereux que celui consistant à cloquer des armes à des mecs désireux de foutre le merdier en quelque point du globe.
Je les raye… Restent les Suisses, la dame…
Je me couche et j’éteins. Ma piaule donne sur l’avenue et, bien qu’il soit près de deux plombes, j’entends encore des bruits de conversation dehors… Il y a des lumières… Au fond de tout cela, la mer produit son grondement incessant, déprimant lorsqu’on se met à l’écouter.
Histoire de l’oublier, je pense à « l’affaire »…
D’accord, le Vieux avait misé juste, seulement cet accident d’aviation n’a-t-il pas annulé les rembours ?
C’est une possibilité… Un point de vue plutôt, mais il en est d’autres… Par exemple, je trouve curieux ce rendez-vous dans ce coin écarté de l’Italie… Pourquoi se rencontrer si loin des grands centres économiques où en général se traitent toutes les affaires, licites ou non ? Il y a une raison précise à cela… Et cette raison, j’aimerais la découvrir… Je vous jure sur la tête de mon lit que j’y parviendrai !
C’est sur cette bonne résolution que je finis par glisser dans les bras de Morphée. Ils ne valent pas ceux de Martha mais on s’y repose davantage.
CHAPITRE IV
Rien n’est plus vide qu’une existence d’estivant en hôtel. Toute l’année, les gens en bavent pour mériter trois semaines de farniente pendant lesquelles ils vont se faire tartir consciencieusement dans un trou impossible.
L’ennui commence sitôt le petit déjeuner expédié. On va acheter des cartes postales qu’on adresse à des truffes qui s’enchosent autre part en vous écrivant les mêmes… Puis on se baigne un peu et on bouffe… Sieste, bain de soleil, trempette… Rebouffe… Conversations… Au dodo… La fuite utile des jours qu’il appelait ça, Victor Hugo ! Tu parles ! De quoi prendre de l’eczéma au cervelet à force de se le gratter pour savoir ce qu’on va faire !
Ça dure comme ça trois semaines… C’est coupé par une excursion à Machin-Chose, un bled où les estivants s’ennuient pendant trois semaines aussi, moins le jour où ils viennent excursionner dans votre bled à vous avec des Kodak autour du ventre et des yeux conquérants.
Et ensuite, on rentre chez soi, la tirelire bourrée de souvenirs qui deviennent merveilleux au fur et à mesure qu’on s’éloigne. On les pense avec les mots qui serviront à épater les copains et on finit par être épaté soi-même… Oui, le miracle se produit : on croit en la beauté des vacances. On les déguste au passé ! Ah ! les hommes, je vous jure !
Félicie, elle, est radieuse. S’évader avec son Antoine, c’est un moment paradisiaque. Je la trouve dans la salle commune, elle m’y attend depuis longtemps, figée dans sa robe noire aux plis bien tirés… Droite, aimable, furtive… Prête à sourire à qui la regarde, en attendant son grand poulet de fils comme un insomniaque attend le lever du jour…
Je l’embrasse.
— En forme, m’man ?
— Oui, mon chéri…
— Tu as déjeuné ?
— Je t’ai attendu…
J’intercepte Gigi qui passe en souplesse, portant trois plateaux à la fois. D’un geste éloquent, je lui explique ce que j’attends de lui.
Il a pigé et me fait un signe affirmatif.
Pendant que nous attendons le déjeuner, la belle Américaine à la petite fille descend, tenant l’enfant par la main. Je lui distribue une œillade veloutée et un sourire révisé par Colgate. Elle a un bref hochement de tête et s’assied non loin de nous.
Tandis que nous prenons, nous le café au lait, elle the coffee and milk, je ne la quitte pas du regard. C’est une très belle personne d’une trentaine d’années, à la chevelure rousse, à la peau bronzée, aux yeux sombres… Elle est carrossée comme une voiture de course et c’est avec un plaisir non dissimulé que je lui jouerais pour elle toute seule le premier acte de « La grosse mite dans les biches », féerie enfantine qui a obtenu le prix du meilleur préjugé qui vous coûtait cher au festival de Pont de Beauvoisin.
Mon attention éveille la sienne. Je constate presto que je ne lui suis pas tout à fait indifférent. C’est le moment de faire jouer mes ramasse-miettes ! S’il y avait un grelot accroché à chacun de mes cils, je lui interpréterais « Prenez mon cœur et mes roses » sans accompagnement.
Lorsqu’elle a fini de faire manger l’enfant, elle cramponne son sac de bain et prend le chemin de la plage.
— Charmante femme, déclare Félicie en essayant de chasser toute malice de sa voix et de son regard.
Je ne bronche pas.
— Qui ça, m’man ?
— La dame qui s’éloigne avec sa petite fille.
— Ah oui ? Je n’ai pas fait attention…
Du coup, Félicie sourit et regarde dans une autre direction.
— Que faisons-nous, ce matin ? s’informe-t-elle.
— Ben ici, tu sais, y a que la plage… Je prendrais bien un bain !
— Tu n’y penses pas, Antoine ! Après avoir mangé…
— Dans un moment… Je vais m’acheter un slip de bain, j’ai oublié le mien chez nous…
Le ciel est bleu, la mer verte. S’il y avait une fenêtre, je l’ouvrirais tout de suite. Je regarde la flotte en attendant de pouvoir m’y ébattre… Mais je ronge mon frein car la belle Américaine, moins à cheval que Félicie sur les problèmes de la digestion, fait déjà trempette depuis un bon moment, tandis que sa fillette joue avec d’autres garnements sur la plage.
Enfin, ma brave femme de mère ayant levé son veto, je galope dans l’onde saumâtre.
Quelques brasses savantes et me voici près d’un radeau flottant à une cinquantaine de mètres de la plage. Mistress Dickson y est étalée, superbe dans un maillot de bain blanc qui étincelle…
Nous faisons très Lac aux Dames, elle crucifiée par le soleil sur cette plaque de bois…, moi jouant les terre-neuves autour d’elle.
Je finis par cramponner un bord du radeau, ce qui l’incline fortement. Le beauté rousse me regarde.
— Hello ! fais-je en américain.
Docile, elle répète d’une voix très nasale :
— Hello !
La conversation se trouvant de ce fait fortement engagée, je me juche à ses côtés. Je suis un peu plus libre, car Félicie étant myope, ne peut m’apercevoir depuis son parasol.
Je fais jouer mes pectoraux pour compenser ma carence linguistique. L’anglais que je suis capable de parler, en effet, tiendrait sur la marge d’un timbre de quittance.
Je m’efforce pourtant de constituer une phrase.
Elle est pauvre mais convenable :
— The sun is good for you, dis-je aimablement[3].
Elle éclate de rire.
— Il est bon pour tout le monde, rétorque-t-elle dans un français parfait.
Elle a un petit accent qui ajoute à son charme.
— Comment ! Vous parlez français ?
Ma stupeur lui fait plaisir. Elle s’amuse comme une petite fille.
— Oui, j’ai fait la guerre en France !
— La guerre ! Mais vous étiez enfant de troupe alors !
— Non, j’ai trente-quatre ans…
— Air connu : on ne vous les donnerait pas…
Brusquement, sur ce radeau flottant, près de cette fille rousse, avec le Mahomet qui nous cogne dessus à grands coups de rayons, je me sens envahi par une étrange félicité. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué (ça me surprendrait à en juger par vos billes) mais il existe brusquement dans la vie des états de grâce. Des tas de tordus — dont vous sûrement — croient que le bonheur est un autobus qu’il faut parvenir à attraper ! Je peux vous annoncer qu’ils se mettent le doigt dans l’œil jusqu’à l’estomac. Le bonheur, voyez-vous, c’est seulement une espèce de flottement passager pendant lequel vos pensées s’engourdissent. Ce qui revient à dire que le bonheur consiste à ne plus penser, à retourner à l’animal…
Un silence interminable s’écoule. Mme Dickson se met sur un coude et me regarde de très près.
— Vous n’êtes pas très causant, remarque-t-elle.
— Parce que je me sens bien… J’ai l’impression d’être couché sur un nuage auprès d’une fée.
Ça l’amuse. Tout l’amuse… M’est avis qu’elle doit commencer à se faire tartir sans son Jules.
— Vous avez une jolie petite fille, dis-je, sachant qu’un compliment de ce genre fait toujours plaisir à une maman.
— C’est ma nièce. Elle est orpheline !
— Pauvre chérie… Et vous aussi êtes seule au monde ?
— Non, j’ai un mari…
— Y a des gars qui sont vernis. Comment se fait-il qu’il ne soit pas avec vous ? Moi, si je possédais une femme pareille, je me l’attacherais au poignet comme un garçon de recettes le fait de sa sacoche…
— Hum, ce ne serait pas un bon système… Les femmes n’aiment pas beaucoup être attachées.
— Vous êtes seule ici ?
— Non, mon mari arrive aujourd’hui…
— Aïe !
— Pourquoi ?
— Voilà bien ma veine, dis-je. Juste au moment où nous lions connaissance…
Elle se rembrunit un peu (ce qui n’est pas difficile sous un soleil pareil).
— Qu’espériez-vous ? demande-t-elle.
Cette question trop précise me déconcerte.
— Mais… heu… devenir votre ami !
— La présence de mon mari ne sera pas un empêchement. C’est un homme très gentil…
— Il est dans les affaires ?
— Oui, il vend des avions à l’Europe. Il est en ce moment à Rome pour traiter une grosse commande avec le gouvernement italien.
Cette histoire de vente d’avions me fait tiquer. Serais-je sur la bonne piste ?
Nous sommes aujourd’hui le 28, c’est-à-dire à la date initialement prévue par les deux groupes pour une rencontre. Si l’accident de Kazar n’a pas apporté de contrordre… Oui, ce sera pour aujourd’hui.
Bon. En admettant que M. Dickson, marchand de zincs, soit le représentant de AA1, celui du groupement arabe ne devrait pas tarder à se présenter non plus. Il faut que j’ouvre l’œil… Et que je l’ouvre béant.
Après quelques considérations sur le soleil, la mer, la nourriture à l’hôtel et la couleur du cheval blanc d’Henri IV, je prends congé de la jeune femme et je plonge dans la tisane…
Mon absence avait déjà inquiété Félicie qui m’imaginait noyé. Je me sèche et je lui propose d’aller faire une petite virée dans le village que nous ne connaissons que pour l’avoir traversé en arrivant. Elle accepte.
J’installe ma brave femme de mère dans un fauteuil-balançoire du jardin de l’hôtel en lui recommandant de m’attendre pendant que je vais me changer.
Martha est comme à son habitude vautrée dans le coin d’ombre du hall. La vieille dame à cheveux blancs demande la communication avec Milano pour le compte de l’amoureux qui attend, debout devant la caisse, tandis que sa souris lui gratouille le creux de la main.
Je m’approche de ma petite Allemande.
— Vous avez bien dormi ? fais-je sans sourciller.
— Très bien, dit-elle de sa voix à la fois chantante et gutturale.
Je me penche sur elle, l’œil en vrille.
— Je crois, mon amour, que nos ébats ont empêché une partie de la population de l’hôtel de ronfler… Tenez, les deux petits vieux, entre autres, me font grise mine…
Elle hausse les épaules.
— C’est une idée que vous vous faites… Ils habitent le 11, à l’autre étage !
— Ah oui ?
— Oui…
— Excusez-moi, je vais me changer…
Elle m’agrippe par un bras.
— Vous revenez me voir, ce soir ?
Mince, elle passe ses commandes de bonne heure, la petite dévoreuse.
— Ben voyons, fais-je, prometteur.
Je m’élance dans l’escadrin jusqu’à ma chambre. Je passe un futal de lin et une marinière blanche… Ensuite je vais à la porte du 11.
J’écoute, pas un bruit. Je frappe légèrement, personne ne répond. D’un geste décidé j’utilise mon petit sésame, l’instrument qui met les serrures à la raison. Cric-crac, me voici dans la strass.
C’est la même chambre que la mienne. Deux pieux jumeaux, avec dessus des pyjamas rococos…
Je cavale à la penderie et je l’ouvre. Il y a des costards de coupe ancienne et des robes fanées… Je fouille les deux valises posées sur un treillis. Elles sont vides, leur contenu ayant été rangé dans le meuble… J’inventorie alors les grands tiroirs… J’y déniche du linge de corps aussi désuet que ceux qui le portent. Décidément, ces deux nistons sont bien des petits rentiers en vacances…
Je vais pour m’esbigner sur la pointe des tiges lorsque, ô catastrophe ! je perçois un bruit de pas dans le couloir. Ces pas s’arrêtent pile devant la porte. Une clé farfouille la serrure. Je sens mon raisin qui se caille. Si je me fais piquer dans une carrée qui n’est pas la mienne, ça va faire un sacré cri dans l’albergo ! Le méchant scandale, avec carabiniers et procession en musique jusqu’à l’hôtel de police…
Comme argument, peau de balle ! Je ne peux prétendre que j’attends le métro !
A toute vibre je fonce dans la salle de bains et je vais me carrer dans la douche. Rapidos je tire le rideau en plastique devant moi. Il ne me reste plus qu’à espérer que l’arrivant ne séjournera pas longtemps icigo et surtout qu’il n’aura pas d’idée hydrothérapique derrière la tête.
J’entends fredonner une voix de femme. Elle susurre un air italien. Je respire : il s’agit de la femme de chambre. Il n’y aurait que demi-mal si elle me découvrait dans cette planque. Je m’en tirerais en lui allongeant un bif de mille lires. Du moins je l’espère…
La voilà qui entre dans la salle de bains. Par l’ouverture du rideau je la vois cramponner une petite pelle à poussière qu’elle avait oubliée là… Elle se casse… Ouf ! Je l’ai échappé belle.
Je quitte mon poste d’observation et je m’apprête à évacuer les lieux lorsque mon pied glisse sur la faïence du receveur de douche et je vais partir de la lanterne contre le mur. Mon pif dérouille et je me mets à pisser rouge… Vite je drope au lavabo pour freiner l’hémorragie. Ça dure deux minutes, ensuite de quoi ça s’arrête. Tout en me soignant, je regarde les différents objets de toilette disposés sur la tablette et mon regard s’arrête sur un flacon de teinture. Ça retient mon attention parce que la teinture en question est blanche… Vous mordez ? Blanche… Les deux petits vieux, au lieu de se grimer en jeunots, accentuent leur âge par cet artifice. Voilà qui est troublant, n’est-ce pas ?
Je quitte la pièce, songeur. Sur les trois groupes de pensionnaires « inhabituels », en voici deux de suspects… La rouquine amerlock qui attend son marchand d’avions aujourd’hui VINGT-HUIT ! Et les deux vieux qui ne sont peut-être pas des vrais vieux !
Il ne me reste plus qu’à m’intéresser aux Suisses… Ceux-là, ils me paraissent blancs comme la neige de leur patelin. Mais on ne sait jamais. Le turbin d’un agent secret consiste à ne pas suivre ses impressions, mais la logique des faits…
Je rejoins Félicie.
— Excuse mon retard, lui dis-je, je me suis cogné le nez dans la salle de bains.
Naturlich je ne lui précise pas laquelle.
Nous déambulons dans les ruelles chaudes du village. Je suis de plus en plus pensif. Midi approche. Midi du 28 juillet et il ne s’est encore rien produit au K2.
Lorsque nous rentrons, les pensionnaires sont déjà dans la salle à manger pour la tortore. Nous gagnons notre table, derrière les Zurichois. Ces gens-là sont solennels comme des cathédrales gothiques. Franchement, ils sont à écarter…
Après le repas, m’man me dit qu’elle est un peu fatiguée par le soleil et qu’elle s’étendrait bien pour une sieste. En réalité, je vous parie une vie de chien contre une vie de chienne qu’elle agit de la sorte uniquement pour me laisser le champ libre. Elle a bien vu que je rôdaillais autour de deux greluses et elle ne voulait pas m’empêcher de mener à bien mes entreprises…
Je m’approche de l’Américaine, assise dans le jardin, tandis que sa nièce fait de la balançoire…
— Votre mari n’est pas encore arrivé ?
— Il ne va pas tarder…
Sur le pas de la porte, bravant le soleil, la môme Martha me foudroie du regard. Elle paraît en crosse, sans doute craint-elle que je lui échappe au profit de l’Américaine…
Je lui file un clin d’œil et je vais la rejoindre dans le salon. On donne un dessin animé polonais à la télévision. C’est passionnant comme un sermon du Révérend Père Riquet…
— Vous faites du charme à tout le monde, me dit-elle avec humeur.
— Allons donc ! Je lui demandais seulement le prénom de sa petite fille…
Je me tais, toute mon attention sollicitée par l’arrivée d’un homme élégant. Il tient une mallette de porc à la main. Il porte un complet beige, en tissu léger, des chaussures de daim champagne, une chemise blanche, une cravate saumon et il est coiffé d’un chapeau de paille à larges bords. Il a une gueule de gravure de mode. On le prendrait pour un acteur ricain.
Je vois Mme Dickson se précipiter sur lui et lui rouler un patin fignolé qui donnerait des idées polissonnes à une réception à l’Académie Française.
Bon, voilà le bonhomme…
Il jacte en amerlock avec sa souris. C’est elle qui parlemente à la caisse. Probable que l’italien ne l’inspire pas, cet homme ?
Martha me laisse un instant pour aller réceptionner l’arrivant et le mettre dans les pattes des serveurs.
Je l’attends en me farcissant la fin du dessin animé. Tout de suite après, j’ai droit à un puissant documentaire sur l’élevage des brebis galeuses.
Retour de Martha. Les Dickson se sont engagés dans les étages. Probable que le Ricain a deux mots à bonnir en particulier à sa pépée. Dans un sens (et même dans l’autre) je le comprends, cet homme…
Martha revient s’asseoir près de moi.
— Etrange, murmure-t-elle…
Elle est songeuse.
— Pourquoi ?
— Ce garçon parle mal l’anglais…
Je bondis.
— Que dites-vous ?
— Qu’il parle mal l’anglais… C’est pour cela que je dis « étrange »… Car enfin, un Américain…
Cette fois je suis certain de tenir du solide.
— Vous avez son passeport ?
Elle va farfouiller dans le tiroir de la caisse.
Puis elle revient, tenant un livret cartonné qu’elle me tend.
Je lis qu’il s’agit de Julius Ber Dickson, né à Kansas City, le 18 juillet 1924… Demeurant 119 Quatorzième rue à New York… La photographie est bien celle de l’homme qui vient d’entrer et le signalement correspond au sien. Je suis troublé.
— Qu’est-ce qui vous fait dire qu’il parle mal l’anglais ? Vous le parlez bien, vous ?
— J’ai vécu deux ans à Chicago chez mon frère…
— Ça n’est peut-être qu’une question d’accent ?
— Non ! Il a usé de termes impropres… J’en suis certaine.
Je rends le passeport à Martha qui va le remettre dans le tiroir de la caisse avec les autres…
Lorsqu’elle revient, San-Antonio n’est plus là… Je fonce dehors et je bouscule intentionnellement la petite fille qui accompagne la rouquine.
La môme se met à chialer… Elle a une petite écorchure au genou. Voilà que je deviens un bourreau d’enfant à ces heures.
Je la prends dans mes bras et je cours vers l’escalier conduisant aux chambres…
En chemin je croise Gigi.
— Mme Dickson, quel numéro ? m’enquiers-je.
— 32… La petite s’est fait mal ?
— Ce n’est rien.
Je galope jusqu’au 32 et je m’immobilise devant la porte avec l’enfant dans les bras. Elle a cessé de chialer justement. Il y a un grand silence dans le couloir. Je dilate mon tympan pour essayer d’esgourder ce qui se dit à l’intérieur.
Je perçois distinctement ceci, proféré par MmeDickson :
— Ils viennent de partir pour la plage…
EN FRANÇAIS !
Et l’autre, le mâle, répond, dans un français encore meilleur :
— Alors, allons-y sans perdre de temps.
Là-dessus je frappe.
La belle rouquine ouvre et pousse un cri en voyant la fillette dans mes bras. Je la rassure.
— Ce n’est rien, madame… Je l’ai bousculée alors qu’elle courait et elle a le genou un peu écorché…
Elle me remercie. Le beau gars s’avance et me regarde. Elle se tourne vers lui. Baratin en anglais.
— Je vous présente mon mari, fait-elle.
L’autre me tend sa paluche en disant :
— How do you do ?
Je réponds :
— Pas mal merci, et vous ?
Et je prends congé, de plus en plus persuadé que j’ai mis le nez dans du pas très frais.
Un homme qui arrive le 28 au K2, qui a un passeport amerlock mais qui parle mal l’anglais. Qui parle bien le français mais qui affecte de l’ignorer… Voilà de quoi troubler un cœur pur, non ?
« Ils viennent de partir pour la plage », a dit la belle souris…
« Allons-y vite », a répondu son gars…
Ils, ce sont les autres… Ceux qui viennent traiter le marché. A moins qu’au contraire ce ne soit Dickson qui représente la Ligue Arabe, peu importe… Conclusion : EN ALLANT SUR LA PLAGE, J’ASSISTERAI A LA RENCONTRE…
Je passe dans la carrée de Félicie… Elle dort… Sans bruit, je referme la lourde. Je griffonne un mot : « Plage », le glisse sous la porte, puis je me casse, le cœur assez battant je l’avoue, toute ma curiosité mise à vif…
Je m’installe dans le transatlantique gracieusement mis à ma disposition par la direction de l’hôtel. Autour de moi, les pensionnaires achèvent leur sieste avant de se faire mariner les couennes dans l’Adriatique.
Jusque-là, R.A.S., comme disaient les communiqués de 40 lorsque les verts-de-gris entraient dans les faubourgs de Montélimar. Puis la famille Dickson annonce sa trilogie dans le secteur. Ils envahissent des fauteuils et se tiennent par la main. Les autres, les Ritals du K2, commencent à les détrancher pour viser comment le mari de la belle esseulée est fabriqué.
Les messieurs qui avaient envie de lui tenir compagnie pendant l’absence du mecton doivent se voter des mentions spéciales pour avoir remis ce projet à une date ultérieure.
Parce que si vous le voyiez torse nu, le Ber, vous prendriez des vapeurs, mesdames ! Des armoires à deux portes commak, on n’en trouve pas chez Lévitan ! Il a des épaules qui ôteraient le hoquet à un minus… Avec ça des deltoïdes de catcheur, des biscotos d’haltérophile, une poitrine couverte d’astrakan et un petit air de ne pas supporter qu’on prenne son échine pour un paillasson.
Je croyais qu’il allait bondir carrément sur « ceux » qui l’attendaient, mais pas du tout. Une main derrière la nuque, tenant de l’autre celle de sa femme, il se contente de regarder jouer la petite fille… Riant de sa joie…
Du coup, je ne sais plus si c’est du lard ou du cochon. Qu’est-ce que tout ça veut dire ?… Hein ? Je vous le demande, tas de foies blancs !
Je bigle les autres, ils se sont lassés de zieuter l’arrivant et ils jouent le second acte de « J’ai la gueule de boa »… Je commence à avoir les nerfs malades.
Mes deux petits vieux sont juste derrière moi. Lui lit un bouquin dont la présentation me laisse penser qu’il doit être prodigieusement emmerdant. Sa pétroleuse tricote un cache-naze pour l’hiver prochain… Je consacre mon attention à cette dernière… Je vois que ses cheveux sont teints, non pas en blanc, mais en gris…
J’examine alors son débris de mari et je pige le pourquoi de la teinture… Il a les cheveux réellement blancs, mais son bouc doit pousser gris et c’est par coquetterie en somme qu’il se le teint en blanc… Je comprends la chose en voyant que sur ses joues, la barbe pousse plutôt foncée… Je crois que j’en ai fait trop hâtivement un suspect. Tout ça, croyez-moi, commence à me peser singulièrement sur la patate.
Ce soleil, ces estivants internationaux unifiés par l’ennui, cette vie d’hôtel morne à crever, cette incertitude, et la fille blême qui m’attend cette nuit pour une nouvelle partie de bilboquet, oui, cela m’accable prodigieusement.
M’man vient me rejoindre une heure plus tard, souriante.
— Bien dormi ?
— Comme une souche !
Il faut vous dire que Félicie n’a jamais été douée pour les métaphores.
Elle s’installe et nous restons une grande partie de l’après-midi à flotter dans une chaude torpeur coupée par les glapissements aigus des mômes et par l’énorme floooc de la mer.
Dickson n’a pas bougé. Il n’a parlé à personne. Mieux, n’a regardé personne… Sa femme non plus… La petite fille paraît être leur unique souci. Ils n’ont d’yeux que pour elle. Gentille famille !
Sur le soir, dislocation du cortège. Un à un, les mecs regagnent l’hôtel, histoire de se loquer pour la tortore… C’est fou ce que les toilettes sont urf au dîner. Ils font ça à l’anglaise, les bourgeois transalpins.
Ils jouent à s’épater.
Je vais me nipper à mon tour, en proie à un pressentiment. Je sens (tout mon corps me le dit) qu’il va se passer quelque chose avant la fin de la soirée.
Je possède un sens infaillible pour renifler la casse.
CHAPITRE V
Je ne sais pas si vous avez vécu des journées d’été lourdes et lénifiantes. Oui, sans doute ? Vous avez beau être un ramassis de cavillons ramollis de partout, principalement de la matière grise, vous vous souvenez de ces impressions…
Tout le jour vous avez sué des chandelles, et puis, en fin de journée, un orage se prépare, et l’air devient brusquement épais comme l’intelligence d’un gendarme. On dirait qu’il se vide d’oxygène… Vous sentez de l’électricité autour de vous. Vous avez besoin que ça pète ou que ça dise pourquoi…
Présentement je suis dans le même état d’esprit. Ma centrale nerveuse est sur le point de sauter. Cette enquête me déprime comme une exposition de mauvais tableaux. J’en ai classe de jouer à l’estivant venu sur les bords de l’onde amère avec sa vieille moman… J’en ai ma claque de me répéter que nous sommes le 28 juillet, que la journée est achevée et que rien, vous m’entendez, bande de constipés de la feuille ? RIEN ne s’est produit, contre toute attente et contre tout espoir !
Ah ! quel métier, je vous jure ! Y a des moments où je me dis que si je possédais la vraie sagesse, je cloquerais ma démission au Vieux… Avec nos éconocroques, j’achèterais un rade dans une banlieue verdoyante, près de la tasse, en cherchant un coin où le goujon ne serait pas trop rétif. Derrière le troquet y aurait un jardin avec des fraisiers. En fait d’effort, la culture de la fraise, c’est idéal, because les branches sont basses. Au rade je placerais une jolie pépée avec un beau sourire et du téton, manière d’amorcer le clille et de le faire passer à la carmouille. La nuit, je lui raconterais les aventures de Popoff…
Au lieu de ça, je m’astreins à une gymnastique cérébrale qui chanstique mes centres nerveux.
Je fulmine tout en me déloquant. Nature, il ne s’est toujours rien passé. Le repas a été d’un calme… plat si je puis avancer ce jeu de mots sans crainte de heurter vos convictions politiques.
Je m’apprête à me fourrer dans les toiles lorsque je pense à la môme Martha qui m’attend dans sa robe de nuit en toile d’araignée paresseuse. Elle compte ferme sur une seconde tranche ! Tirage ce soir ! J’ai autant envie d’aller lui expliquer le rondibet du radada que de me faire thermomètre dans une léproserie !
Les bonnes femmes, je vous l’ai souvent dit, c’est comme les mauvais films : faut jamais les voir deux fois. Pourtant, si je m’abstiens, miss Outre-Rhin sera outrée (mon style est une jonglerie).
Elle est chiche de venir me faire une relance à domicile… J’aurais l’air futé vis-à-vis de Félicie qui a le sommeil fragile comme du verre filé. Bon, d’accord, je vais aller donner ma représentation d’adieu…
Je passe ma robe de chambre en satin bleu nuit à rayures noires et fouette cocher ! En route pour la sérénade au balcon.
Personne dans les couloirs. Je grimpe à l’étage supérieur et vais gratter la porte de Martha en attendant mieux. C’est une véritable sangsue qui se précipite sur moi… Ce soir, je n’ai pas besoin de lui faire choisir dans le répertoire de saynètes comportant ses emplois. D’autorité elle me joue « Branle-bas en Méditerranée », suivi immédiatement de « Constellation » (le monde vu par un trou de serrure) et, pour terminer, « On purge Bébé » par la compagnie Richelieu-Drouot.
Je m’esquive sur le coup d’une heure du matin. Et c’est alors que je vous demande de bien vouloir débloquer vos étagères à mégots ; car c’est à cet instant que la fiesta démarre vraiment.
Le hasard, toujours lui, veut qu’en regagnant ma carrée pour y pioncer du sommeil du juste, mon sens auditif soit alerté par un bruit cristallin qui me meurtrit les trompes[4].
Ça vient de l’étage inférieur. Ça m’a tout l’air d’être le bruit que fait une clé entrant en contact avec le carrelage.
Je m’immobilise, le buste incliné à quarante-cinq degrés au-dessus de zéro et de la rampe.
Je vois passer une ombre tenant quelque chose de volumineux entortillé dans une couvrante. Voilà qui m’intéresse foutrement, comme dirait mon amie la baronne de Maichose. Je vois l’ombre descendre au rez-de-chaussée… Aussi sec, j’ôte mes spartiates et, les radis nus, prenant appui sur les talons pour éviter tout claquement, je me mets à descendre itou…
J’arrive dans le hall au moment où le porteur arrive à la grande porte vitrée. Celle-ci est fermée à clé et la chiave est restée sur la porte. Il délourde en souplesse, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Le paquet qu’il tient se met alors à remuer et je me rends compte qu’il s’agit d’un enfant… Le type (car le clair-obscur est suffisant pour que je puisse voir que c’est un homme) ouvre sans bruit et sort. La lune lui choit dessus, pareille à une grosse bouse de vache dorée. Je reconnais Dickson… C’est sa petite nièce qu’il coltine…
Il contourne l’hôtel en marchant sur la partie dallée. Il est en chaussettes et ses lattes sont attachées à son cou par les lacets… Il va derrière le bâtiment, là où sont garées les tires dans des boxes en roseaux. Il s’approche d’une petite Fiat immatriculée à Rome (je vous casse ces détails car la lune illumine le patelin comme le ferait son mec le père Durand), ouvre sans bruit la portière arrière, y dépose son vivant fardeau[5] et sort la voiture de sa travée en la poussant à la main…
Comme elle est rangée très près de la sortie, et qu’elle est aisée à manœuvrer, il la conduit jusque dans une rue perpendiculaire à l’avenue principale. Ensuite de quoi il enfile ses pompes et s’installe au volant.
Vous verriez alors le gars San-A., vous seriez obligées de vous entifler dare-dare une cuillerée de souris de l’abbé Jouvence, mesdames ! En moins de temps qu’il n’en faut à Brigitte Bardot pour se déguiser en Eve, j’ai gagné ma propre tire et me suis placé sur le siège. Lorsque j’entends ronfler la Fiat de Dickson, j’actionne le démarreur de la mienne. Une manœuvre express et je m’avance jusqu’à la petite rue. Une fois là, je descends voir où en est la situation. Tout ce que j’asperge, c’est deux feux rouges à cent mètres de là. Je leur emboîte la roue, toutes calbombes éteintes… La Fiat vire à droite, puis encore à droite pour retrouver l’avenue, et enfin à gauche en direction du village… Je continue d’y filer le train (un train de pneus of course) à bonne encablure pour ne pas trop attirer l’attention du Ricain… Sa promenade nocturne avec la môme crevette ne me dit rien qui vaille. J’ai l’usine à débloquer qui fait équipe de nuit, vous pouvez me croire…
Nous traversons Cervia où règne encore une certaine animation, puis nous prenons la route de Ravena. C’est une voie rectiligne filant à perte de vue le long du littoral. Dickson bombe à pleins gaz.
Où m’emmène-t-il, ce Chinois vert ? J’ai bonne mine, en robe de chambre et nu-pieds… Pas un faf, pas un laranquet sur moi… Si jamais un perdreau de nuit fait du zèle, je n’aurai que la ressource de chiquer au somnambule !
Nous parcourons plusieurs bornes, dépassons Milano Maritime, la coquette cité construite par messieurs les Milanais, et nous reprenons le cheminement rectiligne…
Soudain, j’aperçois au loin, sens contraire à nous, les loupiotes d’une tire arrêtée… Dickson fait un appel de phares. La voiture à l’arrêt répond par trois petits coups brefs… J’ai bien fait de laisser beaucoup d’avance à mon zig, car sans cela les lampions de l’autre endoffé allaient me cueillir comme le rayon d’un projo.
Dickson ralentit. Moi j’arrête tout et je me range sur l’accotement. L’Américain a stoppé à la hauteur de l’autre bagnole.
Je regarde de mes deux yeux en regrettant de ne pas en avoir davantage pour mieux voir.
Deux hommes sont descendus de l’auto qui attendait. Dickson sort de la sienne à son tour. Ces messieurs ont une brève conversation puis les deux gougnafiers ouvrent la porte arrière de la Fiat, prennent la nistoune et la portent à leur voiture… Les trois compères se saluent. Dickson allume une cigarette en regardant manœuvrer la voiture de ceux qui viennent de prendre livraison de sa pièce. Ladite carriole décrit un arc de cercle, une marche arrière, un nouvel arc de cercle qui la met dans la position opposée à celle qu’elle occupait à l’arrêt. Puis elle fonce sur Ravenne.
J’attends, éberlué, en me demandant ce que va faire Dickson. Du diable si je pige quelque chose à ces giries ! Je m’attendais à tout sauf à ça…
Le silence de la nuit étoilée (pour tous renseignements complémentaires, écrire à Lamartine Alphonse de, en joignant un timbre pour la réponse) n’est troublé que par le grondement de la mer… Malgré la clarté lunaire, on ne la voit pas danser au fond des golfes clairs car il y a un bois d’arbres maigrichons entre elle et la route…
Je suis aussi immobile qu’une sentinelle qu’on a oublié de relever à la porte du Kremlin une nuit d’hiver.
Je suis prêt à vous parier un air d’harmonica contre un hercule que Dickson va faire demi-tour et regagner le pageot où l’attend madame sa rouquine… C’est dans l’ordre des choses… Pourtant il n’en fait rien. Il éteint ses phares, met son feu de position gauche et tire du coffre de son bahut un truc que je n’identifie pas presto.
C’est au bout d’un moment seulement que je constate qu’il s’agit d’un sac de couchage…
Cette nouille aux œufs frais (l’eusses-tu cru ?)[6] traîne l’objet dans le fossé et s’y insinue. Au bout d’un instant, plus rien ne bouge autour de la Fiat. Le gars en écrase comme s’il était payé aux pièces pour ça !
J’attends cinq minutes, puis cinq autres encore, ce qui fait dix en tout si mes souvenirs scolaires sont exacts.
Je me tâte… Ce qui vient de se passer est tellement époustouflant, tellement peu prévisible surtout, que je suis sans volonté. Pourquoi pionce-t-il sur un talus alors qu’il est à un quart d’heure de son étable ?
Comme je ne trouve pas de réponses à ces questions, je me traite d’un tas de noms intraduisibles en patois japonais. Combien grand a été mon manque d’à-propos ! Bonté divine, je devais suivre les types de l’autre bagnole… Si le Vieux apprend que je me suis tressé les poils des bras en attendant que ça se tasse, il va piquer un de ces coups de sang qui font grimper le thermomètre à la cabane poulets.
Je me tâte encore un peu, puis, brusquement, j’opte pour l’action. Assez louvoyé… J’en ai classe de mater par les trous de serrure… Je ne suis pas un valet de chambre mais un agent secret. C’est bon pour les vide-pots de grande taule de se décoller la rétine (encore que les nouvelles serrures aient porté un coup sérieux à la profession par leur étroitesse).
Je soulève la banquette arrière de ma guinde, là où un pote prévoyant a dissimulé un petit appareil à gommer le curriculum. Gentil petit objet… Calibre impressionnant. Ça n’est pas celui de l’homme élégant et il alourdirait le costume de ville. Mais pour le pardingue ou la fouille de robe de chambre, il convient à merveille…
Je m’en saisis et, à pas de velours, je m’approche de la Fiat immobilisée en bordure de la route. Dickson dort gentiment dans son sac de couchage… Un vrai petit ange !
Je m’accroupis auprès de lui et je lui braque soudainement en pleine poire la lampe électrique que j’ai dénichée dans le vide-fouilles de mon baquet.
C’est radical. Il plisse ses lucarnes puis les ouvre, ce qui représente deux mouvements contraires, mais normaux de la part d’un garçon éveillé en sursaut.
Il se voile aussitôt la face pour échapper à l’impitoyable faisceau. Je rigole bien. C’est très divertissant.
— Alors, Dickson, attaqué-je, on est claustrophobe, à ce qu’il paraît ?
Il attend un instant et gronde :
— Ecartez votre sacrée lumière, vous m’aveuglez !
Je me garde bien de lui obéir.
— Si ça te gêne, mon gars, ferme tes jolis yeux. Pour parler, t’as pas besoin d’y voir clair, hein ?
— Qui êtes-vous ?
— Si je te le disais, tu ne voudrais pas me croire…
Courageusement il fait front à la lumière pour tâcher de m’apercevoir par-delà cette source éclatante. Mais ça lui est impossible.
— Que me voulez-vous ?
— J’aimerais savoir à qui tu as remis la charmante petite que tu appelles ta nièce.
Il ne répond pas… J’ai une sainte horreur de ces pieds-plats qui se mettent du sparadrap sur la bouche dès que vous leur posez une question. Pour le lui prouver, je balance un méchant coup de tatane dans le sac de couchage. Il ne bronche pas. Peut-être que le duvet intérieur a amorti le choc, pas vrai ?
— Je t’ai posé une question précise, Dickson… Alors tu vas être un amour et y répondre de même.
— De quoi vous mêlez-vous ! gronde l’homme.
Ses yeux étincellent de fureur. S’il n’était pas coincé dans son sac de couchage comme un rat dans une nasse, je vous prie de croire qu’il me ferait polker les ratiches… Mais il se sent entravé et ça lui coupe le sifflet.
Je biche de ma main qui tient le pétard la cordelière fermant le haut du sac et je tire après avoir mis le pied dessus. Il est coincé là-dedans, le pauvre zig, et il fait triste mine.
— Tu me rappelles une momie avec qui j’ai eu des relations coupables dans les temps très anciens, lui dis-je… On l’appelait Velpo parce qu’elle faisait bande à part…
Il ricane.
— Très drôle…
— A qui as-tu remis l’enfant, Dickson ?
— A son père…
— Il ne pouvait pas venir la chercher jusqu’au K2 ?
— Peut-être que non…
Je me contrôle de moins en moins.
— Tu devines ce qui se passerait si je foutais le feu à tes plumes ? Ça flamberait comme une lampe à souder, et toi dedans… Tu t’aimes comment, bleu ou à point ?
Il dit, d’un ton uni :
— A votre goût, mon vieux… Faites comme pour vous !
Serais-je tombé sur un petit marrant ?
CHAPITRE VI
Dans mon job, on devient psychologue, fatalement, même lorsqu’on est une crêpe, style Bérurier. Dans le cas présent, je pige illico que le gars Dickson est un vieux de la vieille, c’est-à-dire un coriace. C’est pas en faisant « hou ! » dans son dos que vous lui ferez passer le hoquet, croyez-moi. Ce bipède a les nerfs bien accrochés et les trucs susceptibles de lui faire perdre son sang-froid pourraient être gravés sur le chaton d’une blague de petite fille.
Avec ce genre de guignol, il faut de suite employer les moyens extrêmes. Ils prennent ça pour un lever de rideau et ça les fait réfléchir sur la suite du spectacle. L’imagination faisant son boulot, vous risquez d’obtenir un résultat.
Je prends une voix très calme. Je laisse du blanc entre mes phrases pour qu’elles fassent plus lilial.
— Ecoute, Dickson. J’aime bien marcher sur du terrain solide. Alors je te préviens tout de suite : tu parleras. Et si tu ne parles pas, tu réuniras toutes les conditions requises pour faire un beau mort avant la fin de la nuit, tu piges ?
Il ricane :
— J’ai déjà entendu ça dans une superproduction d’Hollywood… Ça s’appelait « Numérote tes plumes, il va pleuvoir… » ou quelque chose dans ce genre…
— Eh bien, je vais te faire un remake de la chose, gars !
Aux grands maux les grands remèdes. Il prend un coup de talon sur le pif qui lui arrache un gémissement en même temps que le bout du tarin…
Je le contemple à la lumière de la lampe. Ça pisse épais.
— Les massages faciaux te réussissent, lui dis-je… D’ici trois minutes de ce régime, tu vas ressembler à un boxer… Dans une exposition canine, t’auras tes chances contre les gayes de la duchesse de Windsor…
Il grommelle des insultes…
— Bon, tu accouches tout seul ou si on emploie les forceps ?
— Des clous !
M’est avis que je peux lui défoncer l’étalage sans rien obtenir. Pour tout vous dire et ne rien vous cacher, bien que je sois en renaud après cette tête d’haineux, ça me contriste un peu de démolir un homme dans l’impossibilité de se parer.
Pourtant, quand on vit des instants pareils, on ouvre la fenêtre en grand sur la nature humaine. Et le spectacle n’est pas chouïa ! Un homme, c’est triste à dire, n’est qu’une bête somnolente dont l’instinct prend la parole à la première occase. Nous nous livrons à des actes que notre intelligence, notre sensibilité condamnent. Plus rien ne nous arrête… Une noire fureur nous anime. Un besoin de nous profaner, de dépasser nos limites…
Je cogne encore sur le pauvre visage informe du gars Dickson.
La sueur plaque mes crins sur ma tempe.
— Tu vas parler, dis, fumelar ! Tu vas te foutre à table avant que je t’aie transformé en ratatouille niçoise !
Mais tout ce que je récolte entre deux gémissements, c’est une insulte bien sentie. Dickson me dit combien il déplore que ma mère m’ait mis au monde ! Il suggère qu’une impécuniosité chronique avait privé ma dabuche d’une installation sanitaire !
Vous voyez à peu près la jactance…
Je m’arrête de le tabasser. Décidément je n’en tirerai rien…
Comme je m’essuie le front d’un revers de manche, je perçois une espèce de déchirure puis, aussitôt, un trait de feu me zèbre l’avant-bras.
Je bondis… Cette carne de Dickson avait un rasoir dans sa poche… Il est parvenu à le récupérer et il s’en est servi pour éventrer son sac et me bondir sur le lardeuss à la première occase. Nature, je me croyais peinard avec sa pomme, vu sa position de saucisson en croûte ! Il ne faut jamais perdre de vue un adversaire…
Tout cela, je me le bonnis en moins de temps qu’il n’en faut au ministre des Finances pour voter un impôt nouveau ! Il s’agit de faire fissa si je veux conserver ma carotide en état. Les manieurs de razif, personnellement j’aime pas ça… C’est une arme de dégonflé ! Pour se promener avec ça sur soi, faut avoir une mentalité d’égorgeur… ou de garçon coiffeur !
Dickson m’a culbuté d’une ruée sauvage, un rédacteur sportif écrirait qu’il impose sa loi, qu’il prend le meilleur sur moi ou encore qu’il bouscule la défense adverse[7]. Ça chauffe pour San-Antonio, les mecs ! Du train où ça va, on va me retrouver débité en tranches… C’est ce qui se fait de plus pratique pour faire voyager quelqu’un dans une mallette avion !
Je me refous en boule (au sens propre du terme) et je roule au creux du fossé. L’autre truffe me suit… J’ai lâché ma loupiote et je vois la lame sanglante de son rasoir scintiller à la clarté de la calbombe céleste.
Heureusement j’ai toujours ma gomme à effacer le sourire. Je braque le canon sur Dickson.
— Stoppe, Figaro, ou je te pratique des orifices supplémentaires !
Autant jouer du Brahms à Popaul-le-sourdingue ! Il continue de me charger, fou de haine. Je recule encore, mais le talus me bloque, la lame s’avance sur moi. Alors, mande pardon, docteur, mais je perds le contrôle économique de mes actes, et mon antagoniste perd son acte de naissance. Pif, paf, pouf ! je lui envoie la fumée ! Il morfle le blaud dans le baquet, pousse un cri, tousse un brin comme le gars qui n’a jamais entendu parler des pastilles Valda, et s’écroule dans l’herbe.
Je me penche sur lui. Mon calibre a fait du travail sérieux. Dickson me paraît aussi mort que l’article de fond du Figaro. Je palpe sa poitrine : plus rien…
Alors j’empoche ma rapière et je me gratte le crâne, sérieusement emmouscaillé par la tournure des événements. On parlait gentiment, et puis voilà que les choses se sont gâtées. Manque de bol ! Qu’est-ce que je vais faire, maintenant, avec cette viande froide sur les bras ?
Il va y avoir du rififi dans le patelin, au petit jour… Enquête à l’hôtel, interrogatoire, etc. Sans compter que cette patate de Dickson est cannée sans m’avoir affranchi le moins du monde. Mon ignorance est intégrale…
Je lui pique son larfeuille et je jette un coup d’œil sur le contenu. Je trouve des fafs amerlocks au nom de Dickson, comme sur son passeport. Il y a aussi du fric… Je glisse celui-ci dans ma poche. C’est pas que j’ai l’habitude de détrousser les morts, mais j’aimerais assez que les condés italiens concluent au crime crapuleux. Un touriste ronflait dans son sac de couchage. Un truand passait… Il a voulu lui sucrer son pèze. L’autre n’a pas été d’accord… Patacaisse ! Oui, c’est la version idéale… Tous les clodos du secteur — et il y en a des paquets, faites-moi confiance — vont se faire ramoner l’alibi par ces messieurs du Guet ! Tant pis…
Moi, je vais farfouiller un peu dans la bagnole… Je ne trouve absolument rien d’intéressant. Vraisemblablement il s’agit d’une tire de location. Rentrons, les soirées sont fraîches.
Je grimpe dans ma brouette et après une manœuvre rapide, je reprends le chemin de l’hôtel…
Quatre heures du mat sonnent au clocher de ma montre-bracelet lorsque je franchis le porche du K2. Je remise ma bagnole et je rentre à pas de loup, comme toujours. Je ne tiens pas à signaler mon arrivée. Je me garde bien de repousser le verrou de la porte, car ça indiquerait que quelqu’un de l’intérieur a verrouillé après le caltage de Dickson…
Je regagne ma chambre, un peu vanné par ces émotions… Equipé en robe de chambre, les gars ! Elle a bonne mine, ma tenue de Casanova, je vous le jure ! Elle est froissée, tachée de boue, déchirée… La manche droite est presque en deux. Le sang l’a collée à ma peau et je passe une minute de jouissance à me la décoller de sur le lard.
Cela fait, je ne peux réprimer une très vilaine grimace car la plaie est plutôt moche ! Il n’y est pas allé avec le dos… du rasoir, Dickson ! La viande est ouverte sur le côté du bras, depuis le coude au poignet… Ça pisse dru… Pourvu que je n’aie pas laissé de traces sur mon chemin !
Du coup, les matuches n’auraient plus qu’à jouer au Petit Poucet, et je serais fabriqué vilain…
Je fais couler le robico d’eau chaude et je nettoie la plaie en me retenant de geindre parce que c’est un truc qui incite à chanter le grand air de l’Acné ! Voilà-t-il pas qu’on frappe doucement à ma porte. Charmant ! J’hésite… J’ai le feu dans la poche de ma robe de chambre… Je le pose à l’extérieur de la fenêtre, puis je vais ouvrir. C’est ma brave Félicie… Elle est en limace de noye avec un fichu sur les épaules et son air inquiet des grands days !
— Antoine, fait-elle, que se passe-t-il ?… Tu…
Elle ouvre de grands carreaux en avisant mon lavabo rouge de sang. Je lui mets la main sur les lèvres et la force à entrer.
— Ne dis rien, m’man…
— Tu es blessé ?
— Une simple coupure…
— Mais… Dans quel état es-tu ? Je t’ai entendu sortir, je ne pouvais pas dormir… Tu sais, lorsqu’il m’arrive de faire la sieste l’après-midi, la nuit qui suit…
— Je sais…
— J’ai cru que tu étais allé faire une promenade au clair de lune…
— Y a de ça…
— Que t’est-il arrivé, on t’a attaqué ?
— Oui !
— C’est affreux ! Montre un peu cette… Seigneur Jésus ! C’est ça que tu appelles une simple coupure !
— Ne te tracasse pas. Un coup de rasoir…
— Mais il faut porter plainte ! Appeler un médecin…
— Tais-toi, je t’en conjure, m’man… J’ai refroidi le type qui m’a fait ça !
Elle est pétrifiée.
— Hein ?
— Oui. Je lui ai cloqué trois prunes dans le buffet. Je crois qu’il est un peu mort sur les bords, à c’t’heure.
Elle est toujours disposée à me voter, les yeux fermés, les circonstances atténuantes.
— C’est de la légitime défense, cela ! Dieu merci, les lois…
— C’était de la légitime défense de sa part, m’man… Ecoute, faut que je te fasse un aveu.
Ça me fend le cœur de la décevoir, mais je lui bonnis tout le pacson, comme quoi je suis en mission et ne l’ai amenée avec moi que pour me servir de façade. Vous croyez qu’elle est déçue ? Pas du tout ! Ce qu’elle voit dans tout ça, c’est que son cher bambin a effacé un sale coup…
Elle devient énergique, comme toutes les femelles de la création lorsque leur progéniture est en danger…
— Il faut de l’alcool, Antoine…
— J’ai un flask de scotch, m’man… Ça titre 43 degrés !
— Donne…
Je pique la boutanche dans ma valoche… Félicie se dégrouille de dévisser la capsule et elle arrose ma plaie avec le contenu…
Ensuite elle va chercher une de ses chemises de toile, la déchire en lanières et me fait un pansement énergique.
— Il faudra surveiller ça de près pour le cas où ça s’infecterait. Que vas-tu faire, maintenant ?
Sa question me colle le pif dans la réalité emmouscaillante.
Oui, que vais-je faire ? Le 28 est écoulé. Il s’est produit une chose absolument différente de celle que nous escomptions… Le seul type douteux que j’ai identifié dans l’hôtel est mort… par mes soins ; alors ?
Je ne mets pas longtemps à décider. Alors, il reste encore sa femme. Et faut en profiter, vu que ça ne durera pas longtemps. D’une minute à l’autre, on va découvrir ma victime… Avant midi on saura qu’elle était descendue au K2 et les archers vont se pointer.
Ce que deviendra Mme veuve Dickson après ça, nul ne peut le dire. Conclusion : il faut que je l’interviewe avant tout le monde. Félicie emporte ma robe de chambre afin de la remettre un peu en état. Je change de pyjama, me donne un coup de peigne, vide ce qui reste de scotch dans mon gosier, embrasse Félicie en lui recommandant de se coucher. Puis je récupère mon feu sur l’appui de la fenêtre et je me dirige enfin vers la chambre de Mme Dickson.
Une fois devant la lourde, je tends l’oreille… Je perçois le bruit régulier d’une respiration. Elle dort, la veuve… Confiante.
Je voudrais bien l’éveiller sans ameuter l’hôtel… J’espère qu’elle n’a pas le sommeil en béton armé !
Après une hésitation de courte durée, je me décide à commencer une séance de grattouillette à sa lourde car rien ne s’entend plus qu’un heurt classique avec le doigt replié.
Mais c’est macache ! Elle continue d’en écraser.
Alors, que voulez-vous, j’ai recours à mon copain le petit sésame… L’outil qui ouvre tout, sauf l’appétit !
CHAPITRE VII
C’est toujours émouvant de pénétrer de nuit dans la chambre de quelqu’un, surtout lorsque ce quelqu’un est une des plus jolies poulettes qu’il m’ait été donné de rencontrer.
C’est le bruit de la porte en se refermant qui la tire des toiles. Elle sursaute et murmure :
— C’est déjà toi, Paul ?
Puis elle donne la lumière et me considère exactement comme si j’étais un pélican en maillot de bain.
— Vous ! dit-elle enfin.
Je m’approche, la bouche fleurie d’un sourire ensorceleur.
— En voilà des façons, attaque la mousmé, comment êtes-vous entré ?
— On m’appelle le passe-muraille dans l’intimité… Les jolies dames me résistent quelquefois, mais jamais leur porte.
— En attendant, filez d’ici…
— Doucement, ma jolie… Je ne viens pas pour abuser de vous, mais seulement de vos instants ! Et puis aussi…
Je la regarde. Je lis une violente colère dans ses yeux, également un brin de curiosité.
Elle fait d’une voix oppressée :
— Et puis aussi ?
— Vous annoncer une mauvaise nouvelle.
— Laquelle ?
— Dickson est mort !
Elle reste immobile, un peu interdite par cette déclaration. Elle ne sait pas ce qu’elle doit penser de mon intrusion. Des bribes de sommeil traînent encore sur la réalité.
— Que racontez-vous ?
— Que Dickson, ou Paul, si vous préférez, est mort à quelques kilomètres d’ici, sur la route de Ravenne. Ça lui est arrivé peu de temps après avoir remis la petite à deux gars en bagnole… Vous êtes au courant !
Ah ! mes aïeux ! Jamais je n’ai vu un visage se décomposer aussi vite et aussi totalement.
— Paul ! balbutie-t-elle. Paul est…
— Mort, oui, ma bonne dame. Il a pris trois balles de ce pétard dans la poitrine et c’est un truc dur à digérer lorsqu’il est administré à bout portant !
Elle bondit :
— Vous l’avez tué ?
— Chut, inutile de réveiller l’hôtel. Je l’ai buté pour sauver ma peau, il est probable que ce décès passera pour le meurtre d’un rôdeur. Tenez, voilà le fric qu’il avait sur lui… Je ne mange pas du pain de mort !
Je jette la liasse de gros bifs sur le lit. Elle regarde les feuillets rosâtres d’un œil vide.
— Vous avez intérêt à ce que cette version soit accréditée, mon petit, parce qu’autrement ça se gâterait pour vous. Si la police en découvre trop, vous serez impliquée dans une histoire d’espionnage, de contrebande et peut-être aussi…
Là, je la regarde, saisi d’une inspiration formide, comme il m’en vient assez fréquemment.
— Et aussi de rapt d’enfant, chère madame Dickson…
— Qui êtes-vous ? demande-t-elle.
— Commissaire San-Antonio, des Services secrets français.
Ça lui file un traczir monumental. Elle doit en avoir une pleine lessiveuse sur la conscience.
— Le propre d’un agent secret, dis-je, c’est d’être non seulement secret, mais discret ! Pour que je puisse l’être, il faut que je sois au courant de tout, en détail. C’est pourquoi vous allez parler. Votre mari est mort pour ne l’avoir pas fait, j’espère que vous aimez assez l’existence pour ne pas charger ma conscience d’un nouveau meurtre ?
Tout en parlant, je joue avec mon pétard.
— Un accident est vite arrivé, ma belle. Vous prenez une olive dans le chignon, je vous colle l’arme dans les pattes et je sors en appelant à l’aide. On pensera que vous avez tué votre mari…
Je hausse les épaules.
— J’ai l’air, comme ça, de vous inventer une histoire policière, mon lapin… Et une mauvaise, soit dit entre nous et un plat de ravioli, pourtant elle marcherait à tous les coups.
La belle rousse, faut que je vous affranchisse, manière de vous faire sécréter les glandes, porte une limace de noye transparente dans les mauves printemps. On a l’impression de la regarder à travers un nuage. Dans son émotion, elle a paumé un sein et je louche un peu dessus…
— Que décidez-vous, beauté ? Vous l’ouvrez ou bien je continue de faire des malheurs ?
Elle hésite. Pour lui affirmer que ça n’est pas de la rigolade de carabin, j’y mets une mandale sur le museau. Elle en a la joue toute rouge.
— Excusez du peu, je suis pressé. J’espère que vous n’allez pas m’obliger à vous esquinter ?
Je l’espère d’autant plus vigoureusement que cette gifle m’a littéralement arraché l’avant-bras. Ma blessure a dû se rouvrir…
Ça me lance terriblement…
— Bon, si vous tardez encore, je vous chope par la taille et vous passe par la fenêtre… Vous commencez à me fatiguer, les Dickson’s partners, vu ?
La colère m’emporte… Je biche la chemise arachnéenne et la fends par le mitan. O vision fugitive ! Elle a beau se draper dans son drap de lit, la donzelle, j’ai pris mon billet de corbeille !
— Joue pas les fantômes, fillette, t’es beaucoup trop en chair pour ça !
Je m’assieds au bord du lit et je lui roule un patin à la soudard !
Sa surprise est telle — la mienne itou d’ailleurs —, qu’elle ne songe pas à se rebiffer. Petite cause grand effet, comme par enchantement, ce baiser suivant de très près mes sévices, lui déclenche une crise de nerfs. Elle se met à chialer comme le Niagara en appelant son Popaul… Elle rue, se débat, étouffe, couine, piaille, grogne, se trémousse… Je fonce au lavabo pour puiser un verre de flotte qu’elle prend en pleine poire… Ça la stoppe… Trois secondes plus tard, c’est une espèce de lamentable loque qui hoquette dans mes bras.
— Allez, môme, lui fais-je doucement à l’oreille, cesse de jouer les Mata-Hari pour quartier pauvre, et dis-moi tout, ce sera plus fastoche. Je ne demande qu’à te tirer du bousin !
Elle a un mouvement d’assentiment.
Cette fois, mes petits, je tiens le bon bout avec cette greluse.
— Commençons par le commencement. Ton Dickson n’était pas amerlock, hein ?
— Non, il est français.
Elle n’arrive pas encore à parler de lui au passé, ça viendra, ça vient toujours. Ensuite, on se demande comment les disparus ont fait pour avoir été là…
— Son vrai nom ?
— Paul Sion !
Je tique.
— L’ennemi public ?
— Oui…
Nom d’une endive meunière, j’en apprends une chouette ! Sion était une des épées du mitan en France après la Libération. Hold-up, faux fafs, traite des blanches, il avait tout ça à son pedigree, plus quelques règlements de comptes tapageurs : un taulier descendu à Marseille en pleine Canebière, et deux autres autour de Pigalle sous le nez d’un gardien de la paix !
Et puis ç’a été tellement brûlé pour sa pomme qu’il a disparu… Le bruit courait qu’il s’était fait flanquer à la Seine par des amis avec son bloc de béton de cinquante kilos attaché au bide… Des charres !
Monsieur s’était gentiment installé en Afrique du Nord sous un passeport amerluche, m’explique sa nistoune, laquelle est anglaise.
Je profite de son état dépressif pour la questionner bien à fond et c’est ainsi que, par petits morceaux, je découvre le pot aux roses. Sion faisait partie de l’organisation AA1 depuis qu’il avait quitté la France.
Il était devenu le sous-fifre de Bucher, le grand patron de AA1, un ancien G.I. qui, ayant goûté de l’Europe, n’avait plus voulu retourner dans ses Etats. Ensemble, ils avaient réussi des coups fumants. Le dernier en date concernait l’achat à l’Angleterre d’une importante cargaison d’armes qui s’était effectuée par l’intermédiaire d’un petit pays d’Amérique centrale.
Pour des achats de cette importance, le processus était toujours identique. Les Affaires étrangères d’un minuscule pays passaient la commande et Bucher rachetait en sous-main. Il prenait directement possession de la marchandise qu’il livrait où bon lui semblait.
Pendant quelques années, tout avait bien boomé entre Sion et Bucher, et puis, récemment, les choses s’étaient gâtées. Sion n’avait pas le tempérament à jouer longtemps les seconds plans. Il avait décidé de se mettre à son compte en faisant un gros coup d’arnaque à son chef. Vous me suivez toujours ? Les ceuss qui seraient un peu paumés dans les méandres de ces explications n’auront qu’à échanger le présent ouvrage contre un abonnement à Rustica. O.K. ? Alors je poursuis…
Profitant d’un voyage aux Etats de Bucher, c’était l’ancien gangster qui avait négocié les transactions pour le dernier achat. Ensuite, il s’était mis en contact avec un gros mouvement terroriste arabe qu’il savait financé par des pontes solides du larfouillet. Il allait leur brader la camouse, et les Africains ne se tenaient déjà plus de joie devant cette aubaine, lorsque Bucher avait cru bon de jouer « Reviens-veux-tu ». Lui n’était pas d’accord pour solder ce lot de « Tout à cent francs » à ces clients-là. Il en avait dégauchi un meilleur prix autre part. La scission s’était alors produite entre les deux truands… Gros bidule, les gars ! Du Wagner chez Messieurs les Hommes, avec cymbales et dégustation de nez !
Bucher allait l’emporter… Sion, très emmouscaillé, voyait ses clilles de la ligue arabe lui tomber sur le pardingue. Pour s’en tirer, il avait fait un coup à sa manière : enlevé la fille de Bucher. Moyennant la forte pincée, il la refilerait aux Arabes qui, ensuite, n’avaient plus qu’à l’échanger contre la cargaison.
Parvenu à ce point du résumé, je dis à la pseudo Mme Dickson :
— Et c’était toi la nounou ?
— Oui… Les rebelles arabes avaient envoyé quelqu’un pour prendre livraison de la petite… Mais ce quelqu’un est mort dans un accident d’avion…
— Kazar ?
— Ah, vous savez…
— Comme tu vois, ma belle. Alors Sion a pris un nouveau rendez-vous avec ses fameux clients, n’est-ce pas ?
— Oui…
Je me gratte le bocal, perplexe… S’il y a une chose qui me défrise les poils des jambes, c’est bien un rapt d’enfant. Voyez-vous, bande de chétifs de la coiffe, pour moi, un môme c’est sacré. C’est un truc en dehors de la vie qu’on doit respecter plus que tout et qui, en aucun cas, ne saurait servir de monnaie d’échange, voire d’instrument de pression.
La pensée de cette pauvre gamine, trimbalée entre les Dickson et les Arabes, me contriste. Je suis d’autant plus inquiet sur son sort que je la vois mal partie avec ces derniers.
Je reviens à mes moutons, c’est-à-dire à ma brebis galeuse.
— Elle s’appelait comment, déjà, la gosse ?
— Carolyne…
Un instant, je la revois, courant sur la plage avec les petits macares de l’endroit. Lorsqu’elle va s’éveiller, tout à l’heure, elle poussera une drôle de grimace en voyant qu’elle a changé de proprio.
Bon, San-Antonio, ça va être à toi de jouer, mon fils… Et pas de fausse manœuvre, hein, mon chou ? Ou alors t’auras droit qu’à ton cercueil la foule vienne et prie !
— Où peut-on trouver Bucher ?
Elle ne répond pas.
J’éclate.
— Espèce de sauteuse à la manque, tu vas me le dire illico ou je mets ta jolie frime en compote ! T’as pas honte, dis, roulure, de prêter ta paluche à des combines aussi dégueulasses ?
Tout en parlant, je lui bourre la bouille de petits coups de poings très secs. Sa chouette portion devient une espèce de punching-ball vivant. Elle part de gauche à droite, d’avant en arrière, pétant contre le panneau du pieu.
— Vas-y, tordue ! Parle ou je t’écrabouille comme une araignée !
Elle pleurniche :
— Laissez-moi, vous me faites mal… Vous êtes un lâche…
— Et kidnapper une pauvre gosse, ça n’est pas de la lâcheté, des fois, hein ?
Une nouvelle mandale, mieux décernée que les précédentes, a enfin raison de sa résistance.
— Bucher est à Montreux, en Suisse… Il habite au Léman-Palace…
— T’es certaine ?
Je l’examine sous le nez pour voir si elle cherche à me carotter, mais je ne le pense pas.
— Parfait, ma fille… Je prends le tuyau pour bon. Mais écoute bien, si jamais tu m’as monté un turbin, je te retrouverai et alors tu pourras te commander un manteau toutes saisons chez le menuisier du coin ! En attendant, tiens fort ta langue, compris ?
Elle hoche du cigare.
Un peu flétrie de la toiture, la gamine ! Elle s’en souviendra de cette noye !
Je la quitte pour regagner enfin ma base… Une fatigue carabinée me cisaille le paletot. Le jour se lève sans bruit… Comme je n’ai rien de plus urgent à faire, je me glisse dans les toiles après avoir bu un grand verre d’eau. Demain, j’aviserai. En attendant, je dois récupérer.
Ma blessure me donne un peu de température… Pourvu qu’il n’y ait pas de complications de ce côté-là ! Parce que, franchement, sans être le fakir Duchnock, on peut prédire que je vais avoir besoin de mes deux bras dans les jours qui viennent !
DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE VIII
Le lendemain, comme prévu, mes condés radinent au K2 pour présenter leurs bien sincères condoléances à la mère Dickson. Elle pique la crise de nerfs numéro 4 bis prévue au décret, on la console, la radio annonce qu’un touriste amerlock a été scraffé par un rôdeur… L’ambassade ricaine proteste auprès des autorités compétentes qui promettent de l’être et on transporte la bidoche de l’ennemi public dans une chapelle ardente… Tout ça sans que votre petit camarade San-Antonio (l’homme qui remplace le beurre parce qu’il s’est enfin débarrassé d’un préjugé qui lui coûtait chérot) soit inquiété[8].
Vers dix plombes, je me fais la grande toilette, je me nippe comme un lord qui aurait de la fantaisie… Et je descends.
M’man est dans le hall, très inquiète. A ses pauvres yeux cernés, je devine qu’elle n’a pas pioncé de la nuit. Je lui donne la bise affectueuse qu’elle attend et je lui explique en termes mesurés que je suis obligé de faire un voyage en Suisse.
— Pendant ce temps, tu m’attendras ici, m’man… Tu es bien, ça te repose. Dans deux jours, au grand maxi, le petit Antoine revient et t’emmène visiter Venise, d’accord ?
Elle soupire, sachant qu’elle ne peut rien contre mon job. Les mères des terre-neuvas savent que la mer est plus fortiche qu’elles. Eh bien, Félicie sait que mon job passe avant mon amour pour elle.
C’est ainsi… La vie est moche. On a des chiares, on les aime immédiatement, on se flanque au feu pour eux, on les couve, on pense chacun de leur pas, on tremble pour eux… Et puis le jour vient où ils vous glissent des mains pour entrer à leur tour dans la fournaise de l’existence !
Je commande à Gigi deux œufs bacon en guise de petit déjeuner. Ça fait plaisir à m’man. Elle aime me voir avaler de la boustifaille. Le jour où j’arriverai à croquer un bœuf sous ses yeux sera le plus beau de sa life.
— Il y a du danger où tu vas ? demande-t-elle.
— Pas le moindre, ma petite bonne femme. Une simple discussion d’affaire, alors tu vois…
— Et ton bras ?
— T’inquiète pas… je l’emmène avec moi…
— Il te fait mal ?
— Absolument pas… Tu sais bien que ma viande pousse comme le chiendent ? Je te parie que c’est déjà cicatrisé…
— Je vais te refaire ton pansement.
— Mais non, il faut laisser faire la nature, ma poule, t’occupe pas…
Je lui laisse un gentil petit pécule et je refile un pourliche d’archiduc à Gigi en lui recommandant de bien soigner Félicie pendant mon absence. Il promet. Je déhote !
Il fait grand nuit lorsque j’arrive dans cette pimpante cité helvétique. Naturellement (et s’il vous reste pour dix grammes de matière grise, vous vous en doutez) mon premier soin est de descendre au Léman-Palace.
Mordez le bath établissement ! De la crèche pour rupinos ! Les zouaves qui débarquent céans n’ont pas leur compte en banque gonflé au gaz de ville, je vous en fiche mon billet ! Il y a un hall dans lequel on pourrait conclure la rencontre Suisse-Hongrie de football, des tapis épais comme des bottins, de gigantesques plantes vertes qui valent une fortune sous notre latitude et pas un maravédis sous d’autres… Des larbins en uniforme de grand amiral suisse, des touristes avec de gros bides nourris au caviar, des péteuses platinées dont un seul regard suffit pour faire la fortune des marchands de boutons du coin… Sans parler des lustres qui ne tiendraient pas à Saint-Pierre-de-Rome, et des fauteuils tellement profonds qu’une équipe de spéléologues pourrait y disparaître à jamais. Bref, vous voyez un peu le genre du pourquoi du chose ?
Je fais un brin pedzouille lorsque je radine à la réception. Je demande une carrée et on me cloque une piaule au sixième. Ensuite, je demande si M. Bucher est laga présentement. On me répond qu’il n’est pas encore rentré, mais que sa femme est au lit, souffrante.
Je remercie et confie mon petit embrasse-en-ville à un bagagiste qui organise une croisière vers l’ascenseur.
Lorsque je suis dans ma chambre, je refile dix francs suisses au mouflet en lui recommandant de me prévenir discrètement dès que M. Bucher rentrera. Il est d’accord. Je ne sais pas ce qu’il s’imagine… Peut-être rien du tout. En tout cas il se retire fier comme bar-tabac[9] avec son billet.
Je décroche le bigophone et réclame d’extrême urgence une assiette de viande froide et une bouteille d’œil-de-perdrix.
Ça va me permettre de patienter en attendant l’arrivée du gars Bucher.
Seulement, je nettoie le plateau, vide la bouteille et rien ne s’est encore signalé à l’horizon. Fatigué, je m’allonge tout fringué sur mon lit… J’essaie de fumer une pipe pour me tenir éveillé, mais le sommeil est plus fort que ma volonté… Je coule à pic dans un repos que j’espère au moins réparateur. Combien de temps dors-je ? Il me serait malaisé de le préciser. Toujours est-il que lorsque la sonnerie de mon bigophone se met à vibrer, j’ai l’impression d’être en pleine forme.
La voix traînante du petit groom m’annonce :
— M. Bucher vient de rentrer, monsieur.
— Merci. Quel est le numéro de sa chambre ?
— Appartement 72, rectifie le préposé qui tient bien à préciser qu’un monsieur de l’importance de Bucher ne saurait se contenter d’une chambre.
Je raccroche et saute de ma planche à clou. Ma breloque marque deux heures du matin… Du moins c’est moi qui les estime « du matin » ces deux heures-là, le cadran de ma montre ne faisant qu’un circuit de douze plombes pour débiter une journée de vingt-quatre. Si vous trouvez que je philosophe d’une façon trop hermétique, faites-moi signe, je vous raconterai l’histoire du nègre qui vient de recevoir la flotte et qui entre dans un bistrot en demandant « un petit blanc sec ».
J’ai la clapeuse épaisse… L’œil-de-perdrix qui m’en a mis un petit coup dans la vue ! Au fond, la nuit, on ne devrait écluser que du vin de messe, comme le dit si justement l’abbé Résina dans son traité sur « L’incidence de la langue braisée dans la Société Moderne ». Je me rince le bac au lavabo… Un petit coup de flotte sur le front… Je calamistre ma chevelure, renoue ma cravate, époussette mon futal, lustre mes godasses avec les rideaux de la fenêtre comme le font tous les Français quand ils descendent dans un hôtel et, ainsi remis à neuf, je pars à la recherche de l’appartement 72.
Un videur de tinette diplômé me rancarde. C’est au second… Il y a vue sur le Léman et l’eau chaude sur l’évier…
Je m’annonce donc devant la lourde à double battant du 72. Un rai de lumière filtre par en dessous.
Je prends un léger temps pour laisser tomber ma tension artérielle. Puis je frappe.
Une voix d’homme demande avec un fort accent yankee.
— Qu’est-ce que c’est ?
Sans me démonter (je ne me démonte jamais sachant bien que je ne saurais pas me remonter, n’étant pas bricoleur pour un sou) je réponds :
— Un message pour M. Bucher !
Il fait fissa pour ouvrir, le Prisunic de l’arme à feu !
C’est un garçon beaucoup plus jeune que je ne l’imaginais. Il a dans les trente-six carats. Il est plutôt grand, avec une chevelure brune plaquée sur la tête comme un casque. Il a un petit nez en pied de marmite chevauché par de grosses lunettes d’écaille.
Ses yeux ont un éclat très intense. Il me regarde, constate que je ne suis pas un employé de l’hôtel et murmure :
— Que me voulez-vous ?
— Un instant d’entretien, monsieur Bucher.
— Qui êtes-vous ?
— Si vous me laissiez entrer, je vous le dirais. J’ai horreur de raconter ma vie dans un couloir d’hôtel…
Il grommelle :
— Come in !
Je pénètre dans un grand salon triste avec des dorures impensables, des meubles qui foutraient le cafard à un sachet de poudre hilarante, et des tableaux au mur qui vous donneraient envie d’avoir du Picasso chez vous jusqu’à la fin de vos jours.
Bucher me désigne un siège. Lui-même pose son socle dans un fauteuil. Il y a plusieurs flacons de whisky sur une table basse avec un siphon et des verres. Il se sert une rasade de scotch carabinée : plus d’un demi-glass. Il lâche dans tout ça un jet prostatique d’eau gazeuse et boit le total en moins de temps qu’il ne lui en a fallu pour le préparer.
— J’écoute ! grogne-t-il.
Je remarque alors combien son regard est étrange… Il y a dans ses yeux bleus à la fois de la clarté et de l’ombre, de la douceur et de la cruauté, de la faiblesse et une énergie peu commune.
— Bucher, je n’irai pas par quatre chemins… Je suis un zig des Services français…
Il ne bronche pas. On dirait que je lui chante le code civil sur l’air de La Main de ma Sœur.
— Quels Services ? demande-t-il.
— Les Services secrets, mon cher monsieur.
— Et alors ?
— Alors ne cherchez pas à me snober parce que ça ne prendra pas. J’en ai maté d’autres plus épais que vous, Bucher… Votre petit ami Sion, par exemple.
Là, il sourcille légèrement. Mais son mutisme demeure absolu.
— Bucher, je suis chargé par mon gouvernement d’empêcher la cession de votre dernière cargaison d’armes aux rebelles arabes. Vous voyez, j’y vais carrément… Je peux me permettre ça étant donné que je suis au courant du rapt de votre enfant…
Il a sa première vraie réaction et c’est une réaction de père.
— Vous savez !
— Mieux, avant-hier, je tenais Carolyne sur mes genoux…
Il se lève, vient à moi.
— Qu’est-ce que vous dites ?
— Que j’ai joué avec votre petite fille, parfaitement… Seulement, à cet instant, je ne savais rien de ce kidnapping… Lorsque j’ai su les détails, il était trop tard…
A mon tour, je lui désigne un siège. A mon tour je vais à la table supportant les flacons de scotch…
Je me prépare un formide…
Puis, l’ayant ingéré, je fais à Bucher un récit on ne peut plus complet de mes démêlés avec son ex-associé. Je ne lui passe rien, ni ce qui m’a amené à Cervia ni ce qu’il est advenu du sieur Dickson, alias Sion.
Il m’écoute sans broncher, les mains croisées sur un genou, très droit. Son regard étincelle.
Lorsque j’ai terminé mon récit, il murmure simplement :
— Carolyne est avec ces gens en ce moment…
— Oui.
— Alors pourquoi ne se sont-ils pas manifestés ?
— Je l’ignore.
— Ne serait-il pas arrivé malheur à l’enfant ?
— Rassurez-vous. Ils l’ont payée une somme trop rondelette… On ne brise pas les objets de valeur…
Il réfléchit un moment et demande :
— Pourquoi êtes-vous venu me dire ça ?
Je soupire.
— Nous y voilà, mon vieux !
CHAPITRE IX
Par mesure de sécurité, et afin de ne pas risquer la panne sèche, je lui écluse un nouveau gorgeon de scotch sans lui demander la permission. Du reste, je l’ai appris par les films made in U.S.A., aux Etats, on pratique comme ça. Chacun pour soi et Dieu pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir du raide de bonne qualité. Ce sont ceux-là les vrais perdants : ceux qui justement n’ont rien à perdre. Il y a des jours où je me dis que l’auteur de la fameuse maxime : « L’argent ne fait pas le bonheur » devait être plein à craquer. Autrement, jamais il n’aurait pensé à débloquer de la sorte.
Bucher me suit du regard ; au fur et à mesure que je tarde à parler, sa figure se crispe. Il est tendu comme un félin pourchassé.
Prenant enfin son exaspération en considération, je m’approche de lui, me mets à califourchon sur une chaise et j’attaque.
— On a toujours intérêt à faire un dessin pour résumer la situation, rien ne l’éclaircit davantage. Nous allons donc en faire un…
Je sors mon stylo, pas l’explosif, le vrai. Tout en crayonnant, je commente :
— Voici un triangle, Mossier Bucher… Chaque angle représente un groupe d’individus… Ici, en haut, les types de la Ligue. Là, vous, la maison AAl… Enfin dans le troisième angle, nous, la maison France. Que désirons-nous les uns et les autres ? Hein ? La Ligue désire les armes. Vous, votre enfant. Nous, nous désirons que les armes ne soient pas vendues à la Ligue et, comme nous avons bon cœur, que vous retrouviez votre gamine. Vous me suivez toujours ?
Il hoche du bonnet, comme on dit chez Cinzano.
— O.K. (bon, v’là qu’à son contact, je m’américanise). Maintenant quels sont les atouts de chacun ? La Ligue a votre fille. Vous, vous avez les armes… Et nous…
Je stoppe et souris.
— Nous, Mister Bucher, nous n’avons rien ! Nous sommes donc particulièrement qualifiés pour intervenir. Notre seul argument, et il est de taille, c’est que nous avons le bon droit pour nous et que nous disposons de moyens d’action officiels, comprenez-vous ?
Bucher secoue la tête.
— Précisément, fait-il, je ne comprends pas. Quand on n’a rien à vendre, on ne va pas s’installer au marché ! Ceci est une affaire entre la Ligue et moi… Ceux qui me rendront ma fille auront les armes, c’est tout ce que je peux vous dire.
Il se lève.
— Et je pense que votre intervention est contre-indiquée, elle risquerait d’indisposer les kidnappeurs et de les amener à… à accomplir un acte irréparable pour moi… Vous êtes français, ici nous sommes en Suisse, vous n’avez aucun droit d’ingérence dans mes affaires…
— Ecoutez, Bucher, je crois que vous n’avez pas assez pensé la chose…
— Je crois que si.
— Non… Si vous étudiez un peu les histoires de rançon, vous constaterez… et je ne dis pas ça pour vous effrayer outre mesure, que ça se termine toujours mal pour la partie sur laquelle s’exerce le chantage. La Ligue va vous demander les armes. Parfait… Mais elle vous promettra votre gosse contre la remise de la cargaison.
« Vous aurez beau ergoter, refuser, exiger le donnant donnant, vous devrez en passer par là, parce que, foutez-vous bien ça dans le crâne, c’est vous qui êtes vulnérable dans cette aventure. Si la transaction rate, pour eux, ça représente une grosse affaire foutue. Mais si elle rate pour vous, c’est votre cœur qu’on vous arrache, pour employer le style mélo. »
— Je saurai négocier l’affaire, dit Bucher. Ne vous tourmentez pas pour moi, monsieur… heu…
Je ne crois pas opportun de lui filer mon blaze.
— Une fausse manœuvre et vous ne revoyez plus votre fille !
Il me touche l’épaule du bout des doigts.
— Et vous, monsieur le flic français, vous êtes certain de ne pas en faire, de fausses manœuvres ?
Il me chope au débotté. Pourtant je conserve toute mon assurance.
— Parfaitement !
— C’est pour le coup que ces salauds commettront le pire lorsqu’ils sauront que la police française est sur l’affaire !
Je m’approche de lui à le toucher. Il y a des lueurs fulgurantes plein les vitres de ses besicles.
— Si vous ne marchez pas avec moi, je ne stopperai pas mon enquête pour autant ! Vous voici prévenu… C’est pourquoi vous et moi avons intérêt à nous allier… Il y a chez nous un vieux proverbe (il y en a des tonneaux du reste) qui dit : « L’union fait la force ».
Bucher hausse les épaules.
— Les flics français sont juste bons à débiter des citations populaires, déclare-t-il. Pour du travail sérieux, efficace, c’est autre chose. J’aimerais mieux collaborer avec un boy-scout qu’avec vous !
Ah la vache ! Comme vannes, il en balanstique des paquets ! J’ai le raisin qui fait plusieurs tours…
Inutile d’insister avec cette truffe. Puisqu’il en est ainsi, je lui prouverai ce dont je suis capable et il me paiera ses sarcasmes avec des intérêts usuraires, c’est promis.
Je hausse les épaules.
— Très bien, allez chercher un boy-scout, j’agirai donc seul et nous verrons lequel arrivera le premier sur la ligne d’arrivée !
Sur ce, je fonce à la lourde d’un pas décidé.
Je quitte la taule sans m’être retourné, mais je sens l’œil aigu du trafiquant dans mon dos. Et ça vous tient plus chaud qu’un Rasurel, parole d’homme !
Très emmouscaillé, je l’admets, par la tournure des événements, je regagne mon terrier. Franchement, ça s’embringue mal ! Au lieu de faire front comme les loustics de la Ligue, nous voici à couteaux tirés, Bucher et moi.
Votre petit San-Antonio joli n’a pour lui que sa bonne mine et son certificat d’études primaires. A part ça, mort au taureau, je suis refait !
Je suis refait car, ne sachant où se terrent les ravisseurs de la petite Carolyne, je ne puis la récupérer pour reprendre les brèmes en main. D’autre part, Bucher ne me dira jamais où se trouve sa cargaison… Il a raison, le Ricain, c’est une affaire entre lui et eux. Pour mézigue, on inscrit au programme : « Va te faire cuire un œuf » avec le gars Bibi dans le rôle de l’œuf !
Il est tard… Je file un coup de périscope à ma tocante. Elle annonce trois plombes et des poussières… Non : il est tôt !
Je réfléchis… J’ai dans le bac un bon goût de scotch… Je n’ai pas sommeil et je me sens en forme.
Je décroche le bigophone et je dis au préposé de me faire grimper d’urgence un flacon de whisky et l’annuaire des téléphones de la Suisse…
Le service au Palace est impec… J’ai satisfaction en quatre minutes trois douzièmes… Y compris le temps que l’employé a mis pour réaliser mon coup de grelot…
Je me prépare un glass super-mahousse. Et tout en le sirotant, je feuillette l’annuaire. Je trouve rapidos ce que je cherchais, à savoir le numéro d’un pote à moi : Justin Bodard, chef de la police genevoise. Nous nous sommes connus l’an dernier chez des amis communs et je l’ai tellement fait marrer avec mes histoires de cornechose qu’on l’a opéré d’une hernie étranglée la semaine suivante. D’autre part, je l’ai revu à Paris où je lui ai facilité certaines démarches pour un voyage qu’il effectuait en A.O.F. Donc, c’est un garçon qui me veut du bien. Les Suisses sont des gars solides sur lesquels on peut compter et ils passent leur vie à le prouver.
Ils ne pigent peut-être pas très vite les histoires de Marie-Chantal, mais par contre ils savent ce que c’est que l’amitié.
Il va pousser une drôle de frime, Bodard, en recevant mon appel à pareille heure !
Je demande pourtant le numéro et je l’obtiens illico pour l’excellente raison que le biniou est automatique au pays de l’horlogerie et du frometon réunis. (Le comble n’est-il pas de les voir mettre du gruyère en montre ?)
Ça carillonne vilain, et longtemps… Quand il est dans les bras de l’orfèvre, il en met un sérieux coup, mon aminche !
Enfin une voix grasse comme une pâte à vaisselle dit :
— Aaaalllôôô ?
Je reconnais Bodard.
— Salut, Bodard, fais-je. Ici San-Antonio…
Un silence, le temps qu’il pige. Et puis il s’exclame. Il dit des « par exemple », des « comment ça se fait ? », des « si je m’attendais à vous », et enfin un : « que se passe-t-il », parce qu’il vient sans doute de bigler son horloge parlante et de s’apercevoir qu’il est une heure industrielle[10].
Je lui présente dans du papelard de soie les excuses d’usage pour mon appel tardif, ensuite je lui dis que je suis en mission secrète en Suisse pour une affaire qui intéresse toute l’Europe (là j’exagère un brin, mais je dois revendiquer comme excuse que le beau-frère de ma cousine germaine a vécu trois jours à Marseille). J’en arrive à ma requête :
— Mon cher Bodard, je voudrais que vous interveniez immédiatement auprès de la police de Montreux pour qu’on mette sur table d’écoute les communications destinées à un certain Bucher résidant au Léman-Palace.
Il se gratte le cervelet avec une idée pointue et s’exclame :
— C’est impossible, mon cher ami… Cela ne se pratique pas en Suisse… Et, en tout cas, ça nécessiterait un tas de formalités… A quel titre, voyons, nous occuperions-nous de la vie privée d’un étranger qui ne fait pas l’objet d’un mandat d’extradition ?
Je m’égosille :
— Au titre de la confiance en un ami, Bodard… Excusez-moi de vous avoir éveillé…
Je raccroche.
Décidément, je m’étais fait des berlues au sujet de la reconnaissance de mon collègue helvète.
Le temps que je parcoure trois fois le tour de ma carrée (doux euphémisme) et le bigophone remet ça… C’est Bodard. Il a eu l’idée d’appeler le Palace pour voir si j’y étais. Pas content, le gars ! Il est tout à fait éveillé cette fois et il me joue Marie trempe ton pain à la clarinette baveuse pour mon mouvement d’humeur. Il me casse une montagne de sucre, comme quoi il est prêt à me prêter assistance, mais dans la mesure où je ne lui demande pas l’impossible.
Je me radoucis comme une crème au caramel.
— Re-excuse, Bodard, mais je suis sur les dents… Ecoutez, le type dont je vous ai parlé va recevoir soit une visite, soit une communication téléphonique. Or il est indispensable, vous m’entendez ? Indispensable que je sois avisé de l’entretien…
Il réfléchit un moment.
— Bon, écoutez, je téléphone à l’inspecteur Cherio… Il a travaillé sous mes ordres et il vient d’être muté à Montreux… Je lui dis de vous voir et de se mettre officieusement à votre disposition… D’accord ?
— Mille mercis, Bodard… Et à un de ces quatre !
Il ne me reste plus qu’à attendre… J’allume une gitane, bois un nouveau scotch…
A cet instant, c’est-à-dire lorsque je repose mon verre vide, on frappe à ma porte. Voilà qui est bizarre. S’il s’agissait d’un employé de l’hôtel (et que me voudrait-il, grand Dieu, à pareille heure !), il se serait annoncé au fil.
Je glisse mon pétard sous un coussin et je vais à la lourde.
— Qu’est-ce que c’est ?
Une voix d’homme, pourvue d’un accent étranger que j’ai du mal à définir, murmure :
— Un ami de Bucher.
J’ouvre aussitôt. Je me trouve devant un type immense qui me dépasse de la tête. Il a un chapeau sur la sienne, des moustaches à la Brassens et un regard complètement éteint bien qu’il soit sombre comme la nuit du 4 août !
Il porte un costard prince-de-Galles.
D’un signe de tête je l’invite à entrer. Ce pèlerin-là n’a pas l’air commode du tout.
Lorsque j’ai refermé la porte, il me toise comme le fait un tailleur qui doit vous envoyer un costume par la poste.
— Je mesure un mètre soixante-douze, lui dis-je. Je suis plutôt brun et…
Je n’en dis pas plus. Avec une promptitude foudroyante, cet enfant de garce vient de me filer un uppercut au menton. Ce parpaing, croyez-le, il n’est pas allé l’acheter à la pharmacie Bailly !
Une locomotive fait explosion dans mon crâne. Tout devient intensément opaque et je sens le plancher qui fait bravo sous mes semelles.
Je m’écroule… Pas en plein pourtant… Je tombe seulement à genoux et je reste inconscient, la tronche appuyée contre le mur… Mon visiteur du soir en profite pour me tirer un shoot précis au creux de l’estomac. But ! Moustachu : un ; San-Antonio : zéro !
Tout le scotch que j’ai éclusé me remonte dans le naze… Je perds la notion exacte des choses… Insuffisamment cependant pour ne pas me rendre compte qu’au lieu de m’achever, l’escogriffe se dirige vers la croisée. Il l’ouvre grande et se penche. Ma chambre donne sur une vaste cour obscure… Depuis mon néant je pige ce que prépare l’envoyé de Bucher… Bien que nous ne soyons pas le premier avril, il s’apprête à me jouer une drôle de farce, pas drôle !
Bucher a flairé le danger que je présentais pour lui. Il a craint que mon zèle ne compromette les tractations et il a chargé un de ses troupiers de m’envoyer finir la noye chez Plumeau.
Impossible de remuer… D’ici tout de suite je vais aller cogner à la lourde de saint Pierre ! Et p’t’être bien que ce sera Miquelon qui me recevra !
Le grand vilain pas beau se la ramène… Par mesure de sécurité, il me cloque un nouveau coup de talon dans les éponges et ce qui me restait d’oxygène se taille de mes soufflets avec un bruit de pneu crevé…
D’une secousse il m’arrache du sol. Il a dû faire des haltères, le copain… C’est exactement comme si je ne pesais pas plus qu’un sujet de baudruche.
Il me coltine jusqu’à la croisée… L’imminence du danger me fouette le ciboulot. L’air frais me ranime un brin… Mais je ne parviens pas à remuer… Il me semble que j’assiste à ce qui m’arrive depuis le fauteuil du cinéma. On peut dire que rarement au cours de ma carrière j’ai été mis K.-O. aussi rapidos. Pas même le temps de dire bonjour… Et le travail fait main, sans le concours d’un instrument quelconque. Monsieur les Gros Bras est un artiste !
Il a pourtant du mal à m’expulser de la fenêtre, car celle-ci n’est pas très large, alors que moi je le suis. Il me pose contre la barre d’appui, les bras ballants à l’extérieur. Puis il me lâche afin de m’empoigner par les radis pour me donner la bonne secousse et me confier aux lois implacables de la pesanteur.
Je pense de toutes mes forces : « Réagis, Tonio, où tu vas jouer à la « torpille-chantée ». J’imagine avec un frisson, auquel participe une espèce de louche extase, le valdingue de six étages… L’atterrissage sur les mandibules… La nuit totale…
Je crois que mon réflexe agit plus vite que ne me le dictent ma volonté et ma trouille. J’ai une ruade éperdue du pied droit. Je sens que mon 42 fillette rencontre un corps solide… Je me retourne… Les Grosses Bacchantes a seulement titubé… Il revient à la charge, pareil à un taureau. Je prends un coup de boule dans le tiroir, un crochet à la tempe et je dis good night à cet univers décevant.
Une fois encore le K.-O. ne dure pas… C’est plutôt comme lorsqu’une prise de courant a un mauvais contact… J’ai des intermittences de pensée.
L’air de la nuit… La notion de ce vide perfide… Une peur sucrée… Puis je sens que ma carcasse n’est plus à l’horizontale… Le sang me monte, ou plutôt me descend à la tête, car je suis incliné en avant… J’essaie de crier, mais j’entends un « couac » lamentable. Deux étaux enserrent mes chevilles, ce sont les paluches effroyables de l’homme… Je bascule… Il pousse, la barre d’appui me racle la poitrine, puis la brioche… Ça y est, je pends… Même si je parvenais à lui échapper par une nouvelle ruade, il serait trop tard… Adieu m’man !.. Adieu, les potes ! Adieu, veau, vache, cochon, percepteur et entrecôte marchand de vin. Il termine sa représentation, le San-Antonio !.. Il va faire une dégustation de trottoir. Six étages à se farcir, ça ne pardonne pas, même quand on a la gueule de bois.
Je regarde avec horreur le fond sombre de la cour… La nuit est obscure… Le silence est intégral… Une suprême poussée du gnaf et me voilà parti… Chute libre — ô combien !
Descendez, on vous demande… C’est étrangement long… C’est moelleux. L’horreur de la situation a quelque chose de suave… J’attends de tout mon être… Et puis soudain : poum ! Je produis un bruit sec comme un coup de feu… Je ne bouge plus… Je suis canné ! Bon, c’était seulement ça la mort ? Pas la peine d’en péter un pendule ! D’écrire mille et un bouquins sur la question.
A ce tarif-là la mort est fumable… Je suis courbatu, seulement courbatu… J’essaie de remuer… Je le peux… Je regarde le ciel sombre où l’on aperçoit quelques étoiles pâlottes… Je vois le rectangle lumineux de ma fenêtre, tout là-haut…
J’essaie de me remettre debout, mais je n’y parviens pas car je glisse… Je palpe… Sous mes doigts je sens une toile de tente… Alors je pige tout… Au fond du Palace il y a une espèce de patio transformé en piste de danse… On a dressé un dais bleu pour abriter l’orchestre et l’estrade… Et c’est sur cette espèce de chapiteau de toile que j’ai atterri.
Ma réaction est imprévue. Je me fous à rigoler comme trente-six bossus chatouillés par Quasimodo !
CHAPITRE X
Voyez-vous, tas de machins indéterminés, ce qu’il y a de bien dans la vie (parfois, s’entend), c’est son ironie… Les renversements de situation qui s’y produisent… Avouez que le mot renversement convient merveilleusement, en l’occurrence pour la mienne !
Il faut reconnaître que je m’exprime dans une langue généreuse, riche en vocabulaire, propice aux métaphores les plus hardies, dans laquelle les mots ambigus abondent… Une langue qui sait toujours où se fourrer, comme dirait Brunswick ! Vous m’en donneriez trois briques que je ne vous la vendrais pas !
Il y a des moments où, après tout, la vie serait belle sans les hommes. J’imagine la planète pour moi tout seul… Je vivrais à loilpé sans crainte que des voyeurs viennent me mater… Des fois je dirais au Barbu de me piquer une côte première pour me fabriquer une Eve, histoire de lui faire part de mes sentiments dévoués, et puis je referais muter Madame en côtelette ! Dites, sans rire, c’est pas le rêve, ça ? Plus de cornichons pour me faire du contrecarre à longueur de journées sous prétexte qu’ils sont décorés ; que leur bagnole a deux chevaux et un âne au volant de plus que la mienne ; que leur dame porte de la peau d’animal rare ! Moi, pour l’hiver, en peau de percepteur que je me loquerais… Ou bien en peau de député, ça remplacerait le veau marin et c’est plus gras de l’intérieur…
Notez que je débloque sur le trajet, mais je sais bien que je me ferais vite tartir… Le temps me durerait de mes semblables avec leur bath couennerie ciselée, et surtout leurs vices cachés derrière des médailles, des fonctions, des uniformes, du drap anglais, des caveaux en marbre, des raisons d’Etat, des oraisons funèbres, des prix de vertu, des Prisunics, des piliers d’église, des colonnes de temple, des colonnes Vendôme, des cinquièmes colonnes, des colonnes de journaux, des lits à colonnes et des colonels !
Oui, j’aurais la nostalgie de ces bons contemporains. Le temps me durerait de leurs sublimes créations parmi lesquelles on compte : le Festival de Cannes ; la canne à pêche ; les romans de François Mauriac ; et le coup du père François !
Je médite sur ma toile de tente, insensible à cette douleur généralisée que le choc a levé en moi… Je suis étonné de vivre après avoir eu le goût de la mort dans ma bouche, après l’avoir comprise, après l’avoir acceptée ! Je suis ravi… Tout va continuer encore un peu : le ciel avec son soleil qui lui va si bien ; la mer trop salée, les morues trop dessalées et la musique de M.Mozart !
Au bout d’un instant je me laisse glisser de la bâche… Il me semble qu’on a frappé chaque centimètre carré de ma personne avec un nerf de bœuf…
Je marche sur le plancher de danse souple comme si c’était de la tôle ondulée. Ah, mes amis, je m’en souviendrai de ce numéro de cascadeur ! Les gars de Médrano m’attriqueraient une fortune pour m’inclure au programme… Avec la petite Nana de Montparnasse, celle qui ramasse une pomme verte en s’asseyant dessus, comme complément de programme, on serait assuré de faire du grisbi…
A prix d’or qu’il nous prendrait, Bruno Coquatrix, vu que le public commence à en avoir quine du jongleur chinois et du chanteur inaudible… On parcourrait la Suisse, l’Autriche ; puis ce serait l’Italie où m’man doit se faire tartir, et l’Espagne…
Non, pas l’Espagne, parce que là-bas la grande sœur à Nana ramasse les melons en s’asseyant et ça tuerait notre numéro !
Le patio est fermé par une grande porte vitrée qui se plie en accordéon dans la journée. J’essaie de l’ouvrir, mais c’est en vain… Je me fouille pour récupérer mon sésame… Ma main rencontre le stylo bidon, celui qui peut éventuellement faire sauter l’immeuble… Rétrospectivement ma pétoche va au maxi ! Vous vous rendez compte, si au lieu de jouer les Cradok sur la bâche, j’avais rencontré le paveton, ç’aurait pu donner un charmant feu d’artifice pour familles nombreuses. Les ploucs en vacances allaient se réveiller morts sur les toits voisins…
Je finis par récupérer mon ouvre-boîtes et la porte vitrée fait comme ses petites camarades : elle me cède.
Un zig qui les écarquille comme pour un mariage, c’est le veilleur de nuit, lorsqu’il me voit surgir… Il a un geste pour s’essuyer les lampions, suivi d’un autre pour s’emparer d’un instrument contondant quelconque. Il ne trouve rien à dire et rien pour cogner. Moi je l’amadoue d’un sourire vanillé.
— Ne vous tracassez pas, mon cher, lui dis-je, je ne fais que passer, j’étais descendu prendre l’air… Si on me demande, vous direz que j’habite le 161…
Je me dirige vers l’ascenseur. A ces heures, les liftiers sont au septième ciel. J’actionne le bidule comme si j’avais marné aux Galeries Lafayette pendant la saison des fêtes et je m’offre le second… Je vais jusqu’à l’appartement de Bucher… Je perçois un bruit de conversation… Deux hommes jactent en anglais… Je vous parie un jour de l’an contre un an et un jour que c’est le maître du AA1 qui se fait rendre compte de mon plongeon par son homme de main.
Je me casse jusqu’à l’angle du couloir… Entre l’appartement de Bucher et l’escalier, il y a des gogues… J’entre sans prendre la peine d’éclairer et je tiens la porte légèrement entrouverte…
Tapi dans l’obscurité, j’attends en retenant mon souffle. L’endroit n’est peut-être pas idéal, mais je m’en tape ! Je ne suis pas là pour faire la conversation à la duchesse de Prans-Mele.
Un courant électrique vadrouille dans mes muscles… J’ai mal partout. C’est maintenant que je sens le plus les effets du plongeon ! Après un entraînement de cet ordre, je suis bonnard pour les Jeux olympiques ! Je reviendrai avec des médailles en gold tout autour du baquet !
Soudain un léger bruit de lourde s’ouvre et se referme et un pas feutré sur le tapis du couloir…
A toi de jouer, San-Antonio !.. Et rappelle-toi que le zig qui a dit que la vendetta se tortorait à froid n’avait jamais fait de pique-nique !
CHAPITRE XI
C’est bel et bien Moustachu qui passe dans le couloir. Le moins qu’on puisse dire de lui, c’est qu’il est décontracté ! Voilà un brave homme qui défenestre ses contemporains dans un grand hôtel et qui, un quart d’heure plus tard, s’offre encore le luxe de traînasser dans les étages ! Il fait pas de complexes, je vous jure !
Mon premier mouvement en le voyant passer est de lui bondir sur le poil pour lui faire déguster ma droite au foie… Mais je me dis que ce fumier est fort comme toute la Turquie. Cette fois il serait chiche de me balanstiquer dans la cage de l’ascenseur et du coup ma colonne vertébrale commencerait à crier classe ! Le plus marle, c’est encore de lui filer le train. Mon heure ne tardera pas… Je la désire trop pour que le premier clocheton venu me la refuse encore longtemps.
Poil-sous-le-naze dédaigne la cage métallique de l’ascenseur et emprunte l’escalier (lequel est sans intérêt). J’attends qu’il se soit payé un étage avant de déhoter de ma guitoune. Ensuite je fonce sur ses talons.
La porte tournante du Palace est encore animée d’un mouvement de rotation lorsque je parviens dans le hall. Le veilleur de nuit se frotte à nouveau les vasistas en m’apercevant. S’il avait lu Shakespeare, il me prendrait pour le fantôme de service. Je lui adresse un salut très courtois et je murmure, pensant au poulardin que mon ami Bodard doit m’expédier…
— Si on me demande, dites que je ne vais pas tarder…
Là-dessus, je sors à mon tour. L’aurore rôdaille derrière les montagnes… Une petite pluie fine met comme un frisson dans l’air frais de cette fin de nuit. Et vlan ! me voilà de nouveau en train de poétiser… Ah, c’est dur à camoufler, le talent, je vous promets !
Je file un coup de saveur à gauche, un autre à droite… Et je finis par apercevoir mon agresseur qui s’éloigne, les épaules rentrées sous son bitos.
La poursuite s’engage sous la bruine. Moustachu arque vite. C’est duraille de le suivre en rasant les murs, d’autant plus qu’il s’engage en terrain découvert, le long du lac. J’espère qu’il ne m’entend pas… La flotte produit un bruit menu qui, heureusement, feutre celui de mes pas. J’espère qu’il ne va pas à pinces jusqu’à Lausanne, le frelot ! Le Marathon, après la secousse que j’ai essuyée, ça n’est pas mon fort.
Nous parcourons un millier de mètres à la queue leu leu, enfin il s’arrête devant une maison de modeste apparence. Il tire une clé de sa poche et ouvre le portail rouillé qui émet un grincement déchirant… Il referme soigneusement, remonte une brève allée semée de graviers, escalade un court perron et, se servant d’une autre clé, il pénètre dans la maison… Je guette, les gobilles rivées à la grille. Je vois une lumière par l’imposte au-dessus de la porte. Puis elle s’éteint… pour réapparaître immédiatement après à une fenêtre du premier étage… J’aperçois l’ombre massive du gars derrière les rideaux… Il doit se déloquer, à en juger par ses gestes. Puis il se zone, aussi sec, et la façade du pavillon retombe dans l’ombre.
J’attends un bon moment contre ma grille, sans savoir exactement quelle attitude adopter… Il serait plus sage de rentrer me pager moi aussi. Après de telles émotions, j’ai droit à un moment de repos au même titre que les héros morts ont droit à une minute de silence… Seulement vous oubliez une chose, bande de noix vomiques ! C’est que San-Antonio, c’est pas le genre de type qui remet à une date ultérieure ce qu’il peut faire le jour même, vu ?
Je respire un grand coup l’air mouillé du matin pour me purifier les soufflets, puis j’escalade la grille… Le portail grince trop pour que je le force avec mon petit bijou.
Une fois à l’intérieur de la propriété, je marche sur la pelouse mal entretenue pour éviter le crissement des gravillons… Mes targettes à semelles crêpe ne font pas de bruit sur le perron. Je biche l’ami sésame et je le suce un peu avant de l’introduire dans la serrure… Ça évite tout cliquetis, essayez-le, c’est radical, comme dirait Mendès !
Avec des gestes d’une douceur infinie, j’actionne l’outil… La serrure, simple comme une fille de ferme, n’insiste pas… Me voici dans la place. Je songe alors avec une certaine amertume que je n’ai pas la moindre arme sur moi… Excepté le fameux stylo, bien entendu… Mais puis-je appeler ça une arme ? C’est à la fois plus et moins.
Enfin, je compte sur ma chance, ma force et aussi… sur le sommeil des Belles-Bacchantes que ses exercices nocturnes ont tout de même dû fatiguer…
Je gratouille une alouf et, à sa petite flamme précaire, je me repère. Je me trouve dans un couloir vieillot, avec des lambris de bois, une vieille lanterne japonaise au plaftard et un porte-pardingue en bambou… Au fond, un escadrin… J’ôte mes pompes et jl’ascension… D’après mes calculs, la chambre de mon assassin doit être la dernière à gauche… Pourvu que cette vieille tante n’ait pas fermaga au verrou ! Du coup je serais marron foncé, les mecs ! Une serrure, on s’explique avec elle, mais pour avoir une targette, faut y aller de l’épaule et ça ne passe pas inaperçu.
Je prête l’oreille. Me voici brusquement rassuré : Moustache ronfle comme toute la Compagnie Air-France. J’empoigne le loquet et je le tourne doucement, doucement…
Tenez, je pense à une chose, et je vous la crache au passage : dans mon job, je crois que les minutes les plus émouvantes sont celles où j’ouvre une porte. Une lourde, c’est le plus fort symbole du mystère, d’abord parce qu’au départ elle est conçue pour abriter, pour défendre, pour cacher… Ensuite parce qu’elle s’ouvre progressivement et qu’on n’a pas une vision totale de l’endroit où l’on établit une tête de pont.
Miracle ! Le grand tordu ne s’est pas barricadé dans sa chambrette à l’instar d’une jeune collégienne qui s’enferme avec la photo de Luis Mariano.
Le panneau se déplace doucement. Je le soulève un peu pour l’empêcher de gémir… Enfin l’espace est assez large pour me permettre d’entrer… L’animal en écrase sauvage ! Il a la conscience pure, ce faisandé du bulbe ! Il fait un peu jour maintenant et je distingue la topographie de la pièce. Je vois le pageot… A côté il y a une chaise de paille sur laquelle sont entassées les fringues du dormeur. Il n’est pas coquet et il a foutu ses loques en tas… Je m’accroupis pour le cas où, éveillé brusquement, il donnerait la calbombe, et je m’approche des nippes à Monsieur Valdingue. Pas besoin de les tâter longtemps. J’y déniche vite ce que je cherche, à savoir une arquebuse.
Au toucher, je me rends compte que c’est de la mécanique sérieuse. Et du calibre pour adulte. Mon pouce expert cherche le cran de sûreté, le trouve et l’ôte… Probable qu’il y a du monde dans le magasin, en général on ne conserve pas un engin pareil en fouille pour s’en servir de breloque porte-clés.
Maintenant me voilà rassuré… Il ne me reste plus qu’à réveiller Moustache… Pas duraille. Je finis par repérer le commutateur et je donne le jus.
La lumière, chose curieuse, ne le fait pas sursauter. Il continue de ronfler un moment, puis son moteur s’arrête… Il se tourne dans son lit, incommodé par la clarté de l’ampoule suspendue au-dessus de sa tête.
Enfin, il ouvre les yeux, cille, bâille, les referme, les rouvre… Et puis il m’aperçoit et sa bouche se fait béante comme une entrée de métro.
J’ai la satisfaction de lire la peur sur sa bouille ensommeillée. Et cette trouille monumentale ne lui vient pas du pétard que j’ai dans la main… Non, elle est le fait de ma seule personne.
— Je m’excuse de te réveiller, mon chéri, lui dis-je… Mais le temps me durait de toi, en Enfer… Alors je suis venu te chercher… Viens chez mon pote Satan, tu verras, y a du feu !
Il est pétrifié.
Je rigole devant sa bouille incrédule.
— Tu vois, ma vieille loque, je suis un zouave comme Raspoutine, pour m’avoir il faut pas pleurer l’arsenic ! La prochaine fois, balance-moi de la tour Eiffel, t’auras des chances… Un sixième, j’en ai rien à foutre… Quand j’étais petit, je les sautais déjà à pieds joints, les six étages, alors tu juges ?
Il m’avait déjà paru peu loquace, tout à l’heure, mais maintenant on lui a plombé la menteuse. Tout ce qui sort de la bouche, c’est un mince filet de bave.
Bon, now j’ai joui de sa stupeur, il s’agit de passer à un autre genre d’exercice… Seulement, auparavant (comme disent les Chinois) je dois m’entourer, non seulement d’une ceinture de flanelle, mais aussi de certaines précautions.
Prompto je lève le pétard et je lui file sur le bol un coup magistral du talon de la crosse. Il prend le gnon sur la tempe et son regard devient vasouillard. Par mesure de sécurité, je lui applique un second cataplasme… Il lui pousse une somptueuse aubergine sur le dôme… Il me paraît out pour un temps… Un filet de sang lui dégouline le long de la joue…
Vite je biche un drap et je le déchire dans le sens de la longueur de façon à obtenir une solide lanière. Après ça j’attache les poignets de l’homme après les montants du lit de fer… Il ne tarde pas à être crucifié… J’en fais autant pour ces cannes… Nous voici en mesure de discuter… Afin de l’aider à récupérer, j’empoigne un flacon d’eau de Cologne sur une coiffeuse et je lui en verse sur le bol. Ça dégouline jusque dans les calots et la douleur le ranime.
Il veut remuer, mais ses solides entraves l’en empêchent.
— Te fatigue pas, bonhomme, l’avertis-je… Et d’abord quel est ton nom ?
Il articule :
— Carnigi…
— Tu travailles avec Bucher ?
— Oui…
— Spécialisé dans le nettoiement des gêneurs ?
Il a une moue.
— Non ?
— Dans ça et dans autre chose.
— Tu veux parler du trafic d’armes ?
Il se force à sourire, mais il n’en a pas envie. Je connais fort bien ce genre d’individu. Ça se croit fort, ça écrase tout, mais lorsqu’on leur cause une surprise comme celle que je viens d’offrir à celui-ci, ils deviennent soumis comme des tapineuses bretonnes.
Je pourrais lui demander n’importe quoi, y compris l’heure et la main de sa sœur, il me les accorderait.
— Bucher t’a appelé ce soir en te disant qu’un gars des Services secrets français cherchait à l’embistouiller. Il t’a ordonné de me liquider presto, non ?
— Oui.
— Qu’est-ce que tu fous dans cette maison ?
— Je la garde…
Du coup, j’ai la comprenette qui s’embourbe.
— Comment ça, tu la gardes ?
— C’est l’adresse officielle de Bucher… Seulement il n’y habite jamais…
Compris. C’est un fin renard, l’Amerlock… Il se tient à proximité dans les Palaces des environs, menant la grande vie à l’abri des surprises tandis que son coéquipier assure la permanence…
— Pour nous résumer, lorsque des acheteurs d’Euréka veulent contacter le boss, c’est ici qu’ils s’adressent ?
— Oui.
— En somme, t’es quelque chose dans le genre du réceptionniste ?
— Oui…
Je me frotte les paluchettes. Mes petits trésors, je peux bien vous le dire malgré vos tristes bouilles, j’ai le sentiment d’avoir fait une bonne opération en investissant cette baraque. C’est le nid, la Centrale ! Pour peu que je sache manœuvrer, ça va me payer de beaucoup de mes peines…
— Les types de la Ligue se sont-ils mis en rapport avec vous ?
Il hésite…
— Que je te dise, fais-je en brandissant le pétard, si tu refuses de parler ou si tu me déballes des foutaises, tu auras droit à une purge de plomb !
Pour l’achever, je lui dis :
— C’est moi qui ai rétamé Sion, alors tu vois que je n’ai pas peur des mouches…
Ma parole, il y a de l’admiration dans son regard. Je passe à ses yeux pour une fameuse épée.
— Oui, dit-il, ils ont téléphoné hier…
— Et qu’ont-ils dit ?
— Ils voulaient parler à Bucher… J’ai dit que j’allais le prévenir… Ils m’ont dit qu’ils rappelleraient tard dans la soirée…
— Et ils l’ont fait ?
— Oui.
— Bucher attendait ici ?
— Oui.
Voilà donc pourquoi il est entré si tard à son hôtel.
— Qu’est-ce qui a été convenu ?
— Rien, ils doivent venir tout à l’heure… pour se mettre d’accord avec le patron.
— A quelle heure ?
— Dix heures…
— Et Bucher compte les rencontrer ici ?
— Bien sûr…
— Leur appel téléphonique venait d’où ?
— De Milano !
Je gamberge tellement vite que ma tête enfle. C’est le frottement ! Comme me disait Sal-Si-Fi, mon pédicure chinois : « La chaleur dilate les cors ! »
— Ecoute, Carnigi, les types de la Ligue connaissent-ils Bucher ?
— Non… puisqu’ils le contactent…
— Je veux dire, l’ont-ils déjà vu ?
— Oh non, jamais… Bucher rencontre rarement ses… clients… Ça se passe avec des intermédiaires.
C’est cette prudence qui fait la force du chef des AA1.
— Parfait… Maintenant, tu vas me dire autre chose…
Il réprime un soupir. Mes questions le turlupinent. Pourtant, il est engrené et il crache ce qu’il sait… C’est psychologique, je vous le répète.
Je m’assieds au bord du lit.
— Où se trouve le dépôt d’armes que veut acheter la Ligue ?
Il secoue la tête.
— Ça, je l’ignore…
Le plus drôle, c’est que je le crois. Malgré tout, je joue le jeu en chiquant au petit incrédule.
— Voyons, Carnigi, tu te rappelles déjà plus de mon avertissement ?
J’approche l’Euréka de sa tempe.
— Pourtant, je suis sérieux, tu sais ?
Il a les grelots. Oui, cette armoire qui sait jouer avec brio « Terreur sur la ville » a peur de canner. Il sue des chandelles comme le pouce.
— Je vous jure ! Je ne sais pas ! Vous ne connaissez pas Bucher ! Jamais il ne fait de confidences… Il se méfie de tout le monde ! Ceux qui gardent les armes en ce moment ne savent peut-être même pas de quoi il s’agit…
Je le regarde.
— Parfait, boy… Je fais comme si je te croyais. Mais si c’est du bidon, on te souhaitera ta fête avec quatre cierges, promis ! A quelle heure doit venir Bucher ?
— Un peu avant dix heures…
— Rien de spécial auparavant ? Tu n’as pas de coup de tube à donner ? Tu n’en as pas à recevoir ?
— Non.
— Bucher entre comment ici ?
— Je lui ouvre…
— Bon… Maintenant fais dodo comme un petit ange. Et ne cherche pas à filer parce qu’il n’existe pas un homme capable d’aller plus vite qu’une balle, tu me comprends ?
— Oui.
— Alors d’accord…
Je prends tous les flacons disponibles sur la coiffeuse et je les pose sur son ventre.
— Ne bouge pas, ça les entrechoquerait. Je vais me payer une petite ronflette dans le fauteuil. Le moindre de tes mouvements fera un bruit de grelot et j’ai le sommeil fragile. Je ne te conseille pas de le troubler parce qu’il ne te resterait plus de dents demain, et peut-être plus de langue pour te commander un râtelier… Allez, mec, good night !
Je descends ouvrir le portail. Je ne ferme pas complètement la porte pour qu’en arrivant demain — ou plutôt tout à l’heure — Bucher n’ait pas l’idée de sonner. Puis je ferme la porte de la maison à clé… Ensuite, regrimpée dans la piaule où mon petit camarade Carnigi joue les statues.
Il évite presque de respirer de crainte de faire tinter la verrerie entreposée sur son baquet. Je glisse le revolver dans l’échancrure de ma chemise, tire l’unique fauteuil de cuir contre la porte afin d’éviter une intrusion semblable à la mienne… Et, le cœur content, l’âme en fête, le corps épuisé… Je m’assoupis…
Mon sommeil est assez précaire. J’ai la bouche en fond de cage à oiseaux et les membres brisés… Pourtant, je pionce, les aminches ! Je pionce avec une farouche délectation, afin de me préparer des lendemains qui chantent.
Que dis-je ! Des lendemains qui braillent !
Ma bonne Félicie dort-elle à cet instant, sur les bords de l’Adriatique ? Sûrement pas. Elle pense à son enfant chéri… Est-ce idiot ? Mais il me semble que sa chaude pensée me protège. Il y a également une autre mère dans l’angoisse… près d’ici… Une mère qui se demande en se mordant les mains si elle reverra jamais sa petite fille.
CHAPITRE XII
C’est un fracas de verre brisé qui me réveille. Je bondis instantanément, le pétard en main.
Carnigi, à bout de force, a fini par céder au sommeil lui aussi. En pionçant, il a remué et une bouteille d’embrocation s’est brisée sur le plancher… Il est vert de trouille et me regarde d’un œil suppliant.
— Je… ce n’est pas ma faute… j’ai dû m’endormir… Excusez-moi !
Une vraie guenille ! Quel paumé tout de même ! Ces tueurs n’ont rien dans le ventre…
Je regarde ma montre. Elle dit neuf heures vingt… Dans le fond c’est mieux ainsi… Je débarrasse le restant de la verrerie et je me passe un peu de flotte sur la hure. J’ai la bouille bouffie et grise. Je ressemble à quelque chose d’avarié. Si je m’écoutais, j’irais me porter à la poubelle…
Mes très sommaires ablutions terminées, je reviens à Carnigi.
— Deux mots, Comte : c’est Bibi qui va recevoir Bucher… Si tu essaies de le rencarder, tu fais le voyage chez Plumeau sans escale, alors avis.
Je griffe une serviette de toilette.
— Ouvre ta grande gueule, bonhomme !
Il obéit. Je lui attache alors la serviette très serrée par-dessus son clapoir ouvert… Ça m’étonnerait qu’il puisse balancer le duce avec ça sur le museau.
Ayant terminé, je vais me poster près de la fenêtre… Au bout de cinq minutes, qui vois-je ici paraître ? Monsieur Bucher, dans un épastrouillant costard bleu de Bresse ! Il s’annonce à pas nonchalants, biglant les alentours pour s’assurer que le secteur est libre… Je dévale l’escadrin à l’allure d’un Egyptien qui vient d’entendre prononcer le mot « juif ». Puis je vais me placer derrière la porte, le zœil au niveau du trou de la serrure.
Bucher est maintenant devant la grille. Il voit qu’elle est ouverte et ça le surprend nettement. Il s’arrête pile.
Pourvu qu’il ne se ravise pas !
J’ai, comme toujours dans les cas graves, une idée géniale. Je me mets à siffler tant que je peux un air dont en ce moment toutes les radios d’Europe nous cassent les tympans… et le reste.
Rien de plus rassurant qu’un type qui siffle. Ça dénote une parfaite, une absolue tranquillité d’esprit.
Mon astuce prend. Bucher, qui flottait, pousse la grille et entre à pas rapides. Il grimpe les marches et heurte la lourde sur un rythme convenu : un, deux, trois, quatre, cinq… Un, deux, trois, quatre, cinq ! Un, deux, trois !
Vous savez ? Comme lorsqu’on porte un ban dans les banquets.
Je m’arrête de siffler et je nasille en prenant la voix de Carnigi :
— O.K. !
Je sais que j’ai pour ma pomme l’élément de surprise, puisque ce connard me croit scrafé — mais c’est une sacrée fine lame et je dois faire vite pour le cueillir. Ou plus exactement l’accueillir.
Très posément j’ouvre la porte. Puis je tire à moi le battant et je me trouve face à face avec Bucher qui, comme prévu, se croit le jouet (d’autres grands plumitifs disent aussi l’objet) d’une hallucination.
Vite je l’alpague par les revers de son époustouflant costard et je lui mets un coup de boule dans le placard. Ensuite je le rentre assez pantelant, je repousse la porte et le finis avec un coup de genou remonté qui lui meurtrit l’honneur au point de le faire dégueuler.
Il s’effondre.
Toujours sans perdre la moindre seconde, je le traîne au fond du couloir. Sous l’escalier il y a une lourde qui doit, je l’espère, être celle de la cave… Mes estimations sont exactes. Je descends Monsieur le marchand de flingots à la cave… L’endroit est encombré de caisses moisies, de vieux tonneaux et de ferrailles multiformes.
Je dépose Bucher dans une grande caisse encore solide. Seule sa tronche et ses jambes en émergent. J’empile sur son buste tout ce que je peux dégauchir de lourdingue : un vieux poêle en fonte, des chenets également en fonte… Plus un petit tonneau que je bourre de saloperies. Il va être un peu ankylosé, le frère. En tout cas, il lui est impossible de remuer le petit doigt.
Je regarde ma tocante : dix heures moins dix ! C’est juste… En galopant, je monte chercher de quoi le ranimer… De son côté, Carnigi est tranquille…
Lorsque je me retrouve à la cave, muni d’un flacon de rhum, Bucher a repris ses sens. Il me regarde en clignant de ses petits yeux inquiétants d’oiseau de nuit réveillé en plein jour.
Je ne perds pas de temps à phraser, non plus qu’à tirer un parti verbal de ma suprématie.
— Je viens de vous prouver, Bucher, que vous avez eu tort de m’envoyer aux prunes, maintenant je reste seul en piste. Je sais tout, votre grand buteur a moufté… Les types de la Ligue vont radiner… Nous allons, eux et moi, discuter… Je vais me faire passer pour vous, négocier les modalités de la rançon… Pour cela il est indispensable que je sache deux choses : où se trouve la camelote et son prix approximatif. Si je n’ai pas ces deux tuyaux, les gars comprendront que je les bidonne et tout sera foutu pour votre gosse. Comprenez-moi, je ne vous tartine pas pour faire joli… Je pense à elle ! Si mes chefs le savaient, ils ne seraient pas d’accord parce que pour eux la vie d’un enfant est puissamment secondaire, mais Dieu merci, je suis encore un homme !
Là-dessus, je ferme ma grande gueule…
L’autre se tait… Il a un regard injecté de sang. Il se croit trahi par son compère à moustaches et je parierais la jambe de bois de votre oncle contre ma gueule de bois qu’il n’hésiterait pas un centième de seconde à lui démolir la figure avec des ciseaux de brodeuse.
En attendant, il ne parle pas… J’ai un pincement au cœur…
— Bucher, je crois que vous ne pigez pas la gravité de la situation…
Silence.
— Bucher, est-ce que votre p… de cargaison a plus de prix pour vous que la vie de votre gosse ?
Ses mâchoires se crispent, mais il continue à la boucler très hermétiquement. Ma colère est telle que je claque des ratiches en continuant à l’exhorter…
— Bucher, votre orgueil est-il donc si grand que vous marchandiez encore avec vous-même ?
Silence.
Mes paumes sont moites… J’ai le cœur qui me fait mal… Toute la partie : ma mission, la vie de la gosse se jouent à cet instant crucial.
— Alors, vous ne voulez pas parler ?
Il ne dit toujours rien… Bon Dieu, est-ce que je lui aurais filé une commotion capable d’annihiler en lui toute mémoire ?
Je le regarde, méprisant.
— Votre silence ne sauvera pas votre camelote, mon salaud ! Je la trouverai, seulement ce sera fini pour la petite… Je serai obligé de jouer cartes sur table avec les Africains…
J’en suis là de mon baratin lorsqu’un coup de sonnette me fait tressaillir. Le visage de Bucher devient tout gris.
— Laissez-moi aller ! articule-t-il d’un ton intense.
— Non !
— Je vous en supplie… C’est moi qui dois m’occuper de ma petite fille.
J’ai les tripes qui se tressent comme des cordes.
Nouveau coup de sonnette.
— Bucher, écoute, si tu menais une vie réglo, tu n’en serais pas là. Tant pis pour ta gueule, tu n’as plus que la ressource d’avoir confiance en moi. Non ? Bon, j’y vais…
Je suis déjà à la porte. Il dit :
— Les armes sont à bord d’un cargo, le Wander, mouillé dans le port de Gênes… Sa cargaison vaut deux milliards !
L’énormité du chiffre me fait sursauter.
— Merci, Bucher… Ayez confiance et fermez votre gueule, hein ?
En courant… Décidément Mimoun n’a qu’à bien se tenir. Je remonte et cavale jusqu’à la grille…
J’ai le battant qui fait du rabe ; bon Dieu, je vais devenir cardiaque si je continue à m’offrir du suspense à cette cadence !
Je rajuste ma cravate, lisse mes crins… Je dois avoir l’air un peu déjeté, mais n’est-ce pas l’aspect logique d’un homme qui vit dans les affres ?
In petto[11]. In petto, j’envoie une ardente prière à celui d’ailleurs. Puisqu’il peut tout, qu’il m’assiste ! Après tout, il a permis qu’on fasse les zouaves sur la planète, non ?
CHAPITRE XIII
Deux types sont derrière la grille. Malgré la douceur du temps, ils portent des lardeus de demi-saison en poil de chameau. Ils sont très bronzés sur les bords avec des crins crépus et des baffies à la Mac-Kac… Pas d’erreur, ce ne sont pas des Norvégiens.
Je les invite à entrer… J’ouvre une porte qui, par bonheur, donne sur un salon fané… Je pousse les volets… Tout cela sans un mot. Je n’ai jamais fait de théâtre, ayant Dieu merci une personnalité affirmée, mais je me cramponne à mon personnage de père ravagé, qui, toutefois, reste un aventurier dans les cas graves. Je leur désigne des fauteuils en priant de nouveau le Seigneur pour que ceux-ci ne s’écroulent pas.
L’un d’eux me regarde d’un œil perspicace. Puis il m’adresse la parole en anglais… Je ne connais cette langue que du bout des chailles. Pourtant je comprends qu’il la parle en « petit nègre ». D’un ton autoritaire, en prenant un formidable accent yankee, je crache sévère :
— Parlons français, je vous comprendrai mieux !
Le plus vieux des deux, un type au visage sérieux dont les tempes grisonnent, a un rire inquiétant. Un rire chevroté qui ne me dit rien qui vaille.
— L’essentiel, fait-il, ça n’est pas seulement que nous nous comprenions, c’est surtout que nous nous entendions.
Je suis sensible au jeu de mots de qualité.
— Votre repartie, fais-je, me prouve que j’ai eu raison de vous demander la langue française. Je vois qu’elle vous est familière.
Il a une courbette pleine d’appréciation.
— Merci… Mais nous espérons pouvoir nous en passer bientôt.
Mettez-vous dans la peau du franchecaille qui esgourde des vannes pareilles ! Je retiens ma menteuse qui serait capable de distiller du baratin mélodramatique.
J’attends la suite. In english : the suite !
L’autre, le plus jeune des Arbis, me demande en me sondant d’un regard intense :
— Alors, Mister Bucher, où en sommes-nous ?
— J’allais vous le demander…
Il me balanstique cette nouvelle phrase qui, comme l’aurait dit Paul Bourget, ne laisse pas de m’inquiéter :
— Nos propositions n’ont pas varié depuis hier…
C’est du terrain mou pour personne fragile. Qu’entend-il par là ? Mystère et constipation chronique !
Le tout, en pareil cas, est de sembler affranchi, sinon tout est à la flotte.
— Elles sont inacceptables lorsqu’on les étudie de près, affirmé-je, très sûr de moi.
Il ne me reste plus qu’à attendre des contre-propositions qui éclaireront ma lanterne magique.
C’est encore une fois celui qui a du carat qui se manifeste.
— Dommage, fait-il, car elles n’ont pas varié : la petite et cinq cents millions !
Soulagé, je fais semblant de discuter.
— Huit cents et Carolyne !
Le gars a un rire qui, décidément, me bat les claouis.
— Allons, Bucher, vous savez bien que nous pourrions avoir la cargaison contre seulement l’enfant.
— Alors, pourquoi proposez-vous du fric ? gueulé-je. Hein ? Parce que vous savez que je suis un homme d’affaires avant tout, hein, espèce de…
— Restez poli ! implore l’autre.
Ça se déroule magnifiquement, suivant le plan prévu, comme disent les maréchaux en pleine retraite.
— J’ai dit huit cents, fais-je… Vous y gagnez près d’un milliard et demi…
— La vie de votre enfant ne vaut peut-être pas cela ? demande le même loustic.
Mon indignation n’est pas feinte :
— Espèce de…
— Ne vous répétez pas…
— C’est honteux d’employer de pareils arguments ! La vie privée d’un homme ne doit pas entrer en ligne de compte sur le terrain affaires !
— Ce sont des affaires très… importantes pour nous, monsieur Bucher.
— Pour moi aussi, figurez-vous !
— Alors acceptez nos conclusions…
J’ai une forte envie de dire Ji-go ! Mais je dois avant tout sauvegarder mon personnage.
— Non. Ces armes vous sont presque aussi précieuses que ma fille ! Qui peut vous céder d’un seul coup un pareil stock, hein ? Alors cessons de tergiverser… Vous devriez vous estimer heureux…
L’autre Arbi lève la main.
— Entendu, dit-il, huit cents millions et la fille.
— L’avez-vous bien traitée au moins ? Je vous préviens que si elle a subi le moindre sévisse…
— N’ayez aucune crainte… Elle vous sera restituée saine et sauve… si vous marchez droit !
— Employez un autre ton pour me parler, voulez-vous ?
Mon coup de saveur leur en impose plus que mes paroles.
— Comptez sur nous…
— Bon, tranche l’autre gars de la Ligue qui semble moins accommodant et beaucoup plus exigeant, alors comment procédons-nous ?
Je réfléchis…
— Je ferai venir la livraison par bateau dans le port de Gênes…
— Et ?
— Procurez-vous un rafiot susceptible d’assurer le transbordement.
— Ensuite ?
— Avant que le changement s’effectue, nous nous rencontrerons sur les quais. Vous serez tous les deux. Vous aurez ma fille à la main…
— Après ?
— La valise contenant l’argent également…
— Et puis ?
— Moi je serai accompagné d’une dame… Une vieille dame. Nous lui remettrons l’enfant et moi je vous indiquerai le nom du barlu, vous pigez ?
— Ensuite ?
— La vieille dame et ma fille partiront. Je donnerai des instructions pour que le déchargement soit opéré… Je serai avec vous et vous pourrez me descendre en cas de… heu… scepticisme de votre part…
Immuable, mon interlocuteur demande :
— Et puis ?
— Lorsqu’on aura achevé le transbordement, vous me remettrez la valise contenant le fric, après, bien entendu, que j’en aurai vérifié le contenu. Alors je quitterai le bord et… tout sera dit…
Les deux hommes se regardent. Leurs yeux sont résolument inexpressifs.
Celui qui paraît prendre les décisions, c’est-à-dire le plus jeune, déclare :
— Cela me paraît à peu près convenable !
Il me regarde et dit en riant quelque chose en anglais.
— Vous en êtes un autre, réponds-je, à tout hasard.
Re-marrage du gnard qui me prouve que j’ai encore mis dans le mille !
L’autre demande :
— Parfait, quand auront lieu les transactions ?
Je réfléchis… Un jour pour régler la situation ici… Un autre pour aller à Cervia… Un troisième pour gagner Genova…
— Après-demain, fais-je… Entendu ?
Ils approuvent.
— Parfait… Quelle heure ?
— Dix heures, comme aujourd’hui… Devant les docks, d’accord ?
— Oui…
— Je voulais aussi vous dire…
Leur physionomie devient attentive.
— Surtout ne cherchez pas à me duper… Ça ne vous porterait pas bonheur… Déjà votre façon d’agir me défrise un peu…
— Nous serons réguliers…
— Je l’espère… pour tout le monde. Ma réputation n’est plus à faire, n’est-il pas vrai ?
Ils ne soulignent pas la provocation voilée que contiennent ces paroles.
D’un commun accord, ou ce qui est mieux dit d’un accord commun, ils se lèvent.
— A… après-demain, dix heures, docks de Gênes, résume le plus jeune des « ligueurs »…
Je leur fais un signe d’acquiescement.
Ils vont à la porte… Je les escorte…
Cette fois, pas l’ombre — même voilée d’une erreur : les dés sont jetés. Je les ai un peu pipés, mais quand on est seul, il faut bien s’assurer une marge bénéficiaire, pas vrai ?
TROISIÈME PARTIE
CHAPITRE XIV
Je regarde s’éloigner les plénipotentiaires… A mon avis, jusque-là tout marche bien…
Lorsqu’ils sont sortis de mon champ visuel, je m’approche du téléphone posé sur une table basse du salon. Je chope l’annuaire afin d’y chercher le numéro du Léman-Palace… L’ayant déniché entre un gars qui s’appelle Lelong et une veuve Lemann, j’en compose fiévreusement le numéro…
Je leur balanstique mon numéro de chambre et un résumé de mon curriculum.
— Personne ne m’a demandé ce matin ?
Le préposé interpelle un collègue. Y a du blabla en suisse-allemand. Après quoi il me dit que « ce monsieur » s’est présenté vers les six heures du mat et qu’il est toujours là à poireauter dans le hall…
La constance de ce flic me va droit au cœur.
— Voulez-vous me le passer ?
Il veut. J’ai bientôt Cherio à l’appareil. Je m’excuse pour le retard, le remercie de m’avoir attendu et le prie de radiner dare-dare à l’adresse de la villa du lac.
Il fait : « Très bien, monsieur le commissaire » et nous raccrochons avec un ensemble parfait.
Bon… Si je ne fais pas de fausse manœuvre, tout doit boomer le mieux du monde… Je vais sur le seuil guetter mon zigoto.
Bien que je ne le connaisse pas (et j’ai pour cela la meilleure des raisons : celle de ne l’avoir jamais vu), je le repère au premier regard. C’est un grand costaud qui a une gueule de marteau et des épaules larges comme une cabine téléphonique… Avec ça l’air commode du monsieur qui vient d’apprendre simultanément que sa femme s’est barrée avec les éconocroques de la casba, qu’il a un cancer au pylore et qu’un plaisantin vient de foutre le feu à son domicile… Pourtant son visage neutre et sévère s’éclaire d’un sourire respectueux lorsque je me présente à lui.
— Commissaire San-Antonio, fais-je…
Il s’incline.
— Enchanté de vous connaître, M. Bodard m’a parlé de vous en termes enthousiastes…
On se fait un peu de tennis-baratin, puis j’entre tête boulée dans le vif de la question.
— J’ai neutralisé un gros trafiquant d’armes et son complice. Il est essentiel pour moi que ces gens soient mis au secret absolu pendant au moins trois jours… Pouvez-vous le faire ?
Il soulève son vieux bitos verdâtre et gratte d’un index embarrassé sa manufacture de pellicules.
— C’est que…
M… arabe ! ça commence mal… Il fait sa chochotte, le Cherio… Il est vrai qu’en Suisse, on ne connaît que le droit chemin, fort de ce qu’il est le plus court d’un point à un autre.
— C’est que quoi, inspecteur ?
— Je ne puis incarcérer quelqu’un sans motif…
— Ces gars-là sont des pirates et vous voulez un motif…
— Je ne nie pas que ce soient des pirates, mais ça n’est pas à moi, vous devez le savoir, de décider leur arrestation. Je ne suis qu’un simple inspecteur…
Je réfléchis.
— Ils se sont livrés sur moi à une tentative de meurtre. Je porte plainte contre eux…
— Alors, il faut aller à la maison de police déposer une plainte en bonne et due forme…
La moutarde me grimpe au nez. Je m’efforce au calme.
— Si je dépose plainte contre eux, ça donnera un procès, n’est-ce pas ? Il y aura de la publicité autour de la chose ?
— Naturellement !
— C’est précisément ce que je veux éviter…
Soudain, je me frappe le front…
— J’ai trouvé… Supposez qu’ils soient ivres… Supposez qu’ils vous insultent… Vous les arrêteriez pour outrage à magistrat et ivresse sur la voie publique ?
— Oui.
— O.K., alors asseyez-vous et patientez encore dix petites minutes, je vais arranger ça…
Je monte dans la piaule où m’attend Carnigi…
— A nous deux, mon petit pote, fais-je… Tu vas…
Je la ferme… Il ne va plus rien faire du tout… Il est violet comme un évêque et ne respire plus… Je suis complètement ahuri parce que ça n’est pas la première fois que je bâillonne un gars… J’ai assez de doigté pour ces sortes de choses…
Je pige tout et, malgré la gravité de la situation, je ne peux retenir un sourire…
L’ironie du sort, les gars ! Le hasard, ce grand maître, etc., etc. Figurez-vous qu’une fois seul, mon assassin a tenté de se débarrasser de ses entraves… Il a tiré dessus, s’est trémoussé, bref a dû faire un tel chahut dans le lit que l’une des quatre boules de cuivre qui en ornaient le fronton et qui ne devait pas être vissée à fond, lui est dégringolé sur le pif… Il a saigné du nez… Le sang s’est coagulé, et comme il ne pouvait respirer par la bouche, il est mort asphyxié… Ma foi, c’est ce qu’on peut appeler la justice immanente…
Je le débarrasse de ses liens, du bâillon… Je roule le tout en boule et j’en fais un paquet… Ensuite de quoi je saisis la bouteille de rhum et je m’évacue en vitesse à la cave… Pourvu que Bucher ne soit pas canné aussi !
Non, il est bien vivant… Il tourne vers moi ses pauvres yeux inquiets.
— Alors ? fait-il…
— Alors ça colle… Je les ai eus… Dans trois jours, vous aurez votre fille…
Il reste très soucieux.
— Mon Dieu, fait-il, enlevez ces saloperies de sur moi… J’étouffe…
— Minute, Bucher… Il faut que nous parlions un peu auparavant.
— Qu’avons-nous encore à dire ?
— Maintenant, c’est moi qui suis Bucher pour les gens de la Ligue. Il est donc indispensable que vous disparaissiez pour quelques jours de la circulation. Vous allez avaler quelques centilitres de ce rhum… En haut se trouve un flic suisse de mes amis qui ne cherche qu’un prétexte pour vous incarcérer en douceur… Vous lui flanquerez votre main sur la bouille… Du reste, vous verrez, on meurt d’envie de le faire rien qu’en le regardant. Il vous bouclera discrètement… Quand vous ressortirez, vous aurez votre enfant, je vous en donne ma parole…
Il hoche la tête.
— Les autres vous auront.
— Je ne le pense pas, ils tiennent aux armes, et je ne les leur donnerai qu’une fois la fillette en sécurité.
— Je n’ai pas confiance en vous !
Il me file hors de mes gonds ! Ce gond-là !
— M’en fous, Bucher ! Confiance ou pas, c’est bibi qui tiens les rênes ! En voilà assez ! Si vraiment vous n’êtes pas d’accord, je vous flanque deux dragées dans le buffet, c’est tout ce qu’une ordure de votre espèce mériterait… Ça serait déjà fait si vous ne m’aviez au sentiment avec votre gosse !
« Maintenant, donnez-moi un mot d’explication pour le capitaine du Wander, que ce brave homme ne tombe pas des nues en me voyant prendre en charge la cargaison…
« Et faites vite, ajouté-je en le libérant de sa curieuse prison… »
Il est tout courbatu, Bucher… Il a de la peine à se tenir debout… Il sort son portefeuille… Puis fait mine de chercher son stylo… J’en étais certain ; c’est un pétard qui apparaît dans sa main… Heureusement que j’ai du flair. D’un coup de savate japonaise j’envoie valser l’arme… Ensuite, je le cramponne par le revers et je lui mets une série de crochets dans la boîte à ragoût ! Il manque d’air, tout comme son copain le moustachu ! Je le relève par sa cravate… Dans l’algarade, il a largué ses besicles et, sans elles, il ressemble à un poisson d’aquarium.
— Bon, t’as compris, fesse de rat malade ? Tu vas finir par gagner le canard…
J’ouvre son portefeuille… Dedans, je trouve des fafs concernant une cargaison de coton véhiculée par le Wander, bateau battant pavillon danois. Je les mets en fouille… A la réflexion, je pique aussi le larfeuille… Les papiers d’identité qu’il contient pourront me servir…
— Tu le connais, le capitaine ?
— Non, jamais vu…
— Fais gaffe… Encore une fois la vie de la petite ne tient qu’à un fil… Comment s’appelle-t-il ?
— Fulmer.
— Et tu ne l’as jamais rencontré ?
— Je vous dis que je ne le connais pas…
— Peu importe, signe-moi tout de même un mot disant que tu donnes toute qualité au porteur de la présente pour réceptionner les marchandises…
Il obéit… Muni de ce matériel, je lui tends la bouteille de rhum…
— Bois !
— Je n’aime pas le rhum…
— M’en fous, avale !
Il refuse toujours.
— C’est ça ou du plomb dans les tripes… T’as le choix, mais décide vite !
Il avale du rhum…
— Encore… Tiens, finis le flacon…
Il le vide.
Vous croyez peut-être qu’un demi-litre de Saint James va le mettre en l’air ? Pas du tout ! Il est aussi tranquille qu’avant de s’être mis le goulot sous le nez…
— Bon, maintenant monte… Tu verras une grande armoire… Cogne-lui dessus, vu ?
— Entendu.
D’une bourrade, je pousse Bucher dans le salon où attend le patient Cherio.
Bucher, propulsé par mes soins, lui choit dessus.
J’adresse un coup d’œil au policier.
— Hé, dites donc, grommelle Cherio… Vous ne pouvez pas faire attention ?
Bucher reste un moment indécis. Je lui plante le canon du feu dans les reins…
Alors il file un ramponneau dans la mâchoire de Cherio… Vous pouvez être certain qu’il n’est pas manchot, l’Amerlock ! Le flic bascule par-dessus sa chaise et s’étale, sonné comme un tocsin !
En soufflant, il se relève… L’autre l’attend de pied ferme.
— Si tu bouges, t’es mort ! lui dis-je… Frapper un policier suisse ! Non, mais t’es malade, je te jure ! Voilà un truc qui va te coûter chérot, pas vrai, m’sieur l’inspecteur ?…
Cherio se masse les croqueuses. Il n’a pas l’air content du tout. Sans doute doit-il vouer mon ami Bodard à tous les diables pour l’avoir embarqué dans cette galère…
D’un geste expert, il sort des menottes et les passe aux poignets de Bucher…
— Je vous arrête ! dit-il…
Puis il m’attire dans un coin…
— Bon, vous le voulez trois jours au cachot ?
— Oui. Et au secret le plus absolu ! Ne lui permettez pas de communiquer avec l’extérieur, ne faites aucune commission dont il serait susceptible de vous charger, compris ?
— Comptez sur moi…
Cherio va pour sortir avec son sujet. Il se ravise :
— Ne m’aviez-vous pas dit qu’ils étaient deux ? demande-t-il…
— Si… Mais l’autre est parti en voyage…
Ça ne contrarie pas Cherio, au contraire… Des clients qui lui déballent des bouquets champêtres comme celui de Bucher, moins il en a mieux ça vaut !
CHAPITRE XV
Félicie est transportée d’allégresse en voyant revenir son petit gars sain et sauf… Ma blessure est refermée, en bonne voie de cicatrisation. Je la lui montre afin de la rassurer.
— J’ai beaucoup tremblé pour toi, dit-elle. J’avais l’impression que tu courais un grand danger !
Je rigole en pensant à mon plongeon du sixième.
— Tu plaisantes, m’man, ç’a été une vraie partie de plaisir…
Je la questionne sur l’enquête de police concernant la mort de Sion. Elle me dit que les pandores ont appris la nouvelle à la belle rouquine… Celle-ci s’est trouvée mal (moi je la trouvais bien). Ce petit cinéma a dû impressionner ces braves Ritals si amoureux des démonstrations exagérées.
— Qu’est-elle devenue ? m’enquiers-je.
— Elle est partie le jour même…
— Eh bien, m’man, nous allons faire une petite virouze aussi…
— Quand ?
— Dès demain… Je vais te faire visiter Gênes !
Elle me sourit.
— Je croyais que nous étions beaucoup plus près de Venise ?
— C’est juste ; m’man, t’as la géographie dans l’œil, seulement j’ai encore une petite affaire de rien du tout à régler à Genova !
Elle soupire :
— Encore !
— Oui… Ce sera la dernière… Après on revient passer huit jours ici, et je te mènerai à Venise, Rimini, etc. Des petits pachas, je te promets…
Gigi nous sert un repas particulièrement copieux et succulent… Les autres pensionnaires sont aimables tout plein. Ils nous disent qu’ils aiment beaucoup la France, malgré la couennerie de ceux qui prétendent présider à ses destinées. Je vois que, par sa gentillesse modeste, Félicie les a tous conquis…
On lui cède le meilleur fauteuil devant le poste de télé. Ce soir, on donne un film formidable d’avant 38. Une superproduction naveteuse avec Marlène Dietrich dans le rôle de Marlène Dietrich et je ne sais plus quelle truffe dans celui d’un autre ! Ça chiale du début à la fin. On voit une jeune femme dont le mari est tyrannique, empêché du zozor et affilié à un réseau d’espionnage.
Il la bat, la fout par terre à tout bout de champ, ce qui est grave, et à tout berzingue, ce qui est pire.
La Marlène se venge avec un gars du réseau adverse… Le mari tue l’amant… J’en suis là lorsque la petite Martha se faufile près de moi… Elle me glisse une main dévastatrice le long du genou. J’en suis gêné !
Elle a des projets précis que nous grimpons réaliser dès que possible. En supergala, sous le haut patronage d’honneur de Monsieur le Président de la République, je lui joue « On défoule Paméla » puis « Bien lavé ça ressert », drame hydrothérapique en deux actes et à la chlorophylle !
Le lendemain matin, nous nous levons malgré tout assez tôt… Je conseille à Félicie de prendre sa chemise de nuit et sa brosse à dents… Un expresso, et fouette cocher ! Nous partons pour Genova, via Firenze…
A cause des routes en lacet, il nous faut la journée pour atteindre le grand port qui donna naissance à Christophe Colomb, le plus espagnol des Italiens, qui, comme chacun le sait, découvrit qu’en découpant l’extrémité d’un œuf dur, on pouvait le faire tenir debout[12] !
Ces randonnées au volant me fatiguent. Pour des vacances peinardes, vous admettrez que je suis gâté ! Après ça, on pourra m’inscrire pour le prochain Rallye de Monte-Carlo !
Nous atteignons Gênes au crépuscule… Le ciel est d’un bleu tirant sur le mauve… Mille et une lumières brillent dans le port.
C’est féerique ! Les gratte-ciel dominant la ville ressemblent à une espèce de seconde ville en suspens au-dessus de la première… Nous descendons dans un hôtel important et nous allons illico sur le port… Une fois là, je me rencarde sur le Wander. Un type fringué comme un as de pique défraîchi et portant une casquette galonnée me renseigne… Je ne mets qu’un quart de plombe à dénicher le barlu dans cette armada de bâtiments de tout poil… C’est un vieux cargo poussif, noir comme un curé, avec une grosse cheminée baguée d’un cercle rouge.
Il est immobile sur l’eau huileuse ; inquiétant… Du moins pour moi qui sais ce qu’enferment ses flancs.
Je dis à Félicie de m’attendre un peu à l’écart et je monte à bord… Un gars se présente à moi sitôt que j’ai mis le pied sur le pont.
Il a un maillot cradingue, une casquette à la visière cassée. Il me pose une question en italien.
— Vous parlez français ? je demande…
Il secoue la tête… Puis lève la main en me faisant signe qu’il va me chercher quelqu’un de compétent.
Il s’évacue et je renifle un peu l’atmosphère… Plutôt malsaine… Je ne sais quoi d’hostile, de pénible, me hante comme une nuit écossaise.
J’en ai un frisson gluant le long de l’échine.
Quelques minutes s’écoulent et un officier paraît. Il est court sur pattes, trapu, avec une barbe poivre et sel et des yeux chafouins.
— Vous désirez ? me demande-t-il en un français guttural.
— Voir le capitaine Fulmer.
— C’est moi !
Je souris…
— O.K… Je suis le collaborateur de Bucher…
Il ne bronche pas, attendant la suite…
— Bucher n’a pas pu venir parce qu’il lui est arrivé un petit truc fâcheux…
Je souris pour l’amadouer, mais il reste de bois.
— Il est incarcéré à Montreux (Suisse)…
Je crois remarquer qu’un sourcil du capitaine se soulève…
— Rien de grave : il a eu des mots avec un inspecteur et l’autre était un grincheux…
Je me fouille :
— De toute façon, c’est moi qui devais venir… Voici un mot de Bucher à votre intention…
Je lui donne le billet que j’ai pris la précaution de faire écrire par l’Amerluche. Le capitaine le ligote en fronçant les sourcils. Puis il me dit :
— Un instant, s’il vous plaît…
Et il disparaît dans la coursive… Le mataf qui m’a reçu paraît et vient se placer devant l’échelle… Le capitaine a dû lui donner des instructions à mon sujet, car l’autre me regarde avec l’air de ne pas vouloir me laisser descendre si j’en avais envie. Je remarque que son futal fait une grosse bosse à droite… Où diantre Fulmer est-il allé ? Je suis vaguement inquiet… Dix minutes s’écoulent, enfin il réapparaît.
Son expression a changé. Il paraît détendu, presque courtois.
— Ça va, dit-il… Descendez…
Je le suis, prêt à empoigner l’ami tu-tues en cas de malheur… Je descends l’escalier roide qui conduit à la coursive… Je file le train à l’officier jusqu’à sa cabine… C’est propre, beaucoup plus propre que l’état du barbu ne le laisserait supposer, ripoliné, avec des coussins, des flacons intéressants…
— Asseyez-vous, me dit Fulmer…
Je m’assieds.
— Excusez, fait-il… Mais j’ai préféré comparer l’écriture de Bucher avec une lettre de lui que je possède… Il vaut mieux pécher par excès de prudence, n’est-il pas vrai ?
— Qui songerait à vous donner tort…
Mais j’ai eu chaud. Si le gars San-A n’était pas d’une prudence extrême, il se serait fait faire marron en la conjoncture !
Je tire de mon portefeuille les paperasses piquées à Bucher et les tends au capitaine…
— Je crois que c’est pour les opérations douanières… Il est question de coton…
Et je rigole manière de lui indiquer que ce coton-là ne servira jamais à faire des pansements, bien au contraire !
— Bon, tranche-t-il après avoir pris possession des fafs… Comment vont se dérouler les opérations ?
Je hausse les épaules.
— A vrai dire, je n’en sais rien encore… Nos acheteurs sont des gars très prudents… Je les rencontre demain à dix heures sur le quai… Je pense qu’un transbordement aura lieu… immédiatement. Soyez prêt avec vos hommes…
Je me lève… Je soupire en pensant à mon stylo. L’occasion de l’utiliser est rêvée… Si je le glissais dans un coin de la cabine du pitaine, tout sauterait… Seulement il y aurait du dégât dans le port, vu le chargement du barlu… De plus, la petite serait fichue car les Arabes, privés de leur camelote, s’en débarrasseraient rapidos !
Non, il faut attendre demain en espérant très fort que tout ira bien.
— A demain, capitaine Fulmer… Et ravi de vous avoir connu…
Il me dit :
— J’espère que Bucher vous aura remis l’argent !
Du coup, j’ai l’œsophage qui se déguise en corde à nœuds.
— Naturellement…
Il sourit.
— Et… bien entendu vous me verserez l’argent du fret avant le déchargement ?
— Ça va de soi !
Je suis plutôt dans les ennuis, vous ne trouvez pas ?
— Il a joint la prime ?
C’est le moment de préciser…
— Il m’a donné une somme globale pour vous, sans la détailler, vous vous attendiez à combien ?
J’ai parlé sec, en type que ces questions presque administratives emmouscaillent prodigieusement.
— Cinquante, dit-il…
Je pense que ce sont des dollars ! A moins qu’il ne s’agisse de millions de francs… Dans le doute, je m’abstiens.
— Il m’en a donné cinquante-cinq.
Le visage de l’autre s’épanouit.
— Parfait…
On se serre la louche très énergiquement, en vieux potes de toujours et, l’allure dégagée, je vais rejoindre Félicie qui commence à trouver le temps long.
CHAPITRE XVI
Dix plombes du matin !
Il y a un ramdam formidable sur le port. Brouhaha confus, intense ! Les sirènes qui ululent dans le ciel d’azur… Des gars qui galopent ! Des wagonnets sur des rails… Des grues avec leur zonzonnement régulier… Et des cris, des exclamations, des interjections, des onomatopées !
J’ai, de bon matin, affranchi Félicie sur le rôle qu’elle allait devoir jouer… Elle est bouleversée en sachant que la petite fille de l’hôtel K2 va lui être confiée et qu’elle devra la mettre à l’abri…
— Ton bizeness est simple, lui ai-je dit. Je me planterai bien en vue… Les types arriveront… Ils auront la fillette. Toi, tu te tiendras cachée à l’écart… Je dirai à Carolyne de te rejoindre… A cet instant, il y aura sur le quai une ambulance que je viens de commander en prétendant qu’elle était destinée à une enfant malade qu’on doit débarquer.
« Tu prendras l’enfant dans tes bras et tu iras à l’ambulance… Nous sommes à l’hôtel Ferrari, Via Emmanuel II, ne l’oublie pas… Donne simplement cette adresse et attends-moi dans ta chambre avec la petite… »
— Et toi ? a-t-elle murmuré…
— Ne t’occupe pas, j’en aurai presque fini…
— J’ai peur pour toi !
— Occupe-toi seulement de la gosse ! San-Antonio a son ange gardien ! Je l’ai convoqué pour ce matin…
C’est à lui que je pense, à mon ange gardien… Il s’appelle Félicie et, d’où je suis, en faisant les cent pas, je l’aperçois, immobile entre deux montagnes de caisses sur lesquelles le mot CUBA est écrit en caractères grands comme ça !
A cinquante mètres de là, l’ambulance mandée est stoppée… Son conducteur, un jeune gars brun en blouse blanche, fume une cigarette, assis sur le marchepied du tank…
De ce côté-là, ça joue…
Un clocher essaie de sonner dix coups dans le tumulte.
Je regarde ma montre, elle se déclare entièrement d’accord avec lui.
Bon Dieu, ces ouistitis ne vont pas tarder, j’espère… J’ai les nerfs qui sont survoltés… Un de ces quatre, faudra que je leur fasse mettre un disjoncteur !
Une minute s’écoule, puis deux, puis trois…
Je piaffe ! Qu’est-ce qu’ils maquillent, les Ben Bougnouls brothers ? Est-ce qu’il y aurait contrordre ? Est-ce que cette came de Bucher serait parvenu à feinter Cherio ? Est-ce que…
Soudain une main me frappe sur l’épaule. Je saute : c’est le plus jeune des Arbis, toujours avec son bath pardingue en poils de camel.
— Fidèle au rendez-vous, monsieur Bucher ? fait-il de sa voix nasale.
Je lui souris.
— Où est l’enfant ?
— Elle va arriver… Auparavant je voulais m’assurer que vous étiez bien seul… Je suis ici depuis six heures du matin !
— Non mais, qu’est-ce que vous croyiez ?
— Rien, je redoutais seulement… J’ai vu qu’il n’y avait que la vieille dame… Parfait…
Il ôte son chapeau marron et s’en évente la frime. C’est un signal… Une bagnole radine… Mon battant bondit dans ma gorge. A l’intérieur j’aperçois l’autre Africain avec Carolyne. Saine et sauve ! Et puis, en même temps que je vois l’enfant, je pense à une chose terrible ! La gosse ne va pas me sauter au cou… Ni m’appeler papa… Au contraire, comme elle se rappellera que je l’ai un peu brutalisée l’autre matin, elle va avoir les chocottes…
Je souris…
— Bon… Vous avez aussi l’argent ?
— Mon collègue l’a…
Je vais pour m’approcher de l’auto, mais il me retient.
— Minute… Avant de récupérer l’enfant, vous allez me dire sur quel bateau se trouve la marchandise. J’irai vérifier… Si ça va, on vous rend la gosse… Sinon l’auto démarre et vous n’entendrez plus jamais parler de la fille ! Et puis n’approchez pas de la voiture car elle filerait également… Autre chose : donnez-moi votre revolver !
J’hésite et le lui tends.
Ce sont des fortiches… Je me dis que leur coup est minutieusement préparé.
J’attends donc après lui avoir désigné le Wander.
L’Arbi s’y dirige, grimpe l’échelle et se met à parlementer sur le pont avec… Je ne suis qu’une intense prière… Pourvu que tout aille bien ! Si par hasard l’auto s’éloigne, je suis bourru. Pas moyen de tirer dans les pneus…
Je piétine et me tords les doigts en adressant des risettes à l’enfant qui me regarde d’un air craintif, le nez aplati contre la vitre de l’auto. L’autre zèbre n’a d’yeux que pour son aminche… Pourtant je l’ai vu déplacer son rétroviseur, ce qui lui permet de surveiller itou mes réactions.
Un instant s’écoule… Le gnare descend de la passerelle… Il s’approche de moi.
— Ça me paraît régulier, Bucher.
— Alors, rendez-moi la gosse…
— Attendez ! Le transbordement ne peut s’effectuer ici… Je l’ai prévu en pleine mer… Vous allez donner des ordres à votre capitaine pour qu’il appareille. Vous viendrez avec l’enfant… Lorsque tout sera fini, je vous remettrai l’argent et vous filerez à bord du Wander.
Je gronde :
— En voilà assez ! Je ne lèverai pas le petit doigt tant que la petite ne sera pas en sécurité !
Ses yeux deviennent presque blancs.
— Et moi je vous dis que si vous n’obéissez pas illico, l’auto fout le camp, compris ?
La sueur me dégouline le long de l’échine.
— Allons-y, tranché-je.
— Montez d’abord…
Il faut obéir. Je grimpe. Lui derrière. La porte de l’auto s’ouvre, le plus vieux des deux poils de chameau fait descendre la petite. Il la tire par la main vers l’échelle au milieu de laquelle je me suis arrêté pour voir.
— Avancez ! intime celui qui commande l’expédition.
Mon regard va chercher celui de Félicie entre ces caisses provenant de Cuba.
Elle est folle de désespoir… Elle pige que ça ne se passe pas comme prévu et que nous allons embarquer avec la môme…
Alors la voilà qui s’occupe de Carolyne… D’une bourrade maladroite, elle l’envoie de côté. Elle rafle la gosse et trotte vers l’ambulance.
L’Arabe pousse un juron, retrouve son équilibre et se lance à la poursuite de m’man. Son pote lui crie des trucs en arabe !
Je vois Félicie perdre du terrain.
— Attention, m’man ! crié-je à plein chapeau.
Je ne sais si au milieu du tintamarre elle a entendu…
Oui ! Elle se retourne… Elle voit l’autre sur elle… Elle recule… Choc ! Le gars titube encore… Félicie lâche la gamine et ramasse un morceau de chaîne cassée qui jonche le sol… Il n’y a que quatre ou cinq maillons, mais ils sont mahousses ! Elle lève ce bout de chaîne et l’abat dans la gueule du méchant qui se propulse à terre en bramant.
Le type de l’ambulance a entendu du bruit. Il a contourné les caisses et il assiste à la scène… Il s’avance. Félicie prend la petite dans ses bras… C’est son air digne, affolé, son air de brave femme qui décide le type de l’ambulance à agir… Il ramasse la petite, flanque m’man dans sa tire, se jette au volant.
Le carrosse décambute… L’Arabe se relève, sort son revolver… Pendant ces faits et gestes qui se sont déroulés en vingt secondes, mon tourmenteur a sorti également son feu. Il le braque sur moi, vert de rage.
— C’est toi qui vas payer, Bucher…
Il oublie une chose, c’est qu’étant engagé plus avant dans l’échelle, je le domine… Je chique au mec docile, lève les bras… Et je lève aussi le genou… Il le déguste là où l’on met une feuille de vigne aux statues. Il tire, mais la balle ne fait que m’effleurer, elle fait « ping » sur la coque du barlu… Son pote, qui s’apprêtait à défourailler sur l’ambulance, sursaute en entendant le coup de feu. Manque de réflexe, sans doute, il regarde… L’ambulance disparaît ! Alors il radine à la rescousse pour tirer son petit camarade de la merdouille.
Je n’ai pas perdu un quart de seconde. J’ai filé un coup de savate dans le bide à mon Mohamed… Puis un crochet au menton et il est allé s’écraser le pif sur le quai où il demeure sans connaissance… Voyant ça, l’autre courageux saute dans sa tire et démarre en trombe. Moi, je crains qu’il ne rattrape l’ambulance… Je saute à bas de l’échelle, ramasse le pétard du copain et je vide le chargeur sur l’arrière du véhicule… Poum ! Un boudin éclate. L’auto décrit une embardée… Le chauffeur essaie en vain de redresser la direction… Sa bagnole pique sur le quai, bute contre une bitte d’amarrage et tombe au jus… Des gars se ruent pour le tirer de là, mais la guinde s’engloutit en tourbillonnant dans l’eau noire… Moi, mine de rien, je fais glisser l’autre type inanimé dans la tisane… Puisque c’étaient des amis inséparables, hein ?
Nature, cette épopée a attiré au bastingage du Wander une bonne partie de l’équipage… Je monte à bord… J’ai encore du boulot à accomplir… Le capitaine pousse une sale gueule, je vous le dis.
— Qu’est-ce que ça signifie ? fait-il.
— Ça signifie que les acheteurs ont voulu me posséder… Ils avaient kidnappé ma fille… Vous parlez, ces foies blancs !
Je m’essuie le visage. La balle du crépu m’a égratigné l’oreille gauche.
— Filez-moi un coup de scotch, dis-je au capitaine.
Il fait la grimace.
— Descendez dans ma cabine. Je vous rejoindrai dès que j’aurai donné mes ordres.
Je descends ; une fois seul, au lieu de pinter du rye, je m’empare du fameux stylo… J’arrache la plume, dévisse le corps d’ébonite, j’introduis la plume dedans et je glisse l’instrument dans le tiroir d’un placard… Voilà, chef, mission remplie…
Maintenant, il ne me reste plus qu’à mettre les adjas avant le badaboum ; les feux d’artifice n’étant pas mon fort… Ni mon faible !
Je m’engage dans la coursive après avoir jeté un regard à ma breloque. Il est dix heures vingt. A vingt-cinq, il y aura du remue-ménage dans le port de Gênes !
Le barlu est agité d’un frémissement. Comme je m’approche de l’escalier, le capitaine paraît.
— Vous appareillez ? demandé-je.
— Immédiatement. Vos manigances vont attirer l’attention sur mon bâtiment et je n’ai pas envie qu’on fouille ma cale !
— C’est plus prudent, en effet. Bon, je descends pour en référer à Bucher, il prendra contact avec vous dès que…
La capitaine Fulmer secoue la tête.
— Pas du tout, vous restez avec nous…
Alors là, les enfants, là je les ai comme l’infante d’Espagne qui était toute petite et qu’un duègne gardait !
— Co… comment ? bégayé-je.
Il a une bouille implacable.
— Je dis que vous restez ici ! Je ne vous lâcherai que lorsque j’aurai touché mon dû… J’en ai assez de ces histoires !
— Mais, vous le toucherez… L’argent est à mon hôtel… Le temps de…
Je file un regard à ma breloque : une minute vient de s’écouler depuis que…
— Vous deviez l’emporter ce matin.
— Je…
— Vous vouliez me posséder ! Si vos intentions avaient été pures, vous ne seriez pas venu sans l’argent… Je tirerai tout ça au clair avec Bucher.
Il crie :
— Hank ! Steve !
Deux matafs du genre « laissez passer ce monsieur » s’insinuent dans la coursive… Mon sang cogne à mes tempes. J’ai mal au cœur. Je me sens faible… Le stylo explosif (nouvelle farce et attrape) est en train d’agir… Dans trois minutes, il explosera et on ne retrouvera que ma dent en or !
Le barlu remue… Il quitte le port lentement… Tant mieux pour les bâtiments voisins…
Fulmer dit quelque chose en danois. Les deux matafs me cramponnent chacun par une aile et m’entraînent.
On va au fond de la coursive… Ils ouvrent une porte, près de la cabine du vieux… Comme ça, je vais être aux premières loges pour le zim-boum-boum !
Plus que deux minutes et demie… Peut-être même pas… San-Antonio, mon chéri, c’est le moment de faire quelque chose… Les gars me propulsent à l’intérieur de la cabine… Je vois que le hublot est aveuglé par une plaque de tôle… Rien à faire…
Je me retourne… Incident technique… En me balançant, il m’ont accroché le pied dans une rainure du parquet et j’ai perdu mon soulier droit. Le plus gros se baisse pour l’enlever car il gêne la fermeture de la lourde. Je n’hésite pas. Prenant appui sur mon pied déchaussé, j’envoie un terrible coup de chaussette à clous dans le crâne du marin baissé. Il ne dit rien et s’écroule. Je me rue à l’extérieur. L’autre, qui filait déjà, se retourne. Il a droit à un une-deux à la nuque qui lui fait voir le pays d’Hamlet comme à travers un porte-plume souvenir !
Je l’enjambe sans m’excuser et je bombe… J’atteins le bout de la coursive… Je grimpe l’escalier… Vite ! Vite ! C’est maintenant une question de secondes… Vite, vite… Le capitaine est là… Mais il y aurait une locomotive que ça ne m’empêcherait pas de passer. Quand on a les jetons à ce point, aucune force au monde ne peut vous arrêter…
— Arrêtez ou je tire ! aboie-t-il.
— Ta gueule, hé, c… ! lui lâché-je malgré mon essoufflement. Ton barlu va sauter, j’y ai placé une bombe !
Il est tellement éberlué qu’il ne pense pas à prendre son pistolet. Je traverse le pont en quatre enjambées.
Le temps me scie les oreilles. Je crois que la fatale seconde va se produire…
Je pique dans la baille… Nom d’un cannibale à roulettes ! ça devrait être maintenant… Oui, ça devrait… A moins que j’aie perdu la notion exacte du temps ?
Je nage comme un fou en direction du port. Nous n’avons pas encore franchi la jetée. Je nage comme un dingue. Et il ne se produit toujours rien… Je nage encore, encore… Je nage… Je dépasse un bâtiment qui gagne les quais… Et j’espère pour ma peau… Si l’explosion se produit maintenant, je m’en sortirai peut-être.
Alors ?
Alors quoi… Je suis loin du Wander… Je me retourne et le vois sur le point de sortir du port… Est-ce que je n’ai pas su armer le stylo ? Est-ce qu’il était de qualité inférieure ? Est-ce qu’il a du retard ? Est-ce…
Et soudain, ce que j’attendais, ce que je redoutais, ce que j’espérais, se produit… Il y a une formidable explosion, suivie, ou plutôt accompagnée, d’une chiée d’autres. C’est une grappe de bruits infernaux !
Le tonnerre à l’état pur ! La quintessence du bruit !
La flotte a un grand frisson profond… Je fais la planche et je regarde… A la place du Wander, il ne reste que d’extraordinaires débris et un nuage de fumée qui évoque le champignon de Bikini[13] !
CONCLUSION
Nous avons passé une bonne fin de vacances, Félicie et moi. J’ai télégraphié à Bucher, lequel, après son séjour au cambron, est venu récupérer sa petite. Je pense qu’il va orienter son activité d’un autre côté, car il a eu chaud aux plumes.
Un coup de tube au Vieux pour lui dire que tout a bien boomé. Je lui ai fait part du retard de l’explosion et il a souri.
— Elle devait se produire un quart d’heure après l’amorçage, m’a-t-il expliqué, radieux… Mais je connais votre imprudence… J’ai voulu vous laisser une marge de sécurité…
— Elle m’a sauvé la mise…
— Alors, tant mieux, je ne sais pas trop où je pourrais trouver un garçon comme vous !
Sur ces bons mots j’ai raccroché… Martha était derrière moi, avec son air désenchanté, sa peau blanche, ses yeux bleus, son petit sourire qui réclame du bonheur… et qui vous en donne tant que vous en voulez !
Elle s’est approchée :
— Qu’est-ce que vous faites ce soir ? a-t-elle murmuré.
Je l’ai regardée :
— Comme d’habitude, ai-je ricané, le fantôme dans les couloirs de l’hôtel après minuit !